|
|
Aux fondements des crises |
|
|
Le marxisme de la chaire et les crises
|
|
|
|
|
Date |
Décembre 2013 |
|
Auteur |
Robin Goodfellow |
|
Version |
1 |
Sommaire
1. Marxisme de la chaire et socialisme scientifique
1.1 Le marxisme, une critique de l'économie politique
1.1.1 Les deux tendances de l’économie politique
1.1.2 L’économie politique marxiste vulgaire
1.2 L’éventail du marxisme de la chaire
1.3 Socialisme petit-bourgeois et parti prolétaire
2. Marx, la baisse du taux de profit et les crises
2.2 La loi la plus importante de l’économie politique moderne
2.3 Marx et les manifestations de la baisse tendancielle du taux de profit
2.4 Les représentations de l’économie politique
2.5 Surproduction de capital et surproduction de marchandises
2.6 Relation entre baisse tendancielle du taux de profit et suraccumulation du capital
2.6.1 Baisse tendancielle et baisse brutale du taux de profit
2.7 La suraccumulation du capital chez Marx
2.7.1 Un cadre théorique à expliciter
2.7.2 La suraccumulation absolue
2.7.2.1 Suraccumulation absolue = crise générale de surproduction
2.7.2.2 Suraccumulation absolue = surproduction de capital
2.7.2.3 Suraccumulation absolue = « taux de profit marginal » nul ou négatif
2.7.3 La suraccumulation par l’exemple
2.7.4 La suraccumulation et la baisse du degré d’exploitation.
2.7.5 La suraccumulation relative
2.8 Les diverses acceptions du terme dévalorisation chez Marx
2.8.4 Dévalorisation = effet des dépenses improductives (sens 4)
2.8.5 Dévalorisation = désaccumulation (sens 5)
2.8.6 Dévalorisation = destruction des valeurs d’usage (sens 6)
2.8.7 Dévalorisation = dépréciation générale du capital (sens 7)
2.9 Marx, la crise de suraccumulation et la dévalorisation du capital
2.9.2 La dévalorisation/désaccumulation.
2.9.3 La dévalorisation/destruction
2.9.4 La dévalorisation/dépréciation
2.9.5 Dynamique du recouvrement
3. Le marxisme vulgaire et la suraccumulation
3.2.1 Un nouvel aigle dans le ciel de la pensée
3.2.2 La théorie du capitalisme monopoliste d’Etat (CME) dans son contexte.
3.2.3 La suraccumulation sans peine
3.2.4 Excédent de capital et surproduction
3.2.5 Une parabole de l’excédent
3.2.6 La suraccumulation dévalorisation
3.2.7 La dévalorisation sans peine
3.2.8 Une double falsification
3.3.1 Le projet de Marcel Roelandts
3.3.2 Le temps, le temps, le temps et rien d’autre
3.3.3 Une conception ricardienne extravagante
3.3.4 Le rôle contradictoire de la concurrence
3.3.5 Les variations du taux d’accumulation de la plus-value
3.3.6 De l’art de fausser les citations
3.3.7 La suraccumulation accélérée
3.3.8 Le marxisme de la chaire et l’entreprise
3.3.9 Le marxisme de la chaire et la statistique
3.3.10 Le capital fixe et le cycle
3.3.10.1 Capital fixe et capital constant
3.3.10.2 Capital fixe et composition organique du capital
3.3.10.3 Capital fixe et révisionnisme statistique
3.3.10.4 La rotation du capital fixe et le cycle
4. La sous-consommation et les crises.
4.1 L’unité de la théorie de Marx
4.2 Les théories de la sous-consommation
4.3 Le grain de vérité des théories sous-consommationnistes
4.3.1 La réalisation du produit social
4.3.2 La forme matérielle du produit social
4.4 Surproduction versus sous consommation.
4.5 Le « fonds du travail » ou l’impossible sous-consommation
4.5.1 Capital variable, capital avancé
4.5.2 La critique de la théorie du fonds des salaires
4.6 Le sous-consommationnisme dans le texte
4.6.1 La dernière cartouche sous-consommationniste
4.6.3 Taux de plus-value et consommation
4.6.4 Evolution du rapport entre les classes
4.7 La conversion de Marcel Roelandts au sous consommationnisme
4.7.1 Continuité de la méthode, absurdité du raisonnement
4.7.2 Une crise en trompe l’oeil
4.7.3 Exégèse sous consommationniste
4.7.4 Surproduction artificielle
5. Annexe : La fonction des classes moyennes
1. Marxisme de la chaire et socialisme scientifique
1.1 Le marxisme, une critique de l'économie politique
1.1.1 Les deux tendances de l’économie politique
Nous avons souvent souligné le fait que Marx effectue une critique de l’économie politique, de la science économique. Marx qualifie de « classique », l’ économie politique depuis sa naissance (Petty, Boisguilbert) à son apogée (Ricardo, Sismondi). Vers 1830, la science économique, sous l’effet de l’apparition d’un prolétariat moderne revendiquant le pouvoir politique et des premières crises de surproduction entame son déclin. L’économie politique classique se mue en économie politique vulgaire.
L’ économie politique classique se divise en deux grandes tendances.
La première d’entre elles, dont le dernier grand représentant est Ricardo, un des théoriciens de la baisse du taux de profit[1], n’admet que la possibilité de crises partielles, contingentes, fortuites. Pour cette école, des disproportions entre les secteurs productifs suscitent des pénuries d’un côté et une surproduction partielle d’un autre. Ces crises limitées se résorbent d’elles-mêmes, dès lors que le jeu du marché n’est pas altéré. Via des modifications dans le niveau des prix et des déplacements de capitaux, un nouvel équilibre est alors atteint.
L’autre tendance, dite sous-consommationniste, dont la dernière figure de proue est Sismondi, met en exergue les limites de la demande solvable et, du même coup, les doutes de la pensée économique la plus évoluée sur les capacités du mode de production capitaliste à exister durablement. Pour les sous-consommationnistes, les facteurs qui freinent l’expansion de la demande solvable et empêchent par la même occasion de la mettre en adéquation avec la production croissante sont structurels et permanents.
1.1.2 L’économie politique marxiste vulgaire
Nous avons également montré que les divers courants dominants et opposés du marxisme loin de se placer dans la tradition de la critique de l’économie politique renouaient avec ces tendances de l’économie politique[2] ramenant la théorie révolutionnaire au rang de l’économie politique vulgaire[3] (laquelle se développe après l’apogée que représente l’économie politique classique) en même temps qu’elle régénérait, partiellement, cette économie politique[4].
Ces épousailles, sur un mode vulgaire, avec l’une ou l’autre de ces deux tendances (quand elles ne produisent pas des confusions syncrétiques encore plus déplorables) de l’économie politique constituent bien entendu une négation et un ensevelissement du socialisme scientifique[5].
1.2 L’éventail du marxisme de la chaire
L'armée républicaine (et fortement marquée par l'altermondialisme, une autre variété de socialisme petit-bourgeois) du marxisme de la chaire se divise elle-même entre les deux grandes tendances de l 'économie politique que nous avons évoquées ci-dessus. Par exemple, dans le débat entre partisans de la baisse du taux de profit et ceux qui insistent sur les effets de la hausse du taux de plus-value et ses conséquences sur la demande solvable nous retrouvons les clivages qui accompagnent l’histoire de l’économie politique.
La polémique a notamment opposé Michel Husson et Alain Bihr aux tenants d’une « orthodoxie » jugée dogmatique par les premiers, une bonne partie de l’ensemble des intervenants se plaçant sous la protection de feu Ernest Mandel[6]. Le débat entre les « sous-consommationnistes », suiveurs modernes de Sismondi, et les partisans de la baisse du taux de profit, d’inspiration ricardienne se poursuit dans le cadre du marxisme de la chaire.
Quelles en sont les grandes figures ?
Commençons par la tendance « sous-consommationniste »
· Michel Husson, chercheur à l’IRES (Institut d’Etudes d’Etudes Economiques et Sociales, organisme lié aux syndicats), ancien du PSU puis de la LCR, soutien de la candidature de José Bové aux élections présidentielles et désormais membre du comité scientifique d’Attac. L’homme ne semble pas manquer d’humour. Il pense néanmoins qu’il lui était indispensable de combler les trous laissés béants par les insuffisances de l’analyse de Marx.
· Gérard Duménil, directeur de recherche au CNRS, membre du comité scientifique d’Attac. Il est partisan d'un autre marxisme qui constate que «(...) les sociétés modernes sont dominées par deux forces sociales, l’une liée à la propriété du capital, l’autre à la compétence d’encadrement organisationnel et culturel. Une politique populaire suppose une alliance avec la seconde pour éliminer la première. » Présentation de l'ouvrage Altermarxisme. Un autre marxisme pour un autre monde.
· Dominique Lévy, directeur de recherche au CNRS, alter ego de Gérard Duménil (ils écrivent de nombreux ouvrages à quatre mains), conseil scientifique d’Attac.
· Jacques Gouverneur, docteur en droit et en économie, a fait tout sa carrière comme professeur à l'université catholique de Louvain-la-Neuve (UCL). Promoteur de politiques petite-bourgeoise pour résoudre la question sociale[7], il est aussi le théoricien d’une conception de la valeur « purement sociale » où bon nombre de concepts propres au socialisme scientifique sont mis à mal.
· Alain Bihr, professeur à l'université de Franche-Comté, d’inspiration plus libertaire que les auteurs précités, il est un des fondateurs et animateurs du bulletin A contre courant, issu de la mouvance cédétiste et donc un des chantres du socialisme d’entreprise, l’autogestion, également variété du socialisme petit-bourgeois.
· Marcel Roelandts, dernier arrivé dans cette grande confrérie, enseignant et chercheur à l’université et dans plusieurs Hautes Ecoles, co-animateur, avec Jacques Gouverneur, du site http://www.capitalisme-et-crise.info[8]. Il est l’auteur du livre intitulé : « Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme ». Bien qu’il partage les analyses générales de la tendance représentée ici[9], sa volonté de synthèse entre les deux branches adverses du marxisme vulgaire nous permettra de le prendre comme référence.
· Quant à etc. que nous ne connaissons pas précisément, il est vraisemblable que son curriculum vitae soit du même acabit.
Passons maintenant rapidement en revue l’autre branche du marxisme de la chaire ; la branche pseudo « orthodoxe » et « dogmatique » qui s’oppose à la précédente. Nous y trouvons notamment :
· François Chesnais, professeur à l’université de Paris 13, membre du NPA et du conseil scientifique d’Attac, animateur du collectif et de la revue « Carré rouge ».
· Louis Gill, professeur retraité de l’université du Québec à Montréal.
· Alan Freeman, économiste auprès de l’Autorité en charge du Grand Londres, chercheur invité à l’université du Manitoba, animateur de l’association des économistes hétérodoxes, co-éditeur du journal « Critique of Political Economy (COPE) »
· Andrew Kliman, co-éditeur, avec Alan Freeman, du journal « Critique of Political Economy (COPE), professeur d’économie à la Pace University, New-York, membre de l’initiative pour un marxisme humaniste qui s’inspire des thèses de Raya Dunayevskaya.
· Robert Brenner, professeur d’histoire, directeur du “Center for Social Theory and Comparative History” à l’université de Californie Los Angeles, éditeur du journal “Against the current” lié à Solidarity (Etats-Unis)[10], membre du comité éditorial de la New Left review.
· Fred Moseley, Professeur d’économie au Mount Holyoke College dans le Massachussets. Il est l’auteur de livres et d’articles sur la baisse du taux de profit. Tout en considérant que les crises récentes ne sont pas fondamentalement le produit de la vision à court terme et de la cupidité des banquiers, il pense cependant qu’il y a un facteur structurel de crise dans le système financier capitaliste. Ce dernier est spéculatif par essence et le meilleur théoricien de ce système financier n’est pas Marx, mais Hyman Minsky. Comme ces dernières crises sont plus des crises selon Minsky que des crises selon Marx, il est important de compléter l’analyse de Marx par celle de Minsky[11].
· Isaac Johsua; ancien maître de conférences à l'université de Paris 11, membre du comité scientifique d'Attac. Dans la grande crise du XXIe siècle, il déclare que « la crise capitaliste type est donc, et de façon assez évidente, non de sous-consommation, mais bien de suraccumulation, et ce pour la vaste période qui s’étend du second tiers du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale. Pourtant si nous relisons Marx, c’est indéniablement sur la crise de sous-consommation que Marx insiste le plus (…) » p.56
· Quant à etc. que nous ne connaissons pas précisément, il est vraisemblable que son curriculum vitae soit du même acabit.
1.3 Socialisme petit-bourgeois et parti prolétaire
« Oubliée et trahie par la société bourgeoise, l’économie politique scientifique ne cherche plus ses auditeurs que parmi les prolétaires conscients » Rosa Luxemburg
Comment imaginer que des gens dont l’action politique vise à la conservation du mode de production capitaliste et à soumettre l’action du prolétariat aux intérêts des classes moyennes puissent produire une analyse scientifique du mode de production capitaliste ?
Comment imaginer que des gens dont l’horizon politique et théorique est celui du socialisme petit-bourgeois puissent développer une analyse théorique qui démontre la nécessité du renversement révolutionnaire de la bourgeoisie ?
Comment imaginer qu’ils puissent faire autre chose qu’instiller dans le prolétariat des théories qui n’ont pour objectif que de perpétuer son statut d’esclave salarié ?
Le socialisme scientifique est la théorie du prolétariat constitué en parti politique indépendant et opposé aux partis des autres classes. Il n’est pas une théorie neutre auxquelles les autres classes peuvent apporter leur contribution dans un débat scientifique ouvert où il suffit d’être un homme de bonne volonté ; il s’agit d’un point de vue scientifique et d’un point de vue de classe et il ne peut être scientifique que parce qu’il est le point de vue de la classe productive. Ce n’est pas que des intellectuels ne puissent pas y contribuer mais, s’ils le font, c’est en abandonnant l’idéologie de leur classe d’origine pour rallier le point de vue du prolétariat révolutionnaire[12]. Sur le terrain scientifique aussi la lutte des classes a cours et elle n’en est pas moins acharnée.
On aura donc beau nous présenter tous les docteurs en économie et tous les prix Nobel d’économie[13] du monde, nous ferons toujours remarquer, avec Bordiga, qu’on est plus près du crétinisme avec son doctorat qu’avec son certificat d’études. En disant cela, le faible parti prolétaire aux lumières vacillantes et de faible portée ne nie pas que l’arsenal d’intelligence, de connaissances, d’expertise, d'érudition, de culture, de capacité d’expression, de poésie, d’esthétique, de raffinement, de sensibilité, de l’énorme masse d’idéologues que la bourgeoisie produit et entretient (autant que toutes les poubelles de l’université peuvent en contenir) lui soit actuellement, et peut-être toujours, bien supérieur à l’exception toutefois de l’intelligence sociale. C’est ce qui donne une portée théorique et historique incomparable au socialisme scientifique et le transforme en un laser puissant, que, avec toutes nos limites et tous nos défauts quant à notre capacité à l’exposer, nous défendrons bec et ongles[14].
Cette présence de l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise va de soi dans les partis réformistes ; qu’elle déteigne sur le mouvement communiste montre à quel point il est détruit, à quel point il se complet dans des idéologies contre-révolutionnaires.
Nous montrerons donc que les théories du marxisme de la chaire conduisent à éterniser le mode de production capitaliste. Au-delà des individus, le marxisme de la chaire représente donc une étiquette que nous pouvons coller sur une tentative qui aboutit à la négation de la critique révolutionnaire que représente le marxisme intégral.
2. Marx, la baisse du taux de profit et les crises
2.1 Introduction
Dans cette première partie, nous examinerons ce que dit Marx des principaux concepts qui sont au fondement de sa théorie des crises. Nous pourrons alors mieux mesurer les outrages que lui font subir les représentants du marxisme de la chaire. Nous commencerons par rappeler la signification de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit et les modalités de son expression. Bien qu’elle n’en soit pas séparée, cette loi de la baisse tendancielle du taux de profit ne doit pas être confondue avec la baisse brutale du taux de profit qui intervient à la fin d’un cycle d’accumulation et qui caractérise la crise de surproduction. Nous montrerons ensuite que les crises de surproduction ont à partir d’une même contradiction deux aspects suivant qu’on les considère sous l’angle de la valeur d’échange ou sous l’angle de la valeur d’usage. D’un côté une insuffisance de production de plus-value conduit à une baisse brutale du taux de profit et à une crise de surproduction de capital, une suraccumulation (les deux termes sont synonymes), de l’autre l’excédent du surproduit peut engendrer une surproduction de marchandises qui aura des effets négatifs sur le taux de profit. Dans ce chapitre c’est le premier aspect qui sera particulièrement étudié ; le second, souvent confondu avec les théories sous consommationnistes, fera l’objet du dernier chapitre. En réponse à cette surproduction, le capital doit se dévaloriser pour rétablir les rapports d’exploitation qui prévalaient. Nous étudierons donc en détail ce que Marx entend par dévalorisation. tout en cherchant à limiter les effets délétères de son propre mouvement en limitant l’accumulation et en s’abandonnant à une baisse (tendancielle) du taux de profit.
2.2 La loi la plus importante de l’économie politique moderne
Bien que nombre de commentateurs l’aient souvent reléguée au second plan de la théorie de Marx, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit est pourtant, selon Marx lui-même, la loi la plus importante de l’économie politique. Elle sous-tend toute la dynamique du capital et exprime la contradiction valorisation/dévalorisation, le développement contradictoire de la productivité du travail qui combine à la fois hausse tendancielle du taux d’exploitation, du taux de plus-value, et baisse tendancielle du taux de profit[15].
« C’est là, à tous points de vue, la loi la plus importante de l’économie politique moderne et la plus essentielle à la compréhension des rapports les plus complexes. Du point de vue historique, c’est la loi la plus importante. C’est une loi qui jusqu’ici, malgré sa simplicité, n’a jamais été comprise et encore moins consciemment exprimée. » (Marx, Manuscrits de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, T.2, p.236)
Il faudrait citer intégralement la suite de ce passage. Marx y retrace tout l’arc de la production capitaliste jusqu’à son renversement par le prolétariat et l’instauration d’une société sans classes. En se développant, le mode de production capitaliste pose les bases matérielles d’une société supérieure. Il développe également le prolétariat, la classe sociale qu’il exploite et qui devra l’abattre. Il montre à un certain point de son développement qu’il est un mode de production dépassé, que le développement de la production et productivité sociales doit passer par une autre société, une société sans classes dont les fondements ont été créés. Ce besoin, comme l’incapacité du mode de production capitaliste à le satisfaire se manifestent aux yeux de tous par des crises générales. Ces catastrophes sociales, dont l’ampleur est tendanciellement croissante, se répètent à intervalle régulier. Tout au long de son chemin de croix où chaque crise est une station qui devient toujours plus pénible et jusqu’à sa crucifixion par le prolétariat, c’est dans la baisse tendancielle du taux de profit que se résume la trajectoire catastrophique de ce mode de production.
Retenons ici juste cet extrait :
« Au-delà d’un certain point, le développement des forces productives devient un obstacle pour le capital ; donc le rapport capitaliste devient un obstacle au développement des forces productives du travail. Parvenu à ce point, le capital, c.-à-d. le travail salarié, entre vis-à-vis du développement de la richesse sociale et des forces productives dans le même rapport que les corporations, le servage, l’esclavage, devient une entrave dont, nécessairement on se débarrasse. L’ultime figure servile que prend l’activité humaine, celle du travail salarié d’un côté, du capital de l’autre, se trouve ainsi dépouillée, et ce dépouillement lui-même est le résultat du mode de production correspondant au capital ; les conditions matérielles et intellectuelles de la négation du travail salarié et du capital, qui sont déjà elles-mêmes la négation des formes antérieures de la production sociale non libre, sont elles-mêmes résultats de son procès de production. L’inadéquation croissante du développement productif de la société aux rapports de production qui étaient les siens jusqu’alors s’exprime dans des contradictions aiguës, des crises, des convulsions. » (Marx, Manuscrits de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, T.2, p.237)
Si cette loi est cruciale pour comprendre les crises et le cours du mode de production capitaliste il est logique qu’elle concentre les assauts de la pensée bourgeoise soit pour la réfuter, soit pour la minorer, soit pour la détourner, la réviser, lui ôter toute portée révolutionnaire. Cette loi qui demeura un mystère qui préoccupa l’économie politique classique[16] est devenue une abomination depuis son élucidation. Il n’est donc pas étonnant que la loi de la baisse tendancielle du taux de profit soit prise pour cible par les critiques du marxisme tandis que ses pseudos défenseurs n’ont d’autre ambition que de la ramener dans le giron de l’économie politique. Il s’agit soit d’en contester le caractère scientifique soit d’en émousser le tranchant révolutionnaire.
2.3 Marx et les manifestations de la baisse tendancielle du taux de profit
Pour Marx, la baisse tendancielle du taux de profit ne se manifeste nettement que :
- sur une longue période
- dans certaines circonstances
2.3.1 La longue période
La longue période induit que cette baisse ne s'évalue que sur plusieurs cycles (Marx parle de trente ans dans le livre III du capital, rédigé avant le livre I qui est publié en 1867, tandis que la première crise moderne date de 1825).
Il ne s'agit pas pour autant d'une loi a-historique indépendante de la configuration du marché mondial. De ce fait, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit s'exerce au sein d'un espace géo-historique défini et concerne plusieurs cycles d'accumulation entrecoupés de crises de surproduction dont la tendance est à l’aggravation.
2.3.2 Les circonstances
D'autre part, cette loi ne se manifeste nettement que dans « certaines circonstances », ce qui suppose une dimension qualitative (un saut, un bond qualitatif) dans l'expression de la baisse du taux de profit, une discontinuité, des moments de l'histoire économique qui viennent rappeler le capital à la réalité et le conduisent à révéler cette baisse, à en reconnaître la nécessité comme le besoin.
Les périodes de crise notamment sont l'occasion d'une recomposition de la base productive et le point de départ d'une nouvelle phase d'accumulation. Dans ces phases d'accumulation, le taux de profit tend à s'élever avant de chuter brutalement au moment de la crise. La baisse tendancielle du taux de profit suppose que tendanciellement la moyenne des taux de profit baisse d'un cycle à l'autre.
Dire que cette baisse tendancielle ne se manifeste que dans certaines circonstances conduit à ajouter que, au-delà même de cette moyenne, certains moments jouent un rôle particulier agissant comme révélateurs d’une tendance qui peut être, outre le phénomène des contre-tendances à la baisse du taux de profit, masquée pendant quelque temps.
Les crises périodiques sont justement une de ces circonstances, celle où le capital est mis à nu, où les effets nominaux éventuels s’évanouissent, où les bulles crèvent, où la base productive est reconstituée via l’élimination des acteurs faillis ou dépassés, la mise au rencart des moyens de production obsolètes …
Pour évaluer la baisse tendancielle du taux de profit, on peut donc ajouter à la courbe moyenne de l’évolution des taux de profit celle qui relie les taux de profit lors des points bas de la production capitaliste.
Ces remarques restent encore dans le cadre d’une continuité de l’histoire économique. Pour tenir compte de la dimension qualitative, discontinue, de l’expression de la baisse tendancielle du taux de profit, on doit aussi comprendre que l’affirmation effective de la baisse du taux de profit, masquée, contre balancée par des facteurs opposés, ne se réalise pleinement qu’au terme de plusieurs cycles, quand le capital épuisé renonce à sa mission historique pour attendre le coup de grâce que doit lui porter le prolétariat.
2.4 Les représentations de l’économie politique
Pourquoi une baisse du taux de profit conduit-elle à la crise ? En quoi les capitalistes ne compensent-ils pas par la masse ce qu'ils perdent par le taux ?
Toutes ces questions ont conduit nombre d'exégètes à rechercher un point particulier, un point « absolu » à partir duquel la crise était inévitable. Suivant qu'ils l'aient trouvé ou pas ils concluent à la pertinence ou non de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit comme facteur explicatif des crises de surproduction.
La reconnaissance de la baisse du taux de profit n’implique pas en soi celle des crises générales de surproduction. Un Ricardo, par exemple, voyait l'évolution de la société vers un état stationnaire, le taux de profit étant tombé tellement bas que l'accumulation ultérieure serait découragée. Nous avons donc l'idée que la productivité augmente chaque année mais moins rapidement que les dépenses pour l'obtenir ; la productivité augmente mais sa progression est décroissante, le taux de profit baisse. Pour une fraction des ricardiens cela peut durer bien longtemps, sans provoquer de crise. Au bout de ce processus, si elle parvient à ce stade, nous aurons une société dans un « état stationnaire »[17].
Les critiques sous-consommationnistes de Marx ont en fait la même représentation que les disciples de Ricardo. Par exemple, les héritiers de Rosa Luxemburg et Rosa Luxemburg elle-même, en bon représentants de ce courant sous-consommationniste, ne voyant pas se dessiner le mur sur lequel le taux de profit déclinant irait butter, concluaient à l'inanité de la loi de la baisse du taux de profit comme facteur explicatif de la crise (on lui substitue l'absence de demande solvable pour réaliser la plus-value à accumuler). Les adversaires aussi bien que les partisans ont donc une interprétation ricardienne de la baisse du taux de profit.
Les critiques sous-consommationnistes qui reconnaissent l’existence des crises, font alors remarquer que ce processus ne peut pas aboutir à une crise. La loi de la baisse tendancielle du taux de profit serait donc incapable d'expliquer les crises de surproduction qui ébranlent à intervalles réguliers le mode de production capitaliste. En conséquence, les sous-consommationnistes en viennent à rejeter ou du moins à atténuer l’importance de la loi de la baisse du taux de profit et portent leur attention sur les conditions de la réalisation du produit social et tout particulièrement de la plus-value.
Mais il est des ricardiens pour qui la baisse du taux de profit engendre des crises. Henryk Grossmann[18] ou Paul Mattick[19] font partie de cette école. Dans cette représentation, on met en évidence, un point « absolu », un point spécifique caractéristique qui annonce la crise. Grossmann et Mattick, considèrent que ce point est atteint dès lors que la masse de la plus-value devient insuffisante pour financer l'accumulation. Grossmann et Mattick substituent, fallacieusement, au taux de profit la masse de celui-ci. Comme nous l’avons déjà montré ailleurs[20] et comme nous le verrons rapidement dans ce texte, ces auteurs s’inscrivent dans une tradition ricardienne. Pour celle-ci, les crises ne peuvent aller au-delà de disproportions, c’est-à-dire de crises partielles où à un excédent dans un secteur fait face un déficit dans un autre. La théorie de Grossmann/Mattick revient à dire que la plus-value est insuffisante en regard des besoins de l'accumulation. Une hausse autonome (c'est-à-dire qui ne tient pas compte de la plus-value) du capital accumulé et de la composition organique du capital conduit à une crise due à l'insuffisance de la plus-value (en fait de crise, il s'agit d'une disproportion imaginaire).
A défaut de pouvoir expliquer les crises périodiques qui secouent la production capitaliste, on les rend permanentes. Qu’ils soient adeptes de la baisse du taux de profit, comme Paul Boccara qui réinterprète et falsifie complètement la théorie de la suraccumulation[21], ou épigones de Rosa Luxemburg, tous convergent, pour des motifs bien différents, et sans toujours le reconnaître, vers l’idée d’une crise permanente.
Contre ces interprétations, nous défendons ce qui est pour nous la véritable conception de Marx. Il existe des moments où le taux de profit baisse brutalement. Cette baisse soudaine est le résultat d'un retournement dans le progrès de la productivité du travail qui pour être surmonté doit se traduire par des dévalorisations qui ne résultent pas du progrès de la productivité mais de l'élimination des capitaux faillis, des baisses de prix ruineuses, des destructions de capitaux inemployés, etc. Il y a une suraccumulation du capital et l'ampleur de celle-ci permet de dire si cette suraccumulation est relative ou absolue (cf. chapitre 2.5). Dans le cours du taux de profit, il y a bien un changement d'état, un changement qualitatif, il ne s'agit pas d'un point absolu, quantitatif et produit par un résultat mécanique mais d'un point relatif, qualitatif, produit d’un développement organique, qui se caractérise, quel que soit le niveau atteint par le taux de profit, par un renversement brutal de la productivité du travail.
2.5 Surproduction de capital et surproduction de marchandises
Traditionnellement, le marxisme présente les crises de surproduction comme des crises de surproduction de marchandises :
« Nous avons vu comment la perfectibilité poussée au maximum du machinisme moderne se transforme, par l'effet de l'anarchie de la production dans la société, en une loi impérative pour le capitaliste industriel isolé, en l'obligeant à améliorer sans cesse son machinisme, à accroître sans cesse sa force de production. La simple possibilité de fait d'agrandir le domaine de sa production se transforme pour lui en une autre loi tout aussi impérative. L'énorme force d'expansion de la grande industrie, à côté de laquelle celle des gaz est un véritable jeu d'enfant, se manifeste à nous maintenant comme un besoin d'expansion qualitatif et quantitatif, qui se rit de toute contre-pression. La contre-pression est constituée par la consommation, le débouché, les marchés pour les produits de la grande industrie. Mais la possibilité d'expansion des marchés, extensive aussi bien qu'intensive, est dominée en premier lieu par des lois toutes différentes, dont l'action est beaucoup moins énergique. L'expansion des marchés ne peut pas aller de pair avec l'expansion de la production. La collision est inéluctable et comme elle ne peut engendrer de solution tant qu'elle ne fait pas éclater le mode de production capitaliste lui-même, elle devient périodique. La production capitaliste engendre un nouveau « cercle vicieux ».
En effet, depuis 1825, date où éclata la première crise générale, la totalité du monde industriel et commercial, la production et l'échange de l'ensemble des peuples civilisés et de leurs satellites plus ou moins barbares se détraquent environ une fois tous les dix ans. Le commerce s'arrête, les marchés sont encombrés, les produits sont là aussi en quantités aussi massives qu'ils sont invendables, l'argent comptant devient invisible, le crédit disparaît, les fabriques s'arrêtent, les masses travailleuses manquent de moyens de subsistance pour avoir produit trop de moyens de subsistance, les faillites succèdent aux faillites, les ventes forcées aux ventes forcées. L'engorgement dure des années, forces productives et produits sont dilapidés et détruits en masse jusqu'à ce que les masses de marchandises accumulées s'écoulent enfin avec une dépréciation plus ou moins forte, jusqu'à ce que production et échange reprennent peu à peu leur marche. Progressivement, l'allure s'accélère, passe au trot, le trot industriel se fait galop et ce galop augmente à son tour jusqu'au ventre à terre d'un steeple-chase complet de l'industrie, du commerce, du crédit et de la spéculation, pour finir, après les sauts les plus périlleux, par se retrouver... dans le fossé du krach. Et toujours la même répétition. Voilà ce que nous n'avons pas vécu moins de cinq fois déjà depuis 1825, et ce que nous vivons en cet instant (1877) pour la sixième fois. Et le caractère de ces crises est si nettement marqué que Fourier a mis le doigt sur toutes en qualifiant la première de crise pléthorique. [En français dans le texte. (N.R.)]
On voit, dans les crises, la contradiction entre production sociale et appropriation capitaliste arriver à l'explosion violente. La circulation des marchandises est momentanément anéantie ; le moyen de circulation, l'argent, devient obstacle à la circulation ; toutes les lois de la production et de la circulation des marchandises sont mises sens dessus sens dessous. La collision économique atteint son maximum : le mode de production se rebelle contre le mode d'échange, les forces productives se rebellent contre le mode de production pour lequel elles sont devenues trop grandes » (Engels, Anti-Dühring, Editions sociales, p.312)
« D'un côté, perfectionnement du machinisme, dont la concurrence fait une loi impérative pour tout fabricant et qui équivaut à une élimination toujours croissante d'ouvriers : armée industrielle de réserve. — De l'autre côté, extension sans limite de la production, également loi coercitive de la concurrence pour chaque fabricant. — Des deux côtés, développement inouï des forces productives, excédent de l'offre sur la demande, surproduction, encombrement des marchés, crises décennales, cercle vicieux : excédent, ici, de moyens de production et de produits - excédents, là, d'ouvriers sans emploi et sans moyens d'existence ; mais ces deux rouages de la production et du bien-être social ne peuvent s'engrener, du fait que la forme capitaliste de la production interdit aux forces productives d'agir, aux produits de circuler, à moins qu'ils ne soient précédemment transformés en capital : ce que leur surabondance même empêche. La contradiction s'est intensifiée en contre-raison : le mode de production se rebelle contre la forme d'échange. La bourgeoisie est convaincue d'incapacité à diriger davantage ses propres forces productives sociales. » (Engels, Anti-Dühring, Editions sociales, p.320)
Cette présentation, claire et pédagogique, met l’accent sur le déséquilibre qui se crée entre la progression de la production, progression d’autant plus grande que la productivité croît, et la croissance de la demande, l’augmentation de la taille et de l’intensité du marché. C’est ce que notait la gauche d’Italie quand elle opposait le « volcan de la production » au « marais du marché »[22]. Ce n’est pas parce qu’un pouvoir d’achat équivalent à la production est distribué (d’ailleurs, pour une part, il ne l’est que si l’accumulation s’effectue), que celui-ci va s’exercer, que les besoins vont croître dans la même proportion. Si la production de pommes de terre double et que parallèlement leur valeur est divisée par deux sous l’effet d’une hausse de la productivité, mon estomac n’avalera pas pour autant le double de pommes de terre. Mais, pour réaliser la même valeur, le capitaliste doit vendre le double de pommes de terre. Si des machines toujours plus efficaces et dont le prix est relativement en baisse arrivent sur le marché, la capacité de les acheter ne dépendra pas uniquement de leur prix mais aussi des débouchés escomptés par le capitaliste pour les produits qu’elle permet de fabriquer. La crise de surproduction de marchandises menace donc régulièrement la production capitaliste ; c’est ce sujet qui est en fait confondu avec la question de la sous-consommation ; nous le reprendrons plus loin (cf. partie 4). Par contre, dans cette partie 2, nous examinerons en détail la surproduction de capital, la suraccumulation.
Notons cependant ici que la surproduction de marchandises que nous venons de mettre en lumière n’est pas strictement identique à la surproduction de capital. C’est d’ailleurs pour cela que nous donnons deux noms différents pour un phénomène identique : la surproduction générale. En fait, tout dépend de l'angle à partir duquel on examine la contradiction : si l'on prend l'angle de la valeur d'échange, la limite du capital s'exprime comme suraccumulation, surproduction de capital ; si l'on prend celui de la valeur d'usage, le capital trouve une limite dans la surproduction de marchandises. Si la surproduction de capital induit celle de marchandise, la surproduction de marchandise n’implique pas la surproduction de capital : sa suraccumulation. Phénoménalement, nous aurons le même résultat : la surproduction générale. Dans un cas comme dans l’autre, le capital sous toutes ces formes (argent, moyens de production, marchandises) se fige : c’est la crise de surproduction. Dans les deux cas, cette crise est une crise générale, une crise catastrophique qui appelle la dévalorisation (nous en verrons les diverses modalités). La surproduction de capital, la suraccumulation est induite par une baisse brutale du taux de profit, baisse dont nous verrons les caractéristiques, tandis qu’avec la surproduction de marchandises nous avons le phénomène opposé, c’est-à-dire que dans ce cas, c’est la surproduction qui a comme effet d’abaisser le taux de profit et le degré d’exploitation.
Nous avons là les deux écueils entre lesquels navigue la production capitaliste. D’un côté, une hausse de la production qui se traduit par une insuffisance de la production de plus-value induit une crise de surproduction de capital et par voie de conséquence, une surproduction de marchandises, de l’autre une progression de la production, une expansion du surproduit, qui ne trouve pas les débouchés correspondants engendre une surproduction de marchandises. Il s’agit de deux manifestations de la même limite. La recherche du maximum de plus-value, la valorisation du capital passe par sa dévalorisation, la hausse de la productivité et la croissance de la masse des marchandises.
Bien entendu, les marchandises sont aussi du capital-marchandise. Si Marx distingue avec la théorie de la suraccumulation, la surproduction de capital de la surproduction de marchandises, c’est pour bien souligner et distinguer les racines des obstacles qui se dressent devant la production capitaliste. Il s’agit de la même limite mais elle est exposée selon deux directions différentes. D’un côté, on insiste sur la dimension propre à la valeur d’échange (sous la forme des limites propres à la production du maximum de plus-value). La suraccumulation, la surproduction de capital est à mettre en relation avec le but même de la production capitaliste : la recherche du maximum de plus-value, la production de valeur d’échange extra, de survaleur, et les limites provoquées par une production insuffisante de celle-ci. De l’autre côté, on met en avant la dimension propre à la valeur d’usage, c’est-à-dire aux questions propres à la forme que prend le produit social, sa composition matérielle (les types de valeurs d’usage qu’il revêt et notamment la distinction entre les marchandises destinées à la consommation productive, les moyens de production, et celles destinées à une consommation individuelle ou collective) et leur volume, leur masse, la distribution des revenus entre les classes, la capacité d’accumulation, la capacité à trouver les débouchés nécessaires à l’expansion du surproduit et de la production en raison des limites provoquées par une trop grande valorisation et le développement de la productivité qui l’accompagne.
Dans les deux cas, il s’agit d’une crise générale de surproduction qui appelle la même solution : une dévalorisation du capital. Dans les deux cas, marchandises, argent, moyens de production se figent tandis que la force de travail rejoint l’armée de réserve industrielle. Dans les deux cas, ce qui rend la crise possible, ce qui lui permet de se manifester, c’est la forme marchande du produit social, la contradiction entre la valeur d’échange et la valeur d’usage, la contradiction entre la marchandise et l’argent qui font que la réalisation du capital-marchandise en argent ne va pas de soi. Surproduction et non-réalisation du produit social signifient dialectiquement la même chose[23]. Que la surproduction de marchandises soit en relation avec la surproduction de capital ou qu’elle soit autonome, dans les deux cas, mais pour des motifs en partie différents, il n’y pas de réalisation du produit social, les marchandises restent invendues, la surproduction est manifeste et il s’ensuit une dévalorisation du capital. Dans le cas de la surproduction de capital, la surproduction résulte de la baisse brusque du taux de profit. Dans l’autre cas, celui d’une surproduction de marchandises, c’est la surproduction qui conduit à la baisse soudaine du taux de profit. Quelle que soit la cause immédiate de la surproduction, la réponse sera la dévalorisation du capital. Quelle que soit la cause immédiate de la surproduction, le capital menacé par ces crises périodiques, doit, à terme, renoncer à son but et s’abandonner à la baisse (tendancielle) du taux de profit.
2.6 Relation entre baisse tendancielle du taux de profit et suraccumulation du capital
2.6.1 Baisse tendancielle et baisse brutale du taux de profit
Une grande source de confusion, présente chez de nombreux auteurs, est d’assimiler unilatéralement la baisse tendancielle du taux de profit et la suraccumulation du capital. En ne distinguant pas au sein de la loi générale de la baisse du taux de profit, le moment particulier qui caractérise la suraccumulation du capital, la surproduction de capital, on ramène la théorie de Marx au niveau de l’économie politique.
La baisse tendancielle du taux de profit est, comme nous l’avons vu, une loi dont la temporalité concerne plusieurs cycles de la production capitaliste tandis que la suraccumulation de capital, corollaire de la crise de surproduction suppose une baisse brutale du taux de profit. Si l’on considère que la crise marque la fin d’un cycle, la suraccumulation du capital correspond à cette période du cycle. Dans son développement, la loi de la baisse du taux de profit se traduit, dans des moments singuliers, par une suraccumulation de capital, une crise générale de surproduction de capital, due à une brusque baisse du taux de profit.
Nous avons donc, d’un côté, une baisse tendancielle qui s’étend sur plusieurs cycles et, de l’autre côté, une baisse soudaine, subite qui marque la fin du cycle. Ce qui revient à dire que tout en connaissant une baisse tendancielle du taux de profit, le capital connaît régulièrement, périodiquement (cycliquement) une baisse brutale du taux de profit qui se traduit par une crise générale de surproduction. La recherche du maximum de plus-value induit notamment le développement de la productivité du travail. Celui-ci s’exprime par la hausse du degré d’exploitation de la force de travail et la baisse tendancielle du taux de profit. Par contre, la baisse brutale du taux de profit qui va caractériser la suraccumulation, la surproduction de capital, est marquée par la brusque baisse de ce même degré d’exploitation.
La loi de la baisse du taux de profit se manifeste donc :
1° en tant que tendance, sur plusieurs cycles, dans un cadre géo-historique donné, dans certaines circonstances, en tant qu’expression du développement contradictoire de la productivité du travail.
2° périodiquement, en fin de cycle, du fait d’un retournement de la productivité, sous la forme d’une baisse brutale du taux de profit, sous la forme d’une suraccumulation, d’une surproduction de capital ou encore, autre écueil que nous verrons plus en détail dans le chapitre 4, sous la forme d’une surproduction de marchandises qui précipite la baisse du taux de profit.
Les deux aspects, nous l’avons vu, ne sont pas séparés. Dans son développement, le processus valorisation dévalorisation se présente sous la forme de la loi de la baisse du taux de profit à la fois dans son aspect tendanciel (intercycles) et son aspect soudain, sa baisse soudaine sous l’effet d’une baisse brusque du degré d’exploitation du travail ou d’une surproduction de marchandises ; ces circonstances particulières caractérisent soit la suraccumulation qui est une crise de surproduction générale de capital soit la surproduction de marchandises (qui est tout aussi générale).
Il est important de ne pas confondre ces deux dimensions. Toute baisse du taux de profit n’engendre pas de crise. En revanche, il y a des moments particuliers où, au contraire, cette baisse prend corps et se traduit par une crise de surproduction générale de capital, une suraccumulation.
Si l’on peut rejeter l’existence de points absolus, mécaniques conduisant à la crise (par exemple, c’est le cas de la théorie de Grossmann/Mattick avec l’insuffisance de plus-value pour faire face à l’accumulation) on ne peut pas ignorer pour autant l’existence de ces points nodaux, de ces points spécifiques, relatifs et non pas absolus, où la productivité se retourne et se traduit par une crise générale de surproduction. Critiquer, à juste titre, la théorisation de l’existence de points spécifiques absolus dans la baisse du taux de profit ne doit pas conduire à nier l’existence de points caractéristiques, relatifs, pour lesquels, quelle que soit la hauteur du taux de profit et sa tendance, une baisse brutale du taux de profit intervient. Ces points nodaux relatifs se caractérisent par un retournement de la productivité du travail[24] dès lors qu’il s’agit d’une suraccumulation. Dans ce cas c’est la baisse soudaine du taux de profit qui provoque la surproduction générale. A l’inverse, dans le cas d’une surproduction de marchandises, phénomène qui intervient quand celles-ci ne trouvent pas le marché qui leur est nécessaire, c’est la surproduction qui engendre la baisse du taux de profit et le recul de la productivité qui accompagne la crise générale.
2.6.2 Une parabole agraire
Si nous avons à nous représenter simplement, et donc très schématiquement, la spécificité de la suraccumulation (surproduction liée à une baisse brutale du taux de profit qui marque la fin du cycle) au sein de la loi générale de la baisse tendancielle du taux de profit (intercycle) on pourrait tenter une parabole agraire.
La baisse brutale du taux de profit provoquant une crise peut être assimilée à une très mauvaise récolte qui se traduit donc par un recul brutal de la productivité du travail tandis que la baisse tendancielle du taux de profit serait l'équivalent des «rendements décroissants » (tendanciellement) pour parler comme les économistes, bref elle refléterait le fait que la productivité non pas se retournerait mais progresserait de moins en moins rapidement, aurait un taux d'accroissement tendanciellement de plus en plus faible.
Le retournement de la productivité du travail engendre une pression à la hausse à la fois sur le capital constant et le capital variable tandis qu’une pression opposée, à la baisse, s’exerce brutalement sur la plus-value. Au mouvement contradictoire de la valeur qui, dans ces occasions, prend la direction opposée de sa tendance historique (avec le développement de la productivité du travail, toutes choses égales par ailleurs, la valeur des marchandises baisse), il faut substituer une dévalorisation, une dépréciation brutale du capital, par une baisse des prix, l'arrêt du processus de production, la destruction de capitaux, tandis que la mévente et la surproduction des marchandises s'installent, que l’armée de réserve industrielle enfle, que le capital argent et les moyens de production restent en jachère, …
Conduit à des crises qui se développent sur la base d’une force productive du travail toujours plus grande et à la gravité tendanciellement croissante, le capital ressent le besoin impérieux de limiter son expansion, sa puissance productive, le développement de la productivité sociale, puisque celle-ci le menace régulièrement. Il lui faut dissiper et gaspiller ce potentiel productif.
Cette dissipation prend plusieurs aspects, limitation du taux d’accumulation via la consommation des classes moyennes, recherche d’une demande solvable sur le marché mondial, réalisation d’investissements en capital fixe (grands travaux, ouvrages d’art) dont les retombées productives sont à long terme, et baisse tendancielle du taux de profit. Au final, acculé, le capital accepte une baisse du taux de profit qui marque pour lui le renoncement à une mission historique, favorise les tendances parasitaires, la spéculation, avoue son impuissance et son caractère limité, se met à se survivre en attendant le coup de grâce que doit lui porter le prolétariat.[25]
2.7 La suraccumulation du capital chez Marx
2.7.1 Un cadre théorique à expliciter
Pour bien faire comprendre ce qu’il entend par suraccumulation, c’est-à-dire surproduction de capital, Marx envisage un cas dit de « suraccumulation absolue ». Son exemple en a dérouté plus d’un. En effet, Marx se place dans des conditions théoriques qui lui permettent d’illustrer son propos sans avoir recours au processus valorisation dévalorisation, sans prendre en compte l’évolution contradictoire de la productivité du travail[26]
Pour mieux mettre en évidence les résultats d’un processus complexe, Marx le simplifie. Pour éviter de traiter le sujet dans un contexte où le développement de la productivité du travail à des effets contradictoires[27], Marx se place dans un cadre théorique qui les élimine.
Ainsi Marx suppose qu’aucune révolution n’intervient dans le progrès des forces productives. En d’autres termes, il écarte le procès valorisation-dévalorisation. Dans cette représentation, on admet donc qu’il n’y a ni progrès de la productivité du travail ni modification de la composition technique du capital (le rapport entre la masse des moyens de production et la force de travail nécessaire pour les mettre en œuvre.). Dans cette hypothèse, la crise de suraccumulation absolue ne peut s’expliquer que par une hausse du salaire telle que la plus-value additionnelle due à l’accroissement du nombre d’ouvriers est dévorée par la hausse générale de l’ensemble des salaires[28].
Pour ce faire, Marx nous replonge dans une situation déjà rencontrée[29] dans le livre I du capital[30]. De ce point de vue, on peut rapprocher suraccumulation absolue et plus-value absolue et le cadre théorique de l’accumulation du capital de l’époque de la manufacture quand le procès de travail n’était pas spécifiquement capitaliste (avant la révolution industrielle) et que donc le capital se subordonnait formellement le travail.
Pour être plus précis, en Angleterre, les périodes historiques où l’on rencontre des hausses de salaires, susceptibles de faire baisser le taux de plus-value sont :
- le XVe siècle, à l’aube de la production capitaliste (la manufacture s’implante surtout à partir du XVIe siècle),
- la première moitié du XVIIIe siècle, période qui correspond à l’apogée de la manufacture et à l’émergence de la grande industrie (le coup d’envoi de la révolution industrielle date de 1735 et elle fera sentir pleinement ses effets dans le dernier quart du XVIIIe siècle[31]).
Marx d’ailleurs fait remarquer que Smith écrit à cette époque où la grande industrie est naissante[32] et il critique Ricardo qui se sert des premières années du XVIIIe siècle comme modèle alors qu’il ne s’agit que d’un cas possible, par ailleurs dépassé par le développement de la grande industrie qui suppose un procès de travail spécifiquement capitaliste (machinisme) et donc la subordination réelle du travail au capital[33].
Bien entendu, dans ces périodes, il n’y a pas ces crises de surproduction[34] propres à la production capitaliste moderne[35] ; celles-ci commencent à partir de 1825[36]. Paradoxalement, Marx se sert donc d’un cadre théorique[37] et historique dépassé, un cadre qui ne connaît pas les crises propres au mode de production capitaliste le plus développé, pour illustrer plus facilement ces crises modernes.
L’avantage que Marx en retire est de ne pas introduire le procès valorisation-dévalorisation et, en conséquence, de simplifier son propos. Donc, ce faisant, Marx peut bâtir un cas pédagogique, un exemple heuristique pour illustrer la suraccumulation. En revanche, une fois la crise de surproduction déclenchée sur la base de critères simplifiés, les modalités du recouvrement de la capacité à accumuler, du rétablissement des rapports d’exploitation et de la restauration du taux de profit qui l’accompagne sont propres au mode de production capitaliste moderne. Les diverses formes de dévalorisation du capital qui y sont envisagées sont celles qui prévalent au sein de la production capitaliste la plus développée.
2.7.2 La suraccumulation absolue
2.7.2.1 Suraccumulation absolue = crise générale de surproduction
Pour Marx, suraccumulation absolue signifie tout d’abord crise générale de surproduction de capital. Il ne s’agit donc pas d’une crise partielle, d’une crise limitée à tel ou tel secteur de la production mais d’une crise générale affectant l’ensemble des domaines de la production capitaliste. C’est le premier sens de cette suraccumulation, surproduction, absolue[38]. On notera que dans cette citation (en note de bas de page), Marx trace de nouveau un trait d’égalité entre suraccumulation de capital et surproduction de capital, ce qui ne laisse aucun doute sur le sens de sa pensée à propos du concept de suraccumulation. S’il est bien évident que la crise éclate à un moment donné, donc à l’occasion d’une nouvelle accumulation du capital, c’est bien l’ensemble du rapport social qui est concerné. On notera que Marx emploie le conditionnel car il s’agit d’une hypothèse théorique. Dans la pratique, la crise, toute générale qu’elle soit, n’a pas besoin de toucher tout le capital de tous les secteurs. Ailleurs, Marx développe l’idée que pour qu’une crise soit générale, il suffit qu’elle concerne les secteurs pilotes de la société[39].
2.7.2.2 Suraccumulation absolue = surproduction de capital
En insistant sur la surproduction de capital, distincte pour une part mais également articulée à la surproduction de marchandises[40], il s’agit pour Marx de montrer que la crise n’est ni un phénomène limité à une sphère particulière, ni un phénomène accidentel mais un produit organique de la production capitaliste qui trouve ces racines au sein de celle-ci. La force de la théorie de la suraccumulation c’est qu’elle recherche l’origine de la crise au cœur même de la production capitaliste. La crise est mise en relation avec la production insuffisante de plus-value (dont la production maximum est le but exclusif de la production capitaliste) par rapport au capital avancé et la baisse brutale du taux de profit qui s’ensuit. La suraccumulation et la crise générale de surproduction qui l’accompagne se caractérisent alors par la dégradation soudaine du rapport d’exploitation, par une baisse subite du degré d’exploitation.
2.7.2.3 Suraccumulation absolue = « taux de profit marginal » nul ou négatif
En effet, Marx définit ensuite la suraccumulation absolue par l’importance de la baisse du taux de profit qu’elle suppose. « il y aurait surproduction absolue de capital dès le moment où le capital additionnel destiné à la production capitaliste serait égal à zéro » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1033).
Cette première définition peut paraître ambiguë. Marx veut-il dire que la fraction de la plus-value accumulée (on pourrait peut-être interpréter ainsi le membre de phrase cité précédemment : « le capital additionnel destiné à la production capitaliste ») devient nulle ou veut-il dire autre chose ? et notamment vise-t-il la plus-value, la survaleur dans son ensemble ?. Il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des brouillons qu’Engels ou d’autres (Rubel notamment) ont édité. Quant aux traductions, elles sont d’une qualité fort inégale.
La pensée de Marx se précise ensuite « (…) dès que le capital accru ne produirait donc qu’autant, voire moins de plus-value qu’avant son accroissement, il y aurait surproduction absolue de capital ; autrement dit, le capital accru C + ΔC ne produirait pas plus de profit, peut-être moins, que le capital C avant son accroissement par ΔC. » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1034)
C’est donc l’idée que la plus-value produite après l’accumulation du capital est identique voire moindre à celle qui était produite sur la base du capital avancé précédemment qui est la bonne (ou que implicitement Marx suppose ici une accumulation de la totalité de la plus-value). C’est ce phénomène qui caractérise la suraccumulation absolue, la surproduction absolue de capital. Cette surproduction absolue est donc le corollaire d’une baisse brutale du taux de profit.
Dans la baisse tendancielle du taux de profit, nous avions à la fois une tendance à la hausse de la composition organique du capital et une tendance à la hausse du taux de la plus-value et l’accumulation s‘accompagnait d’un accroissement de la masse de plus-value. Le phénomène ici est complètement inversé puisque, contrairement à la tendance générale du mode de production capitaliste, le degré d’exploitation de la force de travail diminue brutalement. En effet, avec la hausse des salaires, nous avons simultanément une baisse du taux d’exploitation, du taux de plus-value et une baisse de la composition valeur du capital. Le taux de profit chute brutalement sous l’effet de ce retournement de tendance.
2.7.3 La suraccumulation par l’exemple
Prenons un exemple. Admettons que le produit social se décompose ainsi : 50 c + 50 v +50 pl. Ignorons les questions propres au capital fixe. Admettons maintenant que toute la plus-value soit accumulée et que le capital constant et le capital variable additionnels se répartissent selon la composition organique en vigueur soit 1. Le capital constant additionnel serait alors de 25 et le capital variable additionnel également de 25. La plus-value de 50 est donc accumulée et se décompose en 25 c + 25 v. Le degré de développement des forces productives reste constant tandis qu’elles s’étendent. Ici, l’accumulation entraîne un accroissement proportionnel de la force de travail. Par conséquent, le produit social attendu devrait être :
75 c + 75 v + 75 pl.
Or, Marx nous dit que ce qui caractérise la suraccumulation absolue c’est que la plus-value additionnelle est nulle voire négative. La plus-value totale de la période considérée se retrouve égale ou inférieure à la plus-value totale de la période antérieure. Donc, au lieu des 75 attendus nous avons au mieux 50.
Comment cela est-il possible alors que la population productive augmente ?
Pour nous retrouver dans la situation indiquée par Marx, Il faut que la hausse du salaire pour l’ensemble du prolétariat (le capital variable qui va se transformer en salaire versé à l’ensemble du prolétariat est de 75) vienne contrebalancer l’accroissement de la plus-value due à l’accumulation du capital additionnel (la plus-value nouvelle est potentiellement de 25). Il faut donc que la plus-value potentielle, soit 75, soit ramenée à 50. Pour ce faire, le salaire doit s‘élever de 75 à 100.
Une baisse de la plus-value (de 75 à 50) en relation avec l’augmentation du capital variable (qui passe toutes choses égales par ailleurs de 75 à 100) induit une baisse brutale du taux de profit (il était de 50%, il tombe à 50/175 soit 28%) et décourage les perspectives d’une nouvelle accumulation et donc la réalisation du produit social ; la crise de surproduction éclate.
Lorsque le capitaliste collectif qui a le monopole du produit social souhaite à nouveau salarier le prolétariat existant, il doit désormais débourser 100 au lieu de 75 ; toute la plus-value additionnelle créée lors de la période est annihilée.
Dans le cas explicité par Marx, il n’y a pas de développement contradictoire de la productivité du travail. Le procès valorisation/dévalorisation a été écarté. La hausse des salaires intervient parallèlement au procès de production (par exemple, sous l’effet d’un fort accroissement des offres d’emploi favorisant la hausse des salaires ou encore de luttes de classes qui tournent à l’avantage de la classe productive). Cette hausse se présente comme une contrainte externe. Ce choix permet à Marx d’illustrer son propos sans complications. Mais, nous l’avons déjà vu, il serait absurde de penser que les crises résultent d’une hausse des salaires. Cette perspective est introduite ici, uniquement à des fins simplificatrices. La cause externe, la hausse des salaires permet de ne pas se confronter au processus valorisation/dévalorisation pour introduire la crise de suraccumulation. Mais, en fait, c’est au sein du processus de production que se passe le phénomène qui engendre la suraccumulation. Le choc externe (la hausse des salaires), plus simple à mettre en œuvre, à justifier, à expliquer, à illustrer, remplace le processus interne (retournement de tendance dans le processus valorisation dévalorisation) qui engendre la baisse de la plus-value produite.
Dans la suraccumulation mise en scène par Marx, c’est au moment où la classe capitaliste se lance dans une nouvelle accumulation qu’elle constate que les conditions du marché ont changé. Le prix de la force de travail s’est envolé et la plus-value qui avait été extorquée s’évanouit. A la fin du processus de production, les salaires ont augmenté pour s’élever à 100. La réalisation du produit social rapporte potentiellement 225 au capitaliste. Pour reproduire le niveau d’accumulation antérieur, il devra avancer 75 de capital constant et 100 de capital variable du fait de la hausse des salaires. Il ne lui reste alors plus que 50 de plus value, soit le même résultat que lors de la phase d’accumulation précédente. Il ne disposera pour accumuler que 50 de capital argent additionnels. Pour le prochain cycle, il ne peut espérer une plus-value additionnelle que sur la base d’un taux de profit de l’ordre de 28% contre 50% auparavant et à condition qu’une nouvelle hausse de salaire ne vienne pas ruiner cette perspective. L’accumulation est découragée, la surproduction se manifeste en relation avec une insuffisante valorisation[41], conséquence d’une baisse brutale du degré d’exploitation de la force de travail.
Bien entendu, notre exemple est spectaculaire. Cela tient à l’importance de la croissance de la population productive en raison notamment d’un taux d’accumulation (100% de la plus-value) et d’un taux de profit élevés. La formule générale qui mesure ce taux de croissance est pl k/ (c + v), c’est-à-dire la combinaison du taux de profit (pl/c+v) et du taux d’accumulation de la plus-value (k). Ici, nous avons laissé de côté la question du capital fixe en posant sa rotation égale à l’unité. Toute la plus-value est accumulée et donc le taux d’accumulation (k) est de 100%. Dans notre exemple, le taux de croissance et le taux de profit sont égaux.
Par conséquent, dans le cas d’une suraccumulation absolue, le taux de profit marginal (qu’on nous pardonne ce flirt avec l’économie politique, en attendant de trouver, si possible, un meilleur concept), le taux de profit qui rapporte la plus-value additionnelle au capital avancé additionnel, doit tomber à 0 voire devenir négatif.
2.7.4 La suraccumulation et la baisse du degré d’exploitation
Les contradictions que met en lumière l’analyse de Marx sont dialectiques ; elles ne relèvent pas d’une logique plate et mécanique, d’une logique purement formelle. Si le capitaliste collectif a accumulé la plus-value et avec elle l’ensemble du capital social réalisé, c’est parce qu’il recherchait le maximum de plus-value. Si ce processus s’interrompt, c’est parce qu’il s’est produit, au cœur du processus productif, un événement qui engendre une insuffisance de plus-value, une baisse du degré d’exploitation. Dès lors que celle-ci atteint un certain point, le capital est confronté à la suraccumulation, à une crise de surproduction de capital. Celle-ci se manifeste par un arrêt de l’accumulation et de la reproduction du capital[42] tandis que, corollaire de ce blocage du processus, les marchandises créées se révèlent invendables[43]. La nature même de l’argent, rend possible une scission entre la vente et l’achat. Donc, la réalisation de la plus-value et du capital avancé ne se fait pas dans la mesure où le capital ne se lance plus dans la recherche du maximum de plus-value, déstabilisé qu’il est par cette baisse brutale du degré d’exploitation et du taux de profit qui l’accompagne.
Comment ce phénomène est-il à la fois possible et nécessaire sur la base de la production capitaliste la plus développée ? Nous devons concéder que nous sommes arrivés aux confins de ce que Marx a exploré. Nos travaux mettent à jour ses intentions et sa conception. Et, en même temps qu’ils cherchent à restaurer et à éclairer la théorie, ils mettent en évidence les parties qui sont dans l’ombre, les parties pour lesquelles le parti communiste doit poursuivre un effort scientifique. C’est donc à cet effort que nous appelons pour mieux percer encore les secrets du mode de production capitaliste. Ce sont d’ailleurs des efforts de ce genre qui permettent de montrer que le socialisme est scientifique[44] et non une ratiocination vide de sens ou pire encore, et c’est malheureusement sous cette forme qu’il occupe le devant de la scène, une idéologie de la contre-révolution. Le marxisme orthodoxe que nous cherchons à représenter, ne s’est jamais attelé à l’étude du processus valorisation/dévalorisation. L’enjeu scientifique est là et reste entier. Pour pouvoir l’entreprendre, il faut d’abord se débarrasser des obstacles que constituent les interprétations révisionnistes en général et celles du marxisme de la chaire en particulier.
Il appartient donc aux nouvelles générations du parti communiste de labourer ce terrain pour en faire ressortir une nouvelle moisson qui conduira la théorie révolutionnaire à un nouveau sommet.
Ceci posé, nous pouvons envisager quelques pistes. La hausse des salaires, nous l’avons vu, permet d’illustrer sans effort l’idée d’une baisse brutale du taux de profit. Mais dans le mode de production capitaliste moderne, quand le capital se subordonne réellement le travail en créant une technologie spécifiquement capitaliste (machinisme), qui se caractérise par la baisse du salaire relatif, un tel cas de figure ne peut être qu’exceptionnel.
Si nous écartons également la perspective d’un abaissement brutal de la durée du travail, c’est vers le retournement dans le progrès de la productivité du travail qu’il nous faut nous tourner. Comment cela est-il possible ? Un tel phénomène se comprend très bien dans le cas de l’agriculture ou de la production de matières premières. Des mauvaises récoltes, le recours à des terrains ou des mines moins productifs, font reculer la productivité du travail. Mais tout cela a un caractère accidentel, extérieur, alors que nous cherchons des causes organiques, internes.
Ecartons l’objection naïve qui comparerait la productivité sociale avec celle d’un producteur individuel, son boulanger par exemple, en considérant qu’il maîtrise très bien sa productivité (et moins la demande). Pour Marx, la productivité du travail est toujours une productivité sociale qui résulte de la moyenne d’une force de travail collective. Qui plus est, cette force de travail collective, le seuil à partir duquel la force de travail produit les marchandises dans les conditions sociales moyennes doit augmenter avec le développement de la production capitaliste.[45]. Par conséquent, la maîtrise de la productivité sociale n’est pas du seul ressort de l’entreprise capitaliste. Celle-ci est soumise à un processus social dans lequel elle est immergée et qu’elle subit autant qu’elle y participe. D’autre part, quand nous analysons à un très haut niveau d’abstraction la question de la suraccumulation, nous devons penser que dès lors que nous introduisons le procès valorisation/dévalorisation, il s’ensuit une modification dans la composition organique du capital[46]. Celle-ci ne se traduit pas par une évolution graduelle mais par de véritables sauts qui modifient considérablement voire bouleversent les conditions de production. A ce niveau d’analyse, la maîtrise de la productivité qui résulte de cette nouvelle organisation ne va pas de soi.
Plus la production capitaliste est développée, plus le taux de la plus-value est important, plus la masse des marchandises s’est accrue. Obtenir un surcroît de plus-value suppose un accroissement d’autant plus considérable de la force productive du travail ; l’instabilité de la production capitaliste, du fait de sa difficulté croissante à remplir son contrat : le maximum de plus-value, s’accroît donc et favorise d’autant plus les crises.
Existe-t-il des facteurs qui faussent le jugement de la classe capitaliste ? Peut-il se laisser gagner par l’euphorie et s’engager dans la voie de la suraccumulation ? Indéniablement les indicateurs dont dispose la classe capitaliste sont faussés aussi bien par sa représentation théorique des phénomènes car elle ignore la source de la valeur et de la plus-value que par la réalité objective de ceux-ci. Les comptabilités ne donnent qu’une approximation de la valeur, le profit qui sert de guide n’est qu’une partie de la plus-value. La spéculation est une source d’enrichissement tentante dans bien des occasions. Dans ces périodes d’euphorie spéculative, l’entreprise est facilement entraînée dans des investissements sans lendemain. A l’ivresse de la spéculation succède la gueule de bois de la crise.
Ces derniers éléments montrent d’une part qu’à ce niveau d’analyse, celui du capital total et du capital productif, ne sont posés que les fondements généraux des crises. Pour comprendre les crises réelles, outre une analyse du procès valorisation/dévalorisation, il faut également prendre en compte la sphère financière, le cycle du capital fixe et se placer également au niveau des « capitaux nombreux », des capitaux entrant en concurrence les uns avec les autres sans oublier la lutte des classes comme les interventions de la classe dirigeante et de son Etat.
2.7.5 La suraccumulation relative
Même si l’école normale supérieure pense le contraire[47], en première analyse, le concept de « suraccumulation relative » ne semble pas exister chez Marx. Dans l’édition de Maximilien Rubel, il existe bien un passage, dédié à l’analyse de la suraccumulation, où il est question de « surproduction relative », mais compte tenu de ce qui est dit dans ce paragraphe, il s’agit d’un lapsus pour « surpopulation relative »[48].
Le concept de « surproduction relative », s’il n’est pas associé directement à suraccumulation, est cependant employé par Marx dans des contextes variés.
De même qu’il ne définissait pas uniquement la suraccumulation absolue sur la base de critères quantitatifs[49] comme c’est le cas quand il la définit par un taux de profit marginal égal à 0 voire négatif, Marx utilise plus loin, vraisemblablement en réponse aux économistes bourgeois, le terme de « surproduction relative » dans un sens général[50]. L’expression vise la relativité du mode de production capitaliste. La surproduction n’est pas « absolue » (et donc est « relative ») car elle ne résulte pas du fait que les besoins sont tous satisfaits et la production trop grande. Nous sommes loin d’une telle situation car la consommation du prolétariat est limitée. La surproduction est donc dans ce sens « relative », caractéristique du mode de production capitaliste. La société n’est pas parvenue à la satiété ; c’est le capital, affamé de surtravail, qui a périodiquement du mal à le produire et le digérer. La surproduction démontre le caractère historique, transitoire, de ce mode de production comme la nécessité de son renversement révolutionnaire.
Les économistes comme Ricardo se servaient de l’expression « surproduction relative » pour nier la possibilité d’une surproduction générale, touchant tous les secteurs[51]. Pour eux, si la surproduction était générale, la proportion entre toutes les branches serait respectée, il n’y aurait pas de disproportions entre les secteurs et donc on aurait affaire à un accroissement des forces productives. Par conséquent, s’il y a une surproduction, elle ne peut être que relative, concerner uniquement certains secteurs. La théorie de la monnaie de Marx va à l’encontre de ce raisonnement en montrant que la possibilité d’une scission entre la vente et l’achat est inscrite dans la nature de l’argent et rend possible une surproduction générale, une surproduction qui affecte tous les secteurs. Dialectiquement, la surproduction de marchandises apparaît du fait de la non réalisation du produit social, tandis que la surproduction de capital conduit à la non réalisation du produit social.
Ailleurs, dans les manuscrits de 1857-1858 (Gründrisse), Marx développe l’idée que pour que le capital puisse accumuler du capital fixe dont la réalisation suppose une longue période de production (barrages, canaux, chemins de fer, grands ponts, etc.), un niveau élevé de productivité est nécessaire. Pour qu’une telle production soit possible, une surpopulation et surproduction relatives[52] sont nécessaires. C’est-à-dire, d’une part, qu’une force de travail doit être disponible, libérée du fait du développement de la productivité sociale et non pas rivée à des travaux qui lui assurent juste ce qu’il faut pour se reproduire. D’autre part, une capacité à faire des avances de capital importantes doit exister car il s’écoulera du temps avant que le capital fixe ainsi créé puisse être utilisé. Il faut donc une surproduction relative ce qui signifie dans ce contexte un surplus relatif. Il peut être un vecteur de crise ; non pas de ces crises générales de surproduction dont nous parlons tout au long de ce texte mais de disproportions entre capital fixe et capital circulant, disproportions qui elles-mêmes, du fait des décalages dans la production du capital fixe jouent un rôle dans la périodicité du cycle[53]. Dans ce sens, « surproduction relative » s’oppose à « production nécessaire »[54].
Dans le livre II du capital, lorsqu’il traite de la reproduction du capital fixe, Marx constate que dans une société communiste, il devrait y avoir une « surproduction relative continuelle » pour faire face aux fluctuations. Bien entendu, cela ne signifie pas que la société communiste connaît une crise permanente mais que des stocks régulateurs sont indispensables. Dans la société bourgeoise, ils sont une composante de l’anarchie de la production[55]. Ici aussi le concept a donc un sens particulier qui ne peut être rapproché de la suraccumulation absolue.
On ne peut pas non plus comme nous le faisions dans « Communisme ou civilisation »[56] historiciser les concepts :
· « suraccumulation absolue » pour la période manufacturière (avec en écho, la production de plus-value absolue ou encore la surpopulation absolue) quand le travail est subordonné formellement au capital
· « suraccumulation relative » (et la production de plus-value relative comme d’une surpopulation relative avec l’élévation de la composition organique du capital) avec le mode de production capitaliste moderne où le travail est subordonné réellement au capital.
Il est vrai, nous l’avons rappelé, que le cadre défini par Marx pour mettre en relief la suraccumulation est bien celui de la période manufacturière. Par contre, les caractéristiques de la crise et de la destruction de capital qui l’accompagne sont celles des crises de surproduction qui naissent sur la base de la production capitaliste la plus développée[57]. La première de ce genre, nous l’avons déjà souligné, est datée de 1825. La suraccumulation, qu’elle soit absolue ou relative, ne peut donc intervenir qu’à partir de cette date.
Devons-nous alors renoncer au concept de suraccumulation relative ?
Pour les staliniens du PCF, la suraccumulation relative se définit comme suit : « Dans le cas de suraccumulation relative, à un capital additionnel ne correspond pas une masse de profit additionnel telle qu’elle puisse donner le taux de profit minimum nécessaire. » (Traité d’économie politique marxiste, Editions sociales, T.1, p.38)
On pourrait en conclure qu’il s’agit d’une variante ricardienne de la baisse du taux de profit qui suppose un taux de profit minimum, minimum variable (cf. la citation de Stuart Mill dans le chapitre 2.3) à partir duquel s’interrompt l’accumulation. Si cette interprétation est exacte, ici, à la différence de Stuart Mill, ce n’est pas le taux de profit moyen qui est en cause mais le taux de profit marginal. La représentation générale n’est pas pour autant changée. L’autre manière, plus proche de Smith, d’interpréter cette définition serait de considérer que chaque baisse du taux de profit se traduit par une suraccumulation relative. Une telle conception reviendrait alors à postuler implicitement ce qu’on pourrait appeler un « taux de profit d’or », c’est-à-dire un taux de profit optimum, dont le niveau est inconnu et néanmoins postulé. Chaque éloignement, à la baisse, de ce « taux de profit d’or », chaque baisse du taux de profit induit une suraccumulation (relative)/dévalorisation. Dans cette interprétation nous n’avons plus à considérer qu’il existe un taux de profit minimum à partir duquel apparaît la suraccumulation relative. Comme les théoriciens du PCF ne peuvent (veulent) pas dire qu’à chaque baisse, il y a suraccumulation, ils élaborent des définitions ambiguës de celle-ci[58]. Les théoriciens staliniens sont conduits à la fois à une théorie des crises permanentes (et à le dire officiellement) et, en même temps, pour articuler leur discours avec la théorie de Marx qui nie explicitement l’existence de crises permanentes, à limiter la portée de leurs analyses.
La suraccumulation relative, telle que nous pouvons la concevoir, peut être définie comme une baisse relative, et non plus absolue, de la plus-value par rapport au capital avancé. Ce phénomène intervient dès qu’une hausse de la composition organique n’est pas suffisamment compensée par une hausse du taux d’exploitation. Par conséquent, il y aurait selon cette définition une suraccumulation relative dès qu’une baisse du taux de profit intervient. Une telle représentation est évidemment absurde. Ce ne sont que les baisses brutales qui peuvent être concernées par cette forme de suraccumulation. Nous devons donc préciser la définition en y ajoutant une condition des plus importantes. Nous avons vu en effet qu’il ne s’agissait que des baisses du taux de profit qui correspondaient à un retournement brutal du progrès de la productivité du travail et que de ce fait la suraccumulation relative du capital, pour bien en voir toute la portée, doit être appréciée en introduisant la contradiction valorisation/dévalorisation qui, pour des raisons méthodologiques, n’est pas abordée par Marx dans le livre III du « Capital ».
Par conséquent, la suraccumulation, la surproduction de capital intervient, dès lors que nous prenons en compte le procès valorisation/dévalorisation, en cas de retournement brutal dans le progrès de la force productive du travail. Il s’ensuit une baisse soudaine, brusque du taux de profit qui conduit à l’arrêt du processus de production et de réalisation du produit social, à une crise de surproduction. Si le taux de profit marginal reste positif, la suraccumulation est relative ; si le taux de profit marginal est nul ou négatif, la suraccumulation est absolue.
2.8 Les diverses acceptions du terme dévalorisation chez Marx
Marx emploie le terme de dévalorisation dans des acceptions différentes. On peut en relever, notamment dans les manuscrits de 1857-1858 (Grundrisse), au moins sept :
2.8.1 Dévalorisation = conversion du capital argent en capital productif ou capital marchandise (sens 1)
Dans une première acception, Marx utilise le terme de dévalorisation dans le sens de conversion du capital argent en capital marchandise ou capital productif. Le capital quitte sa forme argent pour pendre la forme du capital marchandise. Dans ce sens, Il se dévalorise. On pourrait écrire dé-valorise pour rendre mieux compte de ce que Marx veut dire. En opposition, la valorisation correspond à la fois à l’accroissement du capital via la plus-value et à la réalisation du capital marchandise en capital argent.
« Le capital s'étant, par le procès de production, 1° valorisé, c'est-à-dire ayant créé une valeur nouvelle 2° dévalorisé, c'est-à-dire étant passé de la forme d'argent à celle d'une marchandise déterminée ; 3° se valorise lui-même, en même temps que sa valeur nouvelle, dans la mesure où le produit est relancé dans la circulation et échangé, en tant que M contre A. » (Marx, Manuscrits de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, T.1, p.386-387)
2.8.2 Dévalorisation = baisse de la valeur du capital sous l’effet de l’accroissement de la productivité (sens 2)
Une autre acception se rencontre plus fréquemment chez Marx. Le capital, valeur en procès, valeur qui cherche à se valoriser en s’accroissant d’une survaleur, d’une plus-value, se dévalorise par la même occasion dès lors que la production de plus-value repose sur la plus-value relative et le progrès de la productivité du travail. Nous avons donc une opposition dialectique entre valorisation et dévalorisation du capital. Pour se valoriser, pour s’accroître d’une survaleur, d’une plus-value, le capital doit se dévaloriser, perdre de sa valeur sous l’effet du développement de la productivité du travail, ce faisant la masse des marchandises enfle. Le but de la production capitaliste est de produire le maximum de plus-value, la forme spécifique du surtravail propre à la production capitaliste. Dès lors qu’existe le mode de production capitaliste moderne, celui qui repose sur la subordination réelle du travail au capital (révolution industrielle), une nouvelle méthode d’extraction de la plus-value, la production de plus-value relative, se met en place via le développement de la productivité du travail. Cette augmentation de la productivité du travail, dès lors qu’elle concerne directement ou indirectement des éléments matériels qui déterminent la valeur de la force de travail, permet d’abaisser cette valeur et, toutes choses égales par ailleurs, d’accroître la plus-value. Le capital se valorise mais la valeur des marchandises baisse, y compris la force de travail, et donc le capital se dévalorise. Et plus le capital est dévalorisé, plus la productivité doit augmenter pour obtenir une même masse de plus-value additionnelle. C’est cette contradiction fondamentale que Marx écarte de son analyse de la suraccumulation absolue, pour lui substituer une hausse des salaires.
« L’augmentation de la force productive (qui, par ailleurs, (…) va toujours de pair avec une dépréciation du capital existant) ne peut directement accroître la grandeur de la valeur du capital que si, en élevant le taux de profit, elle augmente l’élément de valeur du produit annuel qui est reconverti en capital. S’il s’agit de la force productive du travail, ce résultat ne peut se produire (…) qu’autant qu’elle entraîne une élévation de la plus-value relative ou encore une réduction de la valeur du capital constant, donc que si les marchandises entrant, soit dans la reproduction de la force de travail, soit dans les éléments du capital constant, sont produites à meilleur marché. Or, ces deux conséquences impliquent une dévalorisation du capital existant et vont de pair avec la réduction du capital variable par rapport au capital constant. Toutes deux entraînent la baisse du taux de profit et toutes deux la ralentissent. » (Marx, Capital, LIII, Editions du progrès, p.264)
Le capital, à travers ce type de dévalorisation, est détruit en permanence (à chaque accroissement de la productivité sociale). Une des caractéristiques de la crise de suraccumulation, c’est que ce phénomène de dévalorisation s’enraye, se retourne. Il faut donc substituer à cette forme de dévalorisation, d’autres formes (désaccumulation, destruction, dépréciation), tandis que le recouvrement d’une base productive plus forte permet à nouveau à ce processus de s’exprimer et donc de faciliter le rétablissement du rapport d’exploitation (cf. le chapitre sur la dévalorisation au sens 7).
2.8.3 Dévalorisation = absence de valorisation du capital du fait de la fixation du capital dans les diverses phases de son procès (sens 3)
Le capital aimerait changer de référentiel dans l'espace temps de façon à ce que la valorisation soit instantanée. Le capital porteur d’intérêt, la captation de plus-value dans la spéculation lui en donnent l’illusion. Mais il est prisonnier de multiples déterminations qui entravent son cycle et dont il cherche à s'affranchir. Dès lors qu'il est improductif (au sens où il ne se valorise pas, au sens où il n’est pas dans la sphère de la production sous forme de moyens de production et de force de travail), qu'il ne se valorise pas, qu'il se fixe et il doit nécessairement être pour une part fixé, immobilisé, Marx considère qu'il se dévalorise. D’ailleurs, même quand il est dans une phase productive, de valorisation, une phase où il se valorise, cette valorisation n'est jamais assez rapide.
« De même que, en tant que semence, placé en terre, le grain perd sa valeur d'usage immédiate, est dévalorisé en tant que valeur d'usage immédiate, de même le capital est dévalorisé à partir de l'achèvement du procès de production jusqu'à sa retransformation en argent et, de là, de nouveau en capital. » (Marx, Manuscrits de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, T.2, p.12).
La même idée, beaucoup plus développée, est exprimée plus loin. Marx oppose :
1° le capital sous sa dimension de capital circulant[59], c’est-à-dire ici dans le sens de : mobile, fluide, de passage d’une forme à l’autre, d’une phase à l’autre, en se valorisant, c’est-à-dire en s’accroissant d’une plus-value, d’une survaleur ;
2° le capital sous sa dimension de capital fixé, c’est-à-dire dans le sens de : immobile, de prisonnier d’une forme, d’une détermination, d’une phase de son procès.
Il ne s’agit pas de deux espèces de capital mais de deux déterminations formelles du même capital.
« Aussi longtemps qu’il persiste dans une de ces phases – que cette phase n’apparaît pas elle-même comme un passage fluide –, et chacune de ces phases a sa durée propre, il n’est pas circulant, il est fixé. Aussi longtemps qu’il persiste dans le procès de production, il est incapable de circuler, et virtuellement dévalorisé. Aussi longtemps qu’il persiste dans la circulation, il est incapable de produire, il ne pose pas de survaleur, il n’est pas dans son procès de capital. Aussi longtemps qu’il ne peut pas être lancé sur le marché, il est fixé en tant que produit ; aussi longtemps qu’il doit rester sur le marché, il est fixé en tant que marchandise. Aussi longtemps qu’il ne peut s’échanger contre des conditions de production, il est fixé en tant qu’argent. Enfin, si les conditions de production restent sous cette forme de condition et n’entrent pas dans le procès de production, il est de nouveau fixé et dévalorisé. Le capital, comme sujet qui traverse toutes ces phases, comme unité en mouvement, unité en procès de la circulation et de la production, est du capital circulant ; le capital reclus dans chacune de ces phases et posé dans ses différences, est du capital fixé, du capital engagé. En tant que capital circulant, il se fixe, en tant que capital fixé, il circule. La distinction entre capital circulant et capital fixe apparaît ainsi d’abord comme la détermination formelle du capital, selon qu’il apparaît comme unité du procès ou comme moment déterminé de celui-ci. » (Marx, Manuscrits de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, T.2, p.111-112)
L’explicitation du concept de dévalorisation dans ce contexte n’est pas simple. Ce d’autant plus que, dans ces passages, Marx passe facilement d’un sens à l’autre. Plusieurs sens y sont mêlés. Ici, nous comprenons que le capital cherche à parcourir son circuit le plus rapidement possible, se valoriser d’un maximum de plus-value et recommencer. Dès lors qu’il se fixe dans une partie du processus de production, cette fixation apparaît comme une dévalorisation, un frein, un obstacle, une entrave à la valorisation. Le capital n’a de cesse de réduire de tels obstacles. Par exemple, on cherche à réduire la période de circulation[60], les stocks, la période de production, le capital-argent qui reste toujours sous forme argent, à augmenter la durée d’utilisation du capital fixe, … tandis que le capital bénéficie de la présence d’une armée de réserve dans laquelle il peut puiser rapidement la force de travail dont il a besoin avant de l’y rejeter dès lors qu’elle lui est inutile. Dans son idéalité, le capital est totalement circulant, fluide, il se valorise alors au maximum[61]. Dans la situation inverse, aboutissement de la période précédente, lors de la crise générale de surproduction, il est totalement fixé[62]. Dans sa réalité, dans ses périodes intermédiaires où il tend vers l’un ou l’autre pôle faits de renversements brutaux, il est toujours à la fois circulant et fixé[63] dans des proportions variables qui expliquent les variations de la conjoncture, qui vont d’une activité ralentie à la tension exacerbée des forces productives, de la reprise lente à l’expansion fiévreuse, de la stagnation à la surproduction générale[64]
En d’autres termes, tout le capital avancé ne se valorise pas. Pour qu’une partie se valorise, une partie doit rester improductive, fixée, dévalorisée. La proportion de l’une et de l’autre varient suivant les phases de la conjoncture et la tendance du capital est de réduire au minimum la part du capital fixé mais celle-ci renaît à une échelle d’autant plus grande avec les crises.
Il y a, à nouveau, une relation dialectique entre valorisation et dévalorisation mais ici l’opposition prend le sens de valorisation et non valorisation, obtention de profit et absence de profit, fluidité et fixité, activité et oisiveté, fructification et mise en friche.
Du point de vue du taux de profit, cela signifie que la plus-value se rapporte à un capital avancé qui inclut ce capital qui reste fixé, latent, en friche, improductif, dormant. Le taux de profit en est diminué d’autant et dès lors que le capital réduit cette partie du capital avancé, le taux de profit s’accroît. C’est ce qui se passe dans les phases du cycle où la conjoncture est favorable aux affaires. Le phénomène inverse se produit avec la crise générale.
2.8.4 Dévalorisation = effet des dépenses improductives (sens 4)
En relation avec le processus examiné ci-dessus, Marx introduit une nouvelle nuance dans le concept de dévalorisation. Quand le capital est fixé dans la phase de circulation, il ne se valorise pas et donc dans ce sens se dévalorise, c’est ce sens que nous avons jusqu’à présent examiné. Mais dès lors que des dépenses supplémentaires se font jour pour faire circuler ce capital pour contribuer à sa réalisation, elles affectent la plus-value effective qui sera transformée en profit.
« (…) quand je convertis la marchandise sous forme d’argent ou l’argent sous forme de marchandise, la valeur reste la même ; mais la forme est changée. Il est donc clair que la circulation – du fait qu’elle se résout en une série d’opérations d’échange entre équivalents – ne peut augmenter la valeur des marchandises en circulation. Si donc du temps de travail est requis pour mener à bien cette opération, c’est-à-dire que des valeurs doivent être consommées – puisque toute consommation de valeur se résout en consommation de temps de travail ou de temps de travail objectivé, de produits ; si la circulation entraîne donc des frais et que le temps de circulation coûte du temps de travail, cela représente un prélèvement, une abolition relative des valeurs en circulation ; une dévalorisation de ces dernières à proportion des coûts de circulation. » (Marx, Manuscrits de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, T.2, p.123-124)
Par conséquent ici, dévalorisation prend le sens de diminution de la plus-value effectivement transformée en profit du fait des dépenses improductives dans le processus de circulation. Nous verrons dans un autre ouvrage qui sera notamment consacrée à l’incidence de ce type de capital sur le taux de profit que nous aboutissons ainsi à dégager un concept de taux de profit que appelons « taux de profit de reproduction » qui rapporte la plus-value diminuée des dépenses improductives au capital avancé augmenté des dépenses improductives (qui se présentent également comme du capital avancé) selon une formule déjà établie par Joseph Gillman en 1957.
2.8.5 Dévalorisation = désaccumulation (sens 5)
Nous avons déjà vu que par dévalorisation, Marx pouvait entendre la fixation du capital. Le capital s’immobilise brusquement dans les crises et le capital inemployé (sa présence est permanente, bien qu’il se réduise à rien dans les phases d’extrême tension des forces productives) s’étend rapidement.
Tournons-nous vers ce chapitre du livre III du « Capital » où est abordée la suraccumulation et la crise, ainsi que ses effets qui sont autant de conditions permettant de rétablir la situation afin que le capital reprenne sa course à la valorisation.
Nous pouvons relier les concepts de « capital fixé », « capital dormant », « capital en friche »[65] des manuscrits de 1857-1858, tels que nous les avons analysés plus haut avec ceux de « capital inoccupé », « capital oisif », de « mise en sommeil »[66] ou « mise en friche » ou « en jachère » du capital, du livre III[67], tandis que celui de capital circulant, fluide est à mettre en relation avec le « capital actif ».
Comme nous l’avons vu, avec la crise le capital se fige dans les diverses phases de son procès et sous ses différentes formes. Avec la crise ce phénomène est généralisé, l’ensemble du capital se fixe, se fige et est incapable de se valoriser. Ce n’est plus seulement une partie du capital, partie nécessaire pour que la valorisation puisse se faire et que le capital cherche à réduire à son minimum, qui se fixe, mais l’ensemble du capital. Sous l’effet de la scission entre la vente et l’achat, des difficultés rencontrées dans la réalisation de la plus-value et du produit social, et dans la conversion du capital-argent dans les éléments du capital productif[68] le capital est paralysé dans les diverses phases de son procès et sous ses différentes formes.
La classe capitaliste a le monopole des moyens de production, de l’argent, des moyens de consommation. Comme les conditions de la production et celles de la réalisation ne sont pas identiques, c’est la concurrence qui décide de qui va être touché, et dans quelle proportion, par les effets de la baisse du taux de profit et de la crise qui l’accompagne.
La mise en friche, en jachère relève donc de la fixation du capital, de son passage de capital actif au rang de capital fixé, figé. S’il est toujours pour une part dans ce rapport, la détérioration de celui-ci au profit du capital fixé, conduit également à une nouvelle baisse du taux de profit car le capital ne se met plus en valeur, il cesse de se valoriser. Nous entrons donc dans la spirale négative de la crise de surproduction[69]. Dans l’hypothèse la plus favorable, le montant du capital qui se fige est égal au montant du capital qui doit disparaître pour rétablir les conditions d’une exploitation « normale » de la force de travail. Mais, rien n’est réglé quand on est dans cette situation. Le capital est immobilisé, fixé. Dans ce sens, il est dévalorisé au sens 3, au sens de sa non valorisation, de son improductivité comme capital. Pour qu’il reprenne sa course à la valorisation, à la recherche d’un maximum de plus-value, le capital doit sortir de son inaction. Avec la crise, le capital figé s’accroît et donc la dévalorisation de ce type se traduit par une aggravation de la crise. Au mieux, elle en signifie l’effectuation, son accomplissement. La crise en acte, c’est justement la généralisation du passage de l’état actif à l’état fixé.
En même temps, elle en constitue un élément de solution pour autant que la masse du profit puisse en compenser la baisse du taux. En effet, si une partie seulement du capital est fixée tandis que l’autre continue à se valoriser, le taux de profit baisse mais le profit restant peut être suffisant pour absorber le choc lié à la partie du capital qui devient inactif. Cette dimension existe pour les grands capitaux. Mais, pour rétablir pleinement les conditions favorables à la reprise de l’accumulation, à la sortie de la torpeur qui saisit le capital, à la renaissance du capital actif à la poursuite du maximum de plus-value, il faut qu’il y ait une destruction du capital[70].
La crise, nous devons le répéter, n’affecte pas seulement une partie du produit social, notamment la plus-value ou une partie de celle-ci. C’est l’ensemble du produit social qui tend à ne pas se réaliser, à ne pas passer de la forme marchandise à la forme argent. Par la même occasion, le capital argent ne se convertit pas dans les éléments du capital productif. Dit autrement, le capital actif se fige, se fixe et s’immobilise dans ses diverses phases et formes et cesse de se réaliser et de se valoriser. La crise est générale.
Mais cette analyse se situe à un niveau conceptuel particulier. Nous en sommes au niveau conceptuel du capital total. Si le concept tend vers la réalité et la réalité tend vers le concept, il ne faut pas pour autant s’imaginer que dans les crises toute l’activité est paralysée.
Dans le livre III du « Capital », Marx se situe au niveau des « capitaux nombreux » et mesure l’influence de la crise sur ceux-ci. Le capital se déploie dans des entreprises. Les plus grandes concentrent une grande part du capital social tandis que les plus petites pullulent. Ces entreprises elles-mêmes tendent à s’inscrire dans des métiers, des branches de production, des secteurs spécifiques et, sur une autre plan, peuvent faire partie de groupes. Par conséquent, il y a une répartition variable du capital dans un ensemble d’entreprises elles-mêmes engagées dans des activités diverses. Elles ne sont pas égales devant la crise, compte tenu du capital dont elles disposent, de l’activité qu’elles mènent et aussi de leur ancienneté sur le marché. En permanence, même quand les affaires sont « saines », des entreprises disparaissent que ce soit du fait de la cessation d’activité de leur propriétaire, retraite par exemple, ou parce qu’ils se retirent sur la pointe des pieds parce que leur activité n’est pas viable quand ils ne doivent pas la quitter plus brutalement (faillites), alors que d’autres se créent. Avec, la cessation d’activité une partie du capital se convertit en revenu, tandis qu’avec la création d’une entreprise une partie du revenu et autres « valeurs dormantes »[71] se convertissent en capital (nous faisons ici abstraction de l’influence de l’accumulation de la plus-value, du détachement de nouvelles boutures à partir d’anciens capitaux et du crédit). Dans les crises, la création d’entreprise est freinée ; elle se replie tandis que les disparitions s’accroissent. Mais, les pertes peuvent également se manifester sans pour autant faire disparaître l’entreprise. Le capital de l’entreprise diminue ; elle licencie, elle reconvertit et rationalise ses activités en espérant une reprise de l’accumulation.
Marx montre donc que c’est (cas de la surproduction de capital) l’insuffisance de plus-value en regard du capital avancé, la baisse brutale du taux de profit qui conduit à la scission entre la vente et l’achat et donc à la manifestation de la crise. Lorsque cet arrêt se traduit par une réduction du capital avancé que ce soit du fait de pertes, de l’accroissement des faillites et des cessations d’activité tandis que le renouvellement du capital est freiné, il se met en place une nouvelle base productive permettant le redressement du degré d’exploitation et du taux de profit.
Le phénomène de la fixation du capital, de la limitation de la valorisation (et dans ce sens de dévalorisation au sens d’improductivité du capital - cf. ci-dessus -), induit une destruction du capital, qui est un nouveau sens du terme dévalorisation. Il s’agit alors d’une destruction de capital, du fait de pertes, et donc d’une désaccumulation, d’une décapitalisation. La base du capital se replie pour rétablir les conditions d’une reprise de l’exploitation. Elle dispose désormais d’un potentiel productif plus puissant. Les branches mortes sont élaguées et les jeunes pousses, bien que relativement moins nombreuses, prennent pour une part leur place.
Quand on se place du point de vue du capital total, nous constatons que le capital reste en friche, en jachère, en sommeil, fixé dans une des phases (production et circulation) de son circuit, que ce soit sous forme argent, sous forme de capital productif ou sous forme de capital marchandise. Le capital est paralysé, immobilisé et hormis le temps, rien ne vient le perturber. Le capital est en attente d’un nouveau départ que peut donner la dévalorisation/dépréciation brutale (encore un nouveau sens de dévalorisation que nous examinerons plus bas).
L’analyse s’affine dès lors qu’on introduit la décomposition du capital en capitaux nombreux. Pour les capitaux où la masse du profit ne peut compenser la baisse de son taux, pour ceux qui ont une activité trop réduite pour continuer à exister, pour ceux dont les pertes menacent l’existence[72] c’est la voie de la sortie, et donc de la désaccumulation, de la décapitalisation sans issue, qui est indiquée.
Un nouveau couple valorisation/dévalorisation peut être formé comme synonyme de accumulation/désaccumulation - décapitalisation. Le capital se replie sur une base productive plus réduite mais plus productive. C’est cette situation que vise Marx dans cette partie de la citation que nous reproduisons intégralement plus bas. « L’autre côté de la crise se résout en une diminution effective de la production, du travail vivant – pour reconstituer le rapport exact entre travail nécessaire et surtravail qui est, en dernier ressort, à la base de tout. » (Marx, Manuscrits de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, T.1, p.386)
2.8.6 Dévalorisation = destruction des valeurs d’usage (sens 6)
Si, pour des raisons analytiques, nous séparons certains aspects pour mieux en faire ressortir les spécificités, ils restent unis dans la réalité des crises.
La fixation, paralysie, mise en friche, mise en sommeil du capital engendrent une destruction de capital. Sous ce terme, Marx regroupe des phénomènes[73] comme la :
dévalorisation /désaccumulation
dévalorisation /destruction des valeurs d’usage
dévalorisation /dépréciation générale (dernier cas que nous verrons ensuite)
Dans le chapitre précédent nous avons traité la question de la dévalorisation / désaccumulation. Dans ce chapitre nous prenons en compte le point suivant que nous isolons ici avec le sous-titre dévalorisation = destruction des valeurs d’usage,
Dès lors que le capital se fixe, s’immobile, tombe en sommeil, le capital sous sa dimension de valeur d’usage peut s’abîmer du fait de son inutilisation. Le temps joue un rôle négatif. Les stocks s’abîment. Les machines inemployées, les bâtiments désaffectés connaissent le même sort. Un proverbe allemand illustre bien ce cas (wer rastet, der rostet, ce qui s’arrête se rouille)[74] où la valeur d’échange part en fumée avec la perte de la valeur d’usage. A ces valeurs d’usage achevées qui se détériorent, on doit ajouter celles qui ne verront pas le jour alors qu’elles ont fait l’objet d’avances de capitaux (chantiers de construction abandonnés par exemple).
2.8.7 Dévalorisation = dépréciation générale du capital (sens 7)
Dans ce dernier sens dévalorisation signifie dépréciation générale, baisse brutale et ruineuse des prix au moment de la crise afin de rétablir l’équilibre du capital en favorisant sa destruction. Il s’agit de la forme la plus aiguë de la crise, ce que l’économie politique bourgeoise range avec crainte sous le terme de déflation. Les prix ont, dans ce cas, un mouvement inverse de celui de la valeur laquelle tend à augmenter car la productivité du travail s’est retournée ; ils baissent brutalement.
On peut considérer que dans ce sens, le terme de dévalorisation est également classique car cette dévalorisation par la dépréciation générale vient se substituer à la dévalorisation au sens 2 (dévalorisation = baisse de la valeur sous l’effet de l’accroissement de la productivité), dont le défaut a engendré la crise. A la baisse de la valeur sous l’effet du développement de la productivité du travail, corollaire d’un accroissement de la plus-value se substitue, alors que le taux de la plus-value se retourne, une dévalorisation par l’intermédiaire d’une baisse générale des prix. Outre le capital réel, le capital fictif[75], qui a par ailleurs un mouvement autonome, est également concerné par cette dévalorisation[76].
Dans ce cas, Marx a sans doute hésité à employer le terme « dépréciation » plutôt que celui de « dévalorisation ». Mais comme le terme de dépréciation peut être relatif, c’est-à-dire ne concerner qu’une marchandise, ou une entreprise, il préfère parler de dévalorisation d’une part pour en élargir la portée et d’autre part, pour bien montrer que ce processus rétablit l’équilibre brisé par l’arrêt de la dévalorisation au sens 2[77]. Dans ce sens, donc, la dévalorisation signifie une dépréciation générale du capital[78], dépréciation générale, destruction de capital, qui a pour objectif de ramener par la violence la valeur à un niveau ou le rapport entre plus-value et travail nécessaire permet une reprise de la valorisation.
Si, du point de vue du capital total, il s’agit d’une dévalorisation qui affecte l’ensemble du capital dès lors que nous situons l’analyse au niveau de la concurrence et des « capitaux nombreux », ce qui est un des objectifs[79] inachevés de l’oeuvre de Marx, les différents capitalistes ne sont pas égaux devant cette dévalorisation[80].
2.9 Marx, la crise de suraccumulation et la dévalorisation du capital
2.9.1 Changement de décor
Comme nous l’avons dit, Marx se sert d’un cadre historique particulier, historiquement dépassé, pour illustrer la suraccumulation, la surproduction de capital. En revanche, les considérations auxquelles il se livre sur les conditions du rétablissement d’une situation « saine », d’une pleine reprise de l’accumulation, sont propres au capitalisme moderne, aux crises de surproduction inhérentes à la production capitaliste la plus développée.
Dans un schéma idéel, conceptuel, nous avons, lors de la crise générale, une immobilisation totale du capital. Il est figé dans les diverses formes de son procès, sous forme argent, de moyens de production, de marchandises, dans le procès de production ou de circulation. Le capital ne se convertit pas dans les éléments du capital productif, les marchandises, par la même occasion, ne se réalisent pas. Dès lors que le capital ne fructifie pas, il est fixé, immobilisé. Avec la crise, quand on parle de capital fixé, il ne s’agit pas tant de ce capital fixé qui nécessairement existe en relation avec le capital actif (par exemple, dès lors que le capital entre dans le processus de circulation ou quand capital continue à figurer sous la forme de capital argent pour faire face aux fluctuations de l’activité) que de constater que tout le capital devient fixé. Nous avons affaire ici à un arrêt soudain de l’accumulation. Avec la crise, quand la plus-value est insuffisante par rapport aux conditions attendues du niveau d’exploitation, il se produit une scission entre la vente et l’achat, le capital ne se réalise plus tandis que l’argent ne se convertit plus dans les éléments du capital productif. Le capital s’immobilise subitement.
En théorie, dans la dimension abstraite de l’analyse de la crise, c’est l’ensemble du capital social qui peut être paralysé. Dans la réalité, dès lors que nous nous plaçons non plus au niveau du capital total mais des capitaux nombreux, l’immobilisation, l’oisiveté, la mise en sommeil, la mise en friche, la mise en jachère du capital sont autant de solutions pour rétablir les conditions d’une reprise de l’accumulation en rétablissant voire améliorant les conditions d’exploitation qui prévalaient antérieurement. Elles sont à la fois le symptôme de la crise et l’ébauche de la solution pour rétablir l’équilibre troublé. Ici, on ne s’encombre pas avec le droit du travail et les modalités de licenciement. Dès que la crise éclate, brutalement, soudainement et que tout le capital se fige, la force de travail n’est plus salariée et rejoint l’armée de réserve industrielle qui se gonfle d’autant.
Ce schéma théorique ne se présente jamais ainsi dans la réalité. La crise se développe en spirale et s’étend aux divers secteurs à partir de la sphère où elle a éclaté. Si l’ensemble du capital est affecté, ce n’est pas, en pratique, la totalité du capital qui s’arrête. Au niveau du capital individuel, au niveau des « capitaux nombreux », certaines entreprises peuvent même se développer tandis que de nouvelles se créent et prennent pied.
Pour avoir une idée plus circonstanciée de la crise, il est nécessaire de quitter le niveau d’abstraction du capital total pour examiner, analyser le capital dans ses diversités et ses dynamiques. Ces dimensions particulières de la crise, n’étant pas dans le plan du « Capital », Marx ne les traite que de manière incidente renvoyant à un autre ouvrage les questions propres à ces aspects de la crise.
Si le capital s’est immobilisé, fixé, figé et mis en sommeil, en jachère, cela signifie aussi que la scission entre la vente et l’achat s’est manifestée et que la mévente s’est installée. Par conséquent, lorsque la suraccumulation intervient, à un moment du cycle, à la suite d’une accumulation de la plus-value, cela ne doit pas nous faire comprendre que la suraccumulation ne touche que cette partie du capital. C’est l’ensemble du rapport capitaliste qui est ébranlé, l’ensemble du capital social. Il va de soi que dans le cadre de la division du produit social en capital constant, capital variable et plus-value, dès lors qu’une partie de ce capital social seulement peut être réalisée, on commence par imputer ce capital réalisé au capital avancé et donc la plus-value est la première concernée par la crise. Elle n’en constitue pas pour autant la limite. Il ne s’agit donc pas dans la suraccumulation d’un excès d’accumulation de la plus-value mais d’une surproduction au niveau du capital total qui résulte d’une insuffisance de la plus-value produite.
La suraccumulation absolue se caractérise notamment par le fait que le taux de profit marginal est au minimum nul, voire négatif. Ce dernier cas signifie que le capital avancé marginal est pour une part perdu, ce qui affecte au niveau du capital total, le reste de la plus-value.
Pour récapituler toutes les expressions plus ou moins synonymes employées par Marx et que nous avons répétées plus qu’à satiété, nous constatons que quand le capital se fige, se fixe, s’immobilise, est inactif, ne fructifie pas, il reste en friche, il entre en sommeil : c’est la crise de surproduction. Le capital ne se valorise pas. Dans ce sens, il se dévalorise (cf. dévalorisation au sens 3). Mais, cet arrêt, ce blocage soudain, est caractéristique de la crise de surproduction. Elle laisse l’argent immobilisé entre les mains des capitalistes industriels ou commerciaux et des banquiers, les moyens de production inutilisés, les marchandises invendues, et la force de travail sur le pavé.
Pour que l’accumulation reprenne plusieurs facteurs vont intervenir.
Marx fixe le montant du capital à dévaloriser de telle manière que le taux de profit et le rapport d’exploitation qui prévalaient soient rétablis.
Dans son modèle pédagogique, nous l’avons vu, la baisse du taux de profit et la suraccumulation qui la suit est le produit de la hausse du salaire. Par conséquent, si nous en restions à ce schéma, pour rétablir le rapport d’exploitation il faudrait abaisser le salaire. Le fait de licencier la force de travail doit exercer une pression à la baisse sur les salaires et favoriser le rétablissement des rapports d’exploitation antérieurs. Marx évoque bien ce phénomène de balancier dans le livre I, quand il traite du cadre qui sert à la formalisation de la suraccumulation absolue. Il n’oublie pas, bien sûr, de prendre en compte cet aspect dans l’analyse des facteurs qui vont permettre la reprise des affaires. Il les analyse cependant comme un facteur complémentaire[81], un facteur qui épaule « la mise en sommeil et la destruction de capitaux », ce qui montre qu’il traite bien ici des crises de surproduction propres au mode de production capitaliste le plus développé, celui où le capital se subordonne réellement le travail.
Nous avons donc bien dans la présentation de Marx, deux dimensions. Pour faire naître la crise, il met en place une hausse des salaires qui affecte brutalement la production de plus-value et le taux de profit. Une suraccumulation, une surproduction de capital en est le corollaire. Le cadre théorique est historiquement dépassé mais suffisamment simple pour expliciter son propos. Dès lors que nous nous tournons vers les suites de la crise et le procès de recouvrement de l’accumulation, le cadre est changé. Marx ne met plus au premier plan la question des salaires mais celle de la dévalorisation brutale du capital.
Il est également à noter que Marx traite le capital avancé comme un seul bloc sans se soucier particulièrement de la décomposition du capital en capital constant et capital variable. Il faut voir là une nouvelle preuve que nous sommes dans un modèle pédagogique, un cadre théorique simplifié afin de faciliter la compréhension et la démonstration.
Dans la logique qu'il a développée les salaires ont augmenté. Pour rétablir le rapport d'exploitation, il faudrait les abaisser. Ce peut être obtenu dès lors que les licenciements font pression sur les salaires. Mais ce n'est pas tant le propos. En raisonnant, à ce moment, sur le capital total, Marx minore cet aspect du sujet qui effectivement n'a qu’une importance relative dans le cadre des crises de surproduction modernes. Celles-ci intègrent et résultent du procès valorisation dévalorisation, du progrès contradictoire de la productivité du travail et exigent diverses formes de dévalorisation brutale du capital.
2.9.2 La dévalorisation/désaccumulation
Marx parle également lorsqu’il s’agit de rétablir les rapports d’exploitation favorables à la sortie de la crise, de « mise en sommeil et même une destruction partielle de capital »[82]. Du point de vue du capital total, la mise en sommeil est donc à la fois l’expression de la crise et une des modalités du rétablissement de l’activité. Marx envisage les crises, comme l’ensemble des contradictions, sous un aspect dialectique[83]. La crise est à la fois la création d’un déséquilibre par la séparation violente de l’unité que constituent les diverses phases que parcourt le capital et le rétablissement violent de cette unité qui a été troublée.
Le montant du capital mis en sommeil est a priori égal au montant qui doit être dévalorisé pour restaurer le rapport d’exploitation qui permet la reprise de l’accumulation. Le capital mis en sommeil est l’expression de la crise ; la crise se manifeste par la fixation, l’immobilisation du capital. En même temps, à travers la crise, à travers la mise en friche, en jachère du capital, s’effectue le rétablissement violent d’une unité perdue.
Pour les grands capitaux, la masse des profits peut compenser la baisse du taux[84] ; le taux du profit baisse mais la masse du profit est telle qu’elle peut compenser la baisse du taux[85]. Mais dans ce cas, cela signifie que le capital a réalisé l’ensemble du capital marchandise produit. Il encaisse la baisse du taux de profit, parce que toute la valeur capital est réalisée. Il n’y a donc pas ici de mise en sommeil, d’immobilisation du capital. Si celle-ci intervient, cela signifie, par la même occasion, mévente. Une partie du capital se fige et donc ne rapporte plus de profit. De plus, sa reproduction en tant que capital ne s’accomplit pas. Par exemple, des moyens de production inemployés voient leur valeur se perdre. Du point de vue comptable, leur valeur est amortie au même titre que les moyens de production utilisés. Les locaux restent, dans une certaine mesure et pendant un certain temps, identiques qu’ils abritent tant ou tant et plus de salariés. Il en va de même pour les entrepôts ou même pour des bâtiments désaffectés tant qu’ils font partie du capital avancé. Si les salariés sont en sous activité mais ne sont pas licenciés, leur salaire pour la partie inactive se transforme en autant de prélèvement sur le profit réalisé par la partie active. Tous ces facteurs pèsent sur le profit total effectif. Pour ces entreprises, le capital mis en sommeil participe au dénominateur du taux de profit. Pour une part variable, compte tenu notamment de l’importance du capital fixe, il vient aussi en déduction du profit réalisé. Le taux de profit en est affecté d’autant. Suivant leur taille, la masse de leurs fonds propres, leur situation sur le marché, les entreprises vont avoir des résultats différents.
Pour les plus solides parmi les entreprises, les foyers de perte sont compensés et au-delà par les secteurs qui dégagent des profits. Le taux de profit baisse mais reste positif. Pour d’autres, la baisse peut se traduire par une perte[86], mais elles ont suffisamment d’assise pour réagir et s’adapter à la situation ouverte par la crise. Pour d’autres entreprises encore, la crise va précipiter leur fin, soit par un arrêt prématuré de leur activité soit du fait d’une accélération des faillites[87].
Enfin d’un autre côté, la création d’entreprise est freinée tandis que les cessations d’activité croissent. Les nouveaux entrants sont moins nombreux. Par conséquent moins de revenu, moins de « valeurs dormantes », se convertissent en capital. De même moins de plus-value, que ce soit via le crédit ou l’accumulation dans les jeunes pousses et les rejetons de capitaux anciens, s’accumule dans ces nouveaux champs. Le rapport entre capital actif et capital fixé est plus défavorable qu'auparavant. La rentabilité du jeune capital diminue et les masses de capitaux engagées également[88]. En même temps, dans la mesure où ce jeune capital prend pied, il concurrence l’ancien et favorise l’inaction ou la sortie d’une fraction de ce dernier.
Le capital immobilisé, mis en sommeil, mis en friche, ne crée pas les marchandises qui permettent au capital non seulement de se valoriser, d’obtenir un profit, mais également de se reproduire en tant que capital avancé. Par voie de conséquence, les valeurs d’usage utiles à cette double fonction ne sont pas créées, la valeur est perdue et vient en déduction de la plus-value et du capital existants. Les entreprises dont les pertes ont été compensées par les profits ou dont les pertes ont été limitées et momentanées, ou encore celles qui ont une certaine assise pour assumer les pertes[89], conservent cependant leur base productive dans la perspective de reconquérir leur place sur le marché (c’est d’ailleurs un des critères qui a pu guider leur politique en face de la crise qui les touche[90]).
C’est cet aspect de la mise en sommeil que nous avons appelé dévalorisation/désaccumulation. Pour une part, le capital a réduit son assise et encaissé la baisse du taux de profit. En même temps, cette assise s’est affermie.
2.9.3 La dévalorisation/destruction
Comme nous l’avons vu lors de l’analyse des diverses acceptions du terme dévalorisation, les effets de l’immobilisation du capital induisent aussi la destruction de valeurs d’usage. Le capital existant non seulement ne se reproduit pas mais ici, il disparaît du fait de la détérioration des valeurs d’usage (marchandises périssables, marchandises obsolètes, bâtiments inachevés abandonnés, capital fixe mis au rencart, …). La valeur d’échange est perdue avec la destruction de la valeur d’usage. Le capital est dévalorisé d’autant. Ici aussi cette destruction réduit son assise. Des supports matériels de la valorisation sont détruits ou abandonnés inachevés.
2.9.4 La dévalorisation/dépréciation
Marx met aussi en évidence que la forme principale et également la plus aiguë de la dévalorisation est ce que nous appelons la dévalorisation/dépréciation. Sous diverses formes intervient une baisse des prix, une baisse ruineuse des prix qui frappe le « capital en tant qu’il possède le caractère de valeurs, donc la valeur des capitaux ». La dévalorisation/dépréciation générale se traduit par une baisse du niveau général des prix afin de compenser le mouvement inverse de la valeur du fait de la détérioration du rapport d’exploitation et de la diminution relative ou absolue de la plus-value.
Nous avons vu que l’exacerbation de la concurrence engendrée par la baisse subite du taux de profit et le marasme des affaires qui s’ensuit, poussait les capitalistes à baisser les prix afin de limiter les pertes en sauvant le capital quitte à abandonner tout ou partie de la plus-value, empêcher de nouveaux concurrents de prendre pied, ruiner les anciens. C’est la scission entre la vente et l’achat qui permet à la crise de se manifester. C’est donc dans la sphère financière et commerciale qu’elle prend son origine, là où l’argent est mis à disposition des capitalistes industriels[91]. Cette baisse intervient d’abord dans les relations entre capitalistes et entre capitalistes industriels et commerçants, au niveau des prix de gros.
On mesure aussi tout l’intérêt politique qu’il peut y avoir de désigner le « capital financier » comme bouc émissaire de la crise. Alors, la critique ne porte que sur les dimensions parasitaires du capital et non plus sur le cœur même de la production capitaliste : la production d’un maximum de plus-value. L’exploitation du prolétariat est évacuée. Non seulement cet aspect, qui est au fondement de la production capitaliste n’est pas critiqué, mais il est même défendu contre le « capital financier », le « capital fictif » supposés gaspiller et détourner les capitaux de l’accumulation dans la sphère productive de plus-value. Par conséquent, au « mauvais capital » : le capital fictif, le capital financier on oppose le « bon capital » : le capital producteur de plus-value, qu’il s’agit de développer, d’augmenter, de rationaliser, bref on l’engage à poursuivre plus avant et plus rapidement la production de la plus-value relative, gage de l’existence et de la prospérité des classes moyennes tenantes du socialisme petit-bourgeois. Cette classe d’économistes s’imagine que l’on peut séparer le bon gain de l’ivraie, que des banques puissent être nécessaires pour autre chose[92] que pour assurer la transition vers une économie non mercantile[93].
La pensée réifiée prend volontiers une des formes de la plus-value pour la plus-value elle-même, ce qui lui permet d’hypostasier cette forme pour mieux masquer le processus d’ensemble. La rhétorique pour tourner autour du pot est toujours la même. Alors que le but de la production capitaliste, l’être même du capital, est de produire un maximum de plus-value. Pour la pensée vulgaire, ce sont des agents extérieurs, représentants d’une composante de la plus-value, qui conduisent à l’exploitation. Une des formes de la plus-value par son accroissement contraint les autres acteurs, les représentants des autres formes de la plus-value, et tout particulièrement le capital industriel, a une action contre les salariés. Il ne s’agit pas d’une franc-maçonnerie unie contre le prolétariat pour obtenir le maximum de plus-value quitte à se déchirer ensuite pour le partage du butin, mais d’une exploitation induite, conçue comme une dégradation de la situation, résultant des excès d’une fraction.
Pour les altermondialistes, il s’agit du capital financier[94]. En exigeant des rendements élevés des fonds propres afin de « créer de la valeur pour l’actionnaire », le capital financier pousse les entreprises dans la voie du profit à court terme et des « licenciements boursiers » tout en détournant les capitaux de l’accumulation dans la sphère de la production de plus-value.
Quand les coupables ne sont pas les capitalistes financiers, l’intérêt ou la captation de plus-value en relation avec les transactions sur le capital fictif, ce sont les capitalistes commerciaux ou les propriétaires fonciers, la rente et la spéculation immobilière[95]. Quand ce n’est pas la rente et la propriété foncière, ce sont les surprofits des monopoles. Les staliniens sont passés maîtres dans cette rhétorique. C’est sans doute à propos des PME que l’on retrouve les plus belles âneries. Dans sa critique du PCF et de sa théorie de la théorie du CME (capitalisme monopoliste d’Etat), Jacques Valier en propose une abondante moisson. Ainsi dans un livre sur les PME, écrit par Claude Quin, ultérieurement PDG de la RATP, on apprend que celles-ci ne sont qu’un « relais de l’exploitation monopoliste ». Claude Quin, va même jusqu’à dire que ce sont les monopoles qui les « obligent à se retourner contre leurs propres salariés. »
En général, on préserve le petit capital industriel (le coupable est le capital monopoliste) et l'Etat. Ce dernier est épargné car il est, dans la pensée réformiste, l'essence du bien et aussi le garant des salaires des professeurs d’économie politique. C'est la presse libérale qui se charge alors de critiquer l'Etat ou encore le monopole syndical qui laisse des salaires trop élevés. « D’abord parce que le niveau du taux de marge est beaucoup trop bas en valeur absolue, ensuite parce que la hausse des cotisations sociales et des salaires se conjuguent pour baisser encore davantage ce taux, et enfin parce que les entreprises n’ont d’autre solution pour y remédier que l’augmentation de la productivité, ce qui signifie hausse du chômage, rôle accru du capital au détriment de l’emploi, et augmentation des exigences vis-à-vis des salariés (et donc du stress de ces derniers). Les entreprises s’enferment en définitive dans un cercle vicieux où le niveau élevé des charges de production (impôts et salaires chargés) bride le dynamisme et la faculté d’embauche des entreprises, et où la seule réponse possible est l’augmentation du taux de productivité qui bien entendu a ses limites et provoque les réactions opposées des salariés. » (IFRAP, Bertrand Nouel, Pour l’emploi, améliorer le taux de marge des entreprises.)
Que la concurrence pour le partage de la plus value, en s'avivant, pousse les entreprises capitalistes a d'autant mieux réaliser l'être du capital voilà qui laisse perplexe l’économiste petit-bourgeois. Dans la mesure où ils font valoir leur droit à ce que leur situation économique et sociale leur permet, les capitalistes agissent conformément à leur être et dans ce cas il est conforme à la tâche historique remplie par le mode de production capitaliste. Non seulement ils peuvent faire ce qu’ils font mais d’une certaine manière ils le doivent[96]. Cela ne doit pas pour autant masquer le fait que l’origine de cette plus-value est dans l'exploitation de la force de travail.
La critique petite-bourgeoise se concentre sur certaines formes, les formes les plus parasitaires, les plus visiblement parasitaires, devrait-on dire, pour mieux masquer et préserver l'esclavage salarié, laisser intact le mode de production capitaliste[97].
Les entreprises les plus solides sont susceptibles de mieux tirer leur épingle du jeu que les autres. D’autre part, au cours des faillites et des restructurations, la vente à l’encan de moyens de production ou de consommation peut se traduire par une dépréciation de ceux-ci dont profitent les repreneurs. Ce qui est perdu pour les faillis ou les entreprises encore actives qui se restructurent peut être profitable à celles qui achèteront à vil prix ces marchandises. Suivant que la baisse des prix obtenue des fournisseurs sera ou non répercutée (voire amplifiée si la dépréciation se généralise) sur les clients, l’entreprise qui en bénéficie tirera ou non des profits de cette baisse. Si elle même s’engage dans la spirale déflationniste, elle pourra connaître une baisse du taux de profit voire des pertes en dépit des avantages qu’elle aura retiré des baisses de prix de ses fournisseurs. Par ailleurs, ces baisses de prix et leurs fluctuations ont par elles-mêmes un caractère perturbateur qui désorganise le procès de production et de circulation et provoque un effet inverse de celui attendu en nuisant à la reproduction du capital. Une spirale déflationniste empêche le recouvrement d’une situation favorable à une reprise de l’accumulation. Sur le plan international ces phénomènes seraient accentués par la guerre des monnaies tandis que les tendances protectionnistes visant à préserver la masse de plus-value au détriment relatif de son taux s’affirmeraient.
Le cas pédagogique de Marx, ne comprend pas l’effet en retour de la hausse de valeur potentielle du capital constant et, par conséquent, la plus-value reste a priori positive. Pour que toute la plus-value soit perdue le taux d’exploitation devrait tomber à zéro. Mais si nous réintroduisons le procès valorisation/dévalorisation (au sens 2), il n’en est pas de même. La perspective de devoir dévaloriser le capital au-delà de l’ensemble de la plus-value devient possible, du fait que le capital constant lui-même - qui joue un rôle croissant dans la composition du produit social - tend à se revaloriser sous l’effet du retournement de la productivité du travail.
Sur le plan du capital fictif (titres), il en va de même, les baisses de prix sont même relativement plus importantes. Elles sont en proportion de leur hausse artificielle dans la période d’expansion et de surspéculation qui précède l’éclatement de la crise. Désormais, le crédit se fait rare et aggrave la crise générale dans toutes les sphères, tandis que le capital fictif (fraude) émerge au milieu des affaires saines en déroute et de celles qui ont été soutenues par une fuite en avant liée au crédit et au surcrédit. La crise permet une centralisation du capital réel ; elle favorise encore plus la centralisation du capital fictif.
2.9.5 Dynamique du recouvrement
Dans un premier temps, le capital devient inoccupé. Ensuite, les entreprises vont réagir, si elles ne l’ont pas fait par anticipation. Elles vont licencier et en profiter pour mettre à plat les questions d’organisation restées pendantes voire se servir de la crise comme prétexte pour mettre en œuvre des rationalisations jusque-là différées notamment par crainte des réactions des salariés. Par conséquent, une base matérielle plus productive s’installe. Mise au rencart des moyens de production et techniques dépassés, suppression des activités les moins rentables, amélioration de la productivité dans les autres, économies et rationalisations, préparent l’entreprise à un nouveau contexte et améliorent sa productivité vis-à-vis de ses concurrents et permettent un nouveau bond dans la force productive du travail qui facilite le rétablissement sinon l’amélioration du rapport d’exploitation et de production de la plus-value[98].
Dans le cadre de ce processus de restructuration, la dévalorisation du capital via la revente de capitaux dépréciés et destruction des valeurs d’usage a pu intervenir.
La force de travail elle-même, nous l’avons vu, voit son prix se déprécier sous l’action du gonflement de l’armée de réserve industrielle. Ces baisses de salaire favorisent la reprise.
2.9.6 Conclusion
En conclusion nous pouvons tirer quelques constatations quant à la nature de la crise de suraccumulation, de surproduction générale de capital. :
1° C’est une crise générale et non une crise partielle. Elle est générale non seulement par son étendue, en tant qu’elle touche toute les sphères de la société mais aussi parce qu’elle touche l’ensemble des composantes du capital social[99] et pas seulement une partie de celui-ci (totalité ou partie de la plus-value par exemple).
2° C’est une crise de surproduction, caractéristique de la société bourgeoise la plus évoluée, la plus moderne. Il y a surproduction générale de capital dès lors qu’il y a un retournement brutal du taux d’exploitation, ce qui implique dans le cadre du mode de production capitaliste le plus développé, un retournement brutal de la productivité du travail.
3° La crise trouve son origine dans le procès de production, mais elle éclate dans la sphère de la circulation. C’est dans cette dernière sphère que la crise prend corps, du fait d’une possibilité de scission entre la vente et l’achat de la marchandise. Cette possibilité de la crise gisait dans la forme monnaie, dans la fonction moyen de paiement de l’argent. Les conditions de la production et de la réalisation de la valeur et de la plus-value ne sont pas identiques. La crise issue du processus productif éclate à la surface de la société. Nécessité et possibilité de la crise sont alors réunies.
4° Ces crises reviennent périodiquement. Ce ne sont pas des crises permanentes. Elles surviennent brutalement, soudainement. En tant qu’elles dévastent la société comme le ferait une catastrophe naturelle, ces crises générales sont catastrophiques. Mais ici la catastrophe est d’essence sociale[100].
5° Suraccumulation et dévalorisation, destruction de capital, entretiennent un lien dialectique et organique et non une relation mécanique et logique
6° A travers la répétition des crises, dont la tendance est à l’aggravation, se manifeste la tendance à la baisse du taux de profit. Il ne s’agit donc pas d’un cycle ou d’une onde longue de type Kondratiev mais de l’évolution du rapport capitaliste dans un contexte géo historique donné.
7° Ces crises expriment la révolte des forces productives trop à l’étroit dans les rapports de production capitalises dont le but limité, la recherche du maximum de plus-value entre en contradiction avec le développement de la force productive du travail qu’elle suscite. Elles appellent le renversement du capital et la domination politique du prolétariat sous la forme d’une dictature révolutionnaire afin d’instaurer une forme d’organisation sociale supérieure : le communisme.[101]
3. Le marxisme vulgaire et la suraccumulation
Nous allons voir comment des représentants du marxisme vulgaire s’y prennent pour maltraiter la théorie de la suraccumulation. Nous parcourons rapidement, dans la mesure où nous leur avons déjà consacré ailleurs une longue réfutation, les points de vue développés par Grossmann/Mattick qui influencent l’ultra-gauche quoique celle-ci soit désormais en totale déliquescence. Puis, nous passerons à Paul Boccara dont les théories jouent un rôle notable dans l’histoire du PCF et pour finir nous prendrons pour emblème œcuménique du marxisme de la chaire les théories de Marcel Roelandts puisqu’il prétend faire la synthèse de tendances contradictoires. Ce sont autant de tentatives pour étouffer la théorie de Marx.
3.1 Grossmann/Mattick
Le cadre de l’exposé de Marx propre à la suraccumulation absolue ne fait pas que des enthousiastes. Nous avons mis en évidence la dimension pédagogique des hypothèses de Marx (mais qui ont des résonances avec un passé révolu de la production capitaliste) et que ce choix avait pour motivation d’écarter le procès valorisation/dévalorisation.
Parmi les mécontents, nous pouvons ranger Paul Mattick qui affirme :
« Pour illustrer le concept de suraccumulation, Marx recourt à un autre exemple, dont le choix n’est toutefois pas très heureux. » « (…) exemple (…) boiteux car il contredit toutes les données de l’expérience et jusqu’à la théorie marxienne de l’accumulation elle-même. » (Mattick, Crises et théories des crises, Editions Champ Libre, p.86 et p.88).
Nous avons montré qu’il n’en était rien. Bien que nous ayons affaire à des brouillons, il y a une cohérence dans cet exemple dès lors que l’on comprend la volonté simplificatrice de Marx en ce qui concerne l’exposition des causes qui engendrent la suraccumulation.
La théorie de Grossmann, reprise par Mattick, une fois qu’on lui a ôté les quelques masques derrière laquelle elle se dissimule est particulièrement vulgaire. Elle part de l’idée que l’accumulation est à mettre en relation avec le capital déjà avancé et non avec la plus-value produite et que cette accumulation est réalisée sur la base d’un taux de profit marginal décroissant.
Par exemple, supposons que la valeur de la production se décompose en
100 c + 100 v + 100 pl. (c = capital constant, v= capital variable et pl = plus-value)
Si les besoins de l’accumulation[102] s’élèvent à 50 c + 25 v[103] il restera à la classe capitaliste, une plus-value de 25 à consommer.
Lors de la période suivante nous obtenons donc la situation suivante :
150 c + 125 v + 130 pl [104]
Les besoins de l’accumulation deviennent alors[105] par exemple, 90 c + 30 v. Il ne reste plus que 10 à consommer à la classe capitaliste. A un moment donc la consommation de la classe capitaliste diminue pour faire face aux besoins croissants de l’accumulation.
Dans la période suivante nous sommes donc avec un produit social égal à :
240 c + 155 v + 175 pl [106].
Dès lors que les besoins de l’accumulation, déterminés selon la logique de Grossmann, c’est-à-dire en mettant en relation la plus-value accumulée avec le montant du capital existant, supposent, par exemple, un capital constant additionnel de 150 c pour un capital variable de 40 v, la plus-value devient insuffisante.
En effet, une plus-value de 175 est disponible tandis que le besoin (imaginaire) pour financer l’accumulation est de 190 (150 + 40). C’est ici que, selon Grossmann, la crise commence.
En fait, il crée une disproportion imaginaire qui se traduit par des moyens de production inemployés, il accumule la totalité de c (150) tandis que la non accumulation de la totalité de v (40) laisse une force de travail sur le carreau (15 v soit 190 -175).
Le schéma de Grossmann n’est pas aussi grossier car la supercherie serait trop évidente. Grossmann a recours à de nombreux artifices pour masquer ses turpitudes[107] mais le fond de la théorie est là dans toute sa vulgarité.
Il s’agit donc d’une variante ricardienne de la baisse du taux de profit. A la hausse des salaires et de la rente qui réduisent le taux de profit comme une peau de chagrin, Grossmann/Mattick substituent la hausse autonome, déconnectée de la plus-value, de la composition organique et du taux d’accumulation. Le tout s’achève dans une disproportion (c’est-à-dire excédent de capital d’un côté et insuffisance de l’autre) ; qui plus est cette disproportion est une disproportion artificielle, imaginaire !
Grossmann fait bien la distinction entre la baisse tendancielle du taux de profit et la baisse du taux de profit qui caractérise la suraccumulation[108], mais il est incapable de l’expliquer autrement que par une théorie ricardienne.
3.2 Paul Boccara et le PCF
3.2.1 Un nouvel aigle dans le ciel de la pensée
De même que Keynes se prenait, avec sa « théorie générale », pour le nouvel Einstein de l’économie politique, Paul Boccara se pense comme le Newton du marxisme classique. Dans un documentaire qui lui est consacré, Paul Boccara, un des principaux théoriciens, à son époque, du capitalisme monopoliste d’Etat et du Parti communiste français, lance en paraphrasant Newton, « Je suis monté sur les épaules du géant, [Marx on suppose, NDR] et j'ai vu plus loin que lui »[109]. On peut craindre cependant que, en manque d’équilibre sur lesdites épaules, il ait eu du mal à voir plus loin que les pieds, si ce n’est le cul, du géant en question.
On le retrouve en fait, en tant qu’inspirateur de l’ultra-gauche[110], avec son analyse de la révolution informationnelle[111], de la régulation[112], du rôle des classes moyennes[113] ou de la crise. Que le stalinisme soit, à travers Grossmann ou Boccara, la source théorique où s’abreuve l’ultra-gauche reste préoccupant quant à sa capacité à n’être autre chose qu’un appendice de la social-démocratie.
3.2.2 La théorie du capitalisme monopoliste d’Etat (CME) dans son contexte.
Au sein du PCF, la théorie du CME se présente comme une tentative pour s'affranchir de la doxa stalinienne en abandonnant toute référence au léninisme (le centralisme démocratique, le parti d’avant-garde, la dictature du prolétariat) pour plus facilement rejoindre le giron social-démocrate dont, depuis très longtemps, plus rien de le distingue théoriquement. Le marxisme léninisme sera abandonné officiellement, en 1978, lors du XXIII° congrès du PCF. Cela ne va pas sans résistances et dans la mesure où Boccara cherche à « développer » la théorie de Marx, ses adversaires crient au révisionnisme (parmi ceux-ci on trouve notamment Henri Claude - 1909-1994 -, un des initiateurs de la revue Economie et Politique[114]). Boccara développe ses thèses dès le début des années 60[115] (il est né en 1932). Au sein du PCF, le débat se double d'un conflit entre les économistes et les autres intellectuels (philosophes dont Althusser[116], sociologues, …) qui combattent la théorie du CME et notamment sa conception sous-jacente de l'Etat.
La théorie va cependant s'imposer, « réappropiée » par le PCF, car elle va servir de fondement théorique au programme commun de la gauche[117]. Elle est ainsi vulgarisée par la direction du parti et exerce une influence notable non seulement sur le PCF mais également sur le PS[118]. Elle donnera lieu à des débats, comiques sur le plan théorique mais d’une grande importance pour la politique de nationalisation et les relations PC/PS, afin de déterminer à partir de quel seuil de nationalisation on pouvait envisager de quitter « l’antichambre du socialisme »[119] pour espérer gagner rapidement le salon d’apparat. Fixé à 25 groupes, le seuil des nationalisations sera ramené à 9 lors des discussions sur le programme commun. Puis, une fois celui-ci signé, l’étiage augmentera et après la rupture de l’union de la gauche (1977), cela servira de prétexte pour refuser l’accord électoral des législatives de 1978. En 1981, quant le PCF exerce le pouvoir avec les socialistes, la théorie est rangée dans les armoires du parti. Boccara se plaint aujourd’hui des déformations structuralistes de sa théorie. Nous allons cependant montrer, en allant à la source, que la théorie de la suraccumulation/dévalorisation présentée par Paul Boccara est une falsification éhontée de la théorie de Marx.
3.2.3 La suraccumulation sans peine
La représentation que met en avant le PCF à travers le Traité marxiste d’économie politique consacré au capitalisme monopoliste d’Etat (CME) comme celle du principal artisan de la théorie, Paul Boccara, consiste tout d’abord en une falsification de la définition de la notion de suraccumulation à l’instar aussi bien de Michel Husson que de Marcel Roelandts[120]. Boccara est cependant plus subtil que ces derniers dans sa tentative de détournement.
Paul Boccara écrit qu’il s’agit d’un « excès d’accumulation de capital (…) par rapport aux limites de la somme totale de plus-value ou de profit qu’il est possible d’obtenir pour valoriser le capital » (Paul Boccara, Etudes sur le capitalisme monopoliste d’Etat sa crise et son issue, Economie et politique, Editions sociales, p.42).
Dès lors que l'on assimile la suraccumulation à l'excès d'accumulation, on ne parle pas fondamentalement de surproduction de capital, d’une crise générale d’un rapport social, mais d'un excédent partiel de capitaux. D’autre part, on tend à donner à cet excédent un caractère permanent. De fait, pour Boccara, l’excédent, la pléthore de capital pour utiliser un terme repris par Marx, n’est pas le résultat d’une crise brutale, mais prend un caractère chronique. Ce caractère permanent conduit à minimiser la dimension cyclique et périodique des crises pour lui substituer une conception du cycle long, du cycle Kondratiev[121]. Du même coup, l’articulation (et les spécificités) entre la baisse brutale du taux de profit, la crise périodique de suraccumulation, de surproduction de capital, et la baisse tendancielle du taux de profit (inter cycles) est édulcorée. Sur la base d’une définition partielle et quantitative, une représentation moins heurtée du cours du mode de production capitaliste nous est présentée.
Toutefois, en rappelant que suraccumulation est bien synonyme de surproduction, Boccara reconnaît implicitement que sa définition reste insuffisante[122]. Mais, régulièrement, la question est éludée pour faire de la suraccumulation un synonyme d’excédent (partiel et tendanciellement permanent) de capital[123].
3.2.4 Excédent de capital et surproduction
Dans le passage consacré à la suraccumulation, Marx critique l’idée, fréquente chez les économistes, d’une « prétendue pléthore de capital », d’un excédent de capital qui ne soit pas le produit temporaire de la surproduction[124].
Pour Marx, la surproduction de capital n'est pas un phénomène permanent[125]. Cette surproduction est à la fois une des manifestations de la crise et une manière de résoudre violemment les contradictions qui ont permis cette crise[126].
En d'autres termes, dès lors que le capital se fige, se fixe, s'immobilise, il devient oisif, il est mis en friche, il tombe en sommeil, il est mis en jachère. Le capital est excédentaire, le capital est suraccumulé ; il y a une surproduction de capital. Dans la mesure où il traduit la crise, il s'agit d'un phénomène soudain qui appelle le rétablissement des rapports d’exploitation qui prévalaient ; c’est ce qui le rend temporaire. Cela passe par l’absorption du choc. La mise en friche ou en jachère du capital et une dévalorisation brutale du capital (qui sont également des manifestations de la crise), des pertes occasionnées au capital, contribuent au rétablissement violent d’un équilibre compatible avec la sortie de crise. Au passage, la société a été dévastée, à l’instar d’une catastrophe naturelle. Mais ici ce sont uniquement des raisons sociales, du fait de l’existence de la production capitaliste, qui expliquent une telle catastrophe. C’est dans ce sens que, pour Marx, la crise est catastrophique et que donc toute crise générale de surproduction est catastrophique. Le marxisme n’est donc pas dans l’attente d’UNE crise catastrophique, réédition de l’apocalypse, ouvrant le chemin de la nouvelle Jérusalem au prolétariat rédempteur. En revanche, il prévoit que la répétition des crises et leur tendance à l’aggravation pousseront le prolétariat dans la lutte pour la conquête du pouvoir politique afin de renverser le règne du capital et son cours catastrophique.
3.2.5 Une parabole de l’excédent
Pour approfondir la différence de conception entre Marx et Boccara mais aussi nombre de représentations du même acabit, nous pouvons risquer une parabole.
Dans la représentation révisionniste il faut s'imaginer que le corps, le capital, produit de la graisse plus ou moins en permanence. Le capital devient obèse et peine, toujours plus à avancer, entravé par l'excédent de capital.
Dans la représentation du marxisme orthodoxe, le corps certes possède dans des proportions variables suivant la conjoncture toujours un peu de graisse. Celle-ci est nécessaire à son métabolisme. Le capital peut ainsi puiser dans ses réserves dès lors qu'il accélère et s'engage dans une course furieuse à l'accumulation et à la chasse à la plus-value. Mais il prend toujours soin de son corps et essaye d'optimiser cette présence de graisse. Une brusque arythmie cardiaque, un point de côté, à l'issue de sa course effrénée, l'immobilise soudainement. Il est hors d'haleine, tout son métabolisme se transforme et son corps lui parait peser une tonne. Le corps doit faire une pause pour récupérer et pouvoir reprendre sa course. La crise se manifeste par une surproduction de capital et pour y remédier une destruction de capital qui prend diverses formes doit avoir lieu.
En parallèle, se développe un autre phénomène qui est également un produit organique de l’accumulation du capital. Avec le développement du crédit et du surcrédit (donc du capital fictif au sens III) qui lui est inhérent, nous avons à la fois une stimulation de l'accumulation du capital productif ou du capital qui recherche le profit et le développement de tendances parasitaires qui se traduisent par le gonflement du capital fictif au sens I (fictif au sens de imaginaire, illusoire, c’est-à-dire augmentation de la valeur de marché des titres) et au sens II (capital fictif au sens de frauduleux). C’est un peu comme si notre athlète, et non notre obèse, mettait sur ses épaules un sac à dos rempli d'éponges. Elles lui servent à se rafraîchir en épongeant la sueur et améliorent donc sa performance. Mais, en même temps, la sueur s’accumule gonfle les éponges et pèse sur ses épaules. Une fatigue supplémentaire est donc induite et une bulle se forme. Elles contribuent à l’arrêt brutal, à la mise hors course, de notre coureur. Notre exemple ne doit pas laisser croire que le sac à dos pourrait être retiré. Il s’agit d’une excroissance organique. La bulle peut exploser par elle-même et produire une crise qui reste limitée à cette sphère[127] mais quand le cœur s’emballe et entraîne un arrêt brutal de la course, la bulle se dégonfle par la même occasion et accentue la catastrophe sociale. C’est même dans cette sphère que la crise, sur le plan formel, commence.
En vieillissant notre athlète, affaibli par des crises tendanciellement toujours plus graves renonce à sa vocation, abandonne les performances et les compétitions pour se satisfaire d’un entraînement plus ou moins conséquent. Jeune, il a porté plus loin que tous les autres le niveau de performance et les records, mis en place de nouvelles méthodes de préparation et d’entraînement qui laissent augurer de nouveaux records mais, en se survivant à lui-même, il admet qu’une nouvelle organisation pour aller plus avant est nécessaire. Un nouvel athlète qu’il a contribué à former et qui est chaussé de bottes de sept lieues arrive sur la scène pour le remplacer.
Ce dernier aspect de la prévision, la sénilité du capital, ne s’est pas réalisé dans la période envisagée par Marx et Engels. A la suite de deux guerres mondiales et d’une contre révolution sans précédent, le capital s’est rajeuni. En appliquant sa bouche putride sur le jeune prolétariat, il a gagné un nouveau souffle, un nouveau sang, une dynamique qui lui a fait porter le niveau des forces productives à un niveau, et à une vitesse, inégalés dans l’histoire[128]. C’est évidemment une question que doit affronter ce qui reste du parti communiste au sens historique du terme.
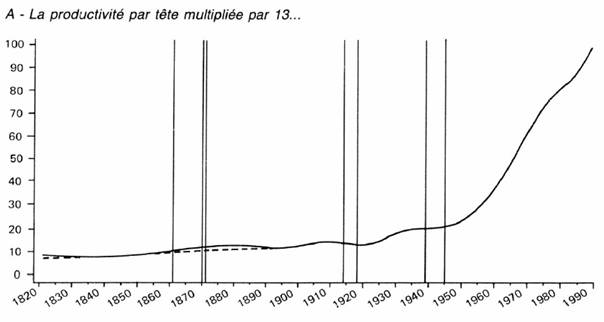
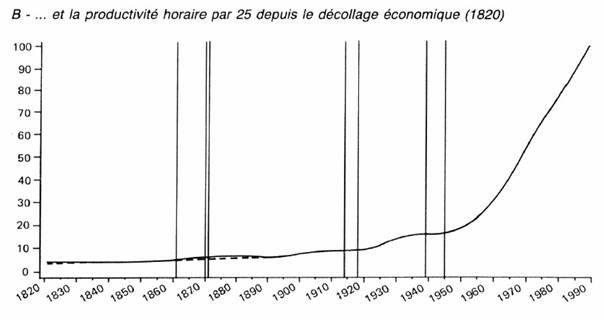
Les auteurs précisent que les traits verticaux correspondent aux changements de territoire et aux guerres et que la courbe de 1821 à 1896 correspond aux indices obtenus des travaux de J.C. Toutain et M. Lévy-Leboyer
Source : Olivier Marchand, Claude Thélot, Deux siècles de productivité en France. Economie et statistiques, n° 235-236, Nov-Déc 1990.
3.2.6 La suraccumulation dévalorisation
Selon Boccara, si Marx emploie le terme de « suraccumulation », il emploie peu celui de « dévalorisation ». Quand Boccara nous dit que « suraccumulation » est utilisée plus souvent que « dévalorisation », nous sommes dans une forme d’understatement (une forme d’euphémisme) comme disent nos amis britanniques. Si nos calculs sont exacts, dans les passages concernés, Marx utilise deux fois le terme « suraccumulation » - il préfère en général parler de surproduction - et une fois le terme « dévalorisation » ! Sauf erreur, de toute l’œuvre de Marx, c’est uniquement dans les brouillons du livre III du capital que l’on fait mention (deux fois nous l’avons vu) du concept de « suraccumulation ». Il équivaut, nous l’avons montré, à surproduction de capital. En revanche, nous l’avons également vu, le terme de dévalorisation était employé dans divers endroits avec des acceptions multiples. Ici, Boccara se présente plus comme un amuseur public que comme un commentateur sérieux de Marx.
Une bonne part des acceptions que nous avons passées en revue se retrouve dans les passages concernés par l’analyse de Boccara, avec un vocabulaire varié (dépréciation, destruction et aussi - une fois - dévalorisation dans le sens de dévalorisation/dépréciation dont nous avons parlé et non dans le sens de valorisation insuffisante comme l’insinue Boccara). Dans le contexte auquel Boccara fait référence, c’est-à-dire le chapitre consacré à la suraccumulation, certaines significations de « dévalorisation » sont, pour une part, regroupées sous le terme de destruction. Marx parle également de dépréciation qui est ici un des synonymes de dévalorisation.
Nous avons montré plus haut que ces divers termes étaient synonymes de dévalorisation dans des acceptions souvent différentes. Mais Boccara trouve le moyen de créer un concept de dévalorisation qui lui est propre. Après avoir falsifié le concept de « suraccumulation », il s’en prend ensuite à celui de « dévalorisation ». Le sens général global que Boccara donne à dévalorisation est celui de valorisation à un taux de profit inférieur à la moyenne, de moindre mise en valeur du capital. Mattick utilise également l’expression de « valorisation imparfaite » pour qualifier la conception de Grossmann. Les représentations de Boccara et de Grossmann sont toutefois fort éloignées. Leur seul point commun est qu’elles falsifient, chacune à leur manière, la théorie de Marx. La valorisation imparfaite de Grossmann provient de l’écart entre le besoin (imaginaire) de plus-value à accumuler et la plus-value disponible, tandis que pour Boccara, il s’agit de capitaux qui obtiennent un taux de profit inférieur au taux de profit moyen du fait de leur mise en sommeil. Mattick trace un trait d égalité entre la valorisation imparfaite et la suraccumulation[129], tandis que Boccara l’identifie avec la dévalorisation.
Marx n’a jamais employé le terme de dévalorisation dans le sens général que lui prête Boccara. Le sens qui se rapprocherait le plus d’un des trois cas réunis par Boccara sous le concept de dévalorisation est celui qui oppose la valorisation à l’absence de valorisation, la mise en valeur du capital à l’absence de mise en valeur (c’est-à-dire la dévalorisation au sens d’absence de valorisation du capital, dévalorisation au sens III, cf.2.7.3)[130]. Mais l’amalgame que fait Boccara entre divers aspects de la crise, et qu’il regroupe sous son concept de dévalorisation, fausse complètement le concept qui se trouve d’ailleurs associé mécaniquement à suraccumulation. Le nom donné par Boccara à sa conception théorique : la « suraccumulation dévalorisation » est révélateur du lien mécanique et non dialectique qu’il introduit dans les relations entre les deux concepts.
A l'excédent de capital répond la dévalorisation vue comme un capital valorisé à un taux de profit inférieur afin que l’autre faction du capital puisse maintenir son taux de profit.
Le développement des concepts est bien une des composantes de l’activité scientifique et, de ce point de vue, il appartient au mouvement communiste de développer ce que Marx a laissé en friche. Mais ici, l’exégèse, bien que Boccara se prenne pour le Newton du marxisme, ne conduit qu’à ramener Marx dans le giron de l’économie politique. En profitant de concepts encore en l’état fragmentaires, on s’efforce d’en altérer le sens et, par la même occasion, la portée révolutionnaire.
3.2.7 La dévalorisation sans peine
En fait, nous savons que, quand on parle de suraccumulation, il s’agit d’une surproduction générale de capital qui se manifeste à l’occasion d’une insuffisance de plus-value en regard du capital avancé. Il s’agit donc d’une baisse soudaine du taux de profit qui correspond (sur le plan du capital global) à une baisse, un retournement brutal par rapport à la tendance générale, du degré d’exploitation de la force de travail[131].
La représentation de Boccara consiste à limiter la question uniquement à la partie accumulée de la plus-value et d’en faire un excédent de capital. Cet excédent n’est pas un excédent temporaire qui doit être résorbé par les diverses formes de destruction et de dévalorisation brutales du capital[132]. Ici, dans la conception de Boccara, l’excédent de capital prend un caractère permanent. Il est résorbé par une « dévalorisation », définie comme une moindre mise en valeur du capital, une mise en valeur avec un taux de profit inférieur à la moyenne (le taux de profit peut devenir négatif, via un déficit, une perte, dans les cas extrêmes).
Plus précisément, Boccara envisage trois solutions pour soulager le capital, décharger son excédent :
1° Une partie du capital, au moins égale à la valeur en excédent, ne se met pas en valeur. Elle ne fonctionne plus comme capital, « elle est en quelque sorte mise en sommeil ». Le profit est nul.
2° Une partie du capital, plus importante que l’autre pour qu’elle ait le même effet, se met en valeur à un taux de profit réduit, inférieur au taux de profit moyen.
3° Une partie du capital, éventuellement inférieure à la première, connaît des pertes. Pour Boccara, il s’agit d’une valorisation négative. Une partie de la valeur du capital accumulé est détruite.
« Ces trois solutions, valorisation nulle, réduite ou négative, correspondent à ce que nous appelons la dévalorisation d'une partie du capital total, permettant en principe la poursuite de la mise en valeur des autres capitaux et du capital global. » (Paul Boccara, Etudes sur le capitalisme monopoliste d’Etat sa crise et son issue, Economie et politique, Editions sociales, p.44).
Le même thème est repris dans le traité marxiste d’économie politique qui ne s’embarrasse pas des nuances et circonvolutions de Boccara[133]. Les ultimes réticences du chercheur devant le texte de Marx sont ici expédiées. Il y a de ce point de vue un certain contraste entre les travaux de Boccara dont les falsifications ne se départissent pas des habitudes, précautions et précisions du chercheur et l’exposé du traité marxiste d’économie politique. Dans ce dernier, l’aréopage des savants de la section économique se montre plutôt laxiste. Le cerveau collectif, contrairement à l’attente, simplifie la pensée et en fait ressortir d’autant plus l’absurdité[134].
Marx, nous l’avons vu, avait au moins sept acceptions pour le terme « dévalorisation », Boccara réussit à en ajouter une qui n’a rien à voir avec les sept précédentes. C’est, bien entendu, une manière de falsifier Marx[135].
Une fraction du capital est mise à l’écart. Ce phénomène n’est pas le corollaire de la crise de surproduction, il ne traduit pas une crise générale, un effondrement de la production capitaliste mais le développement de tendances (le développement du « capital public ») qui mettent à l’écart le capital « dévalorisé », c’est-à-dire un capital dont la mise en valeur est moindre. Ici, la baisse brusque du taux de profit n’induit pas une surproduction de capital qui exige la dévalorisation brutale du capital. On mesure l’intérêt que peuvent tirer nos faussaires du concept revisité de suraccumulation relative. En partant non plus de la suraccumulation absolue mais de la suraccumulation relative, on admet que toute baisse du taux de profit induit un excédent de capital. D’une certaine manière on postule, sans le dire, un « taux de profit d’or ». C’est-à-dire qu’on admet implicitement l’existence d’un apogée de la production capitaliste, un âge d’or, une époque où le taux de profit était optimum. Ce « taux de profit d’or » n’engendrait aucun excédent. La baisse du taux de profit induit un écart croissant vis-à-vis de ce taux de profit d’or et se traduit par une suraccumulation relative, chronique. Cet excédent permanent et croissant de capital est « dévalorisé », c’est-à-dire valorisé à un taux de profit inférieur au taux de profit moyen actuel, pour maintenir l’autre partie au taux de profit d’or. A chaque baisse du taux de profit le phénomène doit se produire[136] ; il peut être différé par l’inflation[137].
Le capital excédentaire, dévalorisé à la mode Boccara, est pris en pension au sein de l’Etat ou des entreprises publiques. Les moindres résultats, le faible taux de profit voire les pertes de ces entreprises ne s’expliquent pas notamment par leur gestion bureaucratique, leur situation de monopole favorisant la dissipation de la productivité, mais exclusivement par le pillage des grands monopoles et la suraccumulation, c’est-à-dire ici un excédent de capital, excédent qui prend un caractère permanent et suppose le gonflement du capital public en même temps que sa faible rentabilité.
3.2.8 Une double falsification
Le capital est donc mis, dans ce nouveau sens, en sommeil. Bien loin de faire un lien entre capital fixé, immobilisé, paralysé temporairement, mis en friche, Boccara trace un trait entre cette oisiveté, cette mise en sommeil, cette mise en jachère et la tendance du capital, tendance qui prend le pas et saisit le capital quand il renonce à sa mission, quand il devient sénile, c’est-à-dire quand la baisse du taux de profit devient évidente, s’impose et que le capital se survit. A ce propos Marx nous dit :
« Le taux de profit, c’est-à-dire l’accroissement proportionnel du capital, est important surtout pour tous les rejetons de capitaux qui cherchent à se grouper de façon indépendante. Et, dès que la formation de capital aurait incombé à un petit nombre de gros capitaux bien établis pour qui la masse du profit compenserait le taux, on verrait s’éteindre le feu vivifiant de la production, laquelle tomberait en sommeil. Le taux de profit est la force motrice de la production capitaliste ; seul est produit ce qui rapporte du profit. » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1041-1042).
Marx vise ici la fin d’un cycle historique qui suppose que les forces centrifuges des jeunes capitaux ne puissent plus régénérer suffisamment le capital[138], que les crises de surproduction l’aient affaibli au point de renoncer à sa mission tandis que la baisse du taux de profit se fait pressante. Ce n’est qu’à travers le rapprochement du terme « sommeil » que Boccara peut faire ce lien. Mais d’une part nous avons vu que les traductions étaient différentes ce qui rend plus difficile le rapprochement sans en tordre le sens et surtout que nous ne sommes pas dans le même contexte.
Avec les crises de surproduction, le capital se fixe, s’immobilise et entre en sommeil et cette mise en sommeil constitue dialectiquement une réponse à la crise de suraccumulation. Ici, la mise en sommeil (la mise en friche) est à la fois la manifestation de la crise et une manière brutale pour la dépasser.
A la relation dialectique fait place une relation mécanique. Chez Boccara, nous n’avons pas affaire à une crise de surproduction se traduisant par une destruction de capital, une dévalorisation/dépréciation brutale mais à l’assoupissement progressif de la production capitaliste qui engendre des capitaux excédentaire que l’Etat prend en pension pour les valoriser à un taux inférieur au profit moyen, rehaussant par la même occasion le profit des monopoles[139].
On confond ici, en en altérant profondément le sens, les manifestations ultimes de la baisse tendancielle du taux de profit et la baisse brutale du taux de profit au moment des crises.
Boccara falsifie donc à la fois le concept de suraccumulation et celui de dévalorisation. Du même coup, il a tendance à minimiser l’importance des crises de surproduction qui se présentent périodiquement au profit d’une conception du cycle long[140] tout en prétendant apporter une théorie unificatrice[141]. Boccara réhabilite donc le cycle Kondratiev[142]. Il n’est pas dans notre propos de critiquer ici les théories et analyses de Kondratiev et autres théoriciens du cycle et ondes longs[143]. Ces conceptions sont aux antipodes de celles de Marx ; nous nous contenterons ici de la critique de Trotski à laquelle nous renvoyons le lecteur[144].
3.3 Marcel Roelandts
3.3.1 Le projet de Marcel Roelandts
Marcel Roelandts se présente comme un enseignant et chercheur à l’université et dans plusieurs hautes écoles. On est donc en droit, a priori, de considérer sa production intellectuelle comme une énième variété du marxisme de la chaire. Cette circonspection dans le jugement est d'autant plus permise que Marcel Roelandts s’annonce accompagné[145].
Outre ces autorités du marxisme de la chaire auxquelles il donne force crédit, Marcel Roelands ne manque pas une occasion d'envoyer des baisers Lamourette à d’autres « économistes marxistes »[146], cet oxymore avec lequel ils se nomment sans vergogne. Manifestement, Marcel Roelandts semble avoir privilégié l’aile sous-consommationniste du mouvement (ce n’est pas le cas d’Isaac Johsua qui appartient plutôt à la tendance opposée mais c’est sur un sujet particulier – la domination du salariat - qu’il reçoit l’adoubement de Marcel Roelandts. D’autre part, nous avons vu que Johsua attribuait à Marx, une théorie sous-consommationniste). Les opposants ne sont pas nommés mais néanmoins tancés[147].
Le projet de Marcel Roelandts n’est pas de proposer une nouvelle interprétation des crises du mode de production capitaliste. Il cherche tout d’abord à se rattacher à un marxisme pour lequel la crise remet en cause les fondements du capitalisme et, par conséquent, vise à dépasser révolutionnairement ce mode de production. Ensuite, il s’efforce de dégager, au sein des grandes controverses qui ont traversé le marxisme, les tendances les plus claires tout en les actualisant et les approfondissant. Notamment, Marcel Roelandts cherche à dépasser l’opposition entre les tenants de l’explication des crises par la suraccumulation, la baisse du taux de profit et ceux pour qui elle résulte d’une insuffisance de la demande solvable.
D’une certaine manière il pense trouver ce dépassement dans la mise en évidence de l’unité de la théorie de Marx dans laquelle il dégage deux axes majeurs ; « d’une part, les contradictions liées à l’extraction de la plus-value qui se traduisent par le mécanisme de la baisse tendancielle du taux de profit ; d’autre part, la tendance immanente du système à comprimer ses propres débouchés suite aux glissements de répartition entre les salaires et les profits découlant des « conditions de répartition antagoniques » du produit total entre le travail et capital (et entre les secteurs de celui-ci). Par leurs logiques internes, ces deux axes débouchent sur des crises récurrentes de surproduction ». (Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, p.5).
Un projet qui cherche à défendre le marxisme orthodoxe serait digne d’éloges et trouverait en nous le plus vif soutien. Las, comme nous allons le voir, la réalisation est bien loin de la promesse. Nous montrerons que le projet théorique de Marcel Roelandts, loin de renouer avec Marx dans une critique révolutionnaire de l’économie politique, reprend dans une horrible synthèse ce qu’il y a de plus mauvais dans chacune de ces tendances pour, finalement, revenir à une variante sous-consommationiste de la crise. Compte tenu du caractère synthétique de son analyse nous en ferons donc un porte-drapeau du marxisme de la chaire.
3.3.2 Le temps, le temps, le temps et rien d’autre
Marcel Roelandts rappelle fort justement que pour Marx, la baisse tendancielle du taux de profit ne se manifeste nettement que, nous l’avons vu, dans certaines circonstances et sur une longue période[148]
Dans l’ouvrage que nous analysons, la présentation de Marcel Roelandts a des accents d’orthodoxie. En fait, il n’en est rien.
Dans un article[149] plein de déférence pour Alain Bihr[150] qui exposerait « clairement une dimension importante de l’analyse des crises chez Marx », Marcel Roelandts revient sur la question de la longue période. Il s’y présente alors comme un défenseur d’une « tendance (nous supposons qu’il vise la tendance à la baisse du taux de profit NDR) [qui] n’agit qu’à très long terme comme aboutissement de tout l’arc du développement capitaliste. » (Marcel Roelandts, article, p.4).
Plus loin, il précise dans quelle temporalité, il faut envisager la baisse tendancielle du taux de profit. « OUI à court (cycle décennaux) et moyen terme (+/- 30 ans), NON à long terme (tendance séculaire) … et sans doute OUI à très long terme (pluriséculaire) … mais cette tendance de très long terme ne se constate pas encore empiriquement (…) » (Marcel Roelandts, extraits article, p.5). Après avoir semble t-il, dans le livre, écarté les cycles « décennaux »[151] dits de court terme, dans cet article, postérieur à son livre, ils sont réintroduits avec, en complément aux cycles de moyen terme sur lesquels reposaient la baisse du taux de profit, les cycles séculaires (eux mêmes rejetés) et pluri séculaires (dont le statut est hésitant).
Dans le livre que nous avons cité, il paraît clair que Marcel Roelandts considère que pour Marx, la baisse tendancielle du taux de profit a pour temporalité plusieurs cycles. Par contre, dans cet article, il réunit dans un même mouvement, le cycle dit de court terme (« cycle décennal ») et un cycle de moyen terme estimé à plus ou moins trente ans.
Nous avons donc ici, un ensemble d’assertions purement révisionniste.
D’une part, on introduit l’idée d’une baisse tendancielle du taux de profit intracycle alors que Marx écrit en toutes lettres qu’elle est intercycles. Cette approximation vise à justifier, comme nous le verrons, l’identification de la baisse brutale du taux de profit qui intervient avec les crises et de la baisse tendancielle du taux de profit qui parcourt plusieurs cycles. Marcel Roelandts n’échappe pas, comme bon nombre d’exégèses, à l’erreur, que nous avons déjà relevée, qui consiste à assimiler, sans autre forme de procès, la baisse tendancielle du taux de profit et la baisse brutale du taux de profit caractéristique de la suraccumulation du capital[152].
D’autre part, on canonise, un cycle de moyen terme de plus ou moins trente ans qui ne correspond qu’à une expression pour une part conjoncturelle de Marx. A l’époque où il l’écrit, cela correspond au recul qu’il a sur le cours de la production capitaliste la plus développée. Ce qui est important dans l’analyse ce ne sont pas les trente ans, mais le fait que la baisse tendancielle du taux de profit soit intercycles. Sa temporalité est la longue période (plusieurs cycles) qui elle même s’inscrit dans une configuration du marché mondial (cf. plus bas, les appréciations d’Engels), une configuration géo historique donnée. Elle ne saurait donc être assimilée à un phénomène transcendant toute l’histoire du mode de production capitaliste le plus développé.
Ce texte complémentaire nous permet également de mieux comprendre que Marcel Roelandts ne rejette pas en soi l’idée d’une baisse séculaire du taux de profit. Il ne la constate pas dans les statistiques[153] et donc il l’écarte, mais ce n’est pas pour des raisons théoriques. Bien au contraire ; la dernière phrase de son ouvrage que nous citons en note n’écarte donc pas cette possibilité. Elle ne fait que constater que Marx et Engels n’ont pu avoir ce recul puisqu’ils datent de 1825, la première crise moderne de surproduction et qu’ils sont morts respectivement en 1883 et en 1895. En prenant en compte les compléments d’analyse fournis par l’article sur Alain Bihr, nous pouvons constater que cela laisse donc ouverte la perspective d’une baisse qui aille au delà de ces trente ans pour embrasser le siècle voire plusieurs siècles. Dans ce cas, pourquoi introduire, en figeant Marx, une période de plus ou moins trente ans ? D’autre part, ce serait oublier que dans l’esprit de Marx, le mode de production capitaliste entrait dans une phase de vieillissement, sa période sénile[154], et que les limites qu’il oppose au progrès de la force productive du travail étaient autant de manifestations de ce vieillissement. Engels pensait que la victoire du socialisme était proche et que s’il ne parvenait pas à empêcher la guerre mondiale qui menaçait toujours plus il sortirait malgré tout vainqueur de celle-ci. Par conséquent, Marx et Engels n’en étaient pas à imaginer la baisse du taux de profit sur des siècles et des siècles[155]. Bien plus, Engels revenant sur le fait que les cycles ne se manifestaient plus aussi nettement dans le dernier quart du XIXè siècle attribuait le phénomène aux nouvelles configurations du marché mondial, ce qui signifie que la baisse du taux de profit doit être analysée sur plusieurs cycles au sein d’une configuration géo historique donnée délimitant une certaine organisation du marché mondial.
Pour la période actuelle, une nouvelle page dans l'histoire du mode de production capitaliste s'est ouverte après la deuxième guerre mondiale. Il est fort probable que la configuration qui régnait jusqu'à la fin des années 1980 ait été modifiée avec la chute/métamorphose, le changement de « modèle », du capitalisme tel qu’il s’était développé en URSS et les pays qu’elle tenait sous sa coupe, avec l'élargissement et l'unification du marché mondial, ce nouvel épisode si mal nommé : la « mondialisation ». De ce fait, la baisse du taux de profit ne peut pas se comprendre sans prendre en compte l’espace géo historique dans lequel elle s'inscrit et ce qui apparaît comme une évolution/métamorphose sous l’effet des modifications intervenues dans le marché mondial. Cette loi n’est pas une loi abstraite, désincarnée, a historique, une loi transcendante[156] mais un phénomène matériel qui ne peut pas être totalement détaché de l’histoire réelle.
3.3.3 Une conception ricardienne extravagante
Dans sa représentation de la baisse du taux de profit, Marcel Roelandts opte pour la plus mauvaise. Il se place dans la logique ricardienne (les « rendements décroissants ») de la baisse du taux de profit, mais prétend ouvrir, à travers elle, une perspective à la crise[157]. Marcel Roelandts ne tient pas compte de la spécificité de cette baisse brutale du taux de profit qui caractérise la suraccumulation du capital. Il est conduit pour justifier son point de vue à une représentation extravagante de l'accumulation capitaliste en passant du plan du capital total au plan du capital individuel, en faisant jouer à la concurrence un rôle contradictoire, pour justifier l'injustifiable.
La séquence est la suivante :
- Première époque : le taux de profit baisse suite à une accumulation qui se révèle peu profitable. Nous sommes sur le plan du capital total
- Deuxième époque : les capitalistes individuels se voient contraints d'accélérer l'accumulation du fait de la baisse du taux de profit. Nous sommes passés au plan du capitaliste individuel. Il permet de justifier un comportement dont la probabilité serait beaucoup plus faible sur le plan du capital total.
3.3.4 Le rôle contradictoire de la concurrence
Cette transition entre les deux époques est facilitée par une incompréhension du rôle de la concurrence et des manipulations de citations de Marx.
Il est certain que pour Marx, la concurrence n’était pas ce deus ex machina qui intervient si souvent dans l’économie vulgaire pour faire office d’explication.
Marcel Roelandts ne l’ignore pas et dans cette perspective, il cite Marx : « C'est la baisse du taux de profit qui suscite la concurrence et non l'inverse ». Cette première citation lui permet de justifier la transition entre les deux époques.
Selon Marcel Roelandts, l'accumulation du capital, à un moment donné, se traduit par une baisse de la rentabilité. Celle-ci, loin de décourager les capitalistes, les pousse au contraire, sous l'effet de la concurrence, à accroître leur effort d'accumulation. Ce dernier aboutit à une profitabilité encore plus dégradée qui conduit, on ne sait pourquoi, à « (…) une crise et un ralentissement de l’activité économique qui restreint la demande finale : baisse des investissements en capital fixe et donc de l’accumulation, faillite des entreprises qui sont trop en-deçà du taux de profit moyen, (…) » (Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, Editions Contradictions, p.23)
Dans l'interprétation de Marcel Roelandts on a donc, dans un premier temps, la baisse du taux de profit qui suscite la concurrence puis, dans un second temps, la concurrence qui suscite la baisse du taux de profit. Des esprits généreux, mais néanmoins naïfs, y verraient de la dialectique ; pour notre part, nous assimilerons plutôt ce genre de raisonnement à la pratique du bonneteau. En deux temps, Marcel Roelandts fait une proposition puis la proposition inverse[158]. La première est conforme à l’esprit de Marx, la seconde lui tourne le dos.
3.3.5 Les variations du taux d’accumulation de la plus-value
Le tour de passe-passe de Marcel Roelandts induit des considérations sur le taux d’accumulation qui sont également autant de contradictions. Après avoir dénaturé le sens de suraccumulation[159], ce qui facilite d’autant plus sa propension à en évacuer les spécificités, Marcel Roelandts établit de fait le schéma intellectuel suivant :
- Première époque : l’accumulation de la plus-value se révèle peu profitable.
- Deuxième époque : la concurrence provoque, en dépit de la baisse du taux de profit, une accélération de l’accumulation et donc, dans ce cadre théorique, une élévation du taux d’accumulation de la plus-value.
- Troisième époque : ralentissement de l’activité économique (associé à la « crise ») qui cette fois induit une baisse du taux d’accumulation et donc une baisse de la demande finale.
Entre la deuxième et la troisième époque, les mêmes causes produisent des effets différents. Ici aussi, on pourrait en appeler à la dialectique mais ce n’est pas la réalité qui est contradictoire, c ‘est la représentation inconsistante de Marcel Roelandts. Lors de la deuxième époque, la baisse du taux de profit entraîne (avec l’argument fallacieux de la concurrence) une élévation du taux d’accumulation. Pourquoi ce phénomène s’inverserait-il lors de la troisième époque, celle de la pseudo-crise ? En effet, pourquoi seule la baisse du taux de profit de la troisième époque serait-elle synonyme de crise ? Seule la variation du taux d’accumulation est le vecteur de la crise. La baisse du taux de profit, interprétée à la mode ricardienne, est un pur enjolivement externe, une décoration « orthodoxe » pour agrémenter le décor « marxiste » de la crise, mais, au fond, elle est inutile pour son propos. La meilleure preuve est que son maître à penser, Michel Husson, clame[160] que le taux de profit ne baisse pas et pourtant développe le même schéma intellectuel
3.3.6 De l’art de fausser les citations
Pour tenter d'apporter du crédit à son interprétation d’un accroissement du taux d’accumulation avec un taux de profit en baisse (deuxième époque), Marcel Roelandts se livre à une manipulation d’une citation de Marx.
La citation est la suivante : « la baisse du taux de profit et l'accumulation accélérée ne sont que des expressions différentes du même processus (...)»
Nous avons déjà eu à commenter cette citation qui, décidément, est un bon point d'appui pour les faussaires, à propos de la théorie de Grossmann. Nous avons montré comment ce dernier la truquait de manière éhontée. Grossmann a trouvé en Marcel Roelandts un bon élève.
Relisons donc la citation dans son entier :
« La baisse du taux de profit et l'accumulation accélérée ne sont que des expressions différentes du même processus : elles expriment toutes deux le développement de la productivité du travail. De son côté, l'accumulation accélère la baisse du taux de profit, dans la mesure où elle implique la concentration du travail sur une grande échelle et, par suite, une composition supérieure du capital. D’autre part, la baisse du taux de profit accélère également la concentration du capital et sa centralisation par l’expropriation des petits capitalistes, du dernier des producteurs directs chez qui il y a encore quelque chose à exproprier. Ainsi, l'accumulation se trouve accélérée, quant à la masse[161], bien que le taux d'accumulation baisse avec le taux de profit. » (Marx, Capital, L.III, La Pléiade, T.2, p. 1024 – souligné par nous)
Marx énonce donc l’inverse de ce qu’on veut lui faire dire. Le taux d’accumulation baisse avec le taux de profit. Comme nous l'avons déjà fait remarquer la tendance du taux d'accumulation est plutôt en phase avec celle du taux de profit. Les théories de Grossmann comme l'interprétation de Marcel Roelandts supposent une élévation du taux d'accumulation avec la baisse du taux de profit, ce qui est un cas de figure qui, sans être impossible, est moins probable que l'inverse. Qui plus est, il ne s'agit pas ici de conjoncture, de cas particuliers ou de tendances passagères, mais de comportements systématiques et systématisés.
On aboutit donc à une conclusion, sur la base de pratiques de faussaires, qui est aux antipodes de la théorie de Marx. Pour Marx, la tendance de l'accumulation capitaliste est d'accroître la masse de plus-value accumulée tandis que le taux d'accumulation a tendance à baisser avec la baisse du taux de profit. En d'autres termes, le taux d'accumulation a tendance à épouser le comportement du taux de profit (élévation du taux quand le taux de profit s'élève et baisse du taux d'accumulation quand le taux de profit baisse).
3.3.7 La suraccumulation accélérée
Revenons un peu plus en détail sur l’opération de dénaturation du concept de suraccumulation que nous avons évoquée en note dans le chapitre 3.3.5.
Dans un premier temps, Marcel Roelandts fait l’amalgame entre baisse tendancielle du taux de profit et suraccumulation. « La suraccumulation, la baisse tendancielle du taux de profit et la pénurie de plus-value ne sont que différentes manifestations d’une même réalité (…) » (Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, Editions Contradictions, p.23).
Puis il trace un lien, qui est effectivement chez Marx mais dont nous avons vu que Marcel Roelandts en manipulait, en falsifiait, le sens effectif, entre baisse du taux de profit et accélération de l’accumulation.
Il ne reste plus qu’à confondre suraccumulation (c’est-à-dire surproduction de capital) et accumulation accélérée du capital. « En effet, chaque capitaliste est contraint par les impératifs de la reproduction élargie à investir de plus en plus sous peine de disparaître : c’est la suraccumulation ou « accumulation accélérée » comme l’appelle Marx. » (Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, Editions Contradictions, p.23).
En trois mouvements, Marcel Roelandts a ramené Marx dans le giron du marxisme de la chaire.
Tout l‘échafaudage vulgaire de Marcel Roelandts a un inspirateur : Michel Husson. Evidemment, les disciples de Mandel ne jurent que par la concurrence[162] mais celle-ci ne peut en rien expliquer la baisse du taux de profit. C’est une vision qui remonte à Adam Smith[163].
Michel Husson commence par distinguer la suraccumulation et la surproduction.
« On peut repérer deux contradictions absolument centrales qui combinent une tendance à la suraccumulation, d’une part, à la surproduction d’autre part. » Michel Husson, Accumulation et crise, 2004.
Par suraccumulation, on comprend que sous l’effet de la concurrence, les capitalistes sont poussés à surinvestir et du même coup à établir les bases d’une surproduction qu’une sous-consommation relative, due à la limitation du pouvoir d’achat, va précipiter.
Marx ne dit rien de tel puisqu’il assimile suraccumulation et surproduction de capital. Les deux termes sont synonymes. En employant le terme de suraccumulation en équivalence à la surproduction de capital, Marx veut montrer que nous avons à faire à une forme spécifique de la crise de surproduction. Ici, celle-ci n’est pas seulement une surproduction de marchandises, c’est-à-dire une crise de surproduction résultant d’un excédent de la plus-value en tant que surproduit. Ici, la crise provient d’une production insuffisante de plus-value en tant que survaleur. Il veut donc montrer que cette surproduction trouve son origine dans la sphère de la production capitaliste, qu’elle résulte d’une production insuffisante de plus-value. Il s’agit donc dans ce cas non plus seulement d’une surproduction de marchandises mais d’une surproduction de capital. Son ressort n’est pas la concurrence qui pousserait à augmenter le taux d’accumulation en créant des capacités de production excédentaires mais une baisse brutale du taux de profit, due à une production insuffisante de plus-value, qui va rendre excédentaire les capacités de production (le capital productif), le capital argent, les marchandises (capital marchandise) et la force de travail.
C’est donc falsifier le sens de suraccumulation que de le séparer de celui de surproduction.
3.3.8 Le marxisme de la chaire et l’entreprise
Un grand avantage, mais aussi inconvénient, qu’a le marxisme de la chaire sur le prolétariat c’est qu’il n’a jamais mis les pieds dans une entreprise. Marx non plus, direz-vous, mais il était renseigné par l’entrepreneur capitaliste Engels. Ici, nous avons affaire à des penseurs de l’université, un ensemble de professeurs docteurs, habitués et habilités à raisonner abstraitement sur de grandes catégories intellectuelles, bref de vrais rois du concept.
Le capital, le taux de profit sont la pâture intellectuelle dont se délecte le marxisme de la chaire sans même soupçonner que ces concepts de déploient dans la réalité des entreprises, ces cellules élémentaires de la production capitaliste. Les petites entreprises (les bêtes noires du socialisme) y pullulent[164]. Nous pouvons illustrer rapidement la situation actuelle en France, par exemple.
L’Insee, qui utilise de nouvelles catégories (que nous ne commenterons pas ici) depuis 2008, classe les entreprises (hors agriculture[165]) de la façon suivante (données 2007) :
|
|
Micro entreprises |
PME non micro |
ETI (taille intermédiaire) |
Grandes entreprises |
|
Nombre |
2 660 000 |
162 400 |
4 510 |
219 |
|
% des entreprises |
94% |
5% |
<1%o |
<1%oo |
|
% de l’emploi salarié |
21% |
29% |
20% |
30% |
Evidemment, ce n’est pas au niveau de l’entreprise qu’il faut parler de taux de profit moyen. Celui-ci y est plutôt l’exception que la règle. Le taux de profit moyen non seulement se situe au niveau des branches d’industrie mais également au niveau de capitaux rassemblés au sein de groupes capitalistes qui investissent, achètent et vendent des entreprises voire des pans entiers de secteurs de l’économie (Marx fait égaliser des masses égales de capitaux), autant de facteurs (sans même parler des questions liées à la rente, aux impôts, à l’incidence des capitaux employant du travail non producteur de plus-value, aux relations entre le capital fictif et le capital réel, aux mouvements de contraction et d’expansion du capital, …) qui rendent absurdes les critiques relatives aux soi-disant erreurs de Marx au sujet de la transformation de la valeur en prix de production (un des grands sujets de débat au sein du marxisme de chaire).
La disparition des entreprises[166] implique qu’elles perdent de l’argent, que structurellement leur activité soit déficitaire. Une perte, par ailleurs, n’engendre pas nécessairement la fin d’une entreprise, mais suppose si elle n’est pas purement conjoncturelle, la recherche d’une nouvelle organisation, de nouveaux marchés, etc. Plus les capitaux propres, pour parler comme les comptables, sont importants et plus elle pourra faire face. Plus le crédit est facile à obtenir plus les à-coups éventuels pourront être lissés. En même temps, ces facteurs préparent la crise de surproduction à une échelle plus grande
Par conséquent, c’est une vue de l’esprit, comme sait en produire le marxisme de la chaire, que d’annoncer, comme corollaire de la crise, la «faillite des entreprises qui sont trop en deçà du taux moyen de profit » (Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, Editions Contradictions, p.23). Ce n’est pas qu’une entreprise qui ne fasse pas assez de profit ne puisse pas être revendue, ni que sa direction ne cherche pas à améliorer sa rentabilité, ni que des profits insuffisants ne puissent pas être un obstacle pour son développement dès lors que des investissements conséquents seraient nécessaires pour rester sur le marché, mais écrire que les entreprises faiblement profitables font faillite est une pure représentation intellectuelle qui est à la fois fausse théoriquement (l’égalisation des taux de profit ne se situe pas à ce niveau) et pratiquement (a-t-on vu des entreprises même faiblement rentables faire faillite ?)[167]
La question est évidemment bien différente quand l’entreprise est confrontée au défaut de paiement d’un client qui dépose son bilan ou fait faillite. Elle découvre brutalement que son actif est fait pour une grande part de capital fictif (elle n’a à travers ses factures en cours et les contrats signés que des reconnaissances de dettes en échange d’un crédit client ; quant à son compte en banque, il est à la merci d’une faillite bancaire) et peut alors être entraînée vers le fond, tandis que ses résultats virent au rouge. Donc, nous ne sommes plus, dans ce cas, dans la faible profitabilité ou la profitabilité amoindrie du fait d’un choc externe (nonobstant le fait que toutes les entreprises font ici ou là de mauvaises affaires) mais dans le monde de la perte.
En fait, à travers cet argument qui n’en est pas un, Marcel Roelandts essaye d’introduire, en contrebande, une crise résultant de la baisse du taux de profit alors qu’il n’a fourni aucune justification quant à ses modalités. Nous avons vu qu’il y a une bonne raison à cela : son ignorance de l’articulation entre baisse tendancielle du taux de profit et suraccumulation de capital.
3.3.9 Le marxisme de la chaire et la statistique
Si le marxisme de la chaire ignore volontiers l'entreprise, il a une prédilection pour les statistiques macro-économiques et tout particulièrement pour l'économétrie[168], cette pratique à base de grandes équations derrière lesquelles s'agitent de petits hommes animés par des théories pitoyables.
Les déviations théoriques comme celles que nous mettrons en évidence à propos du capital fixe, les débats oiseux sur le taux de plus-value, la composition organique et le taux de profit, sont à mettre en résonance avec ce besoin de traitement statistique.
Il n'est pas dans notre intention de contester l'usage en soi de ces statistiques bien qu'elles soient traitées selon des processus techniques toujours délicats et sur la base de théories opposées aux nôtres. Il est de ce fait très difficile de les mettre en adéquation avec la théorie révolutionnaire afin d'en tirer des conclusions relativement pertinentes. Il est possible cependant que des analyses habiles puissent à partir des statistiques disponibles faire émerger des résultats intéressants. Au préalable, la clarté théorique est indispensable et nous en sommes loin.
3.3.10 Le capital fixe et le cycle
3.3.10.1 Capital fixe et capital constant
Marcel Roelandts a une prédilection pour le capital fixe. Cette passion est si forte qu'il en dénature le processus de l'accumulation. Par exemple, il écrit cette phrase, plutôt sibylline en première approche, et que nous allons essayer de comprendre.
« Après un certain temps, l’augmentation du capital consécutif aux investissements ne produit plus les mêmes gains de productivité, ces derniers ne parviennent plus à compenser les dépenses consenties en nouvelles machines pour les obtenir. L’accumulation subit alors des rendements décroissants : (…) » (Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, Editions Contradictions, p.13)
Marcel Roelandts parle ici d’ « investissements », apparemment assimilés uniquement au capital fixe alors que l’accumulation suppose l’accumulation de capital constant - dont le capital fixe n’est qu’une partie – et de capital variable, pour nous en tenir au capital productif.
D’autre part, l’idée que les gains de productivité ne parviennent plus à compenser les dépenses consenties en nouvelles machines vient corroborer l’impression que Marcel Roelandts ne se préoccupe que de la partie fixe du capital constant.
Mêlant allègrement les concepts de l’économie politique bourgeoise, les concepts de Marx et les interprétations de l’économie politique marxiste vulgaire, Marcel Roelandts aboutit à un salmigondis conceptuel où la théorie de Marx est totalement diluée. En combinant une alouette de Marx, une mule d’économie politique marxiste vulgaire et un âne d’économie politique bourgeoise vulgaire, Marcel Roelandts prétend produire un pâté d’alouette labellisé marxiste orthodoxe bio ! Et l’on voudrait que l’on ne crie pas au scandale !
3.3.10.2 Capital fixe et composition organique du capital
On pourrait penser qu'il ne s'agit que d'une imprécision ponctuelle du langage, mais en fait cette confusion est systématique. Revenant sur les contre tendances à la baisse du taux de profit, Marcel Roelandts écrit :
« En fait, tout dépend de l'intensité des gains de productivité : ceux-ci diminuent le prix des machines, ce qui tend à compenser leur acquisition en nombre croissant. » (Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, Editions Contradictions, p.33) puis plus loin « Il en va de même de la composition organique du capital. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, celle-ci n'augmente pas inéluctablement : tout dépend des gains de productivité qui viennent compenser l'utilisation croissante de machines en diminuant le prix de celles-ci. C'est la raison pour laquelle la composition organique du capital ne fait que fluctuer : à la hausse quand l'accroissement du nombre de machines par travailleur (la composition technique du capital) est supérieur aux gains de productivité (faisant diminuer leur prix) et à la baisse dans la configuration inverse. » (Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, Editions Contradictions, p.34).
Marcel Roelandts identifie donc le numérateur de la composition organique du capital au seul capital fixe. Dans le livre I, comme dans le livre III, Marx expose ce qu’il entend par composition organique du capital. Il distingue la composition valeur (le rapport entre la valeur du capital constant et la valeur de la force de travail, la masse des salaires) et la composition technique (le rapport entre la masse des moyens de production et la quantité de travail nécessaire pour les faire fonctionner). La composition organique du capital est la composition valeur pour autant qu’elle reflète la composition technique. Il est donc navrant d'avoir à rappeler que la composition organique (qui unifie la composition technique et la composition valeur ou plus exactement qui est la composition valeur dans la mesure où elle reflète la composition technique[169]) rapporte le capital constant (c'est-à-dire le capital qui au sein du procès de production ne fait que transmettre sa valeur au capital marchandise issu de ce procès de production. Il comprend donc notamment, outre le capital fixe, les matières premières, combustibles et autres sources d'énergie, etc., bref tout le capital constant circulant) au capital variable.
Toutes choses égales par ailleurs, le développement de la productivité du travail accroît la masse des matières premières utilisées dans le procès de production et par conséquent la composition organique du capital. Par exemple, si à partir d'une nouvelle organisation du travail et l'introduction de machines favorisant le développement de la productivité du travail, on produit deux fois plus de chaussures par personne, il faudra utiliser deux fois plus de cuir, deux fois plus de clous ou de colle, de fil, de lacets, etc. Autant de facteurs qui, outre le capital fixe, accroissent la composition organique du capital. Le développement de la productivité dans les sphères amont de la filière comme le cuir par exemple, auront également un effet contrecarrant voire annihilant la hausse de la composition valeur. Il en ira de même de la hausse de la productivité dans les entreprises qui produisent les machines et autres composantes du capital fixe ; celui-ci étant par ailleurs plus particulièrement soumis au processus d'obsolescence qui contribue à sa dévalorisation. Ces facteurs montrent que le changement dans la composition valeur « n’indique que de loin le changement dans la composition technique »[170]. D'un autre côté, au dénominateur de la composition organique nous avons le capital variable dont les évolutions ont également une influence sur la composition valeur.
La hausse de la composition organique du capital, d’une part, ne doit pas être assimilée au rapport entre le capital fixe et le capital variable et, d’autre part, ne doit pas être comprise dans une logique continuiste ou tendances et contre-tendances s’opposent en permanence pour aller dans une direction que l’on a tôt fait de qualifier d’indéfinie. La hausse de la composition organique doit traduire, refléter, l’augmentation de la composition technique (évidente dès lors qu’il y a augmentation de la productivité). Des sauts dans la composition technique, des discontinuités dans le processus de production ou de nouvelles techniques et organisation du travail induisent un bond dans la productivité du travail. La composition valeur est alors le reflet du changement intervenu dans la composition technique. Il ne s’agit donc pas de suivre les fluctuations de la valeur et des prix pour une composition technique donnée. Empêtrés dans des conceptions absurdes, nos économistes[171] sont souvent prompts, pour stabiliser une partie des mouvements de la composition organique, a en changer le statut en rapportant le capital contant à l’ensemble du travail vivant c/v+pl.
Nous laisserons ici ce sujet qui d'ailleurs est encore plus complexe que ce qui ressort des la présentation lénifiante qu’en fait Marcel Roelandts. Notamment, les mouvements de la composition organique ne sont pas liés uniquement à l’accumulation de la plus-value mais à la reproduction du capital dans son ensemble (y compris l’arrivée de nouveaux entrants plus facilement porteurs d’innovations)
3.3.10.3 Capital fixe et révisionnisme statistique
Toutes ces approximations ont pour but, d'une part, de ramener la théorie dans le cadre des catégories statistiques utilisées et réalisées par la bourgeoisie. La théorie est de ce fait dénaturée sous prétexte de rendre compte de faits à partir des outils statistiques existants. D'autre part, elle articule baisse du taux de profit et capital fixe de manière inadéquate. On ajoute ainsi encore plus de confusion tant à la théorie de la baisse du taux de profit qu’aux considérations propres au capital fixe (notamment pour ce qui relève de la détermination du cycle).
3.3.10.4 La rotation du capital fixe et le cycle
Reprenant la question de la temporalité du premier axe explicatif des crises qu'il a mis en évidence (la difficulté d'extraire suffisamment de plus-value), Marcel Roelandts nous dit que cette difficulté « plonge ses racines dans la nécessité d'accroître le capital constant au détriment du capital variable ; son rythme est donc essentiellement lié, d'une part, aux cycles plus ou moins décennaux de rotation du capital fixe et, d'autre part, aux rendements décroissants des gains de productivité sur le moyen terme (+/- 25 à 30 ans) » (Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, Editions Contradictions, p.16).
Dans la note attachée à ce passage, Marcel Roelandts précise :
« Déjà dans Le Capital, mais encore plus dans sa correspondance avec Engels, Marx est sans ambiguïté sur le fait qu'il rattache les cycles décennaux d'accumulation et de croissance principalement à l'alourdissement du capital fixe, ce qui induit un retournement du taux de profit. Précisons encore que Marx fait de la période décennale une moyenne et non un absolu. »
L'exposé de Marcel Roelandts est particulièrement négligent.
Marx, il est vrai, a cherché toute sa vie à mettre en évidence une relation entre la périodicité du cycle et la durée de la rotation du capital fixe. Il serait également juste d’affirmer que l'alourdissement du capital fixe, son importance relative croissante dans le capital avancé est un facteur qui accroît l'incidence du capital fixe dans la détermination du cycle. Mais, il est inexact de dire que :
1° les cycles sont rattachés principalement à cette augmentation du capital fixe.
Marx (Marcel Roelandts le cite) nous dit qu'il s'agit d'une des bases matérielles du cycle et non de la base matérielle principale. Outre la problématique propre à la rotation du capital fixe, il y a au moins à prendre en compte le cycle de l'accumulation lui-même (en intégrant le mouvement valorisation dévalorisation du capital, l’évolution du taux de profit au sein du cycle) qui parcourt différentes phases caractéristiques de la conjoncture du cycle[172], le cycle financier avec le développement du crédit et l'incidence du capital fictif, les réactions liées à l'intervention de l'Etat notamment en matière de politique monétaire, économique, fiscale, … et last but not least le niveau de la lutte des classes. Il y a donc une grande conjonction de facteurs[173] au sein desquels la rotation du capital fixe est une composante.
2° le taux de profit et le capital fixe sont ici à mettre en relation (Marcel Roelandts parle d’ « alourdissement » et de « retournement »).
Dans ces dernières appréciations sur la relation entre le capital fixe et le cycle, Marx insiste sur la différence entre la valeur du capital fixe qui est libérée par fractions, en fonction de son usure et son existence en tant que valeur d'usage où il accomplit complètement son rôle tant qu'il est en état de fonctionner. En étudiant, la reproduction du capital dans les schémas éponymes, Marx constate que la reproduction du capital fixe peut théoriquement s'accomplir sans heurts, aussi insiste-t-il sur les variations dans l'accumulation de ce capital pour étayer la perspective d'un cycle correspondant à la rotation du capital fixe. Si l'inachèvement des travaux de Marx sur ce sujet ont pu ouvrir une perspective révisionniste dont Mattick est un bon représentant[174], l'erreur symétrique serait d'en faire une composante mécanique et principale du cycle.
La dimension cyclique induite par la reproduction du capital fixe ne vient pas de son « alourdissement » progressif au cours du cycle pour précipiter le « retournement » du taux de profit à la fin de celui-ci, ce qui serait une conception mécanique de la plus belle eau. Après avoir écarté la baisse tendancielle du taux de profit au sein du cycle, on réintroduirait une baisse mécanique de celui-ci.
Ce qui est en jeu pour Marx est de montrer que la reproduction du capital fixe contient un élément cyclique. Il n’y est jamais complètement parvenu. Il appartient donc au mouvement communiste de démontrer et notamment de démontrer mathématiquement que les variations de l'accumulation du capital fixe contiennent une dimension cyclique et que la longueur de ce cycle est égale à la période de rotation du capital fixe.
3° le cycle envisagé par Marx est décennal sans dire que dans son esprit, la durée de ce cycle irait en se raccourcissant.
Cette perspective n'est pas indiquée dans des brouillons ou parmi des travaux de recherche préparatoires mais dans le livre I du capital publié de son vivant[175]. Bien entendu, c'est ensuite aux faits de trancher et à l'analyse de mettre en évidence dans les statistiques disponibles la périodicité des crises. Depuis plus de 35 ans, nous avons mis en évidence, que conformément à la prévision de Marx, le cycle s'était raccourci et qu'il était aujourd'hui (depuis 1945 et y compris dans les soi-disant trente glorieuses) d'environ 6 ans. Ajoutons encore que Marx envisageait l'existence de crises intermédiaires (susceptibles d’atténuer la crise générale), à l'instar de ce qui s'était passé avant 1848 où le cycle, si l'on tenait compte de ces crises intermédiaires, paraissait être de cinq ans environ[176]
4. La sous-consommation et les crises
4.1 L’unité de la théorie de Marx
4.1.1 Une unité malmenée
Une pratique habituelle des adversaires de Marx est d’essayer d’opposer Marx à lui-même. On retrouve cette démarche pour ce qui concerne les théories explicatives des fondements des crises. Opposer un Marx partisan de la baisse du taux de profit, de la suraccumulation, de la surproduction à un Marx sous-consommationniste est une attitude fréquente[177]. N’est-ce pas d’ailleurs là dessus, chacune s’appuyant sur un chapelet de citations, que se séparent les deux tendances du marxisme de la chaire que nous avons passées en revue ?
Il y a pourtant une profonde unité dans la théorie des crises de Marx. C’est d’ailleurs, nous l’avons vu, une des promesses du projet de Marcel Roelandts que de nous faire sentir cette unité, de dépasser les apparentes contradictions et les écoles concurrentes pour nous livrer une synthèse unitaire de la théorie de Marx. A la différence d'un Mattick pour qui la séparation en deux tendances reposait sur l'ambiguïté des formulations marxiennes[178], Marcel Roelandts s'efforce de dépasser cette fausse opposition et de présenter une théorie globale ; ceci constitue la dimension orthodoxe de son projet.
Nous avons dit que nous montrerions que, malheureusement, ce projet ne se traduit pas par un dépassement critique mais reprend le plus mauvais de chaque tendance pour aboutir à une synthèse[179] catastrophique pour la théorie révolutionnaire. Dans les chapitres précédents, nous avons mis en évidence que Marcel Roelandts avait repris bon nombre des points les plus sombres des théories de la suraccumulation. Nous avons montré qu’il ne développait qu'une vision rabougrie et intrinsèquement erronée de la perspective marxienne pour se rallier aux interprétations les plus sommaires de l'économie politique marxiste vulgaire, interprétations qui aboutissent à éterniser l'existence du mode de production capitaliste et à justifier la pratique et la politique de la social-démocratie. Nous allons voir qu'il en est de même pour ce qui relève de ce qu'on range traditionnellement sous l'étiquette « sous-consommationniste »
Nous avons également rappelé que le cycle de l'accumulation via la recherche du maximum de plus-value et le procès valorisation/dévalorisation conduisait à la nécessité des crises. Périodiquement, ces crises prennent la forme soit d’une surproduction de capital (suraccumulation) soit d’une surproduction de marchandises. Ces sont les deux écueils entre lesquels navigue l’accumulation du capital. Ils ont, quant au fond, la même origine, ils sont des expressions différentes de la même limite en liaison avec le procès valorisation/dévalorisation du capital. Ce cycle est au fondement de la production capitaliste et s'articule avec le cycle financier[180] et le cycle du capital fixe qui est lui-même un facteur de crise et un élément susceptible d'affermir la régularité du cycle. L'ensemble de ces éléments s’insère sur une période qui s'étend sur plusieurs cycles et dans un cadre géo-historique donné ; le mouvement du capital s’y exprime dans la loi de la baisse tendancielle du taux de profit.
4.1.2 Une unité éclatante
Comme nous l’avons dit, il y a une profonde unité dans la théorie de Marx. Un passage des manuscrits de 1857-1858 (Grundrisse), que nous citons intégralement du fait de son importance, nous le montre explicitement :
« Le concept simple de capital doit contenir en soi ses tendances civilisatrices, etc., et non les faire apparaître, comme l’ont fait les théoriciens de l’économie jusqu’à présent, comme de simples conséquences extérieures. De même, il faut montrer que les contradictions qui surgiront plus tard s’y trouvent de façon latente.
Jusqu’ici, nous avons seulement mis en évidence l’indifférence réciproque des moments singuliers du procès de valorisation [Marx a montré que les disproportions étaient une nécessité permanente NDR] ; qu’intérieurement ils se conditionnent et qu’extérieurement ils se cherchent ; mais qu’ils peuvent se trouver ou ne pas se trouver, se recouper ou non, correspondre ou non les uns aux autres. La nécessité interne de ce qui forme un tout ; en même temps que son existence autonome et indifférente qui constitue déjà la base de contradictions.
Mais nous sommes loin d’en avoir terminé. La contradiction entre la production et la valorisation – dont le capital, selon son concept, constitue l’unité – doit être appréhendée de façon encore plus immanente, comme manifestation indifférente et apparemment indépendante des différents moments singuliers du procès, ou, plus exactement, de la totalité de plusieurs procès qui s’opposent.
Essayons de préciser la chose : D’abord il existe une limite inhérente, non à la production en général, mais à la production fondée sur le capital. [souligné par Marx NDR] Cette limite est double, ou, plutôt, il s’agit d’une seule et même limite, envisagée dans deux directions. [Souligné par nous, NDR]. Il suffit de montrer ici que le capital contient une limitation particulière de la production – contredisant sa tendance générale à dépasser tous les obstacles qui entravent cette production -, pour découvrir du coup la cause de la surproduction, la contradiction fondamentale du capital développé ; pour découvrir tout simplement que le capital n’est pas, comme le pensent les économistes, la forme absolue de développement des forces productives – ni une forme de la richesse qui coïnciderait absolument avec le développement des forces productives. Les stades de la production antérieurs du capital apparaissent, si on les envisage du point de vue du capital, comme autant d’entraves aux forces productives. Mais le capital lui-même, si on le comprend bien, apparaît comme une condition du développement des forces productives, aussi longtemps qu’elles ont besoin d’un stimulant extérieur, lequel apparaît en même temps comme une bride qui les freine. Une discipline qui leur est imposée, et qui devient superflue et gênante lorsqu’elles ont atteint un certain niveau de développement ; de même les corporations, etc. Ces limites immanentes doivent coïncider avec la nature du capital, avec ses déterminations essentielles et fondamentales. Ces limites nécessaires sont :
1) le travail nécessaire comme limite de la valeur d’échange de la puissance de travail vivante ou du salaire de la population industrielle ;
2) la survaleur comme limite du surtemps de travail et, par rapport au surtemps de travail relatif, comme obstacle au développement des forces productives ;
3) ce qui est la même chose, la transformation en argent, la valeur d’usage tout simplement comme limite de la production ; ou encore l’échange fondé sur la valeur ou la valeur fondée sur l’échange comme limite de la production. C’est :
4) la même chose encore, en tant que limitation de la production de valeurs d’usage par la valeur d’échange ; ou encore que la richesse réelle doit, pour devenir un objet de la production, prendre une forme déterminée, différente de la valeur d’échange elle-même et donc pas absolument identique à elle.
D’autre part, il résulte de la tendance générale du capital (le même phénomène se manifestait dans la circulation simple lorsque l’argent n’apparaissait que comme un moyen de circulation évanescent, sans nécessité autonome et donc n’apparaissait pas comme limite et obstacle) qu’il ne tient pas compte et fait abstraction :
1) du travail nécessaire en tant que limite de la valeur d’échange de la puissance de travail vivant ; 2) de la survaleur en tant que limite du surtravail et du développement des forces productives ; 3) de l’argent en tant que limite de la production ; 4) de la limitation par la valeur d’échange de la production de valeur d’usage.
Hinc (d’où), la surproduction : c’est-à-dire le souvenir soudain de tous ces moments nécessaires de la production fondée sur le capital ; d’où la dévalorisation générale suite au fait qu’on les avait oubliés. Et, en même temps, l’obligation dans laquelle se trouve le capital de reprendre sa tentative à partir d’un niveau de développement des forces productives plus élevé et, ce, en étant toujours plus affaibli en tant que capital. De ceci, il ressort clairement que, plus le capital est développé, plus il apparaît comme un obstacle à la production – et donc aussi à la consommation -, sans parler des autres contradictions qui le font apparaître comme un obstacle gênant pour la production et les échanges » (Marx, Manuscrits de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, .T.1, p.354-356)
Dans notre compréhension de ce passage que relevons-nous ? Quand Marx parle de deux directions, il vise la sphère de la production et la sphère de la circulation, de la reproduction ou encore la production vue sous l’angle des limites posées par la valeur d’échange et la production sous l’angle des limites posées la valeur d’usage. Quant à la limite unique, que Marx a ensuite décomposée sous quatre aspects, quatre sous-limites, c’est le capital lui-même. Le capital est la valeur en procès, valeur à la recherche d’un maximum de plus-value. Dans ce procès, la contradiction valorisation/dévalorisation se traduit par des limites dans l’extraction de la plus-value. Ces limites relèvent de la sphère de la production, de la production de valeur d’échange, de la production de plus-value en tant que survaleur. Mais, il existe aussi des limites liées à la valeur d’usage. C’est le cas avec le passage d’une forme de la valeur à une autre, lors de la réalisation du produit social, du fait de la forme valeur elle-même, du fait que la valeur s’exprime en argent et que donc l’ensemble du produit social a un caractère mercantile. C’est également le cas quand on considère la forme matérielle du produit social. Sous ce terme on regroupe deux choses qu’il faut distinguer. D’une part, la composition matérielle du produit social : sous ce terme on vise la distinction entre moyens de production et moyens de consommation, entre marchandises destinées à la consommation productive – matières premières, machines, … - et marchandises destinées à une consommation non productive (consommation individuelle – moyens de consommation nécessaires, moyens de consommation de luxe – ou consommation collective) ; d’autre part, la masse, le volume des valeurs d’usages produites. On touche ici aux limites de la production de plus-value en tant que surproduit.
Les limites inhérentes à la sphère de la production se référent aux contradictions qui surgissent sur la base du mouvement de la valeur, des rapports de valeur, de la production du maximum de plus-value. Elles relèvent donc de la première direction évoquée par Marx. Elles se traduisent, dans le cadre du procès valorisation/dévalorisation, par le fait que, sous l’influence du développement de la productivité du travail, la survaleur s’accroît tandis que le temps de travail nécessaire diminue la valeur de la force de travail comme celle des autres marchandises. En se valorisant, le capital se dévalorise, et la valeur en procès, c’est-à-dire le capital, vient à être niée dans ce mouvement. Tandis que d’un autre coté pour accroître le surtravail, il faut un développement toujours plus conséquent de la productivité du travail. L’extraction d’une unité de plus-value supplémentaire demandant un accroissement plus que proportionnel de la productivité. Ces limites (sous-limites) sont inhérentes à la sphère de la production et relèvent de la première direction de la limite inhérente au capital évoquée par Marx.
Une autre limite (sous-limite) tient à la réalisation de la valeur-capital en argent, dont nous avons vu qu’elle n’avait rien d’automatique et qu’elle contenait la possibilité des crises. Elle ouvre la deuxième direction de la limite inhérente au capital dont parle Marx. Les limites propres à la sphère de la circulation mais qui sont la continuation des contradictions de la production fondée sur le capital. C’est pour cela que Marx nous dit qu’en fait il s’agit d’une limite unique dans deux directions. Ici, ce sont les contradictions entre la valeur d’échange et la valeur d’usage, entre la production et la réalisation, entre la marchandise et l’argent qui sont mises en relief.
Une dernière limite (sous-limite) reliée par Marx aux précédentes appartient également à cette deuxième orientation qui vise la sphère de la circulation. Il ne lui est prêté, généralement, qu’une attention insuffisante. Il s’agit de la forme que revêt le produit social, c’est-à-dire d’une part, les valeurs d’usage qui le constituent, la composition matérielle du produit social, sa destination (moyens de production, moyens de consommation) et d’autre part son volume, la masse des marchandises produites. Ces dimensions induisent, dans le cadre de la production capitaliste, une contradiction, une limite particulière que nous expliciterons.
Ces deux dernières limites, composantes de la deuxième direction, sont justement caractéristiques des contradictions mises en évidence par les théoriciens de la sous-consommation.
Pour autant si ces orientations, ces contradictions, ces limites ont une origine commune dans le mode de production capitaliste, elles peuvent se manifester de manière autonome[181]. La première orientation conduit à une crise de suraccumulation. Une surproduction de capital et par voie de conséquence de marchandises, en relation avec une insuffisance de plus-value et une baisse soudaine du taux de profit du fait d’une expansion insuffisante de la production et de la baisse du degré de développement de la force productive du travail qui y correspond. Notons que cette suraccumulation fonde aussi la nécessité des crises tandis que leur possibilité est donnée par la contradiction entre la marchandise et l’argent, du fait que la réalisation ne va pas de soi et qu’elle dépend du niveau du taux de profit. Dans le cas de la surproduction de capital, toutes les contradictions, toutes les limites s’unissent pour culminer dans la crise générale de surproduction[182]. La seconde orientation, qui possède donc son autonomie, sa spécificité, conduit à une surproduction de marchandises du fait de la trop rapide expansion de la force productive du travail et de l’incapacité de la société à l’absorber du fait des rapports entre les classes et de la forme du produit social (composition matérielle et volume). Elle se traduit de la même manière par une crise générale de surproduction qui induit une dévalorisation du capital qui elle aussi a pour fonction de reconstituer le rapport d’exploitation approprié. Il est en partie vain de s’interroger sur le fait de savoir à quelle forme de surproduction nous avons à faire dans les crises. L’accumulation du capital navigue entre les deux écueils et vient heurter régulièrement l’un ou l’autre, insuffisance de plus-value, de survaleur, du point de vue de la valeur d’échange, excédent de plus-value, de surproduit, du point de vue de la valeur d’usage, ce qui engendre les mêmes effets[183]. Si les deux aspects peuvent et doivent être distingués (insuffisance de plus-value, de survaleur – en valeur – et excédent de plus-value, de surproduit – en valeur d’usage), les deux dimensions ne sont pas nécessairement antagoniques. Si la suraccumulation a pour fondement une insuffisance de plus-value, elle induit cependant un accroissement de la masse des valeurs d’usage, pour ne rien dire de sa composition matérielle et des rapports entre les classes. Par conséquent, on ne peut exclure des cas où l’insuffisance de plus-value se combine avec l’excédent de surproduit pour converger dans la crise générale de surproduction. A un autre extrême, une croissance phénoménale de la productivité pourrait combiner un surproduit considérable et tellement dévalorisé que la survaleur additionnelle apparente serait nulle. Tous ces aspects relèvent d’une analyse du procès valorisation dévalorisation que Marx n’a fait qu’esquisser.
4.2 Les théories de la sous-consommation
4.2.1 Fondements généraux
Marx envisageait une critique complète de Sismondi, la figure de proue, plagiée par Malthus, de la tendance sous-consommationniste, dans le livre consacré à la concurrence et au crédit[184]. Elle n’a donc pas été menée à bien, puisque ce livre n’a jamais vu le jour. Dans le texte cité en note, on trouve cependant le passage suivant :
« Sismondi a le sentiment profond que la production capitaliste se contredit ; que ses formes – ses rapports de production – incitent d’une part à un développement effréné de la force productive et de la richesse ; que, d’autre part, ces rapports sont conditionnés, que leurs contradictions : valeur d’usage, valeur d’échange, marchandise et argent, achat et vente, production et consommation, capital et travail salarié, etc., prennent des dimensions d’autant plus grandes que se développe davantage la force productive. Il ressent notamment la contradiction fondamentale : d’une part développement sans entraves des forces productives et accroissement de la richesse, qui en même temps se compose de marchandises, doit être nécessairement transformé en argent ; d’autre part, comme base, limitation de la masse des producteurs aux moyens de consommation nécessaires. C’est pourquoi les crises ne sont pas chez lui fortuites, comme chez Ricardo, mais sont, à grande échelle et à des périodes déterminées, des explosions essentielles des contradictions immanentes. » (Marx, Théories sur la plus-value, Editions sociales, T.III, p.58-59)
Nous retrouvons donc les deux limites de la deuxième orientation définie dans le chapitre précédent. D’une part, la question de la réalisation du produit social qui du fait de la contradiction entre la marchandise et l’argent ouvre la possibilité d’une crise générale. D’autre part, la question de la forme du produit social (composition matérielle de celui-ci et masse des valeurs d’usage dans lequel il s’exprime) dans le cadre d’un rapport social entre les classes. Dans la citation ci dessus, l’exposé relatif à la forme du produit social, aux valeurs d’usage qui le composent, insiste ici, comme le font les théoriciens sous-consommationnistes, sur les moyens de consommation nécessaires consommés, consommation par essence limitée, par la classe productive, par le prolétariat.
En mettant en relief ces contradictions, les théoriciens sous consommationnistes admettent l’existence de crises générales, c’est-à-dire de crises affectant l’ensemble des branches de production alors que dans la conception ricardienne la surproduction dans une branche est le corollaire d’une sous production dans une autre. Sous l’angle de l’étendue de la crise, les théoriciens sous-consommationnistes conçoivent bien l’existence d’une crise générale, d’une crise qui touche tous les secteurs à la fois. En revanche, sous l’angle de la profondeur, sous l’angle de la relation avec le produit social, la crise n’en affecte qu’une partie. Il s’agit de la plus-value et généralement, au sein de celle-ci, de la fraction destinée à l’accumulation.
Ils ne comprennent pas que les limites qui se manifestent dans la sphère de la circulation et de la distribution des revenus sont à mettre en relation avec les rapports de production aussi cherchent-ils des solutions qui préconisent soit le retour à des formes de production surannées soit une nouvelle forme de distribution des revenus sans remettre en cause la production capitaliste, le salariat et l’existence de l’Etat. Dans cette représentation, les politiques salariales et fiscales, dans la mesure où elles soutiennent la demande, sont favorables à la stabilité de la production capitaliste menacée par une accumulation qui conduit à la surproduction quand elle n’est pas détournée vers des sphères spéculatives qui menacent encore plus rapidement la cohésion de l’édifice. Pour les opposants à cette analyse, en abaissant le taux de profit, en laissant l’Etat accaparer les ressources pour mieux les dilapider, ces politiques nuisent à l’accumulation et favorisent stagnation et crises.
Pour les sous-consommationnistes comme Sismondi la tendance à la crise est permanente car il existe un déséquilibre permanent, intrinsèque, structurel, entre la production et le pouvoir de consommation de la société. Pour Sismondi, les fondements des crises résultent d’un déséquilibre permanent. Dans la mesure où il considère que c'est avec le revenu de la période précédente qu'on achète le nouveau produit annuel, la crise est potentiellement permanente.
Pour Rosa Luxemburg, la plus-value à capitaliser ne peut être réalisée au sein d'un mode de production capitaliste « pur ».
Pour la vulgate keynésienne, un « équilibre » dit de « sous-emploi », c'est à dire un niveau de production en baisse, vecteur de « chômage involontaire », du fait d'une « demande effective » amoindrie est possible. La théorie keynésienne cherche cependant à traiter théoriquement aussi bien les situations de « sous-emploi » que celles de « plein-emploi » qui deviennent non plus la norme mais un cas particulier, non automatique, au sein de la théorie générale (Keynes se prenant pour le Einstein de la science économique).
A cette vision mécaniste, Marx oppose une vision dialectique. Régulièrement, périodiquement, ce qui est rendu possible du fait d'une séparation entre la vente et l'achat, de la contradiction entre la marchandise et l’argent, la réalisation de la valeur de la marchandise en argent ne s’effectue pas. Il y a une scission entre la vente et l’achat. La crise qui éclate dans la sphère de la circulation a une origine dans la sphère de la production capitaliste, en relation soit avec la baisse brutale du taux de profit du fait d’une insuffisance de la production de plus-value (surproduction de capital) soit du fait d’une expansion considérable de la production qui ne pourrait trouver le marché qui lui correspond (surproduction de marchandises). L’école sous-consommationniste a mis le doigt sur certaines contradictions de la production capitaliste, et ce mieux que l’école rivale, mais elle les pose dans le même cadre (celui de la valeur d’échange), celui du pouvoir de consommation (en valeur). Pour faire naître le crise, il lui faut donc mettre en évidence un déséquilibre permanent entre la valeur de la production et le pouvoir de consommation.
4.2.2 Une parabole thermique
Pour illustrer les différences entre les conceptions nous pouvons risquer une parabole « thermique ».
Pour les théoriciens sous-consommationnistes, il y a une fuite permanente dans la chaudière (une insuffisance structurelle de la demande solvable) et donc son rendement ne peut-être optimal. Il s'ensuit des ratés permanents qui pourraient être pour une part corrigés par un apport extérieur (soutien de la demande) quand ce n’est pas par un retour à un modèle ancien et dépassé de chaudière.
Pour les théoriciens de la disproportion, les ratés observés dans la chaudière ne peuvent être que des phénomènes ponctuels, qui se traduisent par un nouveau réglage de la chaudière sachant que la marche interne de la chaudière dispose de mécanismes d'auto-régulation qui doivent permettre, si personne ne s’en mêle en procédant à des actions intempestives, de rétablir le niveau de pression approprié au bon fonctionnement de la chaudière.
Vu sous l'angle de la baisse du taux de profit, la vision ricardienne aboutit à considérer que la pression tend à diminuer dans la chaudière pour finir par ne plus être à même de produire suffisamment d'énergie additionnelle. Pour la variante ricardienne de type Grossmann / Mattick qui cherche un point absolu à partir duquel la baisse du taux de profit signifierait une crise, il suffit de substituer la masse de la vapeur à la pression de celle-ci pour obtenir le bon indicateur. Dès que cette masse est réputée insuffisante pour un usage donné, un point bien défini, la chaudière s’éteint, la crise peut se manifester.
Pour les théoriciens staliniens, nous avons de fait une baisse de pression permanente. Chaque baisse du taux profit équivaut à une diminution de la pression. Pour faire face à cette situation on transvase dans une chaudière annexe aux dimensions croissantes une partie de la vapeur à très basse pression, ainsi la pression et le rendement de la chaudière restante, dont la taille relative diminue, sont maintenus
Pour le marxisme une pression croissante à tendance à régner dans la chaudière et des mécanismes correcteurs, des soupapes, évacuent pour une part cette surpression (recherche du maximum de plus-value, valorisation/dévalorisation du capital). Quand succède à la forte expansion, un recul brutal de la pression, les mécanismes internes sont fortement déstabilisés, une contradiction violente intervient dans la chaudière et menace de la faire exploser (suraccumulation, surproduction de capital). Sinon, une forte expansion de la pression est également susceptible de mettre à mal la chaudière car les mécanismes d’évacuation ne sont pas bien adaptés à cette surpression et l’explosion menace (surproduction de marchandises). Dans un cas comme dans l’autre, les mécanismes régulateurs ne fonctionnent plus correctement, il faut ouvrir la chaudière qui répand sa chaleur et brûle tout sur son passage (dévalorisation brutale, crise catastrophique). Quand la chaleur a été suffisamment évacuée, la chaudière peut repartir pour un nouveau cycle. Pour tenter de limiter ces crises, on cherche à faire en sorte que la pression dans la chaudière ne monte pas trop vite. On limite l'apport en énergie et son rendement (limitation du taux d'accumulation, baisse tendancielle du taux de profit) et on cherche des soupapes complémentaires (consommation improductive, exportation, développement de grands ouvrages fixant le capital sans retombées productives immédiates).
4.3 Le grain de vérité des théories sous-consommationnistes
Contrairement à ce qui est souvent soutenu par maints représentants du marxisme de la chaire, la théorie des crises de Marx ne relève pas de la sous-consommation. Nous allons voir en quoi, il n’est pas possible de la ranger dans cette catégorie. Mais, sous la fausse théorie sous-consommationniste se cache un grain de vérité. Ce grain de vérité est inextricablement emmêlé dans un écheveau théorique hautement critiquable. Mais on peut le faire ressortir :
1° La réalisation du produit social ne va pas de soi. Des crises générales sont possibles.
2° Les facteurs relevant de la composition matérielle comme du volume du surproduit et du produit social ne sont pas sans importance pour comprendre les crises de surproduction.
4.3.1 La réalisation du produit social
L'absence de réalisation de la valeur et de la plus-value (la transformation en argent du produit social) n'est pas un processus mécanique du à un déficit chronique de la demande sociale, intrinsèque au fonctionnement de la société. Il ne s’agit pas d’une limite permanente dans le pouvoir de consommation absolu de la société. Les crises sont périodiques, et leur possibilité réside dans la possibilité d'une scission entre la vente et l'achat, dont l’origine est à rechercher dans la nature de l'argent. Cette critique de la marchandise et de l’argent conduit d’ores et déjà à un dépassement de l’économie mercantile, à mettre fin à une production où le produit social s’exprime en argent. Ce dernier n’est pas un simple médiateur des échanges mais une forme d’existence de la marchandise, une forme d’existence nécessaire car celle-ci doit se représenter nécessairement sous la forme d’une valeur d’échange, être exprimée en argent. Ces facteurs sont une première condition de la production capitaliste, une production dans laquelle le produit doit nécessairement être une marchandise et s’exprimer en argent. La critique de l’absence de réalisation est donc bien plus vaste que celle accomplie par les théoriciens sous-consommationnistes car elle touche à l’existence même de la production capitaliste. La critique devient alors une critique révolutionnaire.[185]
La scission potentielle entre la marchandise et l’argent, entre la vente et l’achat, rend les crises possibles. Pour que le capital poursuive son procès, le capital marchandise issu du procès de production doit se transformer en argent, la valeur doit se réaliser, s'autonomiser dans la forme argent pour pouvoir ensuite reprendre la course à la valorisation, à la recherche du maximum de plus-value. Contrairement aux idées ricardiennes cette réalisation n'a rien d'automatique. La réalisation suppose la vente de la marchandise ; elle ne va pas de soi. Mais cette absence de réalisation n'est pas due à une insuffisance de demande intrinsèque, structurelle au mode de production capitaliste. La plupart du temps, cette réalisation s’effectue. On ne doit pas pour autant en tirer la conclusion que parce que la crise n’a pas lieu systématiquement, elle ne se produira pas. En fait, la crise est périodique.
Par ailleurs, faire de ce potentiel, la cause des crises revient à expliquer la crise par la crise.[186] Par conséquent, il est important de comprendre et d’expliquer les crises sur la base d’une conception unitaire. C’est notamment l’intérêt de la théorie de la suraccumulation. En montrant que la surproduction de marchandises, qui peut exister de manière autonome, est aussi le résultat de la surproduction de capital, de la suraccumulation, dont les racines se trouvent dans la production capitaliste, du fait de l’insuffisance de plus-value, Marx explique, unifie, la possibilité et la nécessité des crises. De son côté, la surproduction de marchandises du fait de l’insuffisance (ponctuelle, périodique) de la capacité de consommation, provient également de ce que le but de la production capitaliste est la recherche du maximum de plus-value. Pour y parvenir la capital développe la force productive qu travail comme si elle n’avait pas de limite, ensuite le marché se révèle incapable de suivre la progression de la production et le développement de la productivité qui l’accompagne.
Mais pour le marxisme, à la différence des sous-consommationnistes, pour être périodiques et non permanentes, ces crises sont cependant potentiellement plus importantes. Contrairement au point de vue sous-consommationniste, c’est l'ensemble du produit social qui est concerné par la crise de surproduction et non seulement la plus-value ou une partie de celle-ci. Les sous-consommationnistes ont mieux perçu la possibilité de la crise, les limites du capital, que l’école de Ricardo, mais ils n'en ont pas donné les fondements. Aussi cherchent-ils des solutions utopiques et réactionnaires au lieu d’envisager un saut révolutionnaire, non mercantile, pour le futur de l’humanité.
4.3.2 La forme matérielle du produit social
La composition matérielle du produit social comme sa masse ou son volume sont des facteurs de crises. Si, d’un point de vue abstrait, il importe peu de produire telle ou telle valeur d’usage, du moment qu’elle peut être vendue avec profit, la question de pose différemment au niveau social.
Qu’advient-il dès lors que se met en place le mode de production capitaliste le plus développé ? Le capital recherche le maximum de plus-value. Pour une durée, une intensité, une qualité et une complexité données du travail, le capital obtient plus de surtravail, de plus-value, en développant la productivité du travail. Nous constatons ainsi que le processus valorisation dévalorisation se traduit par une croissance de la masse des marchandises en relation avec le développement de la productivité du travail. Toutes chose égales par ailleurs, il faut une productivité toujours plus grande pour obtenir une masse supplémentaire égale de plus-value.
Supposons que la valeur équivalente au travail vivant qui se décompose en capital variable et plus-value soit de 100 et que la masse des marchandises (nous supposons ici une marchandise unique) correspondante soit de 100 unités.
Nous avons donc la situation initiale suivante :
w = v + pl = 100 pour une masse de 100 unités (100 u) soit une valeur unitaire de 1.
Pour reproduire leur force de travail, les salariés consomment 50 unités. Nous supposons le salaire réel constant.
De combien doit s’accroître la productivité du travail vivant (nous ignorons ici les incidences du capital constant et de l’accumulation) pour obtenir une plus-value additionnelle de 10 ?
Pour parvenir à ce résultat, la valeur de la force de travail doit être réduite de 50 à 40, tandis que la plus-value augmente de 50 à 60. Les 50 unités qui permettent la reproduction de la force de travail doivent désormais valoir 40, soit une valeur unitaire de 0,8 contre 1 dans la situation initiale. La masse totale des marchandises produites s’élève alors à 125. La masse des marchandises s’est donc accrue de 25%. La plus-value a augmenté de 10 soit une augmentation de 20% (10/50) mais la masse des marchandises qui la compose a augmenté de 50% (25/50). La plus-value sous forme de valeur d’échange, la survaleur, a augmenté de 20% mais la plus-value sous forme de valeurs d’usage, le surproduit, a augmenté de 50% soit 2,5 fois plus.
Le consommateur n’achète pas une marchandise pour sa valeur d’échange (hormis les effets du snobisme) mais pour sa valeur d’usage. L’accroissement considérable des valeurs d’usage, ne leur donne pas ipso facto de débouché. Ce n’est pas parce que l’équivalent valeur (le pouvoir absolu de consommation) est potentiellement présent que sa manifestation sera effective, car les besoins à satisfaire sont en relation avec la valeur d’usage et la masse de celles-ci.
La consommation du prolétariat est limitée car son développement entre en contradiction avec le but de la production capitaliste : le maximum de plus-value.
La consommation des capitalistes ne va pas nécessairement s’étendre dans des proportions aussi grandes que ce qui est permis par le développement de la productivité. Cet accroissement de la consommation par les capitalistes est d’autant plus limité que la fonction du capitaliste n’est pas la consommation – même s’il s’y laisse aller toujours plus avec le développement de la production capitaliste – mais l’accumulation.
Le surproduit est passé de 50 à 75 unités. Si la classe capitaliste en consommait 25 unités, elle devrait augmenter sa consommation de 50% pour que le rapport entre la plus-value consommée et la plus-value accumulée soit maintenu. Si la part consommée de la plus-value restait identique, la classe capitaliste consommerait 37,5 unités contre 25 auparavant. Le surproduit disponible pour l’accumulation serait alors également de 37,5 unités soit également 50% de plus. Pour maintenir l’accumulation au niveau antérieur soit 25 unités, il faudrait que la classe capitaliste double sa consommation en la faisant passer de 25 à 50 unités. Avec l’augmentation de la productivité, la valeur unitaire des marchandises a baissé de 20% (0,8 au lieu de 1). Pour uniquement maintenir le rapport de valeur entre plus-value accumulée et plus-value consommée, c’est-à-dire que la valeur de la plus-value accumulée soit égale à la valeur de la plus-value consommée (soit en valeur la moitié de 60 pour chaque fraction et la moitié de 75 unités pour chaque fraction sous l’angle de la valeur d’usage), la masse des marchandises consommées par la classe capitaliste devrait s’accroître de 50% et elle devrait doubler, augmenter de 100%, pour éviter l’emballement de l’accumulation du capital. A supposer qu’un tel accroissement soit possible, il n’en demeurerait pas moins que faire de la consommation des capitalistes le but de ce mode de production serait commettre une grande erreur, car cela revient à nier le capital[187].
Faisons maintenant l’hypothèse, plutôt restrictive compte tenu de la vocation du capital qui est de produire le maximum de plus-value, d’un maintien de l’accumulation au même niveau en valeur (soit une valeur de 25). Cette perspective suppose l’accumulation non plus de 25 unités mais de 31,25 unités (avec une valeur de 25 on obtient désormais 31,25 unités contre 25 auparavant du fait de la diminution de la valeur unitaire des marchandises). D’une part, de la même manière que pour la consommation individuelle, il faut élargir les débouchés, vendre plus de machines, de matières premières, etc. et parallèlement accroître considérablement la consommation improductive des capitalistes. Toute élévation de l’accumulation de la masse de la plus-value pose la question des débouchés de ceux-ci sur une base élargie. Ce serait une autre manière d’interpréter la fameuse citation sur l’accélération de l’accumulation (si on entend masse par la masse des valeurs d’usage et non masse en valeur). Mais toute accélération de l’accumulation dont l’objectif est le maximum de plus-value et dont il faut attendre un développement de la productivité poserait sur une échelle accrue la question qui vient juste d’être résolue et avec elle la perspective d’une autre solution à cette contradiction : la surproduction de marchandises. Qui plus est, plus le taux de profit est élevé, plus le taux d’accumulation est grand, plus le niveau de la productivité élevé et plus la surproduction de marchandises menace[188].
Il n’a y qu’un Tougan-Baranowsky, héritier de Ricardo, pour s’imaginer que la production capitaliste puisse fonctionner avec un seul ouvrier faisant fonctionner l’ensemble de la machinerie capitaliste, l’ensemble de la production et de la réalisation du produit social s’effectuant sans heurts sous prétexte que les schémas de reproduction ne laissaient pas apparaître de contradictions dans les rapports de valeur (de valeur d’échange). Ces schémas étant conçus pour expliquer à partir des concepts fondamentaux du marxisme, et ce pour la première fois dans l’histoire de la science économique, le processus de reproduction du capital, c’était bien le moins qu’on pouvait leur demander[189]. Mais tout cela laisse intact la question de la masse et de la forme des marchandises suivant qu’elles sont destinées à la consommation productive ou la consommation non-productive (qu’elle soit individuelle ou collective), question toujours plus lancinante dès lors que le processus valorisation dévalorisation s’avance[190].
« Il en va de même pour la force productive. D’une part, le capital a nécessairement tendance à l’augmenter au maximum pour augmenter le surtemps relatif. D’autre part, il diminue simultanément le temps de travail nécessaire, c’est-à-dire la capacité d’échange des travailleurs. En outre, comme nous l’avons vu, la survaleur [plus-value] relative croît dans une proportion bien moindre que la force productive, et cette proportion diminue d’autant plus que la force productive a déjà augmenté. Mais la masse des produits croît dans une proportion semblable – sinon un nouveau capital ainsi qu’un nouveau travail seraient libérés, qui n’entreraient pas dans la circulation. Mais, en même temps que la masse des produits, augmente aussi la difficulté de valoriser le temps de travail contenu en eux – parce que les exigences de la consommation augmentent. » (Marx, Manuscrits de 1857-1858, Grundrisse, Editions sociales, T.1, p.362).
Les sous-consommationnistes confondent cette difficulté en l’assimilant à une absence théorique, une insuffisance structurelle, de demande au sens où le pouvoir de consommation de la société serait différent, en valeur, de la valeur de la production. Marx, par exemple, s’en prend à Proudhon[191] : « Proudhon qui entend bien les ânes braire, mais ne sait jamais dans quelle étable, fait découler la surproduction du fait que « le travailleur ne peut racheter le produit qu’il a fabriqué ». Il entend par là que l’intérêt ou le profit constituent une charge qui s’ajoute au prix du produit ; ou que celui-ci est surchargé par rapport à sa valeur réelle. Cela prouve d’abord qu’il ne comprend rien à la détermination de la valeur qui, pour parler de manière générale, ne peut rien inclure en guise de surcharge. (…) ». Proudhon confond la valeur et les prix et donc imagine que l’intérêt et le profit viennent s’ajouter au prix du produit, surchargeant ainsi la valeur réelle. Proudhon en conclut « que l’ouvrier ne peut pas racheter son produit, c’est-à-dire la partie aliquote du produit global objectivant son travail nécessaire. ». Il en tire alors la conclusion que « le capital ne peut échanger de manière adéquate et qu’il y a donc surproduction ». Or, au-delà de la compréhension erronée de Proudhon sur le rapport entre valeur et prix de production, en tout état de cause sa compréhension des racines de la surproduction est également fausse.[192]. La surproduction ne vient donc pas d’une inadéquation structurelle entre la valeur de la production et la capacité de consommation. La contradiction n’est pas mécanique mais dialectique. La contradiction ne se résout pas en surproduction de manière permanente mais périodiquement.
Ce type de surproduction, la surproduction de marchandises, c’est-à-dire de capital-marchandise, résulte du développement d’une productivité du travail poursuivant des buts limités : la valorisation maximum du capital, la production d’un maximum de plus-value, sans égard à la capacité de consommation de la société, capacité à absorber le volume comme le type de marchandises produites. Quand elle éclate, dans la sphère de la circulation, lors de la réalisation du produit social, la crise de surproduction de marchandise induit une baisse du taux de profit. Alors que la suraccumulation, la surproduction de capital résulte d’une insuffisance de plus-value, d’une baisse brutale du taux de profit, ici, c’est la surproduction de marchandises qui provoque cette baisse.
Pour rétablir une situation propice à la reprise de l’accumulation du capital, une dévalorisation, dans un cas comme dans l’autre, est nécessaire. La société bourgeoise navigue donc entre deux écueils, une accumulation rapide liée à une hausse de la productivité, comme éventuellement du taux de profit (nous sommes dans des phases ascendantes du cycle périodique), conduit le capital sur le chemin de la surproduction de marchandises et plonge la société dans le marasme. D’un autre côté, une baisse soudaine de cette productivité détériore le rapport d’exploitation, engendre une baisse brusque du taux de profit qui conduit à une paralysie de la reproduction sociale, à une crise de surproduction du type suraccumulation.
Dans la perspective de la surproduction de marchandises, il y a chez Marx, l’idée que dans son mouvement organique, le capital déstabilise le rapport entre moyens de production et moyens de consommation et fragilise la société dans la mesure où la consommation finale (assimilée ici à la consommation non productive), la consommation de moyens de consommation est limitée[193]. Il ne s’agit pas d’une disproportion classique ou trop de moyens de production seraient produits contre pas assez de moyens de consommation, mais d’une contradiction nécessaire de la société bourgeoise dès lors qu’elle suit ses propres tendances[194]. Quand éclate la crise, les deux types de marchandises sont en surproduction. Mais c’est la tendance à accumuler pour valoriser le capital[195], à rechercher un maximum de plus-value, que ce soit par l’élargissement de la production[196] ou le développement de la productivité, qui tend à détériorer le rapport entre les deux types de marchandises et précipiter la crise de surproduction[197].
Ces phénomènes ont une grande importance pour le développement de tendances inhérentes au capital. Outre le fait que la production du maximum de plus-value puisse se traduire par la création de plus de valeur et de plus-value dans le même temps (développement de l’intensité[198], de la complexité[199], de la qualité[200] et d’optimisation de sa place en tant que capital national dans la division internationale du travail[201]), pour différer cette contradiction, pour en contrecarrer les effets, le capital met en œuvre un ensemble de réponses de nature différente. Nous pouvons les classer en fonction du type de réponse qu’elles apportent :
1° Pour faciliter la vente, la réalisation du produit social, développement du crédit
2° Recherche de débouchés et de nouveaux champs d’accumulation externes, exportation, lutte pour la conquête de nouveaux marchés.
3° Développement de la publicité et de la mercatique (marketing) pour attiser le besoin et en susciter de nouveaux, conférer de nouveaux attraits à la marchandise.
4° Diversification, création de nouveaux besoins, création de nouvelles valeurs d’usage. Développement de moyens de consommation de luxe dont un des intérêts est que généralement elles permettent du fait de l’emploi relativement plus élevé de travail vivant, la production d’une masse plus grande de plus-value et comme ces branches ont une composition organique moins élevée que la moyenne, elles favorisent aussi la hausse du taux de profit.
5° Evolution historique des valeurs d’usage et des besoins conduisant à freiner la baisse de la valeur unitaire des marchandises. « Revalorisation » des valeurs d’usage[202], évolution des besoins : le luxe d’hier devient le nécessaire d’aujourd’hui.
6° Programmation de l’obsolescence des marchandises. Organisation du gaspillage des ressources.
7° Fixation du capital. Accumulation de capitaux fixes qui ne sont pas immédiatement productifs (grands ouvrages d'art, grands travaux, canaux, par exemple) et donc absorbent de la plus-value sans produire un effet immédiat sur la productivité du travail.
8°Développement d’une classe de consommateurs qui consomme sans produire, d’une classe improductive. Une classe de consommateurs est nécessaire. Cela aussi, les théoriciens sous consommationnistes, notamment Malthus, l’ont pressenti. Ce ne peut pas être le prolétariat dont la consommation est limitée et d’autant plus limitée que le salaire relatif baisse avec le progrès de la production capitaliste. Une hausse du salaire réel peut certes intervenir, mais nécessairement dans des limites étroites. Cette classe improductive moderne, c’est la classe moyenne. Avec son développement, on limite ainsi le taux d’accumulation et la demande de moyens de consommation s’accroît et avec elle la consommation de produits plus raffinés et de produits de luxe.
9° Baisse du taux de profit et du taux d’accumulation. L’accumulation ralentit, la croissance ralentit, le capital diffère ces contradictions en renonçant à sa mission.
C'est bien cette voie, prévue par Marx, qu'emprunte, le mode de production capitaliste. Le développement des forces productives induit une limitation et une destruction de celles-ci.
Nous nous contenterons d’évoquer dans ce travail[203] la question de la classe moyenne, question d’autant plus ignorée par le marxisme de la chaire qu’il en est un des porte-parole, et nous laisserons celle du capital fixe, du commerce extérieur, du crédit, des divers aspects relatifs à la valeur et à la valeur d’usage, etc. à un autre article.
4.4 Surproduction versus sous consommation.
Marx et Engels, ce dernier notamment dans un ouvrage relu et pour une part écrit par Marx, se sont exprimés sans ambiguïté contre une interprétation sous-consommationniste de leur conception des crises. Ceux qui, ensuite, prétendent le contraire font donc preuve de mauvaise foi ou d’une grande incompréhension de leur théorie.
4.4.1 La critique d’Engels
Commençons par Engels dont l’interprétation des propos ne souffre aucune discussion. Il réfute explicitement toute tentation d’assimiler la théorie marxiste des crises à la sous-consommation.
« Il est évident d'après cela que chez M. Dühring, les crises industrielles périodiques n'ont nullement la signification historique que nous avons dû leur attribuer. Les crises ne sont chez lui que des déviations occasionnelles de la « normale » et elles donnent tout au plus sujet de «déployer un ordre plus réglé». La «façon habituelle» d'expliquer les crises par la surproduction ne suffit nullement à sa «conception plus exacte». Certes, cette façon serait «sans doute admissible pour des crises spéciales dans des domaines particuliers». Ainsi, par exemple, «un encombrement du marché de la librairie par des éditions d’œuvres qui tombent brusquement dans le domaine public et se prêtent à un débit massif». M. Dühring peut à coup sûr se mettre au lit avec la bienfaisante conscience que ses œuvres immortelles ne provoqueront jamais semblable catastrophe mondiale. Mais pour les grandes crises, ce ne serait pas la surproduction, mais plutôt
«le retard de la consommation nationale... la sous-consommation artificiellement engendrée... l'inhibition du besoin national (!) dans sa croissance naturelle qui élargissent, de façon si critique en fin de compte, la faille entre les stocks et le débit.»
Et pour cette théorie des crises qui lui est bien personnelle, il a tout de même eu la chance de trouver un disciple.
Par malheur, la sous-consommation des masses, la réduction de la consommation de masse au minimum nécessaire à l'entretien et à la procréation n'est pas du tout un phénomène nouveau. Elle a existé depuis qu'il y a eu des classes exploiteuses et des classes exploitées. Même dans les périodes de l'histoire où la situation des masses était particulièrement favorable, par exemple en Angleterre au XVe siècle, elles étaient sous-consommatrices. Elles étaient bien loin de pouvoir disposer de la totalité de leur produit annuel propre pour le consommer. Si donc la sous-consommation est un phénomène historique permanent depuis des millénaires, alors que la stagnation générale du marché qui éclate dans les crises par suite de l'excédent de la production n'est devenue sensible que depuis cinquante ans, il faut toute la platitude de l'économie vulgaire de M. Dühring pour expliquer la collision nouvelle non pas par le phénomène nouveau de surproduction, mais par celui de sous-consommation qui est vieux de milliers d'années. C'est comme si, en mathématiques, on voulait expliquer la variation du rapport de deux grandeurs, une constante et une variable, non pas par le fait que la variable varie, mais par le fait que la constante reste la même. La sous-consommation des masses est une condition nécessaire de toutes les formes de société reposant sur l'exploitation, donc aussi de la société capitaliste; mais seule la forme capitaliste de la production aboutit à des crises. La sous-consommation est donc aussi une condition préalable des crises et elle y joue un rôle reconnu depuis longtemps; mais elle ne nous explique pas plus les causes de l'existence actuelle des crises que celles de leur absence dans le passé[204].
M. Dühring a d'ailleurs des idées curieuses sur le marché mondial. Nous avons vu comment, en véritable érudit allemand, il cherche à s'expliquer des crises spéciales réelles de l'industrie à l'aide de crises imaginaires sur le marché du livre de Leipzig, la tempête en mer par la tempête dans un verre d'eau. Il se figure, en outre, que l'actuelle production patronale doit « tourner surtout avec son débouché dans le cercle des classes possédantes elles-mêmes », ce qui ne l'empêche pas, seize pages plus loin seulement, de présenter, à la façon courante, comme industries modernes décisives, l'industrie du fer et celle du coton, c'est-à-dire précisément les deux branches de la production dont les produits ne sont consommés que pour une part infiniment petite dans le cercle des classes possédantes, et sont faits plus que tous autres pour la consommation de masse. De quelque côté que nous nous tournions, nous ne trouvons que bavardage à tort et à travers, vide et contradictoire. Mais prenons un exemple dans l'industrie cotonnière. Si, à elle seule, la ville relativement petite d'Oldham, - l'une des quelque douze villes de 50 à 100 000 habitants autour de Manchester qui pratiquent l'industrie du coton, - si, à elle seule, cette ville a vu le nombre des broches qui filent uniquement le numéro 32 s'élever de 1872 à 1875, en quatre ans, de 2 millions 1/2 à 5 millions, de sorte qu'une seule ville moyenne d'Angleterre possède autant de broches filant un seul numéro qu'en possède, somme totale, l'industrie cotonnière de l'Allemagne entière, y compris l'Alsace; et si dans toutes les autres branches et localités de l'industrie anglaise et écossaise du coton l'extension s'est produite dans des proportions sensiblement égales, il faut une forte dose d'aplomb radical pour expliquer la totale stagnation actuelle du marché des filés et des tissus de coton par la sous-consommation des masses anglaises et non par la surproduction des fabricants anglais de coton. » (Engels, Anti-Dühring, Editions sociales, p. 323-324)
Une note accompagne cette partie du texte : « L'explication des crises par la sous-consommation vient de Sismondi et chez lui elle a encore un certain sens. C'est à lui que Rodbertus l'a empruntée et c'est dans Rodbertus que M. Dühring à son tour l'a copiée avec son habituelle manière de tout affadir. » (Engels, Anti-Dühring, Editions sociales, p. 325)
Dans cet extrait, Engels oppose donc la conception qui veut que les crises modernes (quand il écrit, elles ont « cinquante ans » d’existence, ce qui nous ramène bien à 1825 pour la première de ce genre) soient non pas des crises liées à la sous-consommation des masses mais des crises de surproduction. Il ne s’agit même pas ici d’opposer la suraccumulation à la sous-consommation car c’est dans ce livre (l’Anti-Dühring) que nous trouvons les citations sur la surproduction de marchandises que nous avons évoquée dans le chapitre 2.4. Ce qui signifie que la contradiction qui est mise en avant relève de la forme du produit social, les rapports de valeur (valeur d’échange) étant en arrière-plan. Par ailleurs, la sous-consommation n’est pas spécifique du mode de production capitaliste mais de toutes les sociétés de classes. Du même coup, la sous-consommation est au fondement des crises en ce sens qu’elle en est une « condition préalable » mais ne peut expliquer leur cause. Cela signifie que la crise moderne est bien permise par l’existence d’une société divisée en classe, mais que cette caractéristique ne suffit pas. Il faut pour qu’elles se manifestent sous forme de crises de surproduction, que non seulement existe le mode de production capitaliste et sa soif de plus-value mais aussi le mode de production capitaliste le plus développé. Dans ce dernier, le capital se subordonne réellement le travail, car il existe désormais une technologie spécifique au mode de production capitaliste : le machinisme. La démultiplication de la productivité, le développement de la plus-value relative, l’accumulation du capital, et l’accroissement de la masse des marchandises qui les accompagnent, ne rencontrent plus que les limites inhérentes à la production capitaliste.
On pourrait encore avoir un doute sur ce qu’Engels appelle la sous-consommation. Tout le monde parle-t-il de la même chose ?
La note d’Engels est également sans appel. Pour lui comme pour Marx, la référence est Sismondi. La cible est donc identique. La science économique de la bourgeoisie atteint son apogée avec Ricardo et Sismondi. Ce dernier, de plus, émet des doutes quant à la pérennité du mode de production capitaliste. Avec Sismondi, nous avons donc atteint le point le plus élevé[205] propre à cette conception qui ensuite se poursuit sous des formes vulgaires et ce jusque dans les rangs du marxisme. La critique de type sous-consommationniste est aujourd’hui le vade mecum de la pensée social démocrate[206] (de la gauche aux gauchistes en passant par les altermondialistes) qu’elle puise son inspiration dans Keynes et Malthus ou dans un Marx revu, corrigé, tronqué, falsifié et aseptisé. Comment ne pas reconnaître la pensée du Dühring dans maintes déclarations et analyses du réformisme moderne ?
Engels fait également référence à une période comme le XVème siècle en Angleterre, où les salaires ont augmenté. C’est en pensant à une telle période que Marx traite de l’accumulation du capital et sa propension à favoriser l’augmentation des salaires dès lors que la composition organique du capital demeure identique. C’est un tel cadre, nous l’avons montré, qu’il utilise pour simplifier sa présentation de la suraccumulation absolue
Par conséquent, que le salaire soit plus au moins élevé ne change en rien le fait que la sous-consommation de la classe exploitée soit une condition de base de l’existence des sociétés de classe. Par conséquent, la question n’est pas tant celle d’un déficit de demande (au sens de la valeur d’échange) que celle de la composition matérielle et de la masse du produit social, les valeurs d’usage et leur volume et les rapports entre les classes qui les conditionnent.. La surproduction est l’aboutissement de la contradiction entre la valeur d’échange et la valeur d’usage, la contradiction entre la poursuite de la valeur d’échange (sous la forme spécifique de la recherche du maximum de plus-value) et de la masse des marchandises produites qui en est le corollaire et le renouvellement de cette contradiction dans la sphère de la circulation lors de la réalisation de la plus-value et du produit social[207]. Ces facteurs conduisent avec la production capitaliste la plus développée (à partir de 1825) à des crises de surproduction de marchandises.
4.4.2 La critique de Marx
Passons à Marx.
« Affirmer que les crises proviennent de l’absence de consommation ou de consommateurs solvables est pure tautologie. Le système capitaliste ne connaît que les modes de consommation payants, exception faite de la consommation sub forma pauperis (celle du pauvre) et celle du « filou ». Dire que les marchandises sont invendables signifie simplement qu’elles n’ont pas trouvé d’acquéreurs capables de payer, donc de consommateurs solvables (que les marchandises soient achetées en vue de la consommation productive ou individuelle). Pour donner une apparence de justification plus profonde à cette tautologie, on prétend que la classe ouvrière reçoit une part trop faible de son propre produit et que l’on pourrait remédier à ce mal en lui accordant une plus grande part de ce produit, donc des salaires plus élevés. Mais il suffit de rappeler que les crises sont chaque fois préparées précisément par une période de hausse générale des salaires, où la classe ouvrière obtient effectivement une plus grande part de la fraction du produit annuel qui est destinée à la consommation. Du point de vue de ces chevaliers du « simple » bon sens, cette période devrait au contraire éloigner la crise. Il semble donc que la production capitaliste implique des conditions qui ne dépendent point de la bonne ou de la mauvaise volonté, conditions qui ne permettent cette prospérité relative de la classe ouvrière que temporairement, et cela uniquement comme messagère d’une crise. » (Marx, Capital, L.II, Pléiade, T.2, p.781)
Les chevaliers du simple bon sens, les théoriciens sous-consommationnistes, ne voient la crise que sous l’angle des rapports de valeur et considèrent qu’il existe un déséquilibre (permanent) entre la valeur de la production et la capacité de consommation. Pour le marxisme, ce n’est pas tant ce déséquilibre qui est en jeu que les formes du produit social. Sous la représentation fausse de la théorie sous-consommationniste se dissimule un grain de vérité. D’une part, la contradiction entre la marchandise et l’argent ouvre la possibilité d’une crise générale, d’autre part, la masse des marchandises produites et la différence dans les valeurs d’usage suivant qu’elles sont destinées à la consommation non productive (individuelle ou collective - la limitation intrinsèque de la consommation ouvrière ouvre donc une difficulté particulière qu’il faut résoudre) ou à la consommation productive posent la question de la croissance du marché, des débouchés. Si nous y ajoutons la possibilité de disproportions entre les différentes branches de la production ou entre les grandes catégories de capitaux (capital fixe et capital circulant par exemple) nous aurons un tableau plus complet quoique ce type de crise ne relève pas de la crise générale. Ces crises se caractérisent par une surproduction de marchandises. Ici, c’est la surproduction qui engendre la baisse du taux de profit, alors que, dans le cas de la suraccumulation, c’est l’inverse. La capacité de consommation, compte tenu des rapports antagoniques entre les classes, de la limitation structurelle de la consommation ouvrière (du fait de la recherche d’un maximum de plus-value), des limites liées à l’accumulation de la plus-value, ne suit pas le développement de la productivité du travail et l’expansion de la production[208]. Pour pallier cette difficulté, la consommation des capitalistes, bien qu’ils aient une soif croissante de dépense[209], ne peut suffire. Les débouchés extérieurs, la réalisation de travaux de grande ampleur s’étalant sur plusieurs années, la revalorisation des valeurs d’usage en les dotant de caractéristiques supplémentaires ou la création de nouvelles (articles de luxe par exemple) et last but not least la création d’une classe de consommateurs improductifs qui consomme sans vendre sont parmi les réponses qu’apporte la production capitaliste à cette menace récurrente[210].
4.5 Le « fonds du travail » ou l’impossible sous-consommation
4.5.1 Capital variable, capital avancé
Les tenants de la sous-consommation, mais la remarque vaut pour leurs adversaires dans la mesure où elle revient à nier la nature des crises et à en minimiser le potentiel, masquent complètement le fait que la consommation du prolétariat, la dépense du salaire ne vient pas réaliser une partie de la production présente mais une partie de la production antérieure.
Pour le sous-consommationniste, plus le salaire est élevé, plus la consommation sera importante et les facteurs de crises amoindris. Ce qui pose une difficulté est la réalisation de la plus-value, et, au sein de celle-ci, la fraction destinée à l’accumulation.
A l’issue du processus de production nous avons un capital marchandise dont la valeur w est symbolisée par c + v + pl, soit la somme du capital constant, du capital variable et de la plus-value. Nous avons donc : w = c + v + pl
Pour le sous-consommationniste, le capitaliste reproduit son capital constant et voit refluer le capital variable à mesure que le prolétaire dépense son salaire en moyens de consommation. S’il se présente une difficulté ce sera au niveau de la plus-value. Par conséquent, plus celle-ci est petite moins grande ou moins étendue sera la difficulté. De ce fait, plus le salaire est élevé plus la consommation est soutenue et le risque écarté. Voilà la politique des chevaliers du simple bon sens.
Mais le marxisme ne dit rien de tel. Il considère que le capital constant (la valeur des moyens de production) comme le capital variable (qui va devenir le salaire du prolétaire) sont avancés. Ce capital avancé, qu’il soit constant ou variable a une contrepartie matérielle existant déjà dans la société. Pour le capital constant, c’est évident, puisque le travail ne se fait pas sans moyens de production. Par conséquent, le capital constant fait face concrètement au prolétaire au sein de l’entreprise[211]. Mais la contrepartie du capital variable, peu importe sa forme matérielle précise et sa part exactes, existe également. Cette contrepartie n’existe pas dans une entreprise donnée (sinon partiellement en fonction de sa production spécifique ou quand une partie du salaire est en nature) comme les moyens de production, mais dans l’ensemble des entreprises. Le prolétaire n’est pas un associé du capital, qui amènerait sa force de travail (tandis que le capitaliste apporterait les moyens de production) et qui repartirait uniquement avec la partie correspondante à la valeur de sa force de travail et pourrait s’estimer berné parce qu’il n’a pas obtenu l’intérêt, voire le profit moyen, sur son apport[212]. En fait, la classe capitaliste a le monopole du capital qu’il soit sous forme argent, sous la forme de moyens de production (Ici il peut être, pour une part, partagé avec la propriété foncière) ou de marchandises.
Les économistes classiques, donc quand l’économie politique était une science en développement, étaient fort conscients de cela. Ils appelaient cette contrepartie sociale du capital variable, le « fonds du travail » ou le « fonds des salaires ». Le capital variable, comme le capital constant, se réfère à du travail passé. Dans le Capital, comme dans les Théories sur la plus-value, Marx fait une critique acerbe de la théorie du « fonds des salaires ». Cependant cette critique ne remet jamais en cause, bien au contraire, l’idée qu’il existe un travail passé qui permet de salarier la force de travail. Le capital variable est comme le capital constant du capital avancé par le capitaliste.
4.5.2 La critique de la théorie du fonds des salaires
Ce que critique Marx dans la théorie du fonds des salaires, c’est l’idée que nous aurions une fraction déterminée, fixe, du produit social qui déterminerait rigidement le salaire. Le salaire serait égal à la valeur des moyens de consommation. Ainsi serait déterminé, pour les économistes classiques, le montant des salaires et donc le capital variable[213]. C’est cette conception rigide, formaliste, mécanique que Marx rejette, mais en aucun cas l’idée que le capital variable est avancé. Il est avancé dans la plupart des cas sous forme argent (il peut exister des formes de salaire en nature) et s’il incarne bien un travail passé, peu importe ensuite la détermination matérielle de celui-ci.
Il n’est pas nécessaire qu’elle corresponde précisément à ce que les prolétaires vont ensuite acheter. Par exemple, si la forme matérielle de ce travail passé consiste en une partie trop importante de moyens de consommation de luxe, ils pourront être exportés tandis qu’on importera les éléments propres à la reproduction de la force de travail. On pourrait aussi prétendre qu’il s’agit de moyens de production et qu’un échange international s’effectue pour obtenir les moyens de consommation achetés par le prolétaire ou encore qu’il est effectué un échange entre le travail passé et le travail présent effectué dans la mesure où l’accumulation absorbe cet excédent de moyens de production et laisserait en échange des moyens de consommation.
Dans sa critique de Ricardo, pour qui il existerait un fonds destiné aux prolétaires rejetés de la production par le machinisme, Marx montre qu’il est absurde de penser que le « fonds » ainsi libéré doit être dépensé comme capital variable[214]. Les moyens de consommation nécessaires ne sont pas divisés en deux classes étanches, fixes dont une serait destinée aux ouvriers et l’autre aux capitalistes et aux classes improductives. Donc, la consommation des autres classes peut augmenter tandis que celle du prolétariat diminue, nonobstant le fait que des allocations chômage et divers expédients pourront soutenir la consommation des ouvriers qui ont rejoint l’armée de réserve industrielle. D’autre part, une partie de ces moyens de consommation peut se transformer en moyens de production (exemple céréales consommées par les animaux) ou être exportés. Enfin, ces moyens de consommation sont disponibles pour faire face à l’accumulation du capital[215] qui suppose une extension du capital variable[216] même si celui-ci augmente proportionnellement moins vite que le capital constant.
Comme on peut le constater, la critique du point de vue ricardien ne remet pas en cause, l’idée que c’est son propre travail passé qui permet l’achat de la force de travail de la classe productive.
En tout état de cause, l’argent avancé par les capitalistes pour salarier la classe productive reflue vers elle[217], en réalisant une fraction du produit social passé. C’est la classe capitaliste qui a le monopole des moyens de production, de consommation et de l’argent. Le capitaliste avance le capital argent aussi bien pour acheter les moyens de production, c’est-à-dire le capital constant que l’argent des salaires, c’est-à-dire le capital variable. A l’issue du procès de production, il dispose de l’ensemble du produit social, c’est-à-dire d’un produit dont la valeur est égale à capital constant + capital variable + plus-value. Il conserve également le capital fixe et les divers stocks de matière qui n’ont pas été absorbés par le processus de production mais qui font partie du capital constant avancé. A ce moment, ce qui doit être réalisé n’est pas seulement la plus-value, même si elle pose la question spécifique de l’argent nécessaire pour cette réalisation, mais la totalité du produit social.
Posons la fiction d’une société où toute la plus-value est accumulée et où le manager est un salarié dont on assimile le salaire à du capital variable. Nous avons affaire alors à un procès de production et de reproduction sous sa forme la plus pure. La réalisation du produit social ne se fait que si, à nouveau, la classe capitaliste se lance, et sur une échelle plus vaste, une reproduction élargie, à la recherche du maximum de plus-value.
Le prolétariat dépensera progressivement son salaire et l’argent refluera entre les mains de la classe capitaliste mais ce faisant il ne réalise que la fraction du travail passé correspondant au prix de sa force de travail. Il y a d’ailleurs une contradiction, rarement soulignée, dans les schémas de reproduction du livre II du Capital de Marx. Marx fait consommer le produit présent pour ce qui relève de la reproduction simple et le produit passé pour ce qui est de la plus-value accumulée. Cela montre, une fois de plus, que ceux-ci n’étaient qu’à l’état de bouillons et comportent donc des imperfections techniques et non théoriques comme nombre de commentateurs à l’instar de Rosa Luxemburg ont bien voulu le dire.
Evidemment, la conception selon laquelle le capital variable est comme le capital constant un capital avancé, qu’il se réfère à un travail passé, réduit à néant les théories sous-consommationnistes, pour autant qu’elles mettent l’accent sur les rapports de valeur (valeur d’échange) dans l’explication des crises. Que le salaire soit plus ou moins haut ou bas n’a pas d’effet sur la réalisation par le prolétaire du produit social actuel. En revanche, comme le montre l’exemple pédagogique de Marx sur la suraccumulation absolue, il aurait une influence sur le taux de profit ; si l’augmentation des salaires était suffisamment élevée, elle précipiterait la baisse du taux de profit. Comme ensuite, la réalisation de l’ensemble du produit social dépend de l’accumulation de l’ensemble du capital et que ce qui détermine l’accumulation et la réalisation qui s’ensuit est le taux de profit, une baisse brutale du taux de profit engendrerait une crise de surproduction de capital, une suraccumulation.
De par son étendue, la crise concerne l’ensemble de la valeur capital et non seulement une fraction de celle-ci : la plus-value. On comprend mieux aussi pourquoi cet aspect de la théorie de Marx est passé sous silence, car il permet de minimiser la portée et le potentiel des crises. Dès lors qu’elles ne portent que sur la plus-value voire sur la plus-value accumulée, on peut aussi déduire de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit que leur intensité relative irait en diminuant puisque la plus-value ne représente plus qu’une fraction décroissante de l’ensemble du produit social (si pl/c+v diminue, il en va de même pour pl/c+v+pl). Si, de plus, le taux d’accumulation de la plus-value diminue avec la baisse du taux de profit, les crises propres à la question de la réalisation de la plus-value accumulée perdent encore plus de leur intensité relative. Ces théories postulent, nous l’avons vu, l’existence d’une « base installée », composée du capital constant et variable déjà en fonction, qui serait automatiquement réalisée. Ajoutons-y la plus-value consommée comme amortisseur des crises et nous voilà aux antipodes du catastrophisme marxiste. En revanche, la voie du révisionnisme et du réformisme est toute tracée, cette représentation lui donnant une base théorique.
4.6 Le sous-consommationnisme dans le texte
4.6.1 La dernière cartouche sous-consommationniste
Nous avons largement montré en quoi le marxisme n’était pas sous-consommationniste. Nous avons également vu les spécificités, ignorées ou escamotées par les deux tendances du marxisme de la chaire, de la surproduction de marchandises. Nous pouvons maintenant commenter une des citations qui sert de point d’appui aux théoriciens sous-consommationnistes pour justifier leur analyse.
Que dit ce passage si souvent cité ?
« La raison ultime de toutes les crises réelles, c’est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l’économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n’avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société. » (Marx, Capital, L.III, Pléiade, T.2, p.1206).
Pour bien le comprendre il faut citer l’ensemble du passage.
« Imaginons une société composée uniquement de capitalistes industriels et de salariés. Négligeons en outre les variations de prix qui empêchent d’importantes parties du capital total de se remplacer dans leurs proportions moyennes et qui, étant donné la cohésion générale du processus de reproduction (particulièrement favorisé par le crédit), ne peuvent manquer de provoquer périodiquement une stagnation générale. Négligeons également les affaires fictives et les transactions spéculatives suscitées par le système de crédit. Une crise ne pourrait alors s’expliquer que par une production disproportionnée dans les diverses branches de l’économie et par un déséquilibre entre la consommation des capitalistes eux-mêmes et leur accumulation. Toutefois, dans l’état actuel des choses, le remplacement des capitaux engagés dans la production dépend surtout du pouvoir de consommation des classes non productives, tandis que le pouvoir de consommation des travailleurs est limité en partie par les lois du salaire, en partie par le fait qu’ils ne sont employés qu’aussi longtemps que leur emploi est profitable pour la classe capitaliste. La raison ultime de toutes les crises réelles, c’est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l’économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n’avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société. (Marx, Capital, L.III, La Pléiade, T.2, P.1206)
4.6.2 Explication de texte
« Raison ultime » : il s’agit donc de la raison en dernier ressort, en dernière analyse. Marx a dépouillé son analyse, réduit la société aux capitalistes et aux salariés, éliminé le crédit, etc., pour se concentrer uniquement sur une sphère délimitée, son « noyau dur », de la production capitaliste. Notre texte ne fait pas autre chose, car il se concentre sur les fondements de crises. Marx ici ne prend pas donc en compte tous les déterminants des crises. Ce qui est visé ici c’est leur fondement absolu, un rappel du cadre général dans lequel ces crises s’inscrivent[218].
« Crises réelles » : il s’agit donc non pas des crises contingentes, des épiphénomènes qui ont un caractère transitoire, de crises partielles ou encore de crises qui restent limitées à une sphère particulière mais des crises fondamentales et générales qui affectent l’ensemble de la production capitaliste.
« Pouvoir de consommation absolu » signifie pouvoir de consommation théorique, potentiel. D’un point de vue théorique, le pouvoir de consommation, est potentiellement égal à la valeur de la production, soit c + v +pl (nous faisons abstraction de l’incidence du crédit, des variations du patrimoine et de l’épargne, …). Il existe donc un potentiel de consommation égal à cette production qui permettrait de la réaliser. C’est sur ce fait que s’appuient Ricardo et Say (et avant eux James Mill) pour dire que la production crée sa propre demande, ses propres débouchés[219]. En montrant qu’une scission entre la vente et l’achat est possible, que la réalisation[220] de la plus-value et du produit social, le passage du capital marchandise au capital argent et, par la même occasion, du capital argent en capital productif ne sont pas automatiques, Marx montre la possibilité de la crise générale. Les difficultés potentielles de la réalisation concernent alors l’ensemble du produit social (c + v + pl) et non pas seulement une partie de celui-ci (pl ou partie de pl).
« tendance à développer les forces productives » : Le but de la production capitaliste est la recherche du maximum de plus-value, ce faisant nous l’avons vu, il tend vers la surproduction (suraccumulation ou surproduction de marchandises). Dans la phase d’expansion du cycle, le taux de profit se relève et la masse des marchandises se gonfle sous l’effet d’un développement de la productivité qui est d’autant plus grand que la plus-value relative s’accroît. Plus les forces productives sont développées, plus la productivité doit croître pour arracher un excédent de plus-value et plus la masse des produits s’accroît.
« C’est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses » : Ecartons, comme nous l’avons montré, la possibilité qu’une quelconque partie du produit social annuel (le capital argent, le capital productif, le capital marchandise qu’il s’agisse de moyens de production ou de moyens de consommation, sont le monopole de la classe capitaliste) soit réalisée par le prolétariat. Par conséquent la consommation restreinte des masses n’est pas à la base d’une limitation absolue dans la réalisation de la production dont le corollaire, vecteur d’amélioration de la situation, serait la hausse des salaires. La réalisation n’est pas donnée en soi et cela rend la crise générale possible. Mais la critique ne s’arrête pas là. Marx montre également que la composition matérielle (suivant que les marchandises sont destinées à la consommation productive ou non productive) et la masse du produit social (le volume des marchandises produites) est source de crise, et celles-ci sont dictées par les buts poursuivis par le mode de production capitaliste. Il ne s’agit donc pas tant de sous-consommation des masses en soi, sous-consommation qui a existé dans les autres sociétés de classes, que de celle qui résulte du mode de production capitaliste. Il faut comprendre que c’est la forme même, la composition et la masse de cette production, qui pose des difficultés et ceci est la résultante des conditions sociales, des rapports de production capitalistes, des relations entre les classes et des objectifs limités de cette production : la mise en valeur du capital, la recherche du maximum de plus-value. En recherchant le maximum de survaleur, on expose la société à un excédent de surproduit.
4.6.3 Taux de plus-value et consommation
Quand Marx fait remarquer aux chevaliers du simple bon sens que, avant les crises, quand le capital est dans une phase d'expansion de son cycle, que son taux de profit s'élève, que les salaires réels s'élèvent sous l'effet de la reprise de l'accumulation et qu'avec elle se résorbe l'armée de réserve industrielle, il ne dit pas pour autant que le taux de plus-value diminue.
Il dit que la classe ouvrière obtient une plus grande part de la fraction annuelle du produit social destiné à la consommation. C'est-à-dire que la classe ouvrière obtient une part plus importante de la valeur représentée par la consommation non productive.
En d'autres termes, la classe productive améliore sa position relative par rapport aux autres classes prises comme un tout. Cela ne veut pas dire que le prolétariat améliore sa situation relative par rapport au capital. Ce serait contraire, sinon occasionnellement, à toute la perspective marxienne.
Décomposons la partie du produit social correspondant au travail vivant soit :
w = v + pl (le capital variable et la plus-value),
Introduisons la consommation des classes improductives (v’) nous obtenons :
w = v + v’ + pl’ avec v’ + pl’ = pl.
Dans cette représentation, la fraction du produit social destinée à la consommation est égale à v + v’.
Par conséquent, si le rapport v/v’, le rapport du capital variable à ce qui représente la consommation des classes improductives au sein du MPC (classe moyenne, capitalistes, propriétaires fonciers) s’accroît, on ne peut en tirer aucune conclusion quant à l’évolution du rapport pl/v.
Ce dernier est égal, compte tenu des éléments additionnels que nous avons pris en compte, à :
(pl’ + v’)/ v .
Ce rapport peut augmenter tandis que l’autre (v’/v) diminue.
Prenons un exemple.
Temps 1 : w = 50 pl’ + 20 v’ + 30 v
Temps 2 : w = 60 pl’ + 15 v’ + 25 v
Les valeurs n’expriment ici que des valeurs relatives, on peut très bien envisager (c’est même la tendance effective) que, avec l’accumulation, les valeurs absolues au temps 2 soient plus élevées qu’au temps 1.
Dans notre exemple, le taux de plus-value est passé de 70/30 (2,33) à 75/25 (3) tandis que le rapport de consommation passe de 30/20 (1,5) à 25/15 (1,66). Tout en étant plus exploitée, la classe productive obtient une part plus importante du produit social destiné à la consommation. Tout cela correspond à une accélération de l’accumulation et une augmentation du taux d’accumulation ce qui suppose, en tendance, une évolution favorable du taux de profit (c’est ce qui advient dans les phases d’expansion du cycle).
4.6.4 Evolution du rapport entre les classes
Admettons que nous ayons face à face uniquement le prolétariat et le capital et donc que toute la plus-value soit accumulée. Le taux de profit tend à s’élever avec la recherche d’un maximum de plus-value, la masse des marchandises dont celles qui prennent la forme du capital fixe enfle avec le développement de la productivité, la masse et le taux de la plus-value augmentent. La masse de la plus-value accumulée s’accroît et la masse des moyens de production qui sont produits et accumulés encore plus. Une immense tendance à la surproduction se met en place conformément à l’être du capital, la recherche du maximum de plus-value et la poursuite continue de celle-ci à travers son accumulation, la tendance à produire pour produire, à développer les forces productives comme si elles n’avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société[221].
Nous l’avons vu, si nous en restons à un rapport entre le capital et la classe productive, la tendance du capital est de réduire la part de la classe productive dans le produit social en accroissant le rapport entre le surtravail et le travail nécessaire, et le rapport entre le capital constant et la capital variable. Cela signifie que la partie qui est produite sous forme de moyens de consommation diminue relativement même si la masse augmente, tandis que la fraction qui doit se présenter sous forme de moyens de production augmente non seulement en valeur mais également en volume. Si on laisse les choses en l’état, le phénomène ne peut que s’accentuer et favoriser rapidement la surproduction.
Cette machine qui s’emballe et que la surproduction (quelle que soit sa forme) menace de toute part, doit être réfrénée, d’où la nécessité d’une classe qui consomme sans produire. Cette classe ne peut pas être le prolétariat puisque la plus-value dépend justement du fait qu’elle ne peut fournir une demande adéquate. Cette classe ne peut pas non plus être, sinon partiellement, la bourgeoisie. Au fur et à mesure qu’elle s’affirme socialement que le capital s’accroît, elle se doit de faire étalage de sa richesse ne serait-ce que pour obtenir du crédit et le développement de produits de luxe obéit à cette nécessité mais sa capacité de consommation reste limitée du fait de son importance et cette tendance ne peut être mélangée avec sa fonction fondamentale qui est l’accumulation de la plus-value[222]. Si des tendances à la surconsommation se manifestent dans la bourgeoisie ce sont des marques de son déclin historique.
En tout état de cause, une autre classe qui ait la passion de la consommation, de la dépense et non de l’accumulation doit prendre le relais afin de ralentir le monstre sans pour autant attenter à son but, la production d’un maximum de plus-value. Cette classe, c’est la classe moyenne, une classe improductive qui incarne la passion de la consommation, de la dépense face à la classe capitaliste, aux managers, dont la fonction est l’accumulation.
En consommant une partie de la plus-value, cette classe stimule notamment la production de moyens de consommation nécessaires et par voie de conséquence favorise l’abaissement de la valeur de la force de travail (y compris la sienne) et ensuite limite la fraction de la plus-value accumulée, donnant ainsi une plus grande stabilité à la production capitaliste en limitant son emballement. Outre la classe moyenne, des investissements en capital fixe dont les effets ne seraient pas immédiats sur la productivité (grandes infrastructures, canaux, etc.) sont aussi une des modalités pour dissiper la plus-value.
La baisse tendancielle du taux de profit s’inscrit également dans cette perspective. Epuisé par des crises régulières, le capital doit baisser de régime, reconnaître qu’il est dépassé, renoncer à sa mission, abandonner pour une part ce qui faisait sa détermination, se survivre à lui-même, développer des tendances parasitaires. La baisse du taux de profit, dans ces circonstances, s’affirme alors pleinement.
Revenons maintenant à la question de l’amélioration de la situation relative du prolétariat par rapport aux autres classes. Avec l’accumulation, la tendance à la surproduction est favorisée tandis que la classe ouvrière obtient une part plus grande du produit destiné à la consommation. On doit donc déduire de cette situation que la demande des classes non productives diminue relativement.
Dans cette perspective, il y a deux situations à distinguer :
D’une part, la phase du cycle qui se traduit par le recouvrement de l’activité, puis par une animation de l’activité, etc., bref la phase d’expansion du cycle ou l’accroissement de la part du prolétariat (et des classes moyennes) dans la fraction du produit social destiné à la consommation résulte des progrès de l’accumulation et donc de la contraction relative de la dépense de la bourgeoisie toute à sa passion de l’accumulation.
D’autre part, la phase finale du cycle où emportée par le tourbillon de la surproduction et de la spéculation, confrontée aux difficultés de production et de réalisation de la plus-value, l’accumulation ralentit, tandis que la bourgeoisie attaque les autres classes sociales à commencer par les classes moyennes[223]. Ce qu’elle gagne en matière de plus-value et de taux de profit, elle risque de le perdre en tant que consommation des classes dominées. La classe moyenne est, au début relativement plus touchée que le prolétariat et son mouvement annonce l’entrée en scène de ce dernier.[224]
4.7 La conversion de Marcel Roelandts au sous consommationnisme
4.7.1 Continuité de la méthode, absurdité du raisonnement
Marcel Roelandts nous a promis une synthèse entre les deux tendances opposées de l’économie politique au nom de l’unité de la théorie de Marx. Nous avons déjà montré qu’en ce qui concerne le taux de profit et la suraccumulation il avait retenu les pires aspects de cette école. Suivons le maintenant dans les méandres de sa conception sous-consommationniste, école à laquelle il finit par adhérer exclusivement, en dépit de ses efforts de synthèse.
Marcel Roelandts héritier des conceptions vulgaires des théories sous-consommationnistes doit montrer, pour expliquer la crise, que la demande finale baisse. Pour ce faire, il emploie la même « méthode » que celle utilisée précédemment lors de l’analyse de la baisse du taux de profit. C’est-à-dire qu’il multiplie les arguments contradictoires. Nous avons vu avec quels tours de passe-passe il créait de toute pièce une crise résultant de la baisse du taux de profit. Une opération similaire est menée pour amener une baisse de la demande solvable. Ainsi après avoir exposé une théorie de la baisse du taux de profit qui n'en est pas une, Marcel Roelandts poursuit par une théorie néo sous-consommationniste qui est également un défi non seulement à la pensée dialectique mais aussi à la pensée rationnelle.
Le fait que la réalisation du capital-marchandise en capital-argent ne soit pas automatique donne la possibilité de la crise. Par conséquent, quand la crise éclate, elle est synonyme d’absence de demande solvable. Pour que l’accumulation reprenne et avec elle une demande permettant la réalisation du produit social, le capital doit être dévalorisé brutalement (baisse ruineuse des prix, destruction du capital du fait de son inaction, mise au rencart de moyens de production obsolètes, faillites d’entreprises, dévalorisation de capital fictif, licenciements et son corollaire augmentation rapide de l’armée de réserve industrielle dont l’un des effets majeurs est de faire pression à la baisse sur les salaires, etc.). Le capital suffisamment dévalorisé peut reprendre son cours, rechercher à nouveau la production d'un maximum de plus-value. La crise est donc à la fois la manifestation d'une rupture de l'équilibre et le rétablissement violent de celui-ci. A cette vision dialectique, Marcel Roelandts substitue, à l'instar des théoriciens sous-consommationnistes, une conception mécaniste. Celle-ci est, par ailleurs, complètement absurde. Et cette absurdité provient notamment de sa tentative de réunification des deux tendances de l'économie politique.
L’absurdité est le produit de la synthèse et la synthèse réunit deux composantes poussées à l’absurde.
4.7.2 Une crise en trompe l’oeil
En effet, s'il y a une crise, on doit s'attendre à ce que la demande solvable fasse défaut sinon cette crise n'a pas d'existence effective. La crise doit se manifester dans la sphère de la réalisation, de la circulation, de la finance et du commerce ; c’est dans cette sphère qu’elle éclate. Dans le schéma de Marcel Roelandts, il n'en est rien. Dans cette représentation c'est la « crise » (nous allons voir qu’en fait de crise, il s’agit d’une illusion, d’un faux-semblant) qui précipite la baisse de la demande solvable. Il y a une logique de cause à effet, une succession dans le temps et non la manifestation dans la sphère de la réalisation d’une crise qui prend sa source dans le processus de production de la plus-value.
Pour Marcel Roelandts, la baisse du taux de profit engendre une « crise et un ralentissement de l'activité économique » (p.23). S'il s'agit d'une crise véritable, non seulement l'activité économique ralentit mais elle recule, les stocks gonflent, la production s'arrête, des entreprises chôment, d'autres ferment, dans les services on attend le client et le temps perdu ne se rattrape que très rarement, le chômage enfle, etc. Les deux termes (crise et ralentissement) supposés exprimer la crise sont en fait contradictoires. Si Marcel Roelandts avait dit qu'à l'issue de la crise l'activité économique ralentissait, c'est-à-dire que l'accumulation reprenait mais à un rythme moins soutenu que lors du cycle précédent, on aurait pu y voir une représentation très stylisée de la baisse du taux de profit (cette représentation sommaire aurait notamment fait l'impasse sur le tendanciel). Mais ce n’est pas le cas dans son analyse. Les deux aspects sont présentés comme concomitants. Or, ils sont contradictoires dès lors que l'on se situe au niveau du capital total.
Par conséquent, dans la représentation de Marcel Roelandts, la baisse du taux de profit, et pour cause, n’a jusqu’ici engendré aucune crise. Le seul effet véritable est le ralentissement économique[225]. Mais un ralentissement économique n’est pas une crise. L’affirmation qu’il existe une crise ne repose sur rien, c’est une poignée de sable lancée par l’illusionniste Marcel Roelandts pour détourner notre regard ou nous aveugler pour faire passer en contrebande une sous-consommation frelatée.
4.7.3 Exégèse sous consommationniste
Après avoir assimilé le ralentissement de l’activité à la crise, donc après avoir escamoté la crise, Marcel Roelandts peut poursuivre la veine sous-consommationniste.. Suivant son point de vue, le ralentissement de l'activité restreint la demande finale. Marcel Roelandts commence par affirmer qu'il y a « baisse des investissements en capital fixe et donc de l'accumulation, (…) » (o.p.c. p.23) On notera à nouveau que l’accumulation du capital est, au fond de sa représentation, seulement une accumulation de capital constant voire uniquement de capital fixe. Comme pour tous les vulgaires, le capital variable ne fait pas partie de l’accumulation du capital.
A ce niveau d'abstraction, deux facteurs déterminent essentiellement le taux de croissance[226].
· Le taux de profit
· le taux d'accumulation
Si le taux de profit baisse, nous l'avons vu, le taux d'accumulation aura également tendance à baisser et le taux de croissance, par conséquent, baissera d'autant plus. Mais cela n'est en rien un facteur de crise. L'activité ralentit, l'armée de réserve industrielle s'accroît à la fois du fait de la hausse de la composition organique et de la diminution du taux d'accumulation mais on ne peut en inférer la preuve d'une baisse de la demande finale. Si nous écartons les crises liées aux disproportions qui surgissent en permanence dans la composition matérielle du capital et celles propres aux mouvements dans la sphère financière, une baisse du taux d'accumulation pourrait correspondre à une hausse du taux de consommation de la plus-value. Par conséquent, nous n’avons pas avancé d’un pouce. La « crise » ne s’est développée que dans l’imagination de Marcel Roelandts.
Le ralentissement de l’activité n’est pas le seul facteur qui influence la baisse de la demande finale. On doit y ajouter une autre composante, tout à fait classique dans l’esprit sous-consommationniste : la baisse de demande engendrée par l‘élévation du taux de plus-value
Dans cette analyse, la hausse du taux de plus-value induit avec la baisse de la part des salaires de la classe productive, dans la valeur créée par le travail vivant, une baisse de la demande de moyens de consommation. Le ralentissement de l’activité et la hausse du taux de plus-value sont donc les deux ressorts qui engendrent une baisse de la demande finale qui, notons-le, ne concerne qu’une partie de la plus-value.
Pour lier les deux aspects de la théorie, pour relier baisse du taux de profit et baisse de la demande, Marcel Roelandts a du entamer une énième révision. Pour Marx, l'obtention du maximum de plus-value qui est le but exclusif de la production capitaliste induit un développement de la productivité du travail dont une des manifestations est la baisse tendancielle du taux de profit (et la hausse tendancielle du taux de plus-value – cf. Chapitre 2.1). Pour Marcel Roelandts, c’est la baisse du taux de profit qui pousse le capital à accroître le taux de plus-value[227]. Nous retrouvons la rhétorique commune à l’économie vulgaire. Ce sont en fin de compte des causes particulières, extrinsèques, qui conduisent le capital à exploiter le prolétariat
Comment ce processus qui, a priori, menace d’être fréquent sinon permanent (le but de la production capitaliste est de produire le maximum de plus-value ; la perspective d’une hausse du taux de plus-value est donc inhérente à l’être du capital) se traduit-il par un cycle (a fortiori « décennal »[228] ? Cela ne nous est pas expliqué. Est-ce parce que justement on nie que le but de la production capitaliste soit de produire un maximum de plus-value ? Ou encore parce que Marcel Roelandts et associés se représentent le phénomène de la crise de surproduction comme un jerrican qui se remplirait de liquide et qui ne déborderait que quand il est plein ? Chaque année, la surproduction s’accumulerait pour ne se révéler que périodiquement. Cette conception ne serait qu’une variante (pour l’essentiel absurde si nous écartons la partie cohérente qui se traduit par la variation des stocks) au sein des théories sous-consommationnistes qui donnent un caractère permanent à la crise.
4.7.4 Surproduction artificielle
Dans le schéma résumant la conception de Marcel Roelandts, la crise est mise entre parenthèses. En effet, nous avons vu qu’elle n’avait aucune légitimité, aucune explication véritable, aucune validité ni fondement matériel. Ce n’est que par un tour de passe-passe que Marcel Roelandts fait accélérer cette baisse du taux de profit en faisant jouer à la concurrence un rôle que Marx a toujours exclu de son analyse[229]. Plus tard, au sein de son livre, en analysant les statistiques, il met en évidence des baisses marquées du taux de profit mais sans pour autant en tirer les conséquences quant à l’articulation entre ces baisses appuyées, brutales, au moment des crises, et la baisse tendancielle du taux de profit ; bref, sans relever que ces baisses du taux de profit qui sont caractéristiques de la surproduction (qu’elles engendrent la surproduction – cas de la suraccumulation – ou qu’elles soient provoquées par elle – cas de la surproduction de marchandises - ) sont un élément à distinguer, une phase bien particulière au sein du processus général que traduit la baisse tendancielle du taux de profit moyen.
Par conséquent, au lieu de déclencher une crise au cœur même du processus de valorisation, crise qui se traduit par une baisse brutale du degré d’exploitation de la force de travail et par conséquent par un manque de plus-value, phénomène caractéristique de la suraccumulation (absolue ou relative suivant son intensité) et qui pose au niveau du capital total (c + v + pl et pas seulement une partie de celui-ci, pl ou partie de pl) la question de la réalisation du produit social, Marcel Roelandts doit introduire une conception mécaniste, caractéristique des théories sous-consommationnistes auxquelles de fait il se rattache, car les préliminaires sur la baisse du taux de profit[230] ne servaient qu’à introduire cette insuffisance de la demande finale.
Dans cette représentation, la baisse du taux de profit a d’ailleurs tellement peu d’importance que l’une des autorités revendiquées par Marcel Roelandts, à savoir Michel Husson, produit le même schéma intellectuel tout en clamant à corps et à cri que le taux de profit ne cesse de croître tandis que baisse le taux d’accumulation pour cause de champ d’accumulation insuffisamment rentable. Par conséquent, que le taux de profit baisse ou augmente n’a aucune importance. Le seul paramètre utile est la baisse du taux d’accumulation avec pour effet d’induire une baisse de la demande de capital fixe (nous avons vu par ailleurs qu’il s‘agissait d’une approche qui limitait l’accumulation au seul capital fixe et non au capital constant et capital variable). Comme d’un autre côté, il est possible que le taux de plus-value augmente quelle que soit la tendance du taux de profit, cette dernière question devient d’autant plus secondaire.
Dans l’autre cas, nous l’avons exposé, la possibilité de la crise est donnée du fait d’une possible scission entre la vente et l’achat. Cette perspective fait que la réalisation du capital marchandise, sa transformation en argent à l’issue du processus de production n’est pas acquise au niveau du capital global. En fin de compte c’est comme s’il existait des lignes de fractures le long d’une boîte, des parties pré découpées, qui en temps normal ne sont pas altérées et assurent correctement l’étanchéité de la boîte mais qui, dès lors qu’une pression interne devient trop forte, se déchirent selon les lignes de fractures définies. La crise de surproduction dont l’origine doit être cherchée dans le processus de production, soit dans la production d’insuffisamment de plus-value en rapport avec le capital avancé, soit dans la croissance accélérée du surproduit et le déséquilibre de ces composantes sous l’effet du développement de la force productive du travail. Le premier phénomène suppose une baisse du degré d’exploitation de la force de travail, donc ici un retournement dans le progrès de la productivité du travail. En conséquence, une baisse brutale du taux de profit exerce une pression qui se traduit par une crise générale de surproduction. L’ensemble de ce capital tend à ne plus fonctionner comme capital et donc ne peut se réaliser en argent. Une production insuffisante de plus-value et la baisse du taux de profit exerce la pression qui rend la crise nécessaire tandis que les facteurs qui font que la réalisation du produit social n’est pas automatique rendent possible son expression sur le marché en tant que crise de surproduction. Sinon, dès lors que l’accumulation s’accélère, que la productivité s’accroît et gonfle la masse des marchandises, leur débouché et la réalisation de la plus-value et de valeur qu’ils contiennent sont d’autant plus compliqués à obtenir que le capital est dévalorisé. Un autre type de surproduction, la surproduction de marchandises menace. Les deux formes de surproduction ne sont pas séparées. Elles sont deux écueils, deux faces d’une même limite, qui trouvent leur fondement dans le développement contradictoire de la force productive du travail.
Il ne s’agit donc pas de facteurs perturbateurs de la demande finale qui viennent s’additionner ou se réduire suivant les fluctuations de l’accumulation et du taux d’exploitation mais d’un ensemble organique qui à un moment donné sous la pression de la baisse brutale du taux de profit ou de la croissance du surproduit se traduit par la séparation des conditions de la production et des conditions de la réalisation. Ce potentiel de crise, la possibilité des crises, comme leur nécessité sont inhérentes à la production capitaliste.
Marcel Roelandts n’a évité aucun des pièges de la théorie sous-consommationniste. Quand il prétend le faire, ce n’est qu’en déformant la théorie de Marx.
Tout d’abord, il accepte l’idée que la question de la réalisation ne concerne qu’une partie du produit social : la plus-value[231]. L’économie politique classique qui par ailleurs ne comprenait pas que la valeur du capital constant entrait dans la valeur du produit social ne pouvait pas, par conséquent, se préoccuper de sa réalisation, pour autant qu’elle y reconnût une difficulté particulière. Il est certain également que la tendance qui reconnaissait la possibilité de crises générales, c’est-à-dire la tendance que représente Sismondi, ne concentrait son attention que sur la plus-value, le profit. Sur ce plan, l’économie politique marxiste vulgaire n’a donc pas avancé d’un pouce par rapport à l’économie politique classique. Les conséquences politiques ne sont pas neutres. D’une part, le potentiel de la crise est sous-estimé. La contrepartie « politique » de cette analyse est d’induire d‘un côté une forme de volontarisme pour ce qui relève d’une conception révolutionnaire et d’un autre côté conduit à minimiser le cours catastrophique de la production capitaliste et conduit dans le marais social démocrate, dans les représentations propres au socialisme bourgeois ou petit-bourgeois.
D’autre part, une crise mécanique est mise en avant. Marcel Roelandts ne parle pas de crise permanente. Bien au contraire, il milite, nous l'avons vu, pour un cycle décennal. Cependant toute sa conception conduit à l'inverse. Cette dimension, engendre politiquement une forme de passivité. On pourrait nous dire que la résultante de ces tendances contraires donne un juste milieu ; en fait, leurs représentants vont de charybde en scylla et errent systématiquement.
4.8 Conclusion
En niant les spécificités de la théorie de Marx, Marcel Roelandts renoue avec l'interprétation la plus vulgaire de la théorie de la baisse du taux de profit et en déduit de manière incohérente une crise. Enlevons cette incohérence et il reste le règne éternel du capital.
Marcel Roelandts a donc réussi, à reprendre, en dépit ou grâce à sa forme oecuménique, ce qu'il y avait de plus mauvais dans la représentation marxiste vulgaire d'inspiration ricardienne.
Nous avons vu que dans la représentation de Marcel Roelandts, la baisse du taux de profit n’engendrait aucune crise. Sa présence dans le processus explicatif était superficielle, un simple verni orthodoxe, fondamentalement inutile mais destiné à permettre une synthèse entre les deux tendances de l’économie politique marxiste vulgaire. Ce faisant, Marcel Roelandts avait repris ce qu’il y avait de plus mauvais dans la tendance ricardienne. Cette dimension, quoique particulièrement vulgaire, étant purement ornementale, elle ne fait que préparer la conversion aux conceptions théoriques de la seconde tendance, la tendance sous-consommationniste dont on reprend tous les défauts quand on ne les amplifie pas. Le projet de Marcel Roelandts aux accents orthodoxes s’achève donc par un naufrage théorique et pratique.
Pourtant le marxisme révolutionnaire à vocation scientifique ne manque pas de sujets d'études. L'étude des conditions pour que se manifeste la suraccumulation du capital et la baisse brutale du taux de profit qui l'accompagne par exemple en est un. Les modalités pour qu’intervienne une surproduction de marchandises en est un autre. Marx nous a donné des photos du cycle de l'accumulation à divers moments de celui-ci. Il est de la responsabilité du mouvement communiste d'en établir le film 3D, qui permettra de relier entre elles ces photos notamment en introduisant le processus valorisation dévalorisation dans l'analyse. Encore faut-il partir des négatifs originaux et non des montages et trucages numériques réalisés qui par des staliniens, qui par des sociaux-démocrates, qui par des petits bourgeois universitaires, qui par des savants bourgeois.
5. Annexe 1 : La fonction des classes moyennes
Comme nous l’avons dit, nous étudierons de façon plus détaillée les conséquences économiques et sociales liées à l’émergence d’une classe moyenne moderne, salariée, qui se développe avec le mode de production capitaliste le plus moderne. Ce sera l’objet de la deuxième partie de ce texte. Mais sans plus attendre, nous souhaitons démontrer que cette évolution du mode de production capitaliste est bien prévue par Marx, comme ne cesse de la répéter notre parti depuis plus de 40 ans. (Cette thèse est déjà défendue notamment dans la revue Invariance, première série). Il ne s’agit donc pas d’une analyse que nous tirons de notre chapeau mais d’une partie constitutive de la théorie de Marx. Cette partie n’a reçu que des développements fragmentaires, mais d’une profonde unité, parce qu’ils devaient être développés dans une autre partie de « l’Economie » de Marx. Elle a pu donc être facilement escamotée par les divers révisionnismes et autres adversaires du marxisme. Cette annexe, que nous réintégrerons dans la deuxième partie de ce travail, démontre donc que la nécessité et le développement d’une classe moyenne salariée sont une composante essentielle de la théorie de Marx.
Dans le livre I du capital, Marx expose le rôle du manager capitaliste en définissant sa fonction sociale comme sa psychologie et son évolution. Le manager capitaliste (à distinguer du propriétaire) personnifie le capital[232]. Il a pour fonction de faire produire le maximum de plus-value, ce qui suppose à la fois d’obtenir le meilleur rendement possible de la force de travail à un moment donné et aussi d’étendre[233], en grandeur comme en profondeur, l’accumulation du capital[234]. La production pour la production, l’exaltation du développement de la force productive du travail, telle est la fonction du capitaliste.
Avec le développement de la production capitaliste la frugalité, l’austérité, l’avarice, propres à cette fonction vont en s’affaiblissant. Le capitaliste cède aux sirènes de la consommation improductive de la plus-value. Il est vrai, dès lors que la concentration et la centralisation du capital ont progressé, qu’une plus-value croissante lui permet d’accroître sa consommation sans pour autant affaiblir notablement son accumulation. D’autre part, cette consommation devient une nécessité professionnelle dans la mesure où l’étalage de sa richesse est un moyen d’obtenir du crédit, d‘inspirer la confiance et d’entretenir le cercle de ses relations.[235] Mais cette tendance rencontre des limites et la jouissance, la dépense se font avec une forme de mauvaise conscience [236].
Dès lors que le capitaliste renoncerait à la jouissance de l’accumulation pour l’accumulation de la jouissance, il renoncerait à sa fonction ; la sanction à terme, pour le capitaliste qui consommerait improductivement la plus-value plutôt que de l’accumuler, serait sa disparition[237]. Du point de vue du capital total, deux écueils opposés guettent le mode de production capitaliste. Si nous supposons une société qui ne serait composée que de prolétaires faisant face à un capital qui n’aurait pour seule préoccupation que la production et l’accumulation de la plus-value, il s’ensuivrait un développement vertigineux des forces productives et de la productivité du travail. Ce développement prodigieux saperait d’autant plus rapidement les bases de cette même production capitaliste en poussant la dévalorisation du capital à son comble tout en créant une immense accumulation de marchandises dont la difficulté d’écoulement, leur réalisation, irait croissant. D’un autre côté, un développement de la production pour la production, concomitant avec un développement de la richesse personnelle du capitaliste, pourrait conduire la production capitaliste à s’étioler, à perdre son dynamisme, à ronronner devant la masse des profits sans chercher à pousser systématiquement au développement de la force productive du travail.
Dès 1845, Marx et Engels insistaient sur le fait qu’en même temps que le mode de production capitaliste développe les forces productives, elles se changent aussi en forces destructives[238]. Tandis que le capitaliste incarne la passion de l’accumulation, l’amour de la production pour la production, il faut que dans la société s’exprime la passion de la dépense, de la consommation pour la consommation. Nous avons vu que le capitaliste ne peut avoir complètement cette fonction sans renoncer à son être. Il faut donc que le pendant dialectique de la production, la consommation, s’exprime dans une autre classe[239]. Une classe qui représente la dépense, la consommation pour la consommation est donc nécessaire. Comme la classe capitaliste, malgré ses progrès, ne peut assurer à elle seule cette fonction et qu’à un certain point celle-ci entre en contradiction avec sa fonction sociale, la classe qui représentera le mieux la passion de la dépense et de la consommation est la classe moyenne. Bien souvent, à ce stade de l’analyse, Marx convoque Malthus[240]. Malthus est réactionnaire[241] car il défend des fractions des classes dominantes (aristocratie terrienne, clergé, …) historiquement dépassées, mais le fond de l’analyse est juste[242]. Et si les classes que représente Malthus déclinent, d’autres, au contraire, se développent avec le progrès de la production capitaliste[243].
Nous venons donc de mettre en évidence, citations à l’appui, la fonction économique générale de la classe moyenne, chez Marx. Elle incarne la passion de la dépense et à ce titre joue un rôle régulateur dans le cadre du mode de production capitaliste. Le volcan de la production est limité dans son expansion et, en même temps, stimulé. Est-ce le seul avantage de l’existence d’une classe moyenne ? A t-elle, pour Marx, un rôle d’amortisseur social dans la lutte des classes ? Les citations suivantes répondent à ces questions.
« Ce qu’elle [la présentation bourgeoise apologétique du machinisme. NDR] affirme – et, en partie à juste titre – c’est que, par suite du machinisme (en général du développement de la force productive du travail), le revenu net (profit et rente) augmente, de telle sorte que le bourgeois a besoin de plus de domestiques et autre travailleurs qui vivent de la classe improductive. Cette transformation des ouvriers en domestiques est une belle perspective. De même qu’il est consolant pour eux de voir la croissance du produit net entraîner l’ouverture de sphères supplémentaires pour le travail improductif, qui se nourrissent de leur produit et dont l’intérêt concurrence plus ou moins, quant à leur exploitation, celui des classes directement exploiteuses. » (Marx, Théories sur la plus-value, Editions sociales, T.2, p.684)
« Ce qu’il [Ricardo – NDR] oublie de souligner c’est l’accroissement constant des classes moyennes qui se trouvent au milieu, entre les ouvriers d’un côté, le capitaliste et le landlord de l’autre, qui se nourrissent pour l’essentiel directement et dans une proportion de plus en plus grande de revenu, qui pèsent comme un fardeau sur la base ouvrière et qui accroissent la sécurité et la puissance sociales des dix mille familles les plus riches. » (Marx, Théories sur la plus-value, Editions sociales, T.2, p.684)
Pour Marx donc, les classes moyennes jouent également un rôle social et politique en servant de rempart aux classes dominantes.