|
|
LA THEORIE DE LA CRISE CATASTROPHIQUE DU MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE, BASE VITALE DE LA PREVISION REVOLUTIONNAIRE DU COMMUNISME |
|
|
Communisme ou Civilisation
Réédition 2013 / V 1.1 (parution originale 1980-1998)
|
|
|
30 €uros |
Sommaire
1.4 Crise et luttes des classes
2.1 La Gauche Communiste d'Italie et la prévision.
2.2 Parti et prévision du communisme.
3. Le doute révisionniste à l'assaut de la théorie communiste.
3.1 La montée du révisionnisme.
3.3 Rosa Luxemburg, chef du mouvement communiste international.
4. La reproduction simple et élargie dans le livre II du « Capital »
4.1 L’état du livre II du « Capital »
4.2 Les schémas de reproduction : la reproduction simple
4.3 Les schémas de reproduction : la reproduction élargie
5.2 Le programme communiste comme critique de l’économie politique
5.3 Le « milieu révolutionnaire », héritier de l’économie politique
6. Les crises et les disproportions
6.1 Un argument en faux-semblant : la composition du produit social.
6.3 Tugan-Baranovsky révise le communisme
6.4 Tougan-Bararanovsky révise les schémas de reproduction
6.5 Tugan-Baranovsky ne rencontre plus de limites
6.6 La théorie communiste et la sous-consommation
7. La tentative de restauration de Rosa Luxemburg et ses limites
7.1 Rosa Luxemburg adoube Tugan-Baranovsky
7.2 Rosa Luxemburg critique des schémas de reproduction
8. La crise chez Rosa Luxemburg
8.1 Rappel des résultats obtenus précédemment
8.2 Ce que la théorie de Rosa Luxemburg n’est pas
8.3 La théorie des crises de Rosa Luxemburg
9. Le marxisme vulgaire contre Rosa Luxemburg
9.1 Les réactions dans la social-démocratie
9.6 Hausse des salaires et réalisation de la plus-value
10. Au delà de Rosa Luxemburg : Les positions du programme communiste
10.1 La structure du Livre II.
10.2 Le circuit du capital individuel.
10.3 Le circuit du capital total.
10.4 La crise générale de surproduction
10.6 Crise historique, crise finale
11. Rosa Luxemburg et l’or dans les schémas de reproduction
11.1 L’inachèvement du Livre II
11.2 La reproduction de la matière monétaire dans les manuscrits du livre II du « Capital »
11.3 Les objections de Rosa Luxemburg
11.4 Le matériel argent doit-il faire l’objet d’une section particulière ?
11.5 Les solutions de Rosa Luxemburg et de Grossmann
11.6 Esquisse d’un schéma équilibré
11.7 Thésaurisation et reproduction simple.
11.8 L’abolition du capital argent
11.9 Remarques complémentaires
12. Accumulation du capital et militarisme : Rosa Luxemburg
12.1 Rosa Luxemburg et le problème des armements.
12.3 Rosa Luxemburg brûle ce qu’elle avait adoré.
12.5 Les épigones sur le sentier de la guerre
12.6 Les racines de la production d’armements
13. La reproduction des armements dans le cadre des schémas de la reproduction élargie du capital
13.1 La production et reproduction des armements
13.2 Un schéma intégrant la production d’armements
13.3 Les effets de la disparition des armements.
14. Accumulation du capital et militarisme : Ernest Mandel
14.1 Ernest Mandel entre dans le troisième âge
14.2 Ernest Mandel, chambre d’écho de l’économie vulgaire
14.3 Ernest Mandel, apôtre de la disproportion
14.4 Ernest Mandel cherche son bâton de maréchal
14.5 Ernest Mandel bat la campagne
15. Rosa Luxemburg et les disproportions dans les schémas de reproduction
15.1 Rosa Luxemburg, le révisionnisme et le programme communiste
15.2 Les deux tendances de l’économie politique.
15.3 Les modifications des schémas de reproduction
15.4 Henryk Grossmann bouleverse la disproportion.
16. La théorie des crises de Fritz Sternberg
16.1 Fritz Sternberg, épigone de Rosa Luxemburg
16.2 Sternberg, luxemburgiste de bas étage
16.3 Sternberg sur son échafaudage
17. Les théories des crises de Grossmann Mattick et le programme communiste
17.1 Le "milieu révolutionnaire"et Grossmann
17.2 Grossmann et l’effondrement du système capitaliste
17.3 Les présupposés des théories de Grossmann.
17.4 Accumulation et consommation de la plus-value
17.5 Grossmann et le schéma de Bauer
17.6 Grossmann énième avatar de l’économie politique vulgaire
17.7 Taux de profit et taux d’accumulation
17.8 Suraccumulation et baisse tendancielle du taux de profit
17.9 Grossmann et Mattick épigones de Ricardo
17.10 Une disproportion imaginaire
17.11 Henryk Grossmann bouleverse le socialisme scientifique
17.12 Grossmann et la limite absolue de la baisse du taux de profit
17.13 Grossmann réécrit le « Capital »
17.14 De la théorie de l’effondrement à l’effondrement de la théorie
17.15 La théorie de la surpopulation
17.16 Grossmann et le cycle industriel
17.17 Grossmann et le taux d'intérêt
18. Grossmann et le commerce international.
18.2 Le communisme théorique et le commerce international
18.4 Les évolutions du PIB : chiffres internationaux.
18.5 Création de valeur et temps de travail.
18.6 Population, population active : chiffres internationaux
18.7 Population active, population employée : chiffres internationaux
18.8 PIB et capital fixe : chiffres internationaux
18.9 Intensité apparente du travail : chiffres internationaux
18.10 Le déclin du Royaume-Uni et des Etats-Unis
18.11 Le communisme et la loi de la valeur à l’échelle internationale.
18.12 Les formes de l’exploitation dans le commerce international.
18.13 Limites de l’exploitation, concurrence et division internationale du travail.
18.14 En guise de conclusion : vers l’euro ?
19. Annexe 1 : Communisme et théorie des crises
19.1 Une lettre de « Il nostro lavoro »
19.2 La prévision de la gauche
19.3 La production de l’or dans les schémas de reproduction
19.4 Les théories de la disproportion
20. Annexe 2 : Où l'on retrouve une classe ouvrière que d'aucuns disaient disparue.
20.1 La diminution de la classe productive
21. ANNEXE 3 : SOMMAIRE DES TRAVAUX DE COMMUNISME OU CIVILISATION
21.1 A- Textes parus dans la revue "Communisme ou Civilisation" (1976-1998)
1. Introduction
1.1 Présentation des textes.
Le présent ouvrage reprend, en un seul tenant, les textes consacrés à la théorie des crises précédemment parus dans les numéros 8, 12, 14, 17, 22 de la revue Communisme ou Civilisation et les numéros 1, 4, 7, 10, 14 de la Revue internationale du mouvement communiste, entre 1980 et 1998.
Par rapport à cette publication, nous avons uniquement procédé - à l’élimination près d’une ou deux injures - à des remaniements formels :
· Elimination des références inter numéros
· Corrections de fautes d’orthographe ou de ponctuation
· Corrections de quelques phrases bancales.
· Prise en compte des errata
· Corrections d’erreurs résiduelles
· Changement de la monnaie de référence (euro contre franc)
· Vérification des citations et des références,
· (Introduction de références Internet)
· Déplacement de quelques remarques conjoncturelles sur les crises dans la présentation du texte
· Et, pour faciliter la lecture, nous avons structuré plus fortement le plan et, le cas échéant, changé le niveau de certains chapitres dans le plan.
Il subsiste encore certainement des erreurs de frappe, des fautes de syntaxe ainsi que quelques citations insuffisamment référencées. La version « V.1.1 » de ce texte améliore la version précédente (notamment en introduisant un passage oublié) mais nous continuerons à l’amender au fil du temps.
La revue Communisme ou Civilisation était animée à la fois par un projet général qui était celui du « retour à Marx » et par la volonté de fonder en théorie ce qui formait alors un ensemble de positions politiques démarquant le mouvement révolutionnaire des tendances social-démocrates ou gauchistes pouvant se réclamer du socialisme : rejet des syndicats, rejet de la démocratie, critique des mouvements de libération nationale… Cependant, nous pensions que les bases théoriques sur lesquelles la plupart de ces thèses étaient énoncées (et le sont toujours, bien qu’il faille distinguer ici entre ce qui était défendu plutôt par l’aile conseilliste, notamment sur les syndicats et les luttes de libération nationale, et ce qui l’était par les composantes léninistes ou « bordiguistes », notamment le PCI[1]) étaient erronées.
En effet, les « découpages » historiques basés sur les notions de phase ascendante/phase décadente de l’histoire du capitalisme, ou du découpage entre phase de libre échange et capitalisme de monopole, par exemple, n’étaient que des déviations, tantôt luxemburgistes (CCI[2], FECCI/PI[3]), tantôt léninistes (PCI), tantôt hybrides (CWO[4], BIPR[5]…), des positions fondamentales de Marx et Engels. Disant cela, il convient d’ajouter que pour nous, Rosa Luxemburg et Lénine, dépassent évidemment de dix mille coudées leurs pâles épigones, et ceci pas seulement en raison de leur engagement concret, physique, dans la direction du plus grand mouvement révolutionnaire de l’histoire de l’humanité.
Dans cette perspective, après avoir, dans les premiers numéros de la revue, travaillé sur la question agraire et la périodisation du capital (cf. notre réédition de ces textes sur le même format, disponibles sur notre site), nous avons entamé, en 1980 la publication de cette étude sur la théorie des crises, thème que nous travaillions déjà depuis plusieurs années.
1.2 Une victoire éclatante.
Que la théorie marxiste ait été haïe, vilipendée, moquée, déclarée mille fois morte par la pensée bourgeoise, ses professeurs, ses prix Nobel, ses politiciens, ses journalistes n’est que parfaitement normal. La vieille société sait bien qu’à toutes les lignes de cette littérature de parti, elle voit l’annonce de sa condamnation à mort.
Que la théorie marxiste ait été avilie, trahie, déformée, détournée par les courants réformistes, révisionnistes, staliniens, gauchistes, cela fait partie des phénomènes inévitables du cours historique de la lutte des classes et de la vie du prolétariat, mais ce qui avait pu être redressé avec la fondation de l’Internationale communiste en 1919 à la faveur de l’immense vague révolutionnaire des années 1920 fut reperdu totalement avec la contre-révolution qui s’ensuivit et qui dure jusqu’à aujourd’hui.
Mais ceux qui, politiquement, avaient maintenu le flambeau, ceux qui ne s’étaient pas couchés dans le collaborationnisme de classe antifasciste dans les années 1930, et à qui il revenait de maintenir vivant, de restaurer et de développer le cœur de la théorie marxiste, ceux-là firent preuve d’une fatale incurie. Au sein des petits regroupements de communistes internationalistes et ce qu’il est convenu d’appeler le « milieu révolutionnaire », Communisme ou Civilisation représenta le seul élément qui s’était fixé pour tâche une activité scientifique de restauration de la théorie révolutionnaire. Nous fûmes bien sûr, pendant plus de trente ans, traités de théoriciens en chambre et considérés comme quantité négligeable. Pendant ce temps les activistes forcenés, outre le fait d’épuiser des générations de militants dans des combats stériles et des déchirements de sectes ont vu tomber progressivement tous les éléments de leurs pauvres constructions théoriques, à la fois sous l’effet du rappel de la théorie et, encore plus, devant la marche des événements historiques. Or la science n’est rien si elle ne sert pas à prévoir, et ce n’est pas un hasard si notre travail sur la crise s’ouvrait, en 1980, sur un chapitre consacré à la prévision et au parti communiste.
Il faut bien rappeler que dans le contexte de profonde contre-révolution de l’époque et avec le reflux de la vague post-68 qui avait mis à la mode un marxisme académique et des positions gauchistes, s’approfondissait une remise en cause totale de la théorie communiste : négation du rôle du prolétariat et de la lutte des classes, négation de l’existence même des crises, consensus démocratique généralisé, aggiornamento des partis de gauche bourgeois par rapport à leurs restes de vernis « socialistes », etc. Du côté du « milieu révolutionnaire » de l’époque, l’inepte théorie de la décadence du capitalisme, défendue notamment par Révolution Internationale et le CCI gangrenait toute pensée révolutionnaire, les adversaires n’ayant à opposer que leurs positions ricardiennes ou léninistes. Nous voulions remettre au centre la théorie des crises de Marx et pour cela mener la critique radicale, aussi bien des positions de Rosa Luxemburg, dont se réclamait le CCI. que de celles de Grossmann/Mattick qui nourrissaient les positions de la CWO..
Notre analyse était la suivante : plutôt que de mener directement une critique de théories ineptes, défendues par des sectes dégénérées, attaquons nous aux fondements théoriques de ces analyses. D’une part, elles sont à l’origine de ces déviations, d’autre part, il s’agit d’analyses d’une valeur sans commune mesure avec l’exégèse des épigones ; c’est le cas notamment pour Rosa Luxemburg. Montrons la supériorité de la théorie de Marx par rapport aux points de vue théoriques les plus élevés développés aussi bien par Rosa Luxemburg que par le léninisme mais aussi par rapport à des théories plus grossières comme celles défendues par Mattick via Grossmann et qui infestent ce qui reste de la tradition révolutionnaire. Du moment que les fondements théoriques seront atteints par la critique, tant les constructions théoriques qui reposent sur ces bases que les considérations politiques qui y sont reliées seront privées de toute consistance.
D’un côté ce projet a été en partie mené à bien. Les pages qui suivent sont effectivement consacrées à une critique détaillée des théories de Rosa Luxemburg et de celles de Grossmann/Mattick. D’un autre côté, il nous est apparu également que le projet de fonder sur la base de la théorie de Marx, la justification d’une autre attitude que Marx et Engels vis-à-vis de questions politiques comme la démocratie par exemple, n’avait pas de réalité. Les fondements théoriques d’un changement de période au sein du mode de production capitaliste depuis Marx et Engels ont perdu la consistance que nous leur attribuions et ont fini par se révéler nuls. En même temps ceci ne veut absolument pas dire que le MPC n’a pas d’histoire et que les communistes sont dispensés d’analyser (bien au contraire !) les développements matériels et historiques qu’il a connu.
Cet abandon d’une périodisation rigide entre deux époques est passée par la critique successive de concepts qui faisaient florès et qui semblaient fonder en théorie les supposées discontinuités historiques du mode de production capitaliste après la mort de Marx et Engels. Par exemple, les concepts de phase de soumission réelle et de phase de soumission formelle du travail au capital, initiés par Invariance[6], sous la forme de « phase de domination formelle » et « phase de domination réelle », paraissaient particulièrement pertinents. A partir de Marx, on tentait donc, à la suite d’Invariance de périodiser le cours du mode de production capitaliste de façon à faire apparaître une coupure, un changement d’époque aux alentours de la première guerre mondiale. Tout en s’appuyant sur Marx, on pouvait envisager un changement dans les conceptions propres au marxisme sur les questions nationales, syndicales, parlementaires et démocratiques... Bref, justifier ces changements en s’appuyant sur les fondements de la théorie. Ainsi, comme l’ensemble de ces courants, nous nous retrouvions, à partir de concepts différents, pour désigner la coupure de 1914, avec l’éclatement de la Première guerre mondiale et l’effondrement de la deuxième internationale, comme le point de rupture entre les deux périodes historiques, qui se voyaient formulées soit comme l’opposition entre période ascendant et période de décadence, entre l’époque de la libre concurrence et celle du monopole ou, en l’occurrence entre la phase formelle et la phase réelle. Au-delà de leurs présentations divergentes toutes ces formes de périodisation sont finalement héritières des analyses de la troisième internationale dans toutes ses composantes.
Cette analyse, dans la lignée d‘Invariance, sera, plus tard, remise en cause à partir d’une analyse plus approfondie de la question, notamment au cours de l’étude qui noua avons menée sur les deux phases de la production capitaliste (parue de 1978 à 1980 dans les numéros 5,7 et 9 de CouC et qui est rassemblée. Au cours du travail que nous avons ensuite patiemment accompli pendant une vingtaine d’années s’est finalement imposée à nous l’inanité de toutes les tentatives de substituer à l’analyse de Marx et Engels un quelconque rythme de l’histoire qui tendrait à montrer que leurs positions défendues à l’époque devaient être abandonnées. A la fois notre travail sur la crise, celui sur l’historique du mouvement ouvrier incluant les questions de tactique par rapport au parti ouvrier et à la démocratie et bien sûr ce travail spécifique sur la périodisation, nous ont fait comprendre que la forme moderne du mode de production capitaliste, celle où il manifeste réellement son être, ne date pas de 1914, mais de 1825 avec les premières grandes crises de surproduction. Il en découle donc un élément fondamental : toutes les positions exprimées par Marx et Engels à partir de 1848, et maintenues intégralement jusqu’à leur mort, respectivement en 1883 et 1895 étaient soit erronées dès le départ (ce qui est somme toute la position des anarchistes), soit doivent être reconduites aujourd’hui, nonobstant les analyses tactiques liées à la conjoncture historique. Mais prendre appui sur un prétendu changement dans la nature profonde du mode de production capitaliste après 1914 pour déclarer, par exemple, que la forme syndicale est caduque, en se basant sur l’argument erroné selon lequel « le capitalisme ne peut plus rien accorder à cause de la décadence », est une position purement idéologique et non scientifique.
Un autre élément fondamental de la remise en cause de notre postulat de départ réside dans la nature même des événements historiques qui ont marqué le monde au cours de ces 30 dernières années. L’essor de la productivité du travail, l’accroissement du PIB mondial, balaient empiriquement, en appui à la démonstration scientifique toutes les fadaises sur la décadence, à moins de n’en garder qu’une vision moralisante et pleurnicharde comme le fait Perspective internationaliste qui, après avoir favorablement évolué un temps sur cette question ne sait plus à quel saint se vouer. Par ailleurs, la récente recomposition des Etats notamment en Europe, la réunification allemande, l’essor de la démocratie bourgeoisie en Europe de l’Est, en Amérique Latine (en attendant le colossal tremblement de terre à la fois social et politique attendu et ardemment désiré en ce qui concerne la Chine) ont montré que la question démocratique était beaucoup plus intelligemment et dialectiquement posée par Marx et Engels au 19° siècle que dans la vulgate ultra-gauche des années 1970.
Ces éléments nous ont conduit à ne plus surestimer le concept de phase de soumission réelle mais à le replacer dans le cadre de l’analyse traditionnelle du socialisme scientifique avec sa traduction effective : subordination (et non phase de soumission ou pire domination réelle[7]) du travail au capital.
De fait, il existe bien, chez Marx, une forme de périodisation du capital, entre l’époque manufacturière et celle de la grande industrie. Ces périodes correspondent aussi au fait que dans l’une le travail est soumis formellement au capital -c’est-à-dire que le procès de travail est hérité des anciens modes de production -, tandis que dans l’autre le travail est soumis réellement au capital - ce qui signifie l’apparition d’une technologie spécifiquement capitaliste en l’occurrence le machinisme-. La subordination réelle du travail au capital (ou la subsomption réelle du travail sous le capital) émerge donc avec la révolution industrielle. En conséquence, à partir de la fin du XVIIIè siècle, la révolution industrielle (initiée en 1735) pèse suffisamment sur la société pour écarter la thèse d’une «phase de domination réelle » contemporaine du début du XXè siècle.
Même sur le plan sémantique on doit noter les différences qui sont introduites avec ces concepts qui en définitive n’étaient que des chevaux de Troie du révisionnisme. Marx ne fait pas que parler de ces sujets dans le chapitre inédit du capital. Dans le livre I, publié de son vivant et qui a fait l’objet d’une traduction qu’il a relu – ce qui n’empêche pas que des contresens aient pu subsister – il y évoque ce concept qui est traduit en français par « subordination »[8]. En conséquence, si l’on voulait être cohérent, il faut parler de subordination (ou subsomption) formelle ou de subordination (subsomption) réelle du travail au (sous le) capital.
La notion de domination réelle du capital, outre ces intentions révisionnistes, traduit aussi l’abandon du point de vue du prolétariat au profit de positions inter-classistes dont Invariance nouvelle série ou les « communisateurs » aujourd’hui se font les hérauts, ouvrant la voie à un abandon complet des positions révolutionnaires.
Arrêtons-nous également sur un autre aspect de cet épisode. Des camarades en Allemagne, nous ont fait remarquer que Marx n’employait pas dans la texte allemand le terme « phase ». Dans le texte du chapitre inédit de Marx, paru en français, il s’agit d’un titre de chapitre ajouté par feu Roger Dangeville et non d’un titre écrit par Marx. En conséquence, il n’y a pas lieu de fonder sur ces concepts, une coupure nouvelle qui pourrait justifier les changements d’orientation politique qui caractérisent, pour faire bref, l’« ultra-gauche ».
Cette idéologie a irrémédiablement fait faillite tandis que la théorie de Marx et Engels triomphait sur toute la ligne. En effet, à la critique théorique est venue s’ajouter la critique pratique du mouvement : la chute du mur de Berlin, et la réunification démocratique de l’Allemagne, la livraison finale du secret de la bureaucratie (bien anticipé par Trotsky et Bordiga à propos de la Russie), en charge de porter le développement capitaliste à un niveau suffisant pour laisser la place à la bourgeoisie, la réouverture de la question nationale avec la nouvelle guerre des Balkans, la réorganisation du marché mondial sans une troisième guerre mondiale ouverte – il y eut une guerre froide continue – et donc la preuve de marges de manœuvres offertes par la démocratie, ont achevé ces idéologies.
Doit-on conclure que c’est l’autre branche de l’alternative ouverte par Bordiga, à savoir que si la révolution ne s’impose pas à la fin du XXème siècle, le dernier marxiste aura disparu au début du XXIème, qui triomphe ?
Evidemment, jamais le rapport des forces n’a été aussi défavorable. Lénine disait que la quantité n’était pas un argument suffisant pour juger du potentiel révolutionnaire, que les révolutionnaires pouvaient ne représenter que le 1/10000 voire le 1/100000 de la classe. Quid quand, ils représentent encore moins ? La quantité ne se transforme t-elle pas en qualité ? Le parti révolutionnaire ne pourrait espérer une quelconque influence qu’en faisant appel à l’homéopathie. Ce serait accepter, plus de 70 ans après, la thèse de Karl Korsch et la reconnaissance de la « crise du marxisme[9] ».
Mais tout cela ne nous éloigne pas de Marx, bien au contraire. Car c’est cette analyse qui triomphe. Il n’est plus nécessaire de fonder de nouvelles politiques, de nouvelles analyses qui s’appuieraient sur de nouveaux fondements de la périodisation du capital. Il est « juste » nécessaire de poursuivre, développer, approfondir les fondements théoriques et pratiques du socialisme scientifique. Il ne s’agit pas uniquement de répéter le passé mais d’intégrer plus d’un siècle d’histoire et de mettre à jour le socialisme scientifique de notre temps.
1.3 Les travaux sur la crise
1.3.1 Les origines des analyses
Les travaux sur la crise n’ont pas souffert, même s’ils les utilisent, des concepts de phase de soumission formelle et soumission réelle. Ils les emploient justement (au terme de « phase » près, dont nous avons vu l’origine) dans le sens de la périodisation que fait Marx ; c’est-à-dire qu’ils recoupent le passage de la manufacture à la grande industrie, l’avènement de la révolution industrielle. Ces travaux ont même permis une prise de conscience de la force de la théorie de Marx et de ses profondes différences avec un « marxisme » qui n’a fait que ramener la théorie révolutionnaire dans le giron de l’économie vulgaire, lui ôtant à la fois sa valeur scientifique et son tranchant révolutionnaire. Ils ont aussi montré que le socialisme scientifique était vivant, que la théorie n’était pas une simple répétition de positions figées mais que sur la base des analyses de Marx, la théorie pouvait aller plus loin et s’approfondir.
Nous avons, sur la base d’une étude minutieuse des textes de Marx, défendu l’idée que non seulement les crises n’avaient pas disparu, mais qu’elles se manifestaient de manière régulière sur un cycle de 6 ans environ, conformément aux prévisions théoriques qui évoquaient un raccourcissement au fil du temps de la durée du cycle, qui était d’environ 10 ans à l’époque de Marx.
Ce chiffre n’était pas une extrapolation arbitraire mais s’appuyait sur les travaux statistiques de l’époque. Au début des années 1970, alors que nous avions entrepris une étude des analyses de Rosa Luxemburg et de Grossmann, Carré, Dubois et Malinvaud publiaient une rétrospective de la croissance française. Cet ouvrage qui s’attira les bonnes grâces des économistes était d’une extrême vulgarité quant à l’analyse des ressorts de la croissance.
Après avoir mis en évidence que « la croissance des années d’après-guerre peut être décomposée en quatre périodes :
· de 1945 à 1951 reconstruction et redémarrage de l’économie
· de 1951 à 1957 premier cycle de l’après-guerre
· de 1957 à 1963 deuxième cycle de l’après-guerre
· de 1963 à 1969 troisième cycle de l’après-guerre »[10]
nos compères concluaient : «Le terme de cycle employé ici ne doit pas faire illusion : nous ne pensons pas que la croissance française soit nécessairement cyclique et que nous risquons de retrouver, approximativement tous les six ans, des périodes de fort ralentissement de la croissance »[11]
Là où les économistes bourgeois triomphant écartaient d’un revers de main la perspective des crises, le marxisme pouvait y reconnaître les caractéristiques du cycle des crises.
1.3.2 La crise de 1981
Après une première vérification expérimentale en 1975, date à laquelle il fallut bien que la bourgeoisie mette un genou à terre pour s’incliner devant l’évidence de la crise, la revue «Communisme ou Civilisation», née en 1976, attendait donc une forte crise en 1981. Celle-ci fut au rendez-vous et occasionna aux Etats-Unis des taux d’intérêt considérables quand la crise battait son plein.
Fort de ces premiers succès nous écrivions dans le numéro 12 de «Communisme ou Civilisation» (mai 1982)
« En fait, de « reprise », si l’amorce d’un nouveau cycle peut permettre au capital de souffler un peu on ne peut s’attendre au retour des euphoriques périodes de « prospérité ». Quelles que soient les perspectives de leur aggravation ultérieure les phénomènes tels que un faible taux de croissance, l’inflation, le chômage, etc. ne s’amélioreront pas de manière substantielle et vont persister d’un cycle à l’autre, en empirant plus brutalement lors des prochaines crises.
Dans tous les cas, si la confirmation des perspectives de crise pour 1981 a constitué une petite victoire théorique pour le communisme, cela ne saurait faire oublier l’immense chemin qui reste à parcourir à ce mouvement communiste pour être à même d’analyser véritablement la crise actuelle et être à même de prévoir la venue de la crise catastrophique, dans le cadre d’une authentique restauration de la théorie communiste des crises. Ce n’est certes pas dans les affligeantes publications du mouvement révolutionnaire actuel que l’on trouvera les jalons pour un tel travail. Comme d’habitude la superficialité et le bricolage théorique y font office de restauration. »
Dans cette représentation, nous attendions que la croissance moyenne dans les périodes de reprise de l’accumulation soit tendanciellement plus faible que dans les cycles précédents et donc que le niveau du chômage ne se résorbe pas complètement pour s’aggraver avec la fin du cycle, tandis que l’inflation irait bon train. Si le niveau du chômage est resté élevé, il a en partie été résorbé, même si le profil type de l’emploi qui a été créé par exemple en France est : un emploi à temps partiel, sur la base d’un contrat précaire (CDD, intérim …), aidé par l’Etat, généralement féminin, payé en dessous de la moyenne des salaires alors que le titulaire est plus qualifié que la moyenne de la force de travail. Au prix d’un endettement important et d’une dégradation des conditions de vie d’une part non négligeable de la population, l’Etat a tenté de juguler le chômage de masse, et y est parvenu pour une part. Plus d’emplois (dont nous avons vu que le profil type est bien différent par rapport aux trente premières années qui ont suivi l’après deuxième guerre mondiale) ont été créés dans les «trente piteuses » que dans les « trente glorieuses », pour reprendre quelques concepts absurdes forgés par les économistes bourgeois. D’une certaine manière, le travail, sur la base d’un coût social considérable, a été « partagé » : baisse générale du temps de travail, développement du travail partiel, taux de chômage élevé en sont les modalités. Cela signifie aussi que sur le plan mondial la bourgeoisie occidentale et française en particulier ont eu d’autant plus de difficulté à faire valoir le travail national comme travail social universel. Les derniers chapitres de ce texte en mettant en relief le déclin des Etats-Unis (et de la Grande-Bretagne) s’interrogent sur le destin de l’Europe.
« La rengaine sur la concurrence des pays à bas salaires n’est donc qu’une des voies idéologiques qu’emprunte la classe capitaliste pour s’en prendre au salaire du prolétariat. S’agit-t-il du discours protectionniste de secteurs plus directement concurrencés par des pays où la valeur des marchandises est plus basse ? ou bien annonce t-on ainsi un déclin relatif général des nations qui jusqu’ici tenaient le haut du pavé ? En d’autres termes le modèle américain ou britannique qui nous est présenté comme la panacée est-il un modèle de déclin relatif propre à ces sociétés ou préfigure-t-il le chemin que devront emprunter les vieilles sociétés européennes, berceau du capitalisme et héritières d’une longue tradition culturelle occidentale ? L’avenir le dira. »
La crise de 2008 vient d’apporter la réponse et elle montre que les positions des pays jusqu’à présent les plus avancés sur l’échelle du mode de production capitaliste vont marquer durablement le pas. Pour autant que la situation du prolétariat bénéficiait de leur domination sur le marché mondial, il va également y perdre ses privilèges[12] et cela également favorisera la résurrection du communisme.
Il fallut donc attendre la crise actuelle pour que la prévision sur le nombre de chômeurs américains soit effective. « Le nombre des chômeurs aux Etats-Unis atteint désormais 12,5 millions. A cela s'ajoutent près de 5,6 millions de personnes disant vouloir trouver un emploi mais non comptabilisées dans la population active. »(Le Monde.fr 6 mars 2009). Bien évidemment, ces constats sont faits sur la base d’un appareil de mesure que l’on s’est efforcé de casser régulièrement en partant du principe que si le thermomètre est brisé on n’aura pas la fièvre. De même, les économistes bourgeois pour qui un certain taux de chômage ne peut être résorbé (le chômage « frictionnel ») ont eu la bonne idée pour servir leurs maîtres de le porter à 5% alors qu’auparavant ils l’évaluaient à 3%. Conclusion : plus les lois du marché dominent, plus le marché est roi, plus il est fluide, plus il «frictionne » !!!. Ce qui devrait être frictionné, ce sont plutôt les côtes de cette engeance.
Outre une politique du chômage dont nous avons vu les effets et les limites, la bourgeoisie se lança à l’assaut de l’inflation. La croissance de l’indice des prix tomba à des taux relativement faibles par rapport aux années précédentes. L’inflation, c’est-à-dire la création monétaire au-delà des besoins de l’accumulation ne fut pas pour autant maîtrisée. Le capital argent excédentaire s’en alla alimenter le développement du capital fictif, redonnant du lustre et du pouvoir aux fractions et aux tendances parasitaires de la bourgeoisie et de la propriété foncière. Le rentier dont Keynes souhaitait l’euthanasie, reprenait vie sous la tente à oxygène du crédit et du gonflement du capital fictif. L’inflation des prix limitée pour le capital industriel et commercial se traduisait d’un autre côté par une croissance vertigineuse du prix des actifs financiers tandis que la rente foncière s’envolait avec la hausse du prix des immeubles, des terrains et des loyers, hausses garantes de nouvelles crises financières et de crises générales.
1.3.3 Une des spécificités des Etats-Unis
La crise de 1981 et la reprise fut l’occasion de faire le point sur le cycle aux Etats-Unis. Nous pouvions constater que celui-ci était légèrement différent de la France
« Certains s’inquiètent au sein du mouvement révolutionnaire de ce que « l’approfondissement » de la crise du M.P.C. n’entraîne pas une plus vaste réaction du prolétariat à l’échelle internationale.
Or, une telle attitude, outre qu’elle aboutit complètement à surestimer les mouvements qui peuvent exister à l’heure actuelle ne tient pas compte de deux choses. La première c’est que le cours de la lutte des classes ne suit pas mécaniquement l’évolution de la base matérielle de la société et que la crise n’entraîne pas ipso facto la mobilisation du prolétariat. La deuxième c’est que la crise elle-même ne suit pas un cours graduel qui irait en s’approfondissant progressivement, mais connaît un développement cyclique fait de l’alternance de phases de dépression et de relative prospérité.
A l’heure actuelle le cycle du capital est d’environ 6 ans, ce qui apparaît assez nettement en France, mais moins aux Etats-Unis où le cycle est un peu plus court et moins régulier. Néanmoins aux Etats-Unis, il possède la physionomie suivante : d’un pic à un creux de l’activité, donc du point le plus haut au point le plus bas du cycle, il s’écoule une brève période d’environ 10 mois, par contre d’un creux à un nouveau pic (phase de reprise) il s’écoule environ 45 mois[13]. Depuis 1974, le taux de croissance de l’accumulation capitaliste a tendance à être plus faible (symptôme de la baisse du taux de profit) ce qui a pour conséquence, entre autres, de ne plus pouvoir absorber, aussi facilement, les séquelles des crises antérieures, dont l’intensité était également plus faible. Les taux de croissance par exemple sont loin de retrouver leurs scores de l’après-guerre, et si les économistes bourgeois américains triomphaient au début de l’année en annonçant un taux de 10,1% puis de 7,1 %, c’est qu’ils effectuaient leur calcul sur une base trimestrielle. Ramené à la totalité de l’année 1984, ce taux baisse déjà à 3,6%. Que dire alors si, comme il est logique, on se livre à des comparaisons sur la totalité du cycle, c’est-à-dire sur une période de 5-6 ans ?
Quant aux arguments avancés sur la baisse du chômage, ils font penser à cette histoire du fou qui se donne des coups de marteaux sur les doigts parce que cela fait du bien quand ça s’arrête. Si le taux de chômage (7,5% en Juillet 84) a baissé de plus de 3% depuis Décembre 82 (10,7%), il reste supérieur de 0,6% à ce qu’il était en 1977, soit deux ans après la crise de 1975 (6.0%). Mais surtout, si l’on compare les deux années de creux d’un cycle à l’autre alors que le chômage était monté à 8,3% en 1975, il est monté à 9,5% en 1992 et 1993. Et encore les chiffres actuels ne tiennent pas compte de 1 ou 2 millions de « travailleurs découragés » qui ne sont plus comptabilisés dans aucune liste. (Sources: US Economic Report of the President – 1984). En comparant les deux cycles et non la pointe et le creux d’un même cycle le chômage s’est donc aggravé.
On retrouve là la physionomie normale du MPC, telle qu’elle a toujours existé, hormis la brève période d’après le second conflit impérialiste où l’accumulation du capital était suffisamment forte pour résorber une bonne partie de la surpopulation relative, ce qui se traduisait par des taux de chômage peu élevés. L’accroissement du chômage n’est donc pas forcément signe de mauvaise santé du capital, il s’agit d’un phénomène inhérent à l’accumulation capitaliste, qui bien évidemment s’aggrave à chaque crise cyclique et est source de tensions sociales.
Et encore, les chiffres avancés aux Etats-Unis ne prennent pas en compte l’aspect qualitatif des mirifiques « 6 millions d’emplois créés en 18 mois » par la locomotive américaine, qui font rêver le patronat européen. La plupart du temps il s’agit de « jobs » ultra-précaires, créés dans les services (ce qui ne veut pas dire que certains ne soient pas productifs) où la rotation du travail est extrêmement rapide, et les salaires extrêmement bas ( 3$55 de l’heure, salaire minimum, soit 17,75 F si l’on ne tient pas compte de la surévaluation artificielle du dollar).
Si l’on ajoute à ce tableau que cette reprise américaine – qui existe, indubitablement – a été également artificiellement dopée par la hausse du dollar, l’appel aux capitaux étrangers, au prix d’un endettement massif, aussi bien extérieur qu’intérieur, on ne voudrait pas être dans la peau des « experts » qui ont prédit au monde et aux Etats-Unis d’Amérique en particulier, des lendemains chantants. Il est bien plus certain que l’économie capitaliste mondiale replongera vers les années 1987 - 88 dans une crise encore plus grave ; que de nouvelles vagues d’ouvriers seront jetés sur le pavé; que l’inflation recommencera à galoper; que l’endettement des Etats atteindra des sommets ; que la baisse du niveau de vie se fera encore plus durement sentir ; que les souffrances de la classe ouvrière s’accroîtront. »(C ou C)
Les chiffres à la base de l’analyse du cycle américain s’appuient sur les travaux de la NBER (National Bureau of Economic Research) un organisme chargé de mettre en place une comptabilité nationale, dans les années 1930, par le gouvernement américain. Il publie une liste des récessions de l’économie américaine de 1854 à nos jours. Quels que soient les doutes que nous puissions exprimer sur ces statistiques, nous ne sommes pas à même de les critiquer de manière opportune. Nous les prendrons donc, pour le moment, pour argent comptant. Voici donc le tableau des moyennes actualisé.
|
Moyenne des cycles : (exprimée en mois)
1854-2001 (32 cycles) 1854-1919 (16 cycles) 1919-1945 (6 cycles) 1945-2001 (10 cycles) |
Du point le plus haut au point le plus bas
17 22 18 10 |
Du point le plus bas au point le plus haut
38 27 35 57 |
Du point le plus haut à l’autre point le plus haut
55 48 53 67 |
Du point le plus bas à l’autre point le plus bas
56* 49** 53 67 |
· * 31 cycles
· ** 15 cycles
La tendance historique du cycle aux Etats-Unis, tel qu’il ressort de ces statistiques, est :
1°un allongement moyen de la durée du cycle (48 mois jusqu’à la première guerre mondiale, 53 mois dans l’entre deux guerres, 67 mois dans l’après deuxième guerre mondiale.)
2°un raccourcissement de la durée de la crise. (22 mois jusqu’à la première guerre mondiale, 18 mois dans l’entre deux guerres, 10 mois dans l’après deuxième guerre mondiale.)
Si le cycle aux Etats-Unis tend vers les six ans identifiés en France (les cycles 1981 et 1991 ayant même dépassé largement ce délai), cela se traduit par un allongement du cycle, alors que la théorie milite pour son raccourcissement. Quant à la durée des crises, rien ne favorise dans la théorie, leur raccourcissement.
Il y a là autant de facteurs, qui doublés avec leur position dominante ne nous ont jamais fait choisir les Etats-Unis comme modèle d’analyse même si toute crise sérieuse doit aussi passer par ce pays.
1.3.4 La crise de 1987
La crise de 1987 allait ouvrir de nouvelles difficultés dans la prévision et le déroulement des crises. Comme nous l’avons vu dans la citation précédente, nous attendions donc une nouvelle crise vers 1987 (1981 + 6). En 1987, une crise importante éclate effectivement mais elle est endiguée à grands renforts d’interventions de la banque centrale qui prépareront aussi les crises à venir.
Aussi nous écrivions en octobre 1990, dans le corps du texte consacré à la théorie de Grossmann et que nous avons déplacé dans cette introduction.
« Quant à l'année 1987, si elle n'a pas été marquée par une crise affectant la sphère de la production, elle s'est traduite par la crise financière la plus importante de l'histoire, suivie par une autre crise importante en 1989 et encore une autre crise en 1990. A travers ces crises financières à répétition, le capital a pu endiguer[14] mais il ne pourra esquiver celle qui marquera la fin du nouveau cycle d'accumulation. »
Quand on regarde les choses de plus près la crise a également touché la sphère de la production. Nous n’avions pas pu tirer cette conclusion, soit parce que cette information du fait des canaux dont nous disposions ne nous était pas parvenue, soit, comme il arrive aussi, parce que ce n’est que rétrospectivement que les statisticiens nous dévoilent les faits et en particulier pour ce qui est des crises.
Toujours est-il que l’Insee a publié une série longue, par trimestre, du PIB. Si nous évitons de nous référer aux « définitions » des économiques bourgeois qui parlent de « récession » pour deux baisses consécutives du PIB nous pouvons constater que, en fin 1986 - début 1987, la crise mord aussi dans la sphère de la production.
|
1980 T1 |
1980 T2 |
1980 T3 |
|
237,7 |
236,7 |
237,0 |
|
1982 T1 |
1982 T2 |
1982 T3 |
1982 T4 |
|
244,5 |
246,7 |
246,5 |
247,8 |
|
1983 T4 |
1984 T1 |
1984 T2 |
1984 T3 |
1984 T4 |
|
251,1 |
252,6 |
252,3 |
253,5 |
253,2 |
|
1985 T3 |
1985 T4 |
1986 T1 |
1986 T2 |
1986 T3 |
1986 T4 |
1987 T1 |
1987 T2 |
|
257,9 |
259,5 |
259,5 |
262,2 |
264,2 |
264,2 |
263,6 |
266,5 |
La crise, dans les années 80, a été coupée en morceaux et c’est le septennat qui est marquée par des ratés à répétition. La lutte contre le prolétariat et les classes moyennes pour redresser la « part des marges des entreprises dans la valeur ajoutée » et donc le taux de profit qui est entreprise en 1983 avec le plan Mauroy-Delors portera ses fruits vers 1986.
Dans ce contexte, la crise de 1987 est très brève. 1988 et 1989 seront même, en France, des années où la création d’emplois est importante.
1.3.5 La crise du début des années 90 et les mutations du marché mondial
La crise enrayée de 1987 se poursuit par une nouvelle crise financière et immobilière en 1989 qui emporte le Japon, puis par une nouvelle crise financière en 1990 qui initie la crise générale qui prend effet en 1990. C’est l’époque où la crise arrive en Australie, Canada puis aux Etats-Unis (à partir de 1990). La crise touche progressivement tous les pays. En France, elle se traduira par une crise sévère en 1993. Celle-ci sera d’autant plus forte que la politique monétaire, à contre courant du fait de la nécessité, pour diverses raisons, de suivre la politique allemande ne laisse d’autres voies qu’un endettement croissant de l’Etat pour limiter les effets immédiats de la crise.
Dans cette épisode, le Japon qui faisait l’admiration mêlée de crainte des économistes bourgeois et petits-bourgeois, marque le pas. Alors qu’à son plus haut la capitalisation boursière de Tokyo en vient à supplanter Wall street, tandis que la rente foncière s’envole vers des sommets, la crise vient balayer durablement les prétentions du Japon. Vingt ans après, il n’a toujours pas digéré cette crise et il doit affronter une nouvelle crise mondiale d’une ampleur inégalée.
Les études les plus récentes sur les orbites des planètes montrent qu’elles sont chaotiques (c’est le terme qu’emploient les métaphysiciens pour parler d’un phénomène sensible aux conditions initiales), ce qui rend impossible toute prédiction précise au-delà de quelques dizaines de millions d’années. La prévision des cycles économiques qui doit prendre en compte une multitude de facteurs, pour laquelle nous ne disposons souvent pas de l’information nécessaire (pour ne rien dire du temps pour les analyser), qui intervient dans une matière historique, qui peut recevoir les effets de la superstructure comme le montre la politique monétaire ne peut a fortiori être un exercice mécanique. On ne peut pas à la fois critiquer les cycles Kondratieff en leur reprochant une vision mécanique, a-historique de l’activité économique et considérer que sur une très longue période de temps des cycles plus brefs pourraient échapper aux évolutions historiques qu’elles soient économiques, politiques, à de grands changements dans le marché mondial, etc.[15]
Or, outre ces remarques générales, le monde connaît de grands changements entre 1987 et 1993. La configuration du monde qui résultait de la seconde guerre mondiale vole en éclat. Le soi-disant monde communiste perd la guerre froide et si une nouvelle guerre mondiale est évitée, le fin de cette période s’accompagne de guerres locales et de révolutions démocratiques. La situation évolue cependant rapidement. Cette période voit notamment (sans volonté ici de donner un ordre à ces événements) : la fin de l’URSS, l’unification de l’Allemagne, l’indépendance de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie, l’indépendance de la Slovénie (un Etat qui n’avait jamais existé), le début de la guerre en Yougoslavie qui se terminera par son éclatement, l’invasion du Koweit par l’Irak, prélude à la première guerre du Golfe, la séparation de la Tchéquie et de la Slovaquie. D’un autre côté, le centre de gravité des échanges mondiaux se déplace vers le Pacifique, la vieille prévision de Marx prend définitivement corps tandis que les Etats-Unis deviennent débiteur net vis-à-vis du reste du monde (1985)[16]. Le triomphe de l’idéologie démocratique et libérale sur l’économie étatisée pseudo communiste donne également des ailes à la bourgeoisie pour accélérer sa politique libérale entreprise quelques années plus tôt. Une nouvelle forme du marché mondial émerge de la fin de la guerre froide ; la Chine, l’Inde et d’autres économies asiatiques se développent rapidement ; les économistes bourgeois dont la profondeur de la réflexion historique doit atteindre celle d’une huître, célèbrent la « mondialisation », comme si le marché mondial venait de surgir ! Il s’ensuit une croissance accélérée du commerce mondial, un recentrage de l’Allemagne, premier exportateur mondial, désormais aux prises avec l’intégration de l’Allemagne de l’Est et attentive aux évolutions de ses zones d’influence traditionnelles devenues libres d’accès, une débauche de crédit, des Etats-Unis vivant toujours plus à crédit sur le reste du monde tout en stimulant la croissance, … Que dans ces conditions le cycle ait été bouleversé ne doit donc pas surprendre.[17] Et c’est sur une base vigoureuse que la croissance s’installe suite aux bouleversements que nous avons vus. Elle va durer près de 10 ans aux Etats-Unis. Les économistes déments de la « nouvelle économie » annoncent une nouvelle phase dans l’histoire du capitalisme, phase portée par l’essor des nouvelles technologies, phase où l’accroissement de la productivité sous estimée par les méthodes traditionnelles de mesure est bien plus importante que ne le disent les économistes de l’ancienne économie, phase où les crises n’existeraient plus tandis que le cours des actifs financiers soutenus par les fonds de pension augmenteraient régulièrement. Ce bel échafaudage théorique sera mis à bas avec la crise qui débute en mars 2000.
1.3.6 La crise de 1997
Mais auparavant, les mêmes difficultés qu’en 1987, se sont présentées. En 1997, une nouvelle crise financière partie d’Asie (ce qui montre qu’elle est entrée de plein pied dans l’arène du marché mondial) où les bourses dévissent les taux de change des monnaies particulièrement malmenés. Par rapport à la dernière crise (1990-1993) nous sommes à nouveau dans l’épure d’un cycle d’environ 6 ans. La crise qui mord les économies sud asiatiques gagne le Japon. Nous pouvions alors écrire dans notre chronique de la crise :
« Le Japon, vient d’enregistrer au second trimestre (le premier de la nouvelle année fiscale), une chute du PIB de près de 3%, ce qui correspond en tendance annuelle à une baisse de plus de 11%. C’est la plus sévère chute enregistrée depuis 1975. Les économistes bourgeois ont l’habitude de ne prendre en compte les crises, baptisées récessions, que si la baisse dure deux trimestres consécutifs.
Bien que le lien entre les deux parties soit beaucoup plus complexe, on ne peut identifier, la crise japonaise et la chute des valeurs boursières dans toute l’Asie du sud-est. Crise financière d’un côté (en Asie du Sud-est) ou du moins crise encore cantonnée dans la sphère financière, crise de surproduction générale de l’autre (au Japon), crise générale de la valorisation du capital.
Les deux parties annoncent que d’ores et déjà, ces pays s’alignent sur le marché mondial, se synchronisent avec le marché universel pour en épouser, et ici en annoncer les vicissitudes.
La dernière crise (90-93) était partie d’Océanie, et l’année d’avant l’ensemble de l’Amérique Latine avait été touchée. Le Japon avait été un des derniers touchés. Si le signal était cette fois-ci lancé depuis l’Asie, il faudrait saluer les progrès rapides de l’accumulation du capital et sa mise en concordance avec le marché mondial.
Ces progrès annoncent aussi, comme l’ont montré les grèves de Corée, que l’unification du prolétariat mondial en est d’autant plus accélérée et que les antagonismes entre les puissances impérialistes mûriront d’autant plus vite. » (Septembre 1997)
Cette crise est aussi l’occasion de spéculations sur la démocratie. C’est le thème d’une de nos chroniques :
« Parmi les motifs qui ont été invoqués pour expliquer la crise financière et monétaire dans le sud-est asiatique, on relèvera l’idée de l’existence d’une oligarchie politico-financière dans nombre de pays touchés. La collusion des intérêts politiques et financiers au sein d’un cercle fermé aurait favorisé la spéculation et, par suite, l’éclatement de la bulle spéculative. En d’autres termes, il est explicitement revendiqué, par les grands donneurs de leçon des pays démocratiques, plus de démocratie pour qu’il y ait moins de spéculation.
Une telle affirmation résiste-t-elle à l’examen ? Le Japon démocratique à la veille de la crise financière de 1989 passait pour avoir la plus grande capitalisation boursière au monde. Elle dépassait celle des États-Unis globalement plus riches et plus peuplés. Quant au prix des terrains dans les métropoles nippones, il faisait saliver plus d’un promoteur européen. Les remarques condescendantes d’un Akio Morishima, l’ancien patron de Sony, qui à l’époque ironisait sur l’économie casino de l’Amérique faisant du profit en dix minutes quand le Japon pensait à dix ans ne pouvaient pas être prises pour argent comptant. L’affairisme, la spéculation, la rente avaient cru plus vite et ô combien que l’accumulation du capital productif sur lesquels ils reposent. Les grandes crise financières de 1987, de 1929 sont parties de la plus grande puissance dominante comme de la plus ancienne et durable république démocratique significative sur le marché mondial : Les États-Unis d’Amérique. En revanche, l’accumulation du capital dans la Russie de Staline et de ses successeurs s’est faite sans bourse des valeurs. Le trotskisme aveugle y voyait même là un argument pour nier le caractère capitaliste des rapports de production de la soi-disante URSS. La Chine, tout aussi capitaliste que la Russie, s’ouvre à peine aux délices de la corbeille désormais électronique, alors que Taiwan et Hongkong ont déjà des pratiques anciennes qui serviront de modèle à la grande Chine. Les régimes fascistes et nazis ne se sont pas non plus distingués par un extraordinaire rebond des bourses des valeurs ni du prix des terrains et des habitations.
S’il y avait donc à tirer une leçon du rapport entre démocratie et spéculation, la conclusion serait plutôt l’inverse de celle des journalistes. C’est bien d’ailleurs de cette façon que notre parti caractérisait la république démocratique quand Engels déclarait qu’elle signifiait l’alliance du gouvernement et de la bourse.
« La forme d'État la plus élevée, la république démocratique, qui devient de plus en plus une nécessité inéluctable dans nos conditions sociales modernes, et qui est la forme d'État sous laquelle peut seule être livrée jusqu'au bout l'ultime bataille décisive entre prolétariat et bourgeoisie, la république démocratique ne reconnaît plus officiellement, les différences de fortune. La richesse y exerce son pouvoir d'une façon indirecte, mais d'autant plus sûre. D'une part, sous forme de corruption directe des fonctionnaires, ce dont l'Amérique offre un exemple classique, d'autre part, sous forme d'alliance entre le gouvernement et la Bourse; cette alliance se réalise d'autant plus facilement que les dettes de l'État augmentent davantage et que les sociétés par actions concentrent de plus en plus entre leurs mains non seulement le transport, mais aussi la production elle-même, et trouvent à leur tour leur point central dans la Bourse. En dehors de l'Amérique, la toute récente République française en offre un exemple frappant, et la brave Suisse, elle non plus, ne reste pas en arrière, sur ce terrain-là. Mais qu'une république démocratique ne soit pas indispensable à cette fraternelle alliance entre le gouvernement et la Bourse, c'est ce que prouve, à part l'Angleterre, le nouvel Empire allemand, où l'on ne saurait dire qui le suffrage universel a élevé plus haut, de Bismarck ou de Bleichröder. Et enfin, la classe possédante règne directement au moyen du suffrage universel. Tant que la classe opprimée, c'est-à-dire, en l'occurrence, le prolétariat, ne sera pas encore assez mûr pour se libérer lui-même, il considérera dans sa majorité le régime social existant comme le seul possible et formera, politiquement parlant, la queue de la classe capitaliste, son aile gauche extrême. Mais, dans la mesure où il devient plus capable de s'émanciper lui-même, il se constitue en parti distinct, élit ses propres représentants et non ceux des capitalistes. Le suffrage universel est donc l'index qui permet de mesurer la maturité de la classe ouvrière. Il ne peut être rien de plus, il ne sera jamais rien de plus dans l'État actuel; mais cela suffit. Le jour où le thermomètre du suffrage universel indiquera pour les travailleurs le point d'ébullition, ils sauront, aussi bien que les capitalistes, ce qu'il leur reste à faire. » Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, chapitre 7, Barbarie et Civilisation)
A défaut d’être un argument en faveur de la démocratie, on peut cependant noter que les pays dits émergents ont appris encore plus vite que leurs prédécesseurs le parasitisme et la spéculation. Ces pays sont des pays modèles. Ils ont connu une croissance sans précédent. En une génération (1965-1995), le revenu moyen par tête a quadruplé en Thaïlande et en Malaise, décuplé a Singapour. Ces pays sont des pays modèles, le capital fictif y a cru encore plus rapidement que le capital productif de survaleur. Dans le baromètre des risques de Septembre 1996, L’Expansion constatait que “Si l’on s’en tient aux 26 places prises en compte dans l’indice élaboré par la société financière internationale (SFI), la part représentée par leur capitalisation boursière dans le total des places mondiales est passée de 6,5% en 1990 à 11,9 % fin 1994, retombant à 9,6% fin 1995. Les seuls marchés asiatiques représentaient 2% de la capitalisation mondiale en 1983 et près de 7% en 1995, soit un poids comparable à celui de la place de Londres.
Rapporté au PIB, le niveau de capitalisation boursière est désormais plus élevé dans bon nombre de pays en développement que dans les pays industrialisés (342% en Malaisie, 94,4% en Jordanie, contre 36,4 % en France ou 72,1% au Japon)” (L’Expansion 12 septembre 1996). Les États-Unis connaissent aujourd’hui une valorisation boursière sans précédent avec un rapport de 110% par rapport au PIB.
Entrés plus tardivement dans la course à la plus-value relative, les fameux “pays émergeants” bénéficient, en partie, dans l’apprentissage du parasitisme comme pour la technologie, du degré de développement déjà atteint par leurs devanciers. Trotski appelait cela le développement inégal et combiné. Il est certain aussi que ce phénomène actuel bénéficie des évolutions technologiques issues de l’électronique et de l’informatique. Un marché financier planétaire, fonctionnant sept jours sur sept et vingt quatre heures sur vingt-quatre est une réalité. Il contribue à la synchronisation du marché mondial. Non seulement ces technologies facilitent la communication mais jouent un rôle important dans la gestion des fonds. Tout krach moderne est assisté par ordinateur.
Quant aux régimes dits totalitaires, ils ne revêtent pas tous la même réalité. Il y a, par exemple, à distinguer ceux qui s’inscrivent dans la longue histoire de l’Europe occidentale et qui se présentent comme des régimes de conservation sociale où la bourgeoise effrayée par le spectre de la lutte des classes abandonne le pouvoir politique à des Bonaparte ou des Mussolini. On peut également observer que dans d’autres pays, la bourgeoisie démocratique a été incapable de mener à bien une révolution conforme à ses intérêts et le développement du mode de production capitaliste a été confié à une bureaucratie. Quand Engels disait que le communisme est la démocratie de notre temps cela signifiait aussi que la démocratie avait été l’idéologie de la bourgeoisie révolutionnaire européenne contre l’absolutisme. A son tour, le communisme constitue le point de vue révolutionnaire du prolétariat. La démocratie est impérialiste. Comme sa cousine grecque, elle ne peut exister en un endroit qu’en niant son existence dans d’autres. Pour se libérer, pour accomplir leur révolution bourgeoise, pour monter plus facilement les barreaux de l’échelle industrielle, d’autres peuples ont du se lever contre la démocratie bourgeoise devenue non plus le symbole de la révolution mais celui du colonialisme et de l’impérialisme. L’ironie de l’histoire a fait que le communisme travesti en stalinisme a servi de drapeau au développement capitaliste contre l’occident. Le drapeau rouge usurpé une fois discrédité, le drapeau vert de l’islam lui a succédé dans maints endroits.
L’histoire et la réalité sont complexes, aussi ne tirera t-on pas un simple trait d’égalité entre PIB élevé et démocratie. Les vieilles nations d’Europe qui ont utilisé la démocratie pour se libérer ont pu l’instaurer avec des niveaux de développement bien inférieur à celui de nombreux pays pauvres d’aujourd’hui. Les bourgeoisies de ces mêmes pays d’Europe n’ont pas hésité à renoncer au pouvoir politique chaque fois qu’elles se sentaient menacées. Aujourd’hui, un des pays les plus pauvres de la planète, le Bangladesh est doté d’un régime démocratique.
La partie de la population mondiale vivant dans un régime démocratique a rarement dépassé 20%. Ces dernières années ont vu croître le nombre de pays qui ont adopté cette forme de gouvernement. Jamais non plus le mode de production capitaliste n’avait atteint un tel niveau de développement et donc jamais l’exploitation du prolétariat n’avait revêtu une telle étendue et intensité.
L’évolution de la Chine sera décisive pour un mouvement de généralisation de la démocratie qui sera, en même temps, un prélude à sa disparition. » (Chronique de la crise, octobre 1997)
« Semez la crise financière, récoltez la crise du capital productif. Comme prévu, la crise qui a éclaté dans la sphère financière se propage à la sphère productive. Bien plus qu’à un ralentissement de la croissance, que les bons experts bourgeois prévoyaient, nous assistons à la première grande crise internationale en Asie. L’Indonésie affiche un recul du PIB de 8,5%. La Thaïlande, la Malaisie, la Corée avouent également un recul du PIB. Quant au Japon, qui connaissait une crise au sein du capital productif depuis la fin de l’année dernière, le voilà contraint de se déclarer en “récession” pour reprendre le jargon des économistes bourgeois. La conformation de la crise générale de surproduction a donné un coup d’arrêt aux bourses occidentales revenues à des niveaux historiques en dépit et en partie grâce (du fait des déplacements de capitaux) à la crise en Asie et à sa diffusion. C’est la deuxième secousse depuis le début de l’année. Mais jusqu’à présent l’Occident a surmonté la crise d’octobre et retrouvé depuis fin janvier (après la deuxième alerte au début janvier) les plus hauts niveaux de l’histoire. La Russie est également entraînée dans la tourmente. » (1998)
A la fin de l’année 1998, la crise gagne la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Dans notre chronique de la cirse nous écrivons alors :
« Tandis que la bourse de New York bat de nouveaux records historiques et que les bourses européennes sont également proches de leur plus haut niveau, on annonce la baisse du PIB allemand pour le dernier trimestre de 1998. Après la Grande-Bretagne, c'est un autre grand pays d'Europe qui fait un pas vers la crise.
Pour ces pays, la crise dans la sphère productive précède la crise financière, car la bourse allemande comme la bourse anglaise sont à l'unisson avec les autres bourses européennes.
Avec le ralentissement de la croissance en Italie, de nombreux indicateurs vont dans le sens du début d'une crise en Europe. Dans cette configuration, la crise en Europe aurait précédé (la situation était inverse dans la crise 1990-1993) la crise en Amérique du Nord. En effet, les Etats-Unis connaissent toujours une vive croissance (certaines industries enregistrent cependant quelques signes de faiblesse). » (Chronique de la crise, Mars 1999)
Puis s’amorce le reflux
« En ce milieu d'année, la situation semble s'être renforcée en faveur du capital. Les bourses mondiales sont au beau fixe et battent de nouveaux records historiques. L'économie américaine continue de plus belle tandis que les pays européens semblent passés à côté de la crise qu'ils ont tutoyé au cours du dernier trimestre 1998.
Le Japon annonce des résultats trimestriels positifs. Il en va de même de la Corée et en Malaisie. Les bourses asiatiques sont renflouées. Le nombre des pays en crise diminue. Il faut se tourner vers la Russie et l'Amérique latine pour voir encore des pays en proie aux plus graves difficultés. Pour la plupart des observateurs, le pire serait derrière eux et le capital aurait triomphé de la crise, avec l'embellie de la plupart des indicateurs.
Devrons nous reconnaître une nouvelle défaite et retourner à nos chères études ? il est encore trop tôt pour nous rendre. » (Chronique de la crise, Juin 1999)
Mais le reflux s’affirme. Nous pouvions penser que le cycle avait été perturbé une première fois avec la nouvelle configuration du marché mondial, une deuxième difficulté s’ouvrait à nous. Sans céder pour autant aux sirènes de l’idéologie ambiante nous écrivions en 2000 que si la crise n’avait pas lieu avant la fin de 2001, nous retournerions à nos études.
1.3.7 La crise de 2001
Mais cette fois la crise qui éclate dans la sphère boursière en mars 2000 continue sa progression dans la sphère productive. Le NBER, le bureau américain en charge de la datation des cycles économiques dont nous avons parlé ci-dessus, fait débuter la crise aux Etats-Unis en mars 2001.
Dans le cadre du réseau de discussion international, Raoul Victor a publié, dans un article consacré à la crise, ce très intéressant graphique
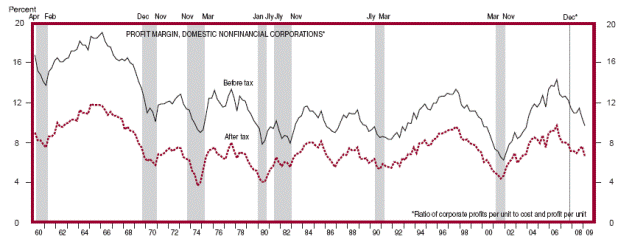
(Source: BEA, Survey of Current Business. Il .s’agit ici de sa version actualisée en juin 2009)
On peut observer que quand les taux de profit marquent une baisse sensible, la crise est sur les rails. Les grands retournements de tendance sont généralement des signes précurseurs et donnent un indicateur à prendre en compte pour la prévision des crises. Si, en règle générale, le taux de profit marque un apogée vers le dernier tiers du cycle, on doit aussi constater que par exemple, en 1986-87, cette baisse à été enrayée pour reprendre à partir de 1989. En 1997, la baisse brutale ne s’est pas immédiatement traduite en une crise, tout comme en 1965-66. Dans ces grands cycles, certains départs de crises ont été annihilés, prolongeant le cycle de quelques années. D’autre part, si une baisse tendancielle se manifeste jusqu’à la crise de 1980-1982, on assiste ensuite, nous l’avons dit plus haut, à un relèvement du taux de profit. A son apogée le taux de profit est plus élevé en 2005 qu’en 1997 ou en 1989. Les deux derniers cycles aux Etats-Unis ont été les parmi les plus longs de leur histoire (108 mois entre les deux points les plus bas pour le cycle 1982 à 2001 et 128 mois – record absolu – pour le cycle de 1991 à 2001). Ils sont en même temps le chant du cygne du capitalisme américain.
1.3.8 La crise actuelle (2007-…)
Avec la crise générale qui s’ouvre à partir de 2007, c’est une nouvelle victoire éclatante que remporte le marxisme orthodoxe et révolutionnaire.
A l’été 2007, il n’y a que pour la bourgeoisie et ses hérauts que la crise financière apparaît comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Pour les révolutionnaires, il y a là la confirmation de l’ouverture d’un nouveau cycle de crise, qui aboutit directement à la déflagration de 2008.
Il convient, en présentant la réédition de ces textes, de revenir sur l’adjectif « catastrophique » accolé au mot crise. Au départ, nous avions tendance à attendre « LA » crise catastrophique et à estimer qu’il y avait un type de crise particulier qui dégénérait en catastrophe. Or, cette vision finaliste est erronée. Dans l’esprit de Marx, toute crise générale de surproduction est catastrophique car elle a les mêmes effets qu’une catastrophe naturelle (un tremblement de terre ou une inondation par exemple), l’activité est paralysée, la main d’œuvre sur le carreau, les marchandises invendues s’abîment, etc. C’est en ce sens, par analogie, que pour Marx, la crise générale de surproduction est catastrophique. Mais les causes de ces effets sont d’origine sociale et non naturelle.
De ce point de vue, la crise de 2008-2009 est d’ores et déjà l’une des plus graves de l’histoire récente du mode de production capitaliste, et tout n’est pas encore écrit. Elle intervient dans un contexte d’endettement phénoménal des principaux états de la planète, et d’une internationalisation des échanges plus intense qu’elle n’a jamais été dans l’histoire. La crise qui a pu, par le passé, être différée dans l’espace ou dans le temps s’est déployée sur l’ensemble de la planète à une vitesse et avec une intensité rarement vues.
Les Etats arc-boutés pour endiguer la crise à grand renfort d’endettement seront-ils eux mêmes en cessation de paiement ou stabiliseront-ils la situation au prix d’une croissance modérée pendant plusieurs années, un retour de l’inflation et un recul général de l’occident vis-à-vis de ses nouveaux rivaux sur le marché mondial ? Ceux-ci, et notamment la Chine, ont été affectés par la crise (baisse brutale des exportations, ralentissement de la croissance du PIB, mise en place de plan de soutien) mais n’ont pas sombré (la croissance soutenue par cet endettement massif[18], même si les statistiques chinoises sont sujettes à caution, reste positive). Toutefois les signes d’une crise qui secouera la Chine se présentent (bulles spéculatives en formation qui sont le signe du développement du capital fictif).
Alors que le commerce mondial plonge, des conflits croissants vont se manifester entre les grandes puissances sur fond de lutte pour l‘accès aux matières premières et de concurrence exacerbée, de montée du protectionnisme tandis que le prolétariat de l’Occident perdra son piédestal et reprendra le chemin du socialisme
1.4 Crise et luttes des classes
Nous attendions également que le retour évident des crises, comme par exemple de celle de 1981, favorise une reprise de l’activité révolutionnaire. Quelle que soit l’ampleur des luttes réelles qui se sont produites, elles n’ont pas pris le chemin de la sortie de la contre-révolution, elles n’ont pas conduit le prolétariat vers la reformation d’un parti politique indépendant.
Dans le numéro 12 de Communisme ou Civilisation (1982), nous abordions le sujet de la relation entre mouvement économique et mobilisation du prolétariat.
« La Gauche Communiste d’Italie soulignait le caractère extrêmement complexe de la liaison dialectique entre mouvement économique et mobilisation du prolétariat .
Dans les « Thèses de Rome » (1922), elle dressait un inventaire des différentes situations qui pouvaient surgir, ajoutant que la caractérisation de telle ou telle phase ne peut se faire qu’à l’issue d’un examen approfondi des tendances historiques qui l’ont précédé (chose que nous ne sommes pas en mesure de faire ici, où nous nous contentons de rappeler quelques principes généraux).
« Qu’il s’agisse d’une période de prospérité croissante ou au contraire de difficultés et de crises, l’influence que la situation économique exerce sur la combativité de classe du prolétariat est très complexe. Elle ne peut être déduite d’un simple examen de cette situation à un moment donné, car il faut tenir compte de tout le déroulement antérieur, de toutes les oscillations et variations des situations qui ont précédé.
Par exemple, une période de prospérité peut donner vie à un puissant mouvement syndical qui, si celle-ci est suivie d’une période de crise et d’appauvrissement, peut se porter rapidement sur des positions révolutionnaires, faisant jouer en faveur de la victoire le large encadrement des masses qu’il aura conservé. Par contre, une période d’appauvrissement progressif peut désagréger le mouvement syndical au point que, dans une période ultérieure de prospérité, il n’offre plus matière suffisante à un encadrement révolutionnaire. Ces exemples (qui pourraient d’ailleurs être inversés) prouvent que « les courbes de la situation économique et de la combativité de classe sont déterminées par des lois complexes, la seconde dépendant de la première mais ne lui ressemblant pas dans la forme. » A la montée de la première peut, correspondre indifféremment, dans des cas donnés, la montée ou la descente de la seconde et inversement.
Les éléments intégrants de cette recherche sont très variés. Il faudra examiner non seulement la tendance effective du prolétariat à constituer et développer des organisations de classe, mais toutes les réactions, psychologiques y compris, déterminées en son sein d’une part par la situation économique, d’autre part par les attitudes et initiatives sociales et politiques de la classe dominante elle-même et ses partis. »
Aucun effet mécanique ne peut donc être dégagé, qui induirait automatiquement de telle situation matérielle, telle situation subjective de la classe révolutionnaire. Et comme le soulignait, par ailleurs, Trotski :
« Ce n’est pas la paupérisation en soi ni la prospérité en soi qui peuvent conduire à la révolution, mais l’alternance de la prospérité et de la paupérisation, la crise. L’instabilité, l’absence de stabilité est le facteur moteur de la révolution. »
En ce sens, la reprise de l’accumulation capitaliste, même et surtout si elle est porteuse d’espoir, d’illusions, etc. est aussi à terme un facteur de reprise de la lutte de classes car ces illusions et ces espoirs seront immanquablement brisés dans une nouvelle crise. Ce mouvement pendulaire (qui lui non plus n’a rien de mécanique dans ses effets : par exemple la grave crise de 1974-75 éclatant après une période de forte prospérité a entraîné plus de réactions ouvrières que celle de 80-81 qui touchait un peu plus une population ouvrière déjà « habituée » à la crise et à ses effets[19]) a pu être occulté et mystifié pendant quarante ans, à la suite du massacre impérialiste qui a permis de détruire la puissance politique du prolétariat et de l’atteler, moyennant miettes et chaînes dorées à la reconstruction du capital.
Toute possibilité, pour la classe ouvrière, de se porter sur le terrain révolutionnaire passe donc d’abord par sa recomposition, sa réunification comme classe, qui possède ses propres objectifs, immédiats et historiques et qui ne soit plus inféodée à l’infecte idéologie bourgeoise du « consensus » et de la paix sociale.
C’est rompre avec 60 années de collaboration de classe où la puissance de la mystification du capital a pu faire oublier l’existence même du prolétariat, que l’on espérait définitivement dilué dans les classes moyennes et à jamais corrompu. Or l’enjeu des années à venir, l’enjeu des grandes luttes comme celles des mineurs anglais (qui dure depuis déjà plus de huit mois) ou dans une moindre mesure des ouvriers de la construction navale en Espagne, c’est précisément briser le faux consensus social que tous – Etat, partis, syndicats, etc. – cherchent à maintenir par tous les moyens. Tant que le prolétariat prendra en compte les intérêts et la logique du capital (qu’elle soit formulée dans le langage du patronat « il faut fermer les secteurs non rentables », ou des syndicats: « il faut rentabiliser et continuer la production nationale ») il ira de défaite en défaite .
L’enjeu de la lutte des mineurs anglais par exemple (et rien n’indique encore que les forces capitalistes, syndicats en tête, n’arrivent pas à maintenir globalement cette lutte sous leur coupe), c’est de montrer que la crise du capital n’atteint pas tel ou tel secteur comme les mineurs, ou telle ou telle région ouvrière[20], mais le prolétariat dans son ensemble jeune et vieux, employé ou non, de la campagne et de la ville, et de tous les pays. La prise de conscience de former une seule classe, dont les intérêts s’opposent totalement à ceux du capital, sera si elle a lieu, le premier pas vers la réunification de la classe, prélude à sa re-formation en parti communiste. Le prolétariat doit briser avec la logique du capital et avec le soutien à l’économie nationale. Pas plus que, lors d’une guerre impérialiste, il ne doit prendre en compte la situation militaire de son pays pour déclarer « guerre à la guerre », il ne doit, dans la guerre de classes en temps de paix, prendre en compte la situation économique de son pays. Le retour cyclique des crises, dont les effets s’aggravent, et qui voient le capital obligé de s’attaquer à des secteurs entiers de l’économie en les démantelant pour les rationaliser (la fameuse « restructuration industrielle » qui ne signifie autre chose qu’exploitation et chômage accrus pour le prolétariat) est un facteur qui peut aider le prolétariat à se mobiliser à nouveau sur des objectifs de classe, contre les intérêts du capital, contre et en dehors des syndicats, etc.
Les luttes actuelles sont ainsi grandes parce qu’elles annoncent (plus que par leur physionomie, syndicale, actuelle[21] ) : la recomposition de ce géant mondial qu’est le prolétariat retrouvant toute sa capacité de lutte contre la vieille société. » C ou C n°12, 1982)
Aujourd’hui, des luttes les plus radicales font émerger une fraction du prolétariat qui semble ne plus s’illusionner sur les perspectives offertes par la société bourgeoise. Ces éléments sont ils le prélude au renouveau de la lutte des classes ou l‘expression d’une radicalité qui sera résorbée dans le réformisme (y compris gauchiste) ?
Les faits sont têtus et l’histoire n’oublie rien. La volonté des hommes, des classes, des gouvernements, des états est totalement impuissante à endiguer les lames de fond qui ne peuvent être brisées que par un élan révolutionnaire mondial. Nul ne sait encore quand celui-ci se produira ni comment, mais il sera d’une ampleur inouïe par rapport à tout ce qui a existé dans l’histoire.
Robin Goodfellow, Juillet 2009
2. Prévision et parti.
2.1 La Gauche Communiste d'Italie et la prévision.
Les conséquences dramatiques de l'absence de restauration de la théorie communiste des crises et des cycles du capital, se voient particulièrement lorsqu'on considère les travaux menés par la Gauche Communiste d'Italie. Comme nous l'avons montré dans les N°s 1 et 2 de CouC, la question de la prévision de la crise catastrophique du MPC et de l'alternative révolution communiste ou 3° guerre mondiale a joué un rôle particulièrement grand dans le processus de dégénérescence et la mort de celle-ci.
Cinq ans après ce qui aurait dû, selon elle, être le point de départ d'un assaut du prolétariat révolutionnaire contre le capital (1975) et alors qu'il n'existe aucun parti communiste dans son sens formel (ne fusse que potentiellement), il est intéressant de s'attarder à nouveau sur les explications fournies ainsi que sur les attitudes prises par les mouvements se réclamant de l'héritage de la Gauche Communiste d'Italie.
Le PCI (Programme Communiste), poursuivant son processus de dégénérescence dans le Trotskisme (activisme forcené, allégeance croissante au léninisme, front commun avec la contre-révolution[22], Soutien critique aux partis bourgeois révolutionnaires dans les luttes anti-impérialistes, etc.), après avoir soigneusement relégué aux oubliettes les prévisions et les perspectives de la Gauche, ne sait plus, lorsqu'il aborde ce sujet, que renier l'importance et les perspectives de cette prévision. Alors que celle-ci indiquait sans équivoque[23], le point de rupture dans l'équilibre capitaliste mondial, posant l'alternative révolution communiste ou guerre mondiale, le PCI en fait une réminiscence vague, dont l'absence de réalisation ne constitue pas un problème, ni théorique, ni pratique.
« C'est vers cette "nouvelle flambée de la révolution permanente conçue dans le cadre international", qu'était tendue notre étude des événements russes tout comme l'ensemble de "nos activités, et c'est pour cela qu'elle ne commémorait pas les quarante ans écoulés de triomphe de la contre-révolution, mais les vingt ans à venir de préparation révolutionnaire, et semble excessivement pessimiste aux gens qui voulaient à tout prix voir la révolution dans la moindre agitation sociale et l'attendaient désespérément d'un jour à l'autre, notre prévision quant au délai qui nous séparait de cette flambée s'est avérée encore trop optimiste.
Car si, effectivement, la première crise générale du capitalisme mondial qui marque la fin de la phase d'expansion du second après-guerre s'est produite en 1975, c'est-à-dire à peu près au moment que nous avions prévu en 1957, elle est loin d'avoir eu toutes les conséquences escomptées. Il ne s'agit encore que d'une secousse préparatoire au tremblement de terre. La crise politique, le développement d'importantes luttes de classe du prolétariat et le retour de groupes prolétaires sur des positions marxistes, est encore en retard sur la crise économique.
Ce fait, comme nous l'avons expliqué dans "Crise et Révolution", ne constitue cependant pas un "démenti" de la prévision de 1957, qui de toute façon ne prétendait pas calculer mathématiquement la date de la révolution. Son objectif était plutôt de fixer un punctum proximum, un délai minimum avant lequel il était illusoire d'espérer une reprise prolétarienne générale. Car après la destruction complète du mouvement de classe du prolétariat réalisée par la contre-révolution, par le stalinisme et ses séquelles, par la participation à la seconde guerre impérialiste, la reconstruction et l'essor mondial du capitalisme, il fallait déjà qu'une crise économique brise matériellement la collaboration entre les classes pour qu'une telle reprise et un retour aux positions communistes deviennent possibles. " (Programme Communiste N° 68 - Oct. 75 p. 13)
A ces conditions objectives, le PCI en ajoutait deux autres, subjectives celles-là, jugées indispensables à la reprise du mouvement prolétarien : l'organisation d'un parti communiste et une restauration théorique. Or, à moins bien sûr de considérer le PCI comme le parti communiste mondial du prolétariat dirigeant la révolution en cours et préparant l'insurrection n'importe quel révolutionnaire lucide doit bien se rendre compte qu'il n'existe aujourd'hui aucun parti formel, ni même un embryon ou un noyau de parti. Quant à l’œuvre de restauration théorique, déjà entravée et incomplète avant 1966 (abandon du travail sur la Chine au début des années 60, variations sur la question de l'épicentre de la future révolution - Allemagne, Chine, Inde ?-, faiblesse sur la question de la crise, polarisation sur "l'énigme russe", retour a-critique au léninisme, montée de l'activisme au sein du parti, etc.), elle est abandonnée complètement depuis cette date, comme en témoigne le lamentable niveau des travaux théoriques fournis par le PCI. Par conséquent, si jusqu'en 1966 le PCI avait une perspective (même fausse, et que la majorité, gangrenée par l'activisme tendait à remettre en cause), pour le guider, désormais il n'en a plus aucune, ce qui ne peut que l'amener à jouer de plus en plus les girouettes et à naviguer au jugé à travers les méandres de l'actualité et les pièges de l’immédiatisme, quitte après coup à justifier n'importe quelle orientation politique, dans la meilleure tradition social-démocrate.
Quant au "Fil du Temps", il maintient une position tout aussi contre-révolutionnaire que celle du PCI, mais opposée quant au fond, puisque lui persévère dans l'erreur, et jure mordicus que la crise a bien eu lieu en 1975., comme prévu. Pour être tout à fait cohérent dans l'absurdité, il n'hésite pas à dire que la troisième guerre mondiale est déjà commencée, et sans doute estime-t-il qu'il en va de même pour la révolution communiste. Pour justifier tout ceci, ce groupe a dû sombrer dans un révisionnisme digne des pires opportunistes. Dans la préface au recueil de Marx et Engels sur la crise, on trouve sous la plume de Roger Dangeville toutes les concessions possibles à l'idéologie bourgeoise.
Remettant en cause totalement le principe de l'invariance de la théorie du prolétariat et la capacité qu'a celle-ci de prévoir le déroulement intégral du MPC, on nous dit sans ambages que l’œuvre de Marx serait incapable de rendre compte du stade le plus développé atteint par le MPC dans les métropoles impérialistes, et notamment d'un phénomène comme l'inflation. Pour pouvoir saisir la nature du MPC. il faudrait alors se tourner vers des zones où celui-ci est moins développé et "drogué", comme par exemple l'URSS, où là, selon une légende, de plus en plus difficile à entretenir il est vrai, régnerait la stabilité des prix, et le mouvement de ceux-ci serait conforme à ce qu'aurait prévu Marx. Le phénomène dont Dangeville est incapable de rendre compte c'est qu’en 1975, alors que l'économie mondiale connaissait la première grave crise de l'après-guerre (et non pas la crise catastrophique, qui reste à venir), les prix de détails n'ont pas baissé. Pour Dangeville, cela signifie que le capital ne se serait pas dévalorisé, et pour expliquer cela on a recours à la théorie d'un capitalisme moribond qui ne se maintient que par l'administration de doses massives de drogue. En fait, si Dangeville n'arrive pas à expliquer le phénomène, c'est qu'il a oublié ce qu'enseigne la théorie révolutionnaire à ce sujet : il ne faut pas observer en premier lieu le mouvement des prix de détail, lequel concerne le rapport entre le capitaliste et le "consommateur" (qui est un être inter-classiste) mais celui des prix de GROS, c'est-à-dire un rapport entre capitalistes. Cela, la Gauche Communiste d'Italie le rappelait fort justement en son temps, mais les épigones ont été frappés d'amnésie. Or, en 1974-75. les prix de gros ont effectivement baissés dans l'ensemble des nations capitalistes les plus développées, Pour être encore plus précis, le mouvement de baisse des prix de gros, non seulement n’est pas contradictoire avec l'accélération de la hausse des prix de détail mais exprime d'une autre manière la même aggravation des contradictions internes au MPC, miné par la contradiction valorisation-dévalorisation qui se présente sous l'aspect de la baisse tendancielle du taux de profit.
Ce qu'exprimé particulièrement cette accélération de la hausse des prix de détail, c'est l'attaque des classes moyennes salariées, c'est-à-dire des classes moyennes propres à la phase de soumission réelle du travail au capital. Dans le n°9 (Thèses sur les deux phases historiques de la production capitaliste - Suite), nous montrerons rapidement le rôle important joué par ces classes moyennes dans la régulation de l'activité capitaliste. Nous reviendrons également sur cette question dans le cours de ce travail sur la crise. Ce qu'il est important de souligner ici. c'est que selon la thèse classique de notre théorie, les classes moyennes sont atteintes en premier par la crise, dont elles subissent les effets, le capital s'attaquant plutôt d'abord aux improductifs, à ceux qui consomment une partie de la plus-value qu'aux travailleurs productifs, aux prolétaires, seuls créateurs de cette plus-value dont le capital cherche perpétuellement à extorquer le maximum.[24]
Selon le syndicat des cadres CGC, La progression du pouvoir d'achat, cumulée sur la période 1970-74 serait de 20% pour les ouvriers, 10% pour la maîtrise et les techniciens, 8,67% pour les fonctionnaires et 7% pour les cadres. Pour la période 1974-78, qui correspond à une accentuation de la crise, la progression n'est plus que de 10,4% pour les ouvriers, 5% pour la Maîtrise et les techniciens, 8% pour les fonctionnaires et 2% pour les cadres. L'ensemble des classes moyennes (techniciens, fonctionnaires, cadres), ont vu leur revenu croître moins vite que celui des ouvriers et leur part relative dans la fraction du produit destiné à la consommation diminuer par rapport à celle des ouvriers. En 1979, la baisse des revenus a été absolue, selon les données officielles - et encore on ne tient compte ici que de la population active, c'est-à-dire qu'on ne considère pas l’aggravation du chômage, dans l'appréciation des effets de la crise. Mais pour qui confond Marx avec Ricardo, les phénomènes du capitalisme moderne (c'est-à-dire du MPC parvenu à la phase de soumission réelle du travail au capital), demeurent incompréhensibles.
Plutôt que d'admettre lucidement les insuffisances de la Gauche et d'en rechercher les causes, plutôt que d'essayer de voir pourquoi la prévision ne s'est cas réalisée et de s'efforcer de dépasser les limites qui ont conduit à prévoir de manière erronée l'alternative révolution communiste ou guerre mondiale pour 1975, le "Fil du Temps" via Roger Dangeville se mue en faussaire. Nous avons montré dès notre N°1 à quels escamotages on recourait pour "présenter" la prévision de la Gauche, mais désormais, pour faire face aux dures réalités de l'histoire, il lui faut aller jusqu'à renier les fondements mêmes de la théorie révolutionnaire. Ainsi Dangeville invente un cycle de 30 ans dans la production capitaliste (1945-1975), qui correspondrait soi-disant à La rotation du capital fixe. Voilà qui est en parfaite contradiction avec les thèses de Marx pour qui la durée du cycle devait aller en se raccourcissant :
" Jusqu'ici la durée périodique de ces cycles est de 10 ou 11 ans, mais il n'y a aucune raison pour considérer ce chiffre comme constant. Au contraire on doit inférer des lois de la production capitaliste, telles que nous venons de les développer, qu'il est variable et que la période des cycles se raccourcira graduellement." (Marx. Capital I,7 XXV)
La prévision de la Gauche reposait sur un cycle de 10 ans, tel qu'il se manifestait au début de la phase de soumission réelle du travail au capital, c'est-à-dire à partir de 1848 en Angleterre. Aussi, après la période de reconstruction 1945-55 la Gauche prévoyait-elle qu'une très grave crise, similaire à celle de 1929 secouerait l'ensemble du monde capitaliste, y compris l'URSS, en 1965 (crise d'entre deux guerres), ouvrant une période de lutte de classes qui devait déboucher sur la révolution communiste, avec la crise de 1975 ou entraîner la défaite définitive du prolétariat révolutionnaire avec le déclenchement de la 3ème guerre mondiale. Cette thèse était exprimée -entre autres- dans le "Dialogue avec les morts" (1957) :
« La progression de la production capitaliste mondiale pendant les dix années d'après-guerre continue encore quelques années. Arrive ensuite la crise d'entre deux guerres, analogue à celle qui éclata en Amérique en 1929. Massacre social des classes moyennes et des travailleurs embourgeoisés. Reprise d'un mouvement mondial de la classe ouvrière, qui aura rejeté tout allié. Nouvelle victoire théorique de ses vieilles thèses. Parti communiste unique pour tous les Etats du monde. Au terme d'une vingtaine d'années, l'alternative de ce siècle difficile : troisième guerre des monstres impérialistes ou révolution communiste internationale. C'est seulement si la guerre ne passe pas que les "émulateurs" mourront. » (pp. 123-124)
Au lieu des échéances qui rythmèrent la contre-révolution : 1929 crise; 1939 : deuxième guerre mondiale, on avait donc la prévision des échéances suivantes, marquant le cours révolutionnaire à venir : 1965 : crise; 1975 : révolution communiste mondiale. En fait la Gauche avait gravement sous-estime le profond rajeunissement opéré par le capital à travers la 2ème guerre mondiale, et l'énorme renforcement de ses capacités qui découlait de cette régénération. La contre-révolution triomphante rendait possible ce qui est nécessaire pour que le capital puisse s'épanouir pleinement dans la phase de soumission réelle : la domination complète du prolétariat par le capital et la mainmise de celui-ci sur tous les secteurs de l'activité sociale. Voilà fondamentalement le sens de l'orgie capitaliste après 1945. C'est cet écrasement qui permit l'exploitation effrénée du prolétariat, l'intégration irréversible des syndicats au capital, le gonflement démesuré des classes moyennes, le développement inouï de la science et de la technique, et bien sûr de l'anarchie, du gaspillage des forces productives.
Un tel élan de la production capitaliste a montré à nouveau combien l'humanité souffre du retard de la révolution communiste, Déjà possible en 1848, celui-ci devient absolument nécessaire en 1914, alors que les forces productives n'étaient déjà que trop développées. Il n'y a plus à attendre de la bourgeoisie qu elle développe celles-ci, mais il faut détruire par la violence les rapports de production capitalistes qui empêchent les bases du communisme déjà présentes au sein de la société, de s'épanouir pleinement. L'humanité vit une situation sublimée, où depuis longtemps déjà aurait dû triompher la révolution communiste. Avec les fantastiques capacités de développement que le capital a puisé dans les massacres de la deuxième guerre impérialiste et la contre-révolution sur le prolétariat, s'est accru le retard de la révolution communiste. "Aussi horriblement une fois encore, la jeune et généreuse bouche du prolétariat, puissante et vitale, s'est appliquée contre la bouche putréfiée et fétide du capitalisme, et lui a redonné, dans une étroite union inhumaine, un autre souffle de vie." (Bordiga). Mais si le fait d'avoir retrouvé des forces en se faisant une nouvelle fois le vampire du prolétariat a permis au capital de prolonger encore de quelques décennies sa vie maudite, il périra dans des convulsions d'autant plus fortes et plus violentes lorsque la crise catastrophique l'atteindra de plein fouet. La révolution communiste jaillira alors, d'autant plus vivante, plus puissante, plus radicale, qu'elle aura 'été contenue plus longtemps.
La Gauche avait donc mal apprécié les conséquences économiques, et politiques d'un approfondissement de la soumission réelle du travail au capital. De même la théorie des crises, celle de la monnaie etc. étaient insuffisamment restaurées, comme le montrent par exemple les erreurs sur la durée du cycle. Si la Gauche sut défendre les principes essentiels du programme communiste elle échoua dans sa tentative de restaurer pleinement celle-ci. C'est pourtant parce qu'elle sut quand même rester fermement sur les positions de classe, en constituant autour d'elle un solide cordon sanitaire, que la Gauche a pu effectivement transmettre le programme aux générations futures. Dans ce sens, elle est morte en accomplissant sa tâche historique, tout comme une femme qui meurt en couches peut donner en même temps la vie.
La scission de 1966 essayait d'affronter correctement la discontinuité créée par le fait que la prévision ne se réalisait pas. Il fallait reprendre l'effort de restauration programmatique que les tendances révisionnistes et activistes au sein du PCI avaient déclaré achevé. Il fallait se situer dans la continuité du mouvement communiste révolutionnaire et retourner aux positions fondamentales du parti, jalonnées par les dates 1951, 1921, 1917, 1871, 1847. Contre l'activisme dévastateur il fallait réaffirmer les fondements mêmes du communisme affirmés dans l’œuvre de Marx et Engels. Cette activité de défense et de restauration du programme ne pouvaient plus s'effectuer au sein du PCI. La référence à la Gauche devait désormais être exclusivement théorique, et il était nécessaire d'en souligner les limites. Cela, le "Fil du Temps" ne le comprit jamais, car il s'est toujours considéré comme le véritable parti, la continuation directe, sur le plan organisationnel, de la Gauche. Des deux revues issues de la scission de 1966, seule Invariance (1ère série, N°s I à 7) s'efforçait de tirer toutes les conséquences du fait que la prévision d'une crise d'entre deux guerres pour 1965 ne s'était pas réalisée, et de la dégénérescence léniniste du PCI. Mais Invariance elle-même ne s'était pas complètement dégagée des insuffisances de la Gauche. Ainsi : " la tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants (...) La révolution ne peut pas tirer sa poésie du passé, mais seulement de l'avenir. Elle ne peut pas commencer avec elle-même avant d'avoir liquidé complètement toute superstition à l'égard du passé. Les révolutions antérieures avaient besoin de réminiscences historiques pour se dissimuler à elles-mêmes leur propre contenu. La révolution... doit laisser les morts enterrer leurs morts pour réaliser son propre objet." (Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte).
D'autre part, déjà dans la première série d'Invariance apparaissent certains germes de révisionnisme trahissant ainsi l'influence montante de l'idéologie des classes moyennes.
Par rapport à la prévision, la position d' Invariance était la suivante : la crise de 1965 avait été englobée, et elle n'était surmontée que temporairement et allait se télescoper avec celle de 1975 dont elle accroîtrait l'ampleur et la violence. Par conséquent, la prévision fondamentale de la Gauche : 1975 = alternative révolution communiste ou guerre mondiale était maintenue. On n'avait procédé à aucune réévaluation de la compréhension que la Gauche avait des crises. Par contre, un des travaux importants d'Invariance était d'avoir amorcé la restauration de la périodisation du MPC en deux phases phase de soumission formelle puis réelle du travail au capital. Plus généralement, il était affirmé que l’œuvre de Marx était restée inachevée et qu'il appartenait au mouvement communiste d'accomplir cette tâche[25].
Invariance a su également mettre en relief la faiblesse de la Gauche par rapport au léninisme et à la critique de l'IC, le danger de considérer le parti comme un deus ex machina, la mauvaise compréhension du rôle des syndicats et de leur intégration. Cela ne fut pas suffisant, et Invariance également devait succomber à la contre-révolution en proclamant avoir dépassé la théorie communiste. Mais ici aussi, en mourant, le courant issu de la scission de 1966 et représenté notamment par Invariance, nous donnait la vie.
En 1975, même si le monde capitaliste était touché par la première grave crise de l'après-guerre (faisant suite à celles, de moindre ampleur, de 1969, 1963 etc.), il fallait être bien sot et ignorant pour y voir la crise catastrophique amenant l'alternative révolution communiste ou guerre mondiale.
A la suite de la 2ème guerre mondiale, la durée du cycle du capital, et de ses crises intermédiaires, s'est raccourcie pour passer de 10 à 6 ans ( 1951, 1957, 1963, 1969, 1975). Le point le plus bas de la prochaine crise que connaîtra le capital devrait donc se situer en 1981, comme nous l'avions indiqué dans notre numéro 2 (1977), et répété dans notre dernier numéro.
En fait, seules les lois mathématiques du multiple commun qui font que 3 cycles de 10 ans équivalent à 5 cycles de 6 ans expliquent que 1975 coïncidait effectivement avec une crise du MPC. Hélas, ce n'était pas encore la crise catastrophique tant attendue. Les faits montraient donc qu'on ne pouvait pas en rester aux simples critiques d'Invariance sur la prévision, et qu'il fallait aller plus loin dans la critique de la Gauche, son dépassement, non pas dans un sens moderniste, mais dans un sens orthodoxe, en revenant aux fondements de la théorie révolutionnaire, à l’œuvre de Marx inachevée, édulcorée, trahie par la contre-révolution et incomplètement restaurée par la Gauche. Pour accomplir cette tâche, placée sous le signe déjà indiqué par Invariance du retour à Marx, il fallait se dépouiller des défroques héritées de la scission de 1966, de manière à ce que le programme puisse trouver une voie d'affirmation plus pure, sans allégeance outrée aux fantômes du passé.
2.2 Parti et prévision du communisme.
« Du fait qu'il est la préfiguration de l'homme et de la société communistes, (le parti) est la base médiatrice de toute connaissance pour le prolétaire, c'est-à-dire pour l'homme qui refuse la Gemeinwesen bourgeoise et accepte celle du prolétariat, lutte pour l'imposer et faire triompher l'être humain. La connaissance du parti intègre celle de tous les siècles passés (religion, art, philosophie, science). Le marxisme n'est donc pas uniquement une théorie scientifique (parmi tant d'autres), il englobe la science et se sert de ses armes révolutionnaires pour arriver au but : la révolution. Le parti est un organe de prévision. S'il n'est pas cela, il se déconsidère." (Origine et fonction de la forme parti. Invariance N°1 1968)
Comme l'a souligné la Gauche Communiste d'Italie, toute l’œuvre de Marx est en premier lieu description de la société communiste. Ce qui forme l'unité de conscience et l'organicité programmatique du parti de classe, ce n'est pas l'addition des opinions, points de vue ou consciences individuels des ouvriers, immergés dans les rapports de production capitalistes que leur travail produit et reproduit, mais le programme du prolétariat en tant que classe qui est "exclue de cette société, mais s'oppose a elle en même temps" (Marx), classe qui est négation de la société bourgeoise, porteuse du communisme comme solution historique, pour elle même et partant, pour l'ensemble de l'espèce humaine.
Capable donc de dépasser la sphère immédiate de la société bourgeoise, la théorie communiste, le programme du prolétariat, n'est pas la biologie du capital, mais sa nécrologie.
Conformément à la méthode dialectique selon laquelle la connaissance des formes les plus développées permet la compréhension des formes inférieures, c'est en se plaçant sur le terrain du communisme, de la destruction du mode de production capitaliste, bref de la classe prolétarienne en tant que négation du capital, que le parti communiste conduit sa critique du mode de production capitaliste et des formes sociales qui l'ont précédé. Là réside la force du programme communiste, dans sa capacité à connaître par avance et à décrire le but final du mouvement prolétarien et, en reliant dialectiquement ce but au mouvement lui-même, à prévoir le cours intégral du MPC et les moyens nécessaires à la destruction du capital: Tous les révolutionnaires qui ont cherché à défendre la théorie communiste, tous les orthodoxes ont défendu cette thèse-ci.
« Grâce à quelle clé magique Marx a-t-il réussi à pénétrer les secrets les plus profonds de tous les phénomènes capitalistes à résoudre comme en se jouant des problèmes dont les plus grands esprits de l'économie politique bourgeoise tels que Smith et Ricardo ne soupçonnaient même pas l'existence? C'est simplement qu'il a conçu l'économie capitaliste tout entière comme un phénomène historique, dont l'histoire s'étend non seulement derrière elle, comme l'admettait à la rigueur l'économie classique, mais aussi devant elle; c'est d'avoir considéré non seulement le passé, l'économie féodale, mais aussi l'avenir socialiste. Le secret de la théorie de la valeur chez Marx, de son analyse de l'argent., de sa théorie du capital., du taux de profit, et par conséquent de tout le système économique actuel, est la découverte du caractère éphémère et transitoire de l'économie capitaliste, son effondrement et par conséquent - ceci n'en est que l'aspect complémentaire -, le but final socialiste. C'est uniquement parce que Marx considérait l'économie capitaliste en sa qualité de socialiste, c'est-à-dire du point de vue historique, qu'il put en déchiffrer les hiéroglyphes; c'est parce qu'il se plaçait à un point de vue socialiste pour analyser scientifiquement la société bourgeoise, qu'il put à son tour donner une base scientifique au socialisme. »
(Rosa Luxemburg - Réforme ou Révolution. Ed. Maspero p.59)
La théorie communiste est une théorie de parti, et ce n'est donc pas aux pâles lumières des cervelles individuelles qu'il appartient d'apprécier les situations contingentes et de définir la position à prendre face à elles, mais au parti, organe collectif dont le fonctionnement organique, unitaire, centralisé, lui a souvent valu, de la part de la Gauche, le qualificatif de "cerveau social". Ce que le pensée individuelle est incapable de faire : dépasser l'immédiat pour parvenir à une appréhension juste des tendances profondes de la réalité historique, le parti, lui, le fait, parce qu'il pense et agit sur une ligne historique fermement tracée par avance. L'importance de la prévision, pour le parti révolutionnaire est donc qu’elle assure dialectiquement la liaison du but et du mouvement. Ce n'est que grâce à la prévision générale du cours historique que l'on peut fonder l'action révolutionnaire d'une manière ferme et sûre, sans qu'elle se fasse au jour le jour en fonction des retournements de situation et de la succession fortuite d'événements imprévus.
Comme le dit si justement Rosa Luxemburg :
"La tâche de la social-démocratie et de ses dirigeants ne consiste pas à se mettre à la remorque des événements mais à les devancer avec lucidité, à embrasser du regard les lignes de force de l'évolution et à abréger cette évolution par une action consciente, à hâter sa marche. '' (Parti et action de masse)
Ce qui permet au parti de ne pas rester englué dans la réalité immédiate, c'est sa capacité à prévoir les divers moments du cours historique, qu'ils soient favorables ou non au prolétariat. Dans le dernier cas, le parti démontre et a démontré sa capacité à connaître les obstacles que rencontre le prolétariat. C'est ce que l'on a exprimé par ailleurs en disant que la théorie communiste était aussi une théorie des contre-révolutions. Intégrer la compréhension du cours contre-révolutionnaire, lorsqu'il s'ouvre, c'est assurer le renforcement du programme communiste, permettre aux maigres forces épargnées par la débâcle de se préserver et de se maintenir sur le seul terrain de la défense du communisme, en dehors de tout activisme et immédiatisme.
Mais cela ne peut se faire - et sans cela la meilleure activité théorique ne serait que travail d'érudit, de savant - qu'en se reliant au prochain cycle révolutionnaire. Mais le parti tire sa force non seulement du fait qu'il se relie à la révolution à venir, mais encore de ce qu'il sait s'insérer dans la totalité de l'arc historique du communisme, reliant entre elles toutes les générations du prolétariat révolutionnaire. C'est au nom de celles-ci, c'est-à-dire des générations passées et des générations à venir que les vivants exécutent la sentence de l'histoire. Le parti (historique) doit être à même de prévoir où et quand les conditions historiques seront à nouveau réunies pour que le prolétariat oppose dans la lutte des classes sa solution révolutionnaire face au capital, son Etat, ses partis, ses syndicats.
Ainsi, loin de s'opposer à la vie, c'est la vie même qui donne à la théorie révolutionnaire la sève nécessaire à son épanouissement. Ce qui fait la force du programme communiste, c'est qu'il émane d'une classe qui n'a d'autre mission que d'abolir toute société de classes et donc de s'abolir lui-même. Le prolétariat n'a pas de position particulière, pas d'intérêt particulier à défendre dans la société. Au contraire "les prolétaires n'ont rien à sauver qui leur appartienne ils ont à détruire toutes garanties privées toutes sécurités privées antérieures" (Manifeste du Parti Communiste) . Le prolétariat ne s'oppose pas au monde existant parce que celui-ci lui aurait fait subir un tort particulier, une injustice spécifique, contre laquelle il lui faudrait s'insurger partiellement, mais le tort absolu d être irrévocablement coupé de son être humain, de la communauté humaine.
C'est donc de la société communiste, dont les prémisses et les bases matérielles sont déjà inclues dans les flancs de la société ancienne, que la théorie révolutionnaire tire toute sa puissance et sa force. Elle seule peut se retrouver dans le labyrinthe de l'histoire. Elle est la boussole qui indique toujours le nord révolutionnaire, vers lequel s'oriente le prolétariat qui n'a pas renoncé à perdre ses chaînes. Sans théorie révolutionnaire pas de mouvement révolutionnaire. Sans prévision, pas de parti révolutionnaire. C'est de la communauté humaine à venir, communauté vers laquelle tend le développement de l'espèce humaine, et qu'elle devra forcément se réapproprier pour ne pas périr, que le parti communiste tire ses caractéristiques fondamentales. Dans un de nos textes de parti (Origine et fonction de la forme parti in : Invariance N°1, cf. aussi CouC N°3, consacré à la communauté), nous avons montré quelles étaient les principales caractéristiques du parti communiste (au sens formel du terme), en tant que préfiguration - et non réalisation comme le veulent les anarchistes- de la Gemeinwesen (Communauté) humaine. La situation de ce parti, préfigurant la société future, mais en même temps immergé dans la société présente, contre laquelle il mène une lutte sans merci, le conduit à prévoir les événements, afin de mieux les diriger, Cette anticipation de la société future, seul le parti de classe est capable de la mener à bien, en tant qu'organe capable d'anticiper sur les développements immédiats de la lutte et de connaître le déroulement du cours historique.
En général, dans l'histoire, les forces sociales agissantes se manifestent toujours sans avoir ni la conscience ni la maîtrise de leur mouvement. Elles engendrent ainsi des forces qu'elles ne peuvent pas contrôler et dont la conscience et la compréhension théorique leur vient "post festum", une fois le fait accompli - et encore de manière déformée. C'est pourquoi Hegel dit, à propos de la philosophie mais cela vaut pour toute expression idéologique en général : « La chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit ».
Avec le prolétariat en tant que classe organisée en parti on a pour la première fois au contraire, un sujet agissant dans l'histoire qui possède la parfaite conscience et connaissance de son mouvement et de son but historiques. Alors que l'individu est incapable de dépasser l'horizon borné de ses intérêts immédiats, le parti lui, pense et sait à l'échelle historique, non seulement pour ce qui concerne hier et aujourd'hui, mais surtout demain.
Tel est le sens du "renversement de la praxis". Il signifie qu’avec la révolution prolétarienne dirigée par le parti de classe il s'effectue un renversement du cours de l'histoire humaine, celle-ci ne s'effectuant plus selon un processus aveugle et indépendant de la volonté des individus, mais selon un plan conscient et harmonieux maîtrisé par la collectivité humaine tout entière. "Le communisme est la connaissance d'un plan de vie pour l'espèce humaine" (Prometeo).
Capable de prévoir, le parti doit être la dissolution des énigmes. Il doit dissoudre toutes les zones d'ombre de la réalité sociale d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Alors seulement il pourra apparaître comme le "havre de repos" (Bordiga) pour le prolétaire, le lieu où s'affirme sa nature humaine échappée à l'aliénation, de telle sorte qu'il puisse être apte à mobiliser toutes ses énergies contre son ennemi de classe. Le parti doit être fort, animé par son programme invariant, pour qu'il n'y ait aucune place laissée au doute révisionniste. Le parti saura donc d'autant plus renforcer son organicité et son unité programmatique, stratégique, tactique, qu'il aura prévu longtemps à l'avance et avec certitude le cours des événements. La prévision est donc un indispensable facteur d'organicité, dans la mesure où nul ne peut se lever pour demander à infléchir dans tel ou tel sens le cours de l'activité du parti sans se mettre en dehors de celui-ci. Ce n'est donc que grâce à la prévision, embrassant dans une seule vision unitaire et organique des années du processus révolutionnaire, que peut fonctionner réellement et convenablement le centralisme organique, celui-ci déniant à une quelconque représentation démocratique basée sur l'opinion individuelle le droit de remettre en cause au jour le jour la ligne d'activité du parti tracée par des générations et des générations de prolétaires révolutionnaires. La Gauche Communiste d’Italie a particulièrement insisté sur le fait qu'il ne pouvait y avoir distorsion entre principes programmatiques et tactique. C'est là un des enseignements de la dégénérescence de l'Internationale Communiste. De même, la première Internationale avait légué en mourant cet enseignement définitif selon lequel il ne peut y avoir distorsion entre programme et principe d'organisation.
La tactique doit donc être globalement fixée par avance, ce qui implique que l'on doive connaître par avance les divers problèmes que le prolétariat affronte à l'échelle mondiale, et délimiter les différentes stratégies et tactiques à employer. On a vu, lors de la dernière vague révolutionnaire des années 20 combien avait pesé sur le sort de la révolution mondiale la non jonction des deux phénomènes révolutionnaires, celui à l’œuvre dans l'aire slave, et celui à l’œuvre dans l'aire occidentale. Les différences de tactique, dues aux divers degrés de développement capitaliste dans les différentes aires n'ont pu être fixées en un plan de combat unitaire qui aurait permis au prolétariat mondial de les combiner dans une stratégie commune. D’où la conclusion, tirée par la Gauche que, désormais la tactique aussi devrait être fixée par avance afin de permettre une action entièrement organique du prolétariat à l'échelle mondiale. Ce n'est qu'en fixant les tâches stratégiques et tactiques par avance, le plus clairement possible, en délimitant le mieux les différents cas et situations auxquels le prolétariat se trouvera confronté - ce qui n'est possible que par la prévision - que l'on pourra éviter une distorsion catastrophique entre principes, stratégie et tactique. Ce n'est qu'ainsi que la ligne de classe du parti sera clairement tracée et son application facilitée, renforçant ainsi l'organicité du parti communiste et de son action à l'échelle mondiale.
« Pour vivre d'une vie organique, le Parti communiste doit posséder une méthode critique et une conscience le portant à formuler un programme propre. C'est précisément pour cette raison que le Parti et l’Internationale communiste ne peuvent accorder la plus grande liberté et élasticité de tactique aux centres dirigeants et remettre la détermination de celle-ci à leur seul jugement après examen de la situation. Le programme du parti n'a pas le caractère d'un simple but que l’on pourrait atteindre par n'importe quelle voie, mais celui d'une perspective historique dans laquelle les voies suivies et les objectifs atteints sont intimement liés. Dans les diverses situations, la tactique doit donc être en harmonie avec le programme, et pour cela, les règles tactiques générales pour les situations successives doivent être précisées dans certaines limites, sans doute non rigides, mais toujours plus nettes et moins fluctuantes à mesure que le mouvement se renforce et approche de la victoire finale. C'est seulement ainsi qu'on parviendra au centralisme maximum dans les Partis et l'Internationale c'est-à-dire que les dispositions prises centralement pour l'action seront acceptées et exécutées sans résistance non seulement par les Partis communistes, mais même par une partie des mouvements de masse qu'ils sont parvenus à encadrer. On ne doit en effet pas oublier qu'à la hase de l'acceptation de la discipline organique du mouvement, il y'a non seulement l'initiative d'individus et de groupes résultant des développements de la situation, mais une progression continue et logique d'expériences les amenant à rectifier leur vision de la voie à suivre pour obtenir la plus grande efficacité dans la lutte contre les conditions de vie que l'organisation sociale actuelle impose au prolétariat. C’est pourquoi avant d'appeler leurs adhérents et ceux des prolétaires qui les suivent à l’action et au sacrifice d'eux-mêmes, les Partis et l'Internationale doivent exposer de façon systématique l'ensemble de leurs règles tactiques générales et démontrer qu'elles sont la seule voie de la victoire. Si le Parti doit donc définir les termes et les limites de sa tactique, ce n'est donc pas par désir de théoriser et de schématiser les mouvements complexes qu'il pourra être amené à entreprendre, mais en raison d'une nécessité pratique et organisationnelle. Une telle définition peut sembler restreindre ses possibilités d'action, mais elle seule garantit la continuité et l'unité de son intervention dans la lutte prolétarienne et c'est pour ces raisons tout à fait concrètes qu'elle doit être décidée. » (Thèses de Rome. 1922)
A la prévision générale du cours historique, et de la société future, se relie dialectiquement une série de prévisions contingentes concernant des événements déterminés dans le cours du développement du MPC et de la lutte des classes.
Un excellent exemple de cette lucidité révolutionnaire qui permet par-delà la prévision des événements contingents de saisir-le cours historique général, est donné par Trotski en 1921. Trotski envisage ce qui se passerait si le cours révolutionnaire se renversait :
« Si l'on admet (nous allons le faire un instant) que la classe ouvrière ne se lance pas dans le combat révolutionnaire et donne à la bourgeoisie la possibilité durant une longue série d'années - disons deux ou trois décennies - de mener la destinée du monde, il est indiscutable qu'un certain équilibre, différent du précédent, va s'établir. L'Europe reculera fortement. Des millions de travailleurs européens vont mourir de faim à cause du chômage et la sous-alimentation. Les Etats-Unis devront changer d'orientation sur le marché mondial, restructurer leur industrie, et connaîtront une dépression pour une période prolongée. Dès qu'une nouvelle division du travail se sera instaurée dans le monde sur ce chemin de souffrance au cours de quinze-vingt-vingt-cinq ans, une nouvelle époque d’essor capitaliste pourrait peut-être commencer. » (Trotski. "La nouvelle étape" 3ème Congrès de l’IC - 1921)
C'est bien ainsi que les choses se sont déroulées : 1928 : contre-révolution ; 1929 : crise ouvrant le cours vers la guerre impérialiste qui éclate en 1939. Nouvel essor du capital grâce à l'écrasement du prolétariat. Il est regrettable que cette lucidité ait abandonné Trotski lorsqu'il a fallu affronter cette situation dans la réalité c'est-à-dire lorsque le cours révolutionnaire s'est effectivement renversé. Loin de reconnaître la défaite et d'adopter une attitude révolutionnaire par rapport à elle, l'ancien chef de l'armée rouge s'est épuisé dans une oeuvre stérile et bouffonne, en cherchant à reconstruire une "Quatrième Internationale", rapidement contre-révolutionnaire.
Servant de guide à l'action révolutionnaire du prolétariat, les prévisions contingentes doivent être fiables, mais seuls ceux qui considèrent le parti comme un deus ex machina, qui n'est pas produit et déterminé par le mouvement historique, mais s'en détache comme force autonome existant toujours avec la même force et la même ampleur, peuvent en arriver à fétichiser les faits, les dates, etc., à privilégier la forme par rapport au contenu. Le grave problème qui se pose avec la prévision de 1965, puis de 1975, ce n'est pas tant que la crise annoncée n'ait pas eu lieu. Le mouvement communiste a déjà commis des erreurs par le passé, à commencer par Marx et Engels qui escomptaient le retour de la crise et de la révolution pour 1852, après la crise de 1847 (ils s'appuyaient sur une durée du cycle de 5 ans, telle qu'elle existait jusqu’en 1848 ). Ce qui est grave, c'est qu'une telle erreur n'ait pas pu être réparée et que le mouvement ait été incapable de percevoir qu'il y avait une discontinuité et de dépasser cette erreur en reprenant un travail plus vaste, en approfondissant le travail de restauration théorique. Si l'on peut rester béatement satisfait en disant que après tout Marx aussi se trompait, c'est seulement à condition d'oublier que Marx, dépassa la perspective devenue caduque de la crise de 1852, en cherchant à préciser les changements apportés dans le cycle du capital, avec le passage à la phase de soumission réelle, et en montrant qu’à partir de 1848, une phase de la vie du capital était terminée et que le rythme du cycle avait changé. Dans la mesure où elle ne sût pas reprendre la prévision à un niveau supérieur, et englober l’erreur dans un travail plus vaste, la Gauche succomba à la débâcle activiste. Alors que les défaites (théoriques, sociales, ou militaires) deviennent des victoires lorsqu'on s'avère capable de les circonscrire, les comprendre et d'en tracer le bilan rigoureux, les débris qui se réclament aujourd'hui de la Gauche Communiste d'Italie officiellement se sont laissés honteusement emporter par le déluge révisionniste, incapables qu'ils sont de fournir le moindre effort pour prévoir les échéances révolutionnaires posées au prolétariat.
Une nouvelle fois le cours historique s'apprête à démontrer la validité des positions communistes sur la crise : le capital doit connaître une intensification de ses contradictions conduisant à la crise catastrophique. Une nouvelle fois s'ouvre un cours marqué par l'alternative guerre ou révolution. Les contradictions du mode de production capitaliste ne peuvent aboutir qu'à un nouvel holocauste mondial, dont les conséquences seraient effroyables pour le prolétariat et l'espèce humaine tout entière, à moins que celui-ci ne se dresse pour y opposer sa solution révolutionnaire. On ne peut séparer le cours vers la révolution du cours vers la guerre. Face à la crise catastrophique du MPC, il s'agit là d'une alternative historique dont les deux termes incarnent chacun des deux grands camps opposés dans la guerre de classes. Du coté du capital la solution réside dans la guerre impérialiste mondiale; du coté du prolétariat la solution réside dans la révolution communiste internationale, l'insurrection de toutes ses forces vitales pour stopper le massacre opéré par le capital, que ce soit dans la guerre ou dans la "paix". Une fois de plus le dilemme devant lequel se trouvera placée l'humanité est le suivant : ou bien poursuite de la CIVILISATION capitaliste, avec ses bagnes et ses charniers, ou bien victoire du COMMUNISME, de la société sans classes.
3. Le doute révisionniste à l'assaut de la théorie communiste.
3.1 La montée du révisionnisme.
La capacité à prévoir, fermement reliée au programme communiste, est donc un sûr garant contre les assauts du doute révisionniste. C'est elle qui permet de ne pas laisser l'immédiat et le conjoncturel prendre le pas sur les considérations théoriques et les positions de principe. Par le passé, le mouvement communiste a déjà eu affaire à des offensives révisionnistes, et à chaque fois il a fallu, entre autres défendre la position classique sur les crises.
Compte tenu de l'importance de cette position pour la prévision et la stratégie révolutionnaires, ce n'est pas par hasard si elle constitue une cible privilégiée vers laquelle les idéologues bourgeois et opportunistes dirigent leurs armes, en cherchant à combattre le programme communiste.
Notre intention ici n'est pas de faire un historique exhaustif de la montée du révisionnisme, et des forces qui l'ont combattu, mais nous voudrions rappeler brièvement les origines et le contenu de ce combat, entamé à la fin du siècle dernier afin d'introduire les développements ultérieurs de cette étude qui porteront dans un premier temps sur les conséquences théoriques et méthodologiques des schémas de reproduction du livre II du Capital etc. Dans la mesure où la lutte- se déroulait entre tenants du développement harmonieux du capital et partisans de la crise catastrophique, il est normal que,. dans la tentative de fonder théoriquement les arguments réciproques, le contenu théorique du livre II, le problème des schémas, aient eu une grande importance. Le révisionnisme, en voulant concilier l’économie vulgaire et la théorie révolutionnaire, s'emparait par exemple des schémas (le livre II du Capital est publié en 1885) où il prétendait trouver, en en dénaturant complètement le sens et la fonction ce que l'économie hyper-vulgaire moderne appelle des "modèles d'équilibre". Nous nous attacherons à restaurer l’importance théorique et méthodologique des schémas du livre II. En attendant ces développements à venir, dans les numéros ultérieurs, rappelons quelle a été la position de toujours des communistes sur la question des crises et de leur rôle dans l'émergence révolutionnaire du communisme.
Dès son émergence (1847), la théorie révolutionnaire affirme que les bases matérielles du communisme sont présentes au sein du mode de production capitaliste, lorsque l'Angleterre est pleinement entrée dans la phase de soumission réelle du travail au capital. Le MPC possède donc dès cette époque sa physionomie propre, et connaît le mouvement cyclique caractéristique de la phase dans laquelle il est entré et dont les premières manifestations se rencontrent en 1826 et 1837 en Angleterre (nous donnons les dates des points les plus bas du cycle).
Ainsi Engels écrit-il dès 1847 :
"Le communisme est le produit de la grande industrie et de ses conséquences, de l'édification du marché mondial, de la concurrence sans entrave qui lui correspond, des crises commerciales toujours plus puissantes et universelles, qui sont déjà devenues de parfaites crises du marché mondial, de la création du prolétariat et de la concentration du capital, de la lutte entre prolétariat et bourgeoisie qui en découle," (Engels. Les communistes et Karl Heinzen. 1847 soul. p. nous)
De même le "Manifeste" décrivait ainsi le mouvement des crises :
"Depuis des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est autre que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production, contre le régime de propriété qui conditionnent l'existence de la bourgeoisie et sa domination. Il suffit d'évoquer les crises commerciales qui, par leur périodicité menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives déjà existantes." (Manifeste p.26)
Le cours capitaliste se présente ainsi : succession de périodes historiques au cours desquelles s'effectue le retour périodique de crises générales intermédiaires; achèvement de cette période historique dans une crise générale catastrophique qui ouvre ou non une vague révolutionnaire; si celle ci n'arrive cas (ex. 1939) ou si la révolution est défaite (ex. 1848, 1871, 1928), s'ouvre une phase d'expansion du capital qui trouve dans la crise même les moyens de sa régénération. De nouveau on aura alors une succession de crises générales intermédiaires, et au terme d'un certain nombre de cycles le retour de la crise catastrophique.
"Dès lors, coïncidant avec le plus haut développement des forces productives et la plus large expansion des richesses existantes commencera la dépréciation du capital, la dégradation du travailleur et l'épuisement de ses forces vitales. Ces contradictions conduisent à des explosions, à des cataclysmes, à des crises, où l'arrêt temporaire de tout travail et l'anéantissement d'une grande partie du capital ramèneront brutalement celui-ci à un point où il sera capable de recréer ses forces productives sans commettre un suicide. Mais parce que ces catastrophes reviennent régulièrement et se produisent chaque fois sur une plus grande échelle, elles aboutiront en fin de compte au renversement violent du capital."
(Marx. Grundrisse. Pléiade t.2 p.273)
C'est cette thèse fondamentale, base vitale pour la prévision révolutionnaire du communisme, qui sera mise en cause, au sein même du mouvement ouvrier par le courant révisionniste. Comme le faisait remarquer Lénine, dans un premier temps la théorie révolutionnaire avait eu à combattre des courants foncièrement hostiles, qui lui étaient extérieurs.
"De 1840 à 1845, Marx et Engels règlent leur compte aux Jeunes hégéliens radicaux, qui s'en tenaient en philosophie à l'idéalisme. Vers la fin de la décade 1840-1850, la lutte s'engage dans le domaine des doctrines économiques contre le proudhonisme. Les années 1850-1860 achèvent cette lutte : critique des partis et des doctrines qui se manifestent pendant la tourmente de 1848. De 1860 à 1870, la lutte passe du domaine de la théorie générale dans un domaine plus proche du mouvement ouvrier proprement dit : le bakouninisme est chassé de l'Internationale. Au début de la décade 1870-1880, en Allemagne, le proudhonien Mülhberger réussit quelque temps à se faire valoir ; vers 1880, c'est le tour du positiviste Dühring. Mais cette fois l'influence que l'un et l'autre exercent sur le prolétariat est tout à fait insignifiante. Dès lors le marxisme l'emporte indéniablement sur toutes les autres idéologies du mouvement ouvrier."
(Lénine . Marxisme et Révisionnisme. 1908)
Le triomphe théorique sur ces mouvements était définitivement établi à la fin du siècle, lorsque surgit le révisionnisme, mais par contre il fallait désormais défendre la théorie révolutionnaire contre les tendances qui cherchaient à la remettre en cause, au sein du communisme lui-même. Au départ le révisionnisme est un opportunisme ce dernier constituant à substituer à la perspective révolutionnaire une vision non dialectique du cours historique, incapable d'intégrer les situations contingentes, et de maintenir l'unité du but et du mouvement.
« Si l'on fait abstraction du bakouninisme dans la Première Internationale (1867-1871) et du sorélisme dans la Seconde (1907-1914), que nous considérons comme des mouvements étrangers au marxisme, une première vague de l'opportunisme au sein du mouvement prolétarien marxiste est représentée par le révisionnisme social-démocrate. Sa vision était la suivante : la victoire de la bourgeoisie étant partout assurée, une phase historique sans insurrection et sans guerre s'ouvre; sur la base de l’extension de l'industrie, de l'augmentation du nombre des travailleurs et du suffrage universel, le socialisme devient possible par évolution graduelle et sans violence. On tente ainsi (Bernstein) de vider le marxisme de son contenu révolutionnaire en prétendant que celui-ci n'appartiendrait pas en propre à la classe ouvrière, mais serait un reflet de mauvais aloi de la période insurrectionnelle bourgeoise. Dans cette période, la question tactique de l'alliance entre partis bourgeois avancés ou de gauche, et partis prolétariens, revêt un aspect différent il ne s'agit plus d'aider le capitalisme à naître, mais d'en faire dériver le socialisme à l’aide de lois et de réformes; il ne s'agit plus de se battre ensemble dans les villes et les campagnes, mais de voter ensemble dans les assemblées parlementaires. Cette proposition de former des alliances et des blocs allant jusqu'à l'acceptation de postes de ministres par des chefs ouvriers, revêt le caractère historique d'un abandon, de la voie révolutionnaire : c'est pourquoi les marxistes radicaux condamnent tout bloc électoral. » (Thèses caractéristiques du parti. 1951)
Le révisionnisme ne surgit pas par hasard, mais se greffe sur une longue série de tendances opportunistes qui se manifestent très tôt au sein du mouvement ouvrier et contre lesquelles Marx et Engels, puis Engels seul après 1883, en tant que représentants du socialisme international, luttèrent toujours avec la plus grande énergie possible, Par exemple, en 1875, lors de la rédaction d'un programme commun au Parti Social-Démocrate des Travailleurs (fondé à Eisenach en 1869 ) et à l'Association Générale Allemande des Travailleurs (fondée en 1864 par Lassalle), alors en pleine crise, les dirigeants sociaux-démocrates (Bebel, Liebknecht), se laissèrent aller à des concessions éhontées aux thèses lassalliennes afin d'aboutir à une fusion des deux organisations.
Après la mort de Marx, en 1883, Engels eut à nouveau à s'opposer à l'opportunisme croissant au sein du mouvement socialiste en général et allemand en particulier. (Cf. par exemple "La question paysanne en France et en Allemagne", où Engels fustige les socialistes français ). Il y a une filiation évidente entre cette tradition diffuse - dont nous montrerons brièvement les racines dans la réalité matérielle - et le révisionnisme des années 1880. A partir de ce moment, ce qui n'était qu'une tendance latente se cristallise, reçoit une expression théorique[26] adéquate, et s'incarne dans une école de pensée dont les principaux représentants sont Bernstein, Conrad Schmidt, Strouvé et Tugan-Baranovsky. Ce révisionnisme s'autonomise alors en tant que théorie spécifique, au sein de la Deuxième Internationale. Il s'agit d'une remise en cause totale des présupposés théoriques du communisme dans la mesure où, comme le faisait remarquer Rosa Luxemburg, le programme communiste constitue une totalité organique dont on ne peut pas nier une partie sans en remettre en cause le Tout.
"Nous l'avons vu : l'opportunisme n'est pas en mesure de construire une théorie positive qui résiste, si peu que ce soit, à la critique. Il n'est capable que de s'attaquer d'abord à certains principes isolés de la doctrine marxiste mais comme cette doctrine constitue un édifice solidement assemblé, il finit par abattre le système tout entier, du dernier étage aux fondations. Ce qui prouve que l'opportunisme pratique est incompatible, par sa nature et ses fondements, avec le système marxiste." (Réforme ou Révolution, p.86)
Les bases matérielles de ce révisionnisme (comme de l'opportunisme en général), sont fournies par l'expansion du capital et la consolidation de la phase de soumission réelle en Europe. Dans la dernière partie du 19è siècle, le capital connaît une période de prospérité durant laquelle les crises paraissent s'estomper[27]. Le cours du capital parait s'être stabilisé, et l'échéance révolutionnaire semble ajournée. (Mais comme toujours l'essor du MPC aggrave les conditions d'exploitation du prolétariat). Si le révisionnisme est un mouvement qui affecte le socialisme international, c'est en Allemagne qu'il trouve s'abord ses principaux théoriciens. Cela s'explique d'un côté par la tradition "théoricienne" classiquement dévolue à cette fraction du prolétariat qui a fourni, avant le prolétariat russe, tous ses grands chefs au mouvement communiste, et d'un autre côté par l'importance du parti allemand dans le mouvement international. Il est important de souligner que l'assaut révisionniste émanait de membres importants du parti, lesquels étaient considérés par Engels lui-même comme aptes à assurer la relève des chefs de ce mouvement. Toutefois, il ne s’agit pas là d'une maladie "allemande", et bien au contraire, c'est dans le centre impérialiste le plus développé à l'époque, c'est-à-dire l'Angleterre qu’il trouve son origine. Bernstein, à la suite des persécutions de Bismarck, a d’ailleurs vécu, à partir de 1888, à Londres, où il a subi l'influence des Fabiens anglais qui voyaient dans le suffrage universel et la démocratie la preuve palpable de la possibilité de parvenir au socialisme grâce à des méthodes de temporisation (le terme "Fabien" vient d'ailleurs du nom d'un homme d'Etat Romain –3è siècle av. J.C.- Fabius Maximus Verrucosus. dit Cunctator. c'est-à-dire le temporisateur), faisant l'économie de la lutte révolutionnaire du prolétariat. Engels disait d'eux qu'ils étaient une clique de chevaliers d'industrie cherchant à corrompre les ouvriers et à exercer sur eux une influence contre-révolutionnaire. Aussi Bernstein verra-t-il la réalité à travers les "lunettes anglaises" (cf. Rosa Luxemburg).
A partir de 1870, l'unité allemande est réalisée et l'Allemagne devient une puissance impérialiste, tout comme l'Angleterre et la France. Aussi, dans un premier temps, le bouleversement des structures économiques de l'Allemagne amenait un fort développement du mouvement ouvrier, capable de faire pièce aux tendances opportunistes des éléments intellectuels, empêtrés dans les visions mesquines et philistines traditionnellement propres à l'Allemagne arriérée, et qui ralliaient la social-démocratie.
"Les petites conditions font les mesquines conceptions, et il faut beaucoup d'intelligence et d'énergie à celui qui vit en Allemagne pour être capable de voir au-delà du cercle tout à fait immédiat et ne pas perdre de vue l'enchaîneraient général des événements historiques. Rien n'est plus aisé que d'y tomber dans "l'objectivité" de ceux qui sont satisfaits et ne voient pas plus loin que le bout de leur nez autrement dit le subjectivisme le plus borné qui soit, même s'il est partagé par des milliers d'individus semblables."
(Engels à Bernstein. Lettre du 25/1/1882)
Mais, en même temps, le bouleversement constant des conditions d'existence du prolétariat, favorisait chez les masses ouvrières une conscience aiguë du développement historique et de leurs tâches de classe. Dans le passage suivant, Engels montre comment des conditions historiques où le capital est encore en train de se frayer un chemin pour balayer les derniers obstacles à l'établissement définitif de sa domination réelle sur la société, favorisent la conscience et l'organisation du prolétariat, alors que les conditions d'un capital pleinement parvenu à maturité, et dont le mouvement apparaît aux exploités comme un cycle naturel avec ses périodes de prospérité et de stagnation, peuvent paralyser temporairement l'émergence révolutionnaire du prolétariat. Dans ce cas, la compréhension théorique des événements est d'autant plus entravée que le capital est stable et prospère, et ce n'est que dans les périodes de crise générale, où les bases de la mystification sont ébranlées qu'on peut avoir une reprise de la lutte des classes.
« Je ne me suis jamais trompé sur nos masses prolétariennes. Leur mouvement ferme, confiant dans la victoire, plein d'allant et d'esprit, est exemplaire et sans reproche. Nul prolétariat européen n'aurait subi aussi brillamment l'épreuve de la loi anti-socialiste et répondu à la répression qui dure six ans déjà par une telle démonstration de sa puissance croissante et de son renforcement organisatif; il n'est pas un prolétariat qui eût pu créer l'organisation qu'il a su mettre sur pieds, sans ce bluff propre aux conspirations. (…)
Nous avons le grand avantage que la révolution industrielle batte toujours son plein, alors qu'elle est déjà terminée pour l'essentiel en France et en Angleterre : la division en ville et campagne, en région industrielle et en district agricole est déjà parvenue au point où les changements seront désormais minimes. Depuis leur enfance, les larges masses y vivent dans des rapports qui continueront d'être les leurs par la suite : ils s'y sont faits, même les fluctuations et les crises sont devenues pour elles quelque chose allant pour ainsi dire de soi. Il y a, en outre, le souvenir des tentatives de soulèvement du passé, et leur échec. Chez nous, en revanche, tout bouge encore. Les vestiges de la production paysanne traditionnelle satisfaisant ses propres besoins en produits industriels sont évincés dans certaines régions par l'industrie domestique capitaliste, alors que dans d'autres cette dernière est déjà supplantée par le machinisme en plein essor. Et c'est précisément la nature même de notre industrie, née bonne dernière qui se traîne encore loin derrière celle des autres, qui exige un bouleversement social aussi radical en Allemagne. » (Engels à Bebel. Lettre du 11/12/1884)
Par conséquent, c'est chez les prolétaires, vivant dans des conditions modernes, que s'incarnait l'esprit révolutionnaire que les membres de l'appareil du parti allemand, bornés par leur philistinisme étroit, et corrompus par les avantages du parlementarisme, étaient prompts à laisser de coté. D'où la nécessité, constamment mise en avant par Engels, dans ses directives aux chefs de la social-démocratie, d'opposer et de s'appuyer sur l'esprit révolutionnaire des "masses" face .aux compromissions des "chefs". Engels insistait notamment sur la nécessité de confier les postes-clés du parti à des prolétaires et non à des intellectuels ou petits-bourgeois ralliés depuis peu.
Avant de voir comment les "masses" elles-mêmes peuvent être corrompues et fournir donc, dialectiquement, une base aux tendances opportunistes de leurs dirigeants, il importe d'ajouter une précision expliquant l'afflux d'éléments petits-bourgeois, intellectuels libéraux etc. dans le parti social-démocrate allemand.
De 1878 à 1890 le prolétariat allemand vécut sous le joug draconien des lois anti-socialistes imposées par Bismarck. L'emprisonnement, l'exil, punissaient les révolutionnaires. Pourtant, le parti se renforçait grâce à une puissante organisation illégale, qui lui permettait d'entretenir une presse clandestine. Face à l'absolutisme de Bismarck et compte tenu de la veulerie et de la lâcheté historiques propres à la bourgeoisie allemande, le parti ouvrier apparaissait comme le seul parti d'opposition digne de ce nom, drainant vers lui tous ceux qui désiraient s'opposer à Bismarck. Les tâches d'opposition bourgeoise, que la bourgeoisie elle-même était incapable de mener à bien, c'était donc au parti ouvrier à les assurer. C'est pourquoi Engels escomptait qu'avec la levée des lois anti-socialistes, l'opposition bourgeoise pourrait se cristalliser et se révéler aux yeux du prolétariat, contribuant ainsi en retour à radicaliser le parti et à épurer celui-ci. En attendant, en l'absence de la possibilité de tout débat public, compte tenu des lois anti-socialistes, il fallait se méfier comme de la peste de tous ces éléments petits-bourgeois, intellectuels, étudiants, etc. qui venaient former les cadres du parti, et que les chefs de la social-démocratie, notamment Liebknecht flattaient à qui mieux mieux. S'il est un phénomène, d'ailleurs, dont le prolétariat a déjà vécu la dure expérience au cours des dizaines d'années de lutte qu’il a mené contre la société bourgeoise, c'est qu'avec le succès arrivent vers le parti tout un tas d'éléments douteux, plus ou moins brûlés dans la société officielle, plus ou moins déclassés, plus ou moins sincères, et qui viennent voir là les possibilités de redorer leur blason. L'internationale Communiste eut également à souffrir de ce genre de "popularité" dont on se passe fort bien. La règle d'or en pareil cas, est de dresser les barrières les plus rigides à la venue de ces gens dans le parti et tout particulièrement leur accession à des responsabilités. C'est seulement en imposant une discipline de fer rigoureusement déterminée par le centralisme organique, qu'un parti communiste pourra mettre ces éléments hors d'état de nuire, soit en les décourageant, soit en les assimilant en exigeant leur soumission inconditionnelle au programme, à la tactique et à la discipline communistes.
Tant que durèrent les lois anti-socialistes (jusqu'à 1890), et malgré l'assurance et l'arrogance des éléments petits-bourgeois opportunistes au sein du parti, Engels déconseillait l'initiative d'une scission, que l'on n’aurait pas pu expliquer publiquement. Il fallait laisser ces éléments se déconsidérer aux yeux des prolétaires et s'arranger pour qu'ils se mettent eux-mêmes en dehors du parti, sans possibilité d'en récupérer les organes, surtout la presse. C'est en effet un principe vital du mouvement communiste de ne jamais laisser tomber ses armes aux mains de l'ennemi. Lorsqu'il y a défaite, tout l'art stratégique et tactique, consiste à se replier en bon ordre. Du vivant de Marx et Engels[28], ce principe put être appliqué victorieusement, avec, par exemple, la dissolution de la Ligue des Communistes ou le transfert du Conseil Général de l’AIT à New-York. Ainsi, la première Internationale n'est pas tombée aux mains des anarchistes. Si l'évolution de la lutte des classes rendait inévitable la dissolution du parti formel du prolétariat, il fallait éviter que ses dépouilles ne tombent aux mains de l'ennemi qui aurait pu s’en revêtir et semer ainsi la confusion dans les rangs du prolétariat. Par contre, et ceci ne fit qu'accentuer la profondeur et l'amertume des défaites suivantes que connut le prolétariat, ni la 2nde Internationale, ni la 3ème ne purent être préservées de la fin ignominieuse qui consistait à être investies par l'ennemi de classe pour être transformées en organes de la contre-révolution. En 1914, le parti du prolétariat tomba aux mains du social-chauvinisme et du social-patriotisme. De même, à partir de 1928, l’IC et tous les partis communistes devinrent parmi les principaux organes de la contre-révolution, faisant peser sur le prolétariat, battu et démoralisé, le poids supplémentaire de la contre-révolution.
Pour en revenir à l'Allemagne des années post-1870, si le bouleversement constant des conditions de la production dues à l'expansion du capital favorisait l'émergence d'un fort mouvement prolétarien, la stabilisation du MPC fournissait dans le même temps des bases pour l'intégration et la corruption de ce mouvement. Face à la montée du mouvement prolétarien, à l'époque des lois anti-socialistes, Bismarck alternait la carotte et le bâton, les reformes sociales et la répression. C'est ainsi que le rapide développement du MPC et de la classe ouvrière permettait de favoriser l'intégration de cette dernière et, donc, l'apparition des mêmes tendances qu’en Angleterre, et, dans une moindre mesure, qu'en France. Etant donné le développement de la phase de soumission réelle du travail au capital, les possibilités matérielles d'attacher la classe ouvrière au char de la bourgeoisie se trouvaient largement accrues. Le maintien et l'amélioration du standard de vie de la classe ouvrière dans les périodes de prospérité favorisent les théorisations révisionnistes et social-impérialistes qui pensent que la classe ouvrière doit soutenir la politique coloniale à condition d'en obtenir quelques avantages.
Lénine, qui faisait de l'octroi des miettes du festin impérialiste la principale cause de l'existence d'une aristocratie ouvrière pensait qu'avec l’émergence d'autres nations impérialistes au côté de l’Angleterre, les surprofits obtenus autrefois par elle seule devraient désormais être partagés entre plusieurs métropoles impérialistes. Ainsi les bases du réformisme s'amenuiseraient et deviendraient précaires, dans la mesure même où le monopole de l'Angleterre sur le marché mondial s'affaiblirait.
En fait, Lénine sous-estimait gravement les puissantes réserves dont pouvait désormais disposer le MPC sur la base de son propre développement "interne" ; c'est-à-dire du passage à la phase de soumission réelle. Or, non seulement les causes "classiques" de l'aristocratie ouvrière, c'est-à-dire la corruption grâce à la redistribution d'une partie de la plus-value obtenue par les centres impérialistes par l'exploitation d'autres nations, ne disparaissaient pas, mais encore il s’ajoutait d'autres facteurs, qui résultaient du propre développement des forces productives de la nation. Grâce au gigantesque développement de la productivité et de l'intensité du travail, le capital de chaque nation pouvait accroître son contrôle sur sa propre classe ouvrière et intéresser celle-ci au développement capitaliste.
Le phénomène de l'intégration de la classe ouvrière, de la création de chaînes dorées dans les périodes d'expansion, de la formation d'une aristocratie ouvrière revêt donc une ampleur d'autant plus grande que la nation capitaliste connaît un fort développement. S'il est vrai que la possibilité du développement de la phase de soumission réelle dans de nouvelles nations ou aires renforce et aggrave les antagonismes entre nations, cela n'atténue pas, bien au contraire, la capacité de la société bourgeoise à s'assurer l'appui du prolétariat. Pour le capital, cela devenait même une question de vie ou de mort : il faut, de toutes façons, que la classe ouvrière marche d'un même pas derrière sa bourgeoisie. Mais désormais, le capital dispose de capacités accrues dans son entreprise de corruption, et de plus grandes forces capables d'influencer idéologiquement le prolétariat.
En considérant, premièrement, que les bases économiques du révisionnisme étaient devenues plus précaires et, deuxièmement, qu'il n'affectait plus qu'une partie de la classe ouvrière, Lénine sous-estimait la force du révisionnisme et cette erreur l'amena à défendre une stratégie beaucoup trop souple vis-à-vis du réformisme au cours de la dernière vague révolutionnaire. La délimitation par rapport au réformisme aurait dû être beaucoup plus tranchée, alors qu'on eut des tactiques comme celle du front unique.. voire même de fusion avec les partis réformistes (entrée dans le Labour Party en Angleterre)[29]; De même la tactique vis-à-vis du parlementarisme dans les pays avances n'était pas assez tranchée. Si le révisionnisme, le social-chauvinisme, étaient mis au pilori en théorie, la cassure dans la pratique était beaucoup moins nette. En sous-estimant leur emprise, on se privait de la possibilité de mettre en place une tactique adéquate contre les "partis ouvriers bourgeois". Il ne suffisait pas d’un petit coup d'épaule habilement donné pour renverser le cours historique mais il fallait une préparation beaucoup plus stricte à l'assaut révolutionnaire.
Le révisionnisme surgit donc à une époque où le mouvement ouvrier est puissant. Mais, porté par le développement du capital, ce mouvement avait à souffrir des capacités accrues du capital à l'enrayer, à le canaliser par des réformes, etc. Cette puissance ne l'empêche donc pas d'offrir de multiples points faibles à partir desquels peut se faire l'intégration à la société bourgeoise, de souffrir de nombreuses tares pacifistes, légalistes, démocrates. Le révisionnisme s'appuie à la fois sur cette puissance et sur ces tares, qu'il théorise en déclarant que désormais le mouvement est devenu assez fort pour obtenir le socialisme de manière pacifique par le biais de réformes. L'important, dès lors, n'est plus la préparation révolutionnaire, mais l'obtention et la conservation de réformes qui sont autant d'éléments socialistes arrachés graduellement au capital. Ainsi aux tendances au réformisme pratique au sein du parti ouvrier, répond la théorie révisionniste : le mouvement est tout, le but n'est rien.
"Je l'avoue ouvertement : j'éprouve pour ce que l'on a coutume d'appeler "but final du socialisme", extrêmement peu de sympathie et d'intérêt. Ce but quel qu'il soit ne signifie rien à mes yeux, le mouvement est tout pour moi. Et par mouvement j'entends aussi bien le mouvement général de la société ? c'est-à-dire le progrès social, que l'agitation politique et économique ainsi que l'organisation en vue d'obtenir ce progrès." (Bernstein)
A partir de tous ces éléments pratiques, Bernstein se livre à la révision totale des principes communistes. Sur le plan philosophique on a un retour à Kant, visant à réhabiliter le facteur moral, éthique dans le combat de la classe ouvrière pour son émancipation et à compenser ainsi la sécheresse du "déterminisme économique" auquel on a, comme d'habitude réduit la théorie communiste avant d'en faire la critique.
Sur le plan politique, le révisionnisme entérine la mystification démocratique et se livre à l'apologie de l'Etat.
"La démocratie est la suppression de la domination de classe, bien qu'elle ne signifie pas encore la suppression de fait des classes," (Bernstein. Les présupposés du socialisme.)
Selon Bernstein, l'Etat n'est plus un pur et simple organe de la classe dominante. Il devient de plus en plus l'Etat de la majorité. C'est donc un instrument indispensable, bien qu'il faille se garder de l'hypertrophie bureaucratique.
Dans un article de 1908. intitulé "Marxisme et Révisionnisme", Lénine résumait ainsi l'argumentation de Bernstein :
"En matière d'économie politique, notons avant tout que les "rectifications" apportées par les révisionnistes furent beaucoup plus variées et circonstanciées; on s'efforça d'agir sur le public par les "récentes données du développement économique". On prétendit que la concentration de la production et l’évincement de la petite production par la grande ne s'observaient pas du tout dans l’agriculture et que dans le commerce et l'industrie, ils ne s'effectuaient qu'avec une extrême lenteur. On prétendit que les crises se faisaient plus rares aujourd'hui, plus faibles, et que vraisemblablement les cartels et les trusts permettraient au capital de les supprimer tout à fait. On prétendit que la "théorie de l'effondrement" vers laquelle s'acheminait le capitalisme était inconsistante, les antagonismes de classe ont tendance à s'émousser, à s'atténuer. On prétendit enfin qu’il serait bon de corriger aussi la théorie de la valeur de Marx d'après Böhm-Bawerk."
Bernstein se rattachait ainsi à l'économie vulgaire qui prétend substituer à la théorie communiste de la valeur fondée sur le temps de travail social, celle, subjective, de la valeur utilité. Cette théorie est tournée directement et de manière avouée contre le mouvement communiste. Ce n'est donc pas par hasard si elle surgit à partir de 1870, dans les pays où le prolétariat avait fourni les sources théoriques du communisme. Ses principaux théoriciens sont : Jevons pour l’Angleterre, Walras pour la France, et l'Autrichien Menger pour l’Allemagne.
En ce qui concerne la théorie des crises, Bernstein prétendait que le MPC avait su se créer des organes d'adaptation qui rendaient le retour des crises improbables. En tous cas, la perspective d'une crise catastrophique était désormais caduque. Selon lui, les éléments ayant permis au capital de compenser ses perturbations" (sic !) étaient :
-"énorme extension territoriale du marché international"
-"réduction du temps nécessaire aux communications et au transport"
En outre, l’effet de ces "perturbations" était soi-disant considérablement atténué par l’:
-"énorme accroissement de la richesse des états industriels"
-"élasticité du crédit moderne"
-"institution des cartels industriels." (Les présupposés du socialisme, p. 123)
"Des dépressions locales et partielles sont inéluctables, mais l'arrêt général -étant donnés l'organisation et l'extension actuelles du marché international et notamment l'énorme essor de la production des vivres- ne l'est pas. Ce dernier fait est de la plus haute importance. Rien peut-être n'a contribué autant à l'atténuation des crises économiques ou a empêché leur développement comme la baisse de la rente et celle du prix des vivres. » (id. p.144)
On peut voir, avec ce dernier argument, combien les mécanismes propres à la phase de soumission réelle du travail au capital sous-tendent la conception révisionniste. S'il est vrai qu'avec cette phase le capital a la possibilité de faire baisser la valeur de la force de travail, en abaissant la valeur des marchandises qui entrent dans la reproduction de la force de travail et qu'ainsi le capital peut accroître la plus-value relative, il s'agit là justement d'un aspect de la contradiction valorisation/dévalorisation. Bernstein ne réussit nulle part -et pour cause- à montrer que cette contradiction aurait disparue.
C'est d'ailleurs du même phénomène - la possibilité d'abaisser le salaire relatif- que Bernstein tire une autre thèse, démentant selon lui les prévisions communistes, et selon laquelle il n'y aurait pas de "misère croissante" ou "paupérisation absolue", étant donné que le sort des ouvriers s'améliore graduellement. Or, comme nous l’avons montré dans le N°7, s'il est possible de dire, dans la phase de soumission formelle, que la tendance est à la "paupérisation absolue", dans la phase de soumission réelle, il est juste de montrer qu'il y a tendance à la paupérisation "relative" : le capital pouvant accroître le salaire réel, tout en accroissant terriblement l'exploitation du prolétariat.
Avec sa négation de la théorie des crises, Bernstein pose les bases théoriques d'une politique de collaboration de classes qui s'achèvera dans les massacres du prolétariat par la social-démocratie en 1919. Selon Bernstein, le capital ne se régénère plus au travers de destructions nécessaires à sa survie, mais au contraire il se développe selon un cours harmonieux et continu, sans crises. Le capital développe donc sans limites les forces productives et les bases du socialisme, mais il sape ainsi la nécessité d'une révolution violente, dont les conséquences seraient préjudiciables à la force productive de l'espèce humaine. La classe ouvrière ne recevrait plus en héritage une machine productive intacte qu'elle pourrait faire fonctionner pour son propre compte, comme le souhaitent les réformistes, mais une machine endommagée, d'où un préjudice et une régression historiques. Ainsi, l'évolution même du capitalisme aurait rendu la révolution non seulement impossible, mais encore non souhaitable.
Bernstein abstrait ainsi les forces productives des rapports de production, en niant que ces derniers doivent être détruits. Le révisionnisme nie ainsi toute dialectique[30] de l'histoire selon laquelle la rupture révolutionnaire doit s'opérer au plus haut niveau de développement des forces productives, afin de libérer celles-ci du cancan des rapports de production.
Nous avons donc vu que, lié au développement de la phase de soumission réelle du travail au capital, le révisionnisme apparaît d'abord dans l'aire capitaliste la plus développée (Angleterre), avant de dériver vers l'Allemagne où il reçoit une formulation théorique adéquate. Le phénomène dérive en outre vers la Russie, où il vient se greffer sur un débat théorique intense, antérieur de plusieurs années et qui avait pour enjeu : quel est l'avenir du MPC en Russie ? et donc, quelle stratégie révolutionnaire pour cette aire là ? On constate que parmi ceux qui luttaient contre les populistes et cherchaient à démontrer l'inévitabilité du MPC en Russie, en l'absence d'une révolution en Occident, tous, sauf Lénine, ont conclu par la suite de cette inévitabilité à un cours harmonieux du capital. Il n'y a que Lénine qui fut capable d'individualiser le cours capitaliste suivi par la Russie sans se faire l'apologiste et le défenseur de celui-ci.
« Le point de départ de la discussion était le capitalisme russe et ses perspectives d'avenir, mais le débat s'étendit par la suite naturellement aux problèmes généraux de l'évolution du capitalisme, l'exemple et les expériences de l'Occident jouant un rôle éminent dans l'argumentation. Un fait était d'une importance décisive pour le contenu théorique de la discussion qui suivit : non seulement l'analyse de la production capitaliste par Marx telle qu'elle est exposée dans le premier livre du Capital était déjà un bien commun des milieux cultivés de la Russie, mais le livre deuxième, avec l'analyse de la reproduction du capital total, avait été publié également en 1885. Le caractère de la discussion s'en trouva profondément transformé. Le problème des crises ne masquait plus comme autrefois le cœur du débat. Pour la première fois, le problème de la reproduction du capital total, de l'accumulation, apparaissait dans sa pureté, au centre de la controverse. En même temps l'analyse ne tâtonnait plus maladroitement autour des notions de revenu et de capital, de capital individuel et de capital total. A présent, le schéma marxien de la reproduction sociale offrait une base solide (...)
… une nouvelle génération de marxistes russes (...) nantis de l'expérience historique et nourris de la science occidentale, entrèrent en lice aux cotés de Georges Plekhanov : le professeur Kablukow, le professeur Manuilov, le professeur Issaiev, le professeur Skoworzov, Vladimir Iliyne (Lénine), Pierre de Struve, Boulgakov, le professeur Tugan-Baranovsky et d'autres encore. Nous nous limiterons, dans ce qui suit, principalement aux trois derniers, car chacun d'eux a donné une critique plus ou moins complète de cette théorie dans le domaine qui nous occupe ici. Ce tournoi souvent brillant, qui passionnait les intellectuels socialistes russes dans les années 1890 et se termina par un triomphe incontesté de l'école marxiste, a inauguré officiellement l'entrée en scène du marxisme en tant que théorie historique et économique dans la science russe. Le marxisme "légal" prit officiellement possession des chaires d'université, des revues et du marché du livre économique en Russie. Lorsque dix ans plus tard le soulèvement révolutionnaire du prolétariat fit apparaître le revers de cet optimisme quant aux possibilités de soulèvement révolutionnaire du prolétariat, pas un seul membre de cette pléiade d'optimistes marxistes - à l'exception d'un seul - ne se retrouvait dans le camp du prolétariat. »
(Rosa Luxemburg. L'accumulation du capital. Petite collection Maspero T.1, p.232-233)
Si l'ouvrage de Bernstein constituait la première tentative pour fonder théoriquement la pratique révisionniste, les fondements théoriques pour une justification "économique" - à partir de Marx - des conclusions bernsteiniennes, c'est-à-dire les perspectives d'un cours harmonieux du capital, furent donnés par Tugan-Baranovsky. Il fut d'ailleurs un des premiers à vouloir concilier la théorie de l'utilité marginale avec la théorie de la valeur de Marx. En outre, il est à l'origine de la plupart des interprétations ricardiennes de Marx.
3.2 Les réactions.
"Les révisionnistes soutenaient que dans la nouvelle situation de l'Europe et du monde capitaliste, la lutte insurrectionnelle l'emploi de la violence armée, la conquête révolutionnaire du pouvoir politique, étaient inutiles, et ils écartèrent complètement la thèse centrale de Marx : la dictature du prolétariat.
A la place de cette "vision catastrophique" ils mirent l’action légale et électorale, l'action législative et parlementaire et on alla jusqu'à voir des élus socialistes participer aux ministères bourgeois (possibilisme, millerandisme) afin de promulguer des lois socialistes favorables au prolétariat. Pourtant les congrès internationaux d'avant la première guerre mondiale avaient toujours condamné cette tactique et déjà à cette époque les collaborationnistes à la Bonomi avaient été expulsés du parti, mais non les Bernstein ou, en Italie, les Turati. Une vague de défiance à l'égard de la forme du parti politique qui donnait beau jeu aux critiques anti-marxistes et anarchistes succéda à cette dégénérescence non seulement de la doctrine mais de la politique des partis socialistes, sur laquelle nous ne pouvons pas nous étendre plus longtemps ici. Dans un premier moment, seuls des courants moins importants numériquement se placèrent sur le terrain de la lutte contre le révisionnisme pour la défense de la doctrine originelle du marxisme (radicaux en Allemagne, révolutionnaires intransigeants en Italie et ailleurs, "durs", "étroits", "orthodoxes" etc.)" (Programme Communiste. N°1- 1956)
Face à l'offensive révisionniste, les réactions au sein de la social démocratie ne furent donc pas toutes aptes à mener l'attaque sur le terrain d'un véritable retour à Marx et d'une pleine restauration de la théorie des crises. Kautsky par exemple, représentant du centre orthodoxe, tout en essayant de démontrer face a Bernstein que le cours historique suivi par le capital était bien tel que la théorie l'avait prévu : concentration croissante, y compris dans l'agriculture, etc. ne parvint jamais à remettre le prolétariat sur les rails d'une perspective orthodoxe et révolutionnaire. C'est surtout de la gauche (Rosa Luxemburg, Lénine) qu'allait venir une véritable critique tendant à renouer avec la perspective de Marx sur les crises.
La critique de R. Luxemburg est importante à double titre. D'une part, parce qu’elle dépasse le cadre du révisionnisme bernsteinien pour critiquer le phénomène réformiste en général et lui opposer l'exigence révolutionnaire. D'autre part, en cherchant à approfondir les bases théoriques de sa démonstration, Rosa Luxemburg fournissait, avec son livre « L'accumulation du capital », une des contributions théoriques les plus importantes de ce siècle, au mouvement communiste.
Dans le prochain chapitre nous étudierons en détail le problème des schémas, et le débat relancé par les travaux de Luxemburg. Nous nous contentons ici, succinctement, de résumer les arguments qu'elle opposait à Bernstein.
Examinant les différents "facteurs d'adaptation" du capitalisme qui, selon Bernstein, permettaient à celui-ci de dépasser ses contradictions et de résorber ses crises, Rosa Luxemburg n'avait pas de mal à montrer que, dialectiquement, de tels facteurs ne pouvaient au contraire qu'amener le retour de crises encore plus graves et plus profondes. Le crédit, par exemple, en permettant par son élasticité une expansion de la production capitaliste accroît la sphère de la production qui se trouve touchée par la crise. De même, les cartels exacerbent la concurrence et les antagonismes entre groupes de capitalistes, au lieu de les aplanir. Tout en montrant que la concentration du capital avait effectivement lieu selon les prévisions de la théorie révolutionnaire, Rosa Luxemburg insistait sur le rôle joué par les petits capitaux, régulièrement détruits, mais régulièrement régénérés, dans l'établissement du profit moyen et dans la dynamique de l'accumulation capitaliste.
En ce qui concerne l'obtention de réformes par le biais des syndicats (thèse qui était surtout développée par Conrad Schmidt), Rosa Luxemburg, qui à l'époque avait bien perçu les limites et le processus d'intégration des syndicats, montrait l'impuissance de ceux-ci au cours de la phase de soumission réelle du travail au capital.
« Commençons par les syndicats : leur principale fonction - personne ne l'a mieux exposée que Bernstein lui-même en 1891 dans la Neue Zeit - consiste à permettre aux ouvriers de réaliser la loi capitaliste des salaires, c'est-à-dire la vente de la force de travail au prix conjoncturel du marché. Les syndicats servent le prolétariat en utilisant dans leur propre intérêt, à chaque instant, ces conjonctures du marché. Mais ces conjonctures elles-mêmes, c'est-à-dire d'une part la demande de force de travail déterminée par l'état de la production et d'autre part l'offre de force de travail créée par la prolétarisation des classes moyennes et la reproduction naturelle de la classe ouvrière, enfin le degré de productivité du travail sont situés en dehors de la sphère d'influence des syndicats. Aussi ces éléments ne peuvent-ils pas supprimer la loi des salaires. Ils peuvent, dans le meilleur des cas, maintenir l'exploitation capitaliste à l'intérieur des limites "normales" dictées à chaque instant par la conjoncture, mais ils sont absolument hors d'état de supprimer l'exploitation elle-même, même progressivement. (...) L'activité des syndicats se réduit donc essentiellement à la lutte pour l'augmentation des salaires et pour la réduction du temps de travail, elle cherche uniquement à avoir une influence régulatrice sur l'exploitation capitaliste en suivant les fluctuations du marché ; toute intervention sur le processus de production lui reste, par la nature même des choses, interdite (…) A ce stade, la lutte se réduit nécessairement de plus en plus à la simple défense des droits acquis, et même celle-ci devient de plus difficile. Telle est la tendance générale de l'évolution dont la contrepartie doit être le développement de la lutte de classe politique et sociale. » (Réforme ou Révolution. Maspero p.33-35)
Nous avons souligné l'importance de Tugan-Baranovsky dans l'affirmation théorique du révisionnisme. Dans "l’Accumulation du Capital", Luxemburg réduisait à néant son argumentation. De même critiquait-elle d'autres représentants "éminents" de la social-démocratie comme Strouvé, Boulgakov. Nous y reviendrons plus en détails par la suite. De son coté, Lénine menait le combat contre les mêmes adversaires. Après avoir affronté les populistes et leurs théories néo-sismondistes, il se retournait contre ceux qui, de la démonstration de l'inéluctabilité du capitalisme en Russie, en étaient arrivés à croire que ce développement serait éternel et harmonieux. En même temps, Lénine pourfendait tout le révisionnisme dans la question agraire en montrant que dans ce domaine là. la théorie révolutionnaire se trouvait intégralement confirmée. Avec la même violence que Rosa Luxemburg, il dénonçait le pacifisme et le social-chauvinisme du révisionnisme, tout en montrant que la théorie des crises de Marx n'avait rien perdu de sa validité.
Mais mieux qu'aucune démonstration théorique ne pouvait le faire le mouvement réel allait se charger de faire rentrer dans la gorge des opportunistes leurs déclarations sur le cours harmonieux du MPC. En 1914 éclate la plus terrible des "solutions" du capital à sa crise : la guerre mondiale, mettant aux prises sur les champs de bataille, des millions de prolétaires trahis et abandonnés par leur organisation de classe. 1914 marque donc la faillite et la trahison définitives de la IIème Internationale, mais démontre pratiquement la validité de la théorie communiste et la justesse des conceptions de Lénine, Luxemburg etc. quant à leur fond, sur le retour inévitable des crises et des révolutions[31]. 1917 allait à son tour confirmer brillamment la théorie communiste.
Cette confirmation globale, historique n'empêche pas qu'il fallait poursuivre le travail théorique afin de restaurer la théorie des crises d'une manière purement communiste. Cette tâche, la IIIème Internationale ne sut pas la mener à bien intégralement.
S'il fallait encore des faits pour démontrer la validité de la thèse communiste, il suffirait de citer la crise de 1929, celle de 1939 et la seconde boucherie impérialiste qui s'ensuivit. Mais cette fois-ci, le prolétariat qui avait subi la terrible défaite de 1928, écrasé, trompé, privé de tous ses organes de classe passés à l'ennemi, fut totalement incapable d'opposer sa solution historique, classiste et révolutionnaire, au massacre impérialiste.
C'est aussi le poids de cette défaite qui fait qu'aujourd'hui le travail théorique sur la nature des crises, le cycle du capital, etc. n'est que balbutiant. Seule la Gauche Communiste d'Italie avait entamé un travail, mais nous avons montré dans quelles conditions, et ce qu'il en est advenu.
Aujourd'hui le mouvement révolutionnaire, incapable d'aborder les questions de fond, se débat dans de lamentables confusions théoriques. Heureusement la crise (?) est là - pour certains depuis 1968 - ce qui leur épargne la tâche pénible d'avoir à démontrer théoriquement l’existence des crises, ou d'en prévoir le retour et d'en expliquer les causes. En bons empiristes et immédiatistes, il ne leur reste plus, une fois constatée l'existence des prémisses, qu'à passer à l'élaboration des conclusions, et à discuter afin de hâter le processus de "regroupement des révolutionnaires". Quant à faire autre chose que de remuer du vent et à entamer un véritable travail théorique de restauration sur ce problème, il ne saurait en être question.
Or, sans un tel travail, le mouvement communiste sera incapable de faire face au retour périodique des crises, incapable de prévoir celles-ci et donc de se lier à la révolution future.
Nous avons a plusieurs reprises dit que sur certains points, l’œuvre de Marx était inachevée. Elle est en friches, bien que tous les éléments existent pour l'achever, dans le droit fil des principes communistes, et dans l'esprit de totalité qui préside a toute oeuvre de restauration.
3.3 Rosa Luxemburg, chef du mouvement communiste international.
Lénine disait, au début de « L’Etat et la révolution » :
« Du vivant des grands révolutionnaires, les classes d’oppresseurs les récompensent par d’incessantes persécutions ; elles accueillent leur doctrine par la fureur la plus sauvage, par la haine la plus farouche, par les campagnes les plus forcenées de mensonges et de calomnies. Après leur mort, on essaie d’en faire des icônes inoffensives, de les canoniser pour ainsi dire, d’entourer leur nom d’une certaine auréole afin de « consoler » les classes opprimées et de les mystifier ; ce faisant, on vide leur doctrine révolutionnaire de son contenu, on l’avilit et on en émousse le tranchant révolutionnaire. C’est sur cette façon d’ « accommoder » le marxisme que se rejoignent aujourd’hui la bourgeoisie et les opportunistes du mouvement ouvrier. »
Mais une autre façon pour la bourgeoisie de combattre l’influence posthume des théoriciens du prolétariat, peut être de railler leurs travaux. Tel est parfois le cas de Rosa Luxemburg, certainement une des figures les plus méconnues du mouvement communiste.
De son oeuvre majeure : « L’accumulation du capital », on ne connaît bien souvent que la littérature critique, dont la grossièreté polémique ne peut qu’étonner celui pour qui la féconde plongée dans les « classiques » de la littérature communiste ne procède pas de la froide curiosité universitaire, mais bien du besoin vital de s’immerger dans la vie et dans l’histoire de la classe prolétarienne, aux sources même de la théorie révolutionnaire.
En effet, de la masse de critique qui ont été faites à « L’accumulation du capital », ressort surtout la condescendance des « marxistes » pour une oeuvre qui n’aurait fait qu’aborder les problèmes sans les comprendre.
Tel le chœur antique, le monde savant n’a qu’une seule voix pour insulter Rosa Luxemburg :
« La camarade Luxemburg a mal compris le caractère, le but et la signification des schémas de Marx » (Eckstein)
« ...ce simple fait démontre la stérilité de la critique Luxemburgiste, il devient évident qu’il s’agit d’une critique purement verbale et formelle qui ne repose sur aucune idée très profonde, et cela prouve que Rosa Luxemburg non seulement n’était pas capable d’opposer une démonstration positive de ses critiques au schéma de Marx, mais qu’elle n’entreprend pas de le faire une seule fois. » (Grossmann. La production de l’or dans les schémas de reproduction de Marx et de R. Luxemburg).
« Nous avons quelques difficultés à croire que Rosa Luxemburg fut incapable de lire convenablement les chiffres. La seule explication possible est qu’elle se contenta d’une lecture superficielle du tableau avant de foncer tête baissée contre son auteur. » (A. Emmanuel. Le profit et les crises, p. 186)
« Et voilà qu’elle (RL – Ndr) montre encore une fois son incapacité étonnante à lire correctement un schéma. » (idem)
« Il a été démontré depuis belle lurette que le « problème » auquel Rosa Luxemburg s’attaquait n’existait que dans son imagination. On peut ajouter que si un tel problème se posait réellement, la « solution proposée serait parfaitement impuissante à le résoudre ou même à l’atténuer » (Bulletin critique du cercle marxiste de Rouen).
Bref, à les en croire, Rosa Luxemburg n’était rien d’autre qu’une demeurée, incapable de faire une addition, rendue inapte à la compréhension des mathématiques par le défaut (hélas naturel chez elle) d’être une femme. Enfin c’est tout juste si nos critiques daigneraient faire figurer son oeuvre dans une bonne « bibliothèque marxiste ».
Et le militant communiste, avide de sources programmatiques dans lesquelles il aille puiser des forces pour repartir au combat, qu’en pense-t-il ? Car lui, contrairement aux savants de toutes sortes, connaît le personnage de Rosa Luxemburg. Il sait qu’elle a vécu et est morte pour l’émancipation du prolétariat et la révolution communiste. Qu’elle a lutté aux cotés de Lénine et des Gauches dans la seconde Internationale contre la dégénérescence opportuniste de celle-ci. Qu’elle a été un des principaux chefs du mouvement ouvrier allemand et international, à la tête duquel elle a menée une lutte exemplaire. Qu’elle a été assassinée, avec Karl Liebknecht par les chiens de la social-démocratie réformiste, ivres de haine contre-révolutionnaire, contre le prolétariat et ses chefs.
Évidemment, soixante ans après, dans la grisaille contre-révolutionnaire moderne, où des minables et des salauds ont droit à la reconnaissance des « masses » de telles « lettres de noblesse » révolutionnaires sont bien peu de choses aux yeux du philistin, de l’universitaire imbu de ses diplômes, qui consacre quelques chapitres à la critique de Rosa Luxemburg.
Mais justement, qui sont-ils ces contradicteurs, et quel est leur palmarès ?
Eckstein, tout d’abord Rosa Luxemburg le caractérisait elle-même ainsi :
« Eckstein fait partie de cette race de journalistes surgis avec le développement de la presse ouvrière, qui peuvent écrire n’importe quand sur n’importe quoi : sur le droit familial japonais, la biologie moderne, l’histoire du socialisme, l’épistémologie, l’histoire de la civilisation, l’économie politique, les problèmes tactiques – tout ce dont on a besoin au jour le jour. De tels polygraphes se meuvent dans les domaines du savoir avec cette assurance dénuée de scrupules que peuvent sincèrement leur envier les savants sérieux. Ils pallient leur incompétence sur un sujet par l’insolence et la lourdeur. »
Signalons au passage que, bien loin du dilettantisme du journaliste, Rosa Luxemburg, elle, sut faire preuve d’une réelle profondeur de réflexion dans des domaines variés, et notamment dans l’étude des sociétés pré-capitalistes (cf. son « Introduction à l’économie politique »).
Parmi les autres grands mentors de la polémique, l’un des plus connus, jouissant même d’un certain prestige au sein du milieu révolutionnaire, est Henryk Grossmann. Né en 1881, cet universitaire ne vient au communisme qu’à la faveur de l’immense vague révolutionnaire qui secoue le monde à partir de 1917. A partir du début des années 20, Grossmann se met à étudier sérieusement Marx, et publie en 1929, lorsque la contre-révolution triomphe, son principal ouvrage consacré à la loi de l’accumulation et de l’effondrement de la production capitaliste. Cet homme venu tard au communisme (à l’âge de 40 ans), continuera à étudier l’œuvre de Marx, sans se départir du soutien à la Russie, même lorsque celle-ci devient stalinienne. Ses conception théoriques se ressentiront de cette évolution, provoquant une interprétation ricardienne, et non communiste orthodoxe de la théorie de la baisse du taux de profit chez Marx.
Grossmann aurait pu rester ce qu’il est, c’est-à-dire un médiocre professeur stalinien d’économie politique, si Paul Mattick, qui incarnait la continuation de la tradition révolutionnaire des Gauches allemande et hollandaise dans les milieux de l’émigration, au moment de la débâcle contre-révolutionnaire, n’avait malheureusement réhabilité son oeuvre en la considérant comme une restauration conséquente de la doctrine de Marx. Par la même occasion, en valorisant une oeuvre qui aurait dû rester enfouie dans les poubelles de l’histoire, Mattick se fourvoyait à son tour, et avec lui tous ses épigones, dans le marais de l’économie politique.
Autre contradicteur, plus moderne, Arghiri Emmanuel fait partie de l’intelligentsia tiers-mondiste, petite-bourgeoise et stalinienne, brillant esprit pour le maniement du paradoxe et de délire théorique. Il est capable de démontrer tour à tour que le capitalisme se survit parce que les ouvriers des pays développés exploitent leurs frères du tiers-monde et que l’impérialisme est une époque bénie pour les peuples de couleur. Ou encore il entreprend de fonder « scientifiquement » la supériorité du système « socialiste » sur celui capitaliste[32].
Enfin, si l’on entre dans le dernier cercle de cet échantillon de la nullité, on tombe sur le « Cercle marxiste de Rouen » énième produit dégénéré de la répugnante agonie des courants issus de la revue contre-révolutionnaire « Socialisme ou Barbarie ».
Evoluant à la lisière du gauchisme, et en parasite du mouvement ouvrier communiste, cette secte locale, totalement désorientée après que toutes les prévisions de SouB et successeurs se soient révélées fausses, en arrive à faire l’apologie du menchévisme : « Les mencheviks par contre, développent des positions plus orthodoxement marxistes (que les bolcheviks NDR !!!) pour l’époque ; compte tenu de la faiblesse du développement des forces productives, la révolution communiste ne pouvait être à l’ordre du jour, seule une révolution bourgeoise est objectivement possible ; mais ce type d’organisation a réellement joué un authentique rôle contre-révolutionnaire. Signalons pour ouvrir un abîme de réflexions que l’histoire a historiquement (sic !) donné raison à ces derniers. »
Quelque chose unit toutefois ce bric-à-brac idéologique tout ce marché aux puces de la « pensée théorique » en putréfaction, et ce quelque chose c’est leur nature viscéralement contre-révolutionnaire, et leur haine fondamentale du prolétariat et du communisme.
Rosa Luxemburg n’a certes pas besoin qu’on la « réhabilite », mais il était important, en introduction à notre travail de rappeler quelles sont les forces réelles qui s’affrontent au sein de la polémique qui lui est adressée.
D’un coté il y a programme révolutionnaire du prolétariat, le programme de la société sans classe, de la révolution communiste, dont Rosa Luxemburg a été un dirigeant éminent. D’un coté donc, un chef du mouvement communiste, théoricien de premier plan, et qui connaissait l’œuvre de Marx sur le bout des doigts.
De l’autre coté la répugnante engeance des intellectuels contre-révolutionnaires, les Petits esprits qui mobilisent tout leur faible talent pour se faire les adversaires acharnés de l’émancipation de l’espèce humaine, les idéologues stipendiés par la civilisation capitaliste pour faire accepter son cortège d’infamies, les descendants des assassins de Rosa Luxemburg, qui n’abordent le programme communiste qu’avec l’intention de le falsifier, le renier, à grand renfort de « dépassements » et de « mises à jour. »
4. La reproduction simple et élargie dans le livre II du « Capital »
4.1 L’état du livre II du « Capital »
Après la parution du livre II du Capital, édité par Engels, en 1885, à partir des brouillons laissés par Marx mort deux années plus tôt, le révisionnisme allait tenter de fonder sur les éléments théoriques qu’ils contenaient une théorie du développement capitaliste et des crises niant le programme communiste et sa théorie du développement catastrophique du MPC. C’est contre ces tentatives contre-révolutionnaire que se dressaient les Gauches de la IIè Internationale et, tout particulièrement, Rosa Luxemburg.
Avant de voir plus en détail les théories de Rosa Luxemburg et sa critique du révisionnisme, nous devons rappeler brièvement l’origine du livre II du Capital ainsi que les ébauches réalisées par Marx des chapitres relatifs à la reproduction simple et à la reproduction élargie.
Comme nous l’avons déjà dit le livre II a été publié après la mort de Marx. Les brouillons qui ont servi à cette édition ont été rédigés pour une part entre 1865 et 1870 et pour l’autre part entre 1877 et 1879. Engels, pour réaliser le livre II, utilisera environ la moitiés des textes écrits par Marx. En effet, dans ceux-ci, il y a un bon nombre de variantes presque identiques. Pour l’essentiel, la section III c’est-à-dire celle qui est consacrée aux théories de la reproduction simple et élargie est « un rapiéçage de deux rédactions qui procèdent suivant deux méthodes différentes » (Engels). La première a été écrite en 1870 et la seconde dans les années 1877-79. Cette seconde rédaction a d’autre part la particularité d’avoir été « menée de force à terme dans un état de maladie où le cerveau était en proie à une insomnie chronique » (Engels), ce qui eut pour conséquence que « l’ordre logique du texte est souvent interrompu, l’analyse par endroits incomplète et surtout la fin tout à fait fragmentaire. » (id)
Un des grands mérites de Rosa Luxemburg sera de faire ressortir que ces textes, loin de correspondre au tout artistique voulu par Marx n’étaient que des brouillons inachevés, écrits par un Marx malade, dans la dernière partie de sa vie, alors que s’aggrave son état de santé. Ainsi Rosa Luxemburg pouvait-elle remarquer que « le Chapitre XXI, qui nous intéresse particulièrement, « l’accumulation et la reproduction élargie »... a été le moins travaillé de tous. Il comprend en tout 35 pages seulement et s’interrompt brusquement au milieu même de l’analyse ». (L’accumulation du capital T.I. p. 143)
A l’inverse le révisionnisme, en la personne d’un Tugan-Baranovsky par exemple, verra dans le livre II le travail le plus élaboré de Marx[33], avec pour perspective d’opposer le livre II au livre III et justifier un développement illimité de la production capitaliste. Or, qu’y avait-il donc dans le livre II qui ait pu faire croire à l’existence, dans l’oeuvre de Marx, d’une telle vision idyllique du cours du MPC ?
Pour répondre à cela il nous faut revenir au contenu du livre II et plus particulièrement aux exposés sur la reproduction simple et la reproduction élargie.
4.2 Les schémas de reproduction : la reproduction simple
Dans le MPC, la valeur de la totalité du produit social se décompose en capital constant, capital variable et plus-value (c+v+pl).
Marx appelle capital constant la partie du capital qui, dans le cours de la production se transforme en moyens de production, c’est-à-dire en matière premières, matières auxiliaires et instruments de travail, et ne modifie pas la grandeur de sa valeur. Cette partie du capital ne fait que restituer (en une ou plusieurs périodes de production), sa valeur au produit.
Par contre « la partie du capital transformée en force de travail change, au contraire, de valeur dans le cours de la production. Elle reproduit son propre équivalent et de plus un excédent, une plus-value qui peut elle-même varier et être plus ou moins grande. Cette partie du capital se transforme sans cesse de grandeur constante en grandeur variable, c’est pourquoi nous la nommons partie variable du capital » (Marx t. I p. 762)
Au sein du produit social, dont la valeur est donc égale à c + v + pl, l’on peut distinguer deux grandes sections.
D’une part la section des moyens de production, c’est-à-dire des marchandises destinées par leur forme à la consommation productive (section I).
D’autre part, la section des moyens de consommation, c’est-à-dire des marchandises destinées par leur forme à la consommation individuelle de la classe ouvrière et de la classe capitaliste (section II).
Chaque section peut, bien entendu, être décomposée en ses éléments c + v + pl respectifs.
C’est-à-dire que la valeur du produit total de la section I sera égal à c1+ v1 + pl1, alors que la valeur du produit de la section II sera quant à lui égal à c2 + v2 + pl2.
Marx, lorsqu’il analyse la reproduction du capital, distingue entre la reproduction simple et la reproduction élargie. Ce qui caractérise la reproduction simple est que la plus-value est consommée individuellement dans sa totalité par la classe capitaliste (nous faisons ici abstraction de la circulation monétaire).
Reprenons l’exemple de Marx qui figure dans le livre II du capital.
I 4 000 c + 1 000 v + 1 000 pl = 6 000 Section des moyens de production.
II 2 000 c + 500 v + 500 pl = 3 000 Section des moyens de consommation.
La valeur totale de production est donc de 9 000 dont 6 000 pour la section des moyens de production et 3 000 pour la section des moyens de consommation.
Dans chaque section le capital se décompose en c + v + pl. Cela signifie donc que pour produire 6 000 de moyens de production l’on a utilisé 4 000 de moyens de production, de capital constant, et 2 000 de travail vivant, lesquels se décomposent en 1 000 de capital variable qui vont constituer les salaires des ouvriers et 1 000 de plus-value. De la même façon, dans la section des moyens de consommation, nous aurons respectivement 2 000 de capital constant, 500 de capital variable et 500 de plus-value. Pour renouveler les moyens de production usés, les capitalistes de la section I trouveront dans leur propre section l’équivalent en valeur et valeur d’usage des moyens de production qu’ils viennent d’utiliser pour extorquer le maximum de plus-value aux prolétaires qu’ils exploitent. Par conséquent sur les 6 000 € (ou heures de travail) de moyens de production, 4 000 sont achetés par les capitalistes de la section I pour reproduire le capital constant utilisé lors du cycle productif précédent. Les capitalistes de la section II, par contre, ne trouveront pas dans leur section les éléments nécessaires à la reproduction de leur capital constant. Ils ne pourront renouveler celui-ci qu’en l’achetant auprès de la section I.
Par ailleurs, les ouvriers et les capitalistes de la section I doivent pour se reproduire comme classes se fournir en moyens de consommation auprès de la section II.
L’échange entre les deux sections peut donc s’accomplir.
Les ouvriers du section I achètent pour 1000 € de moyens de consommation nécessaires à la reproduction de leur force de travail. La valeur obtenue permet aux capitalistes de la section II de renouveler une partie – la moitié en l’occurrence – de leur capital constant en achetant des moyens de production à la section I. Par la même occasion les capitalistes de la section I récupèrent le capital variable qu’ils ont avancé au début du processus de production. Comme nous l’avons dit, la reproduction simple se caractérise par le fait que la classe capitaliste consomme la totalité de la plus-value à des fins individuelles. Par conséquent, la classe capitaliste de la section I ne se livre à aucune accumulation. Elle se procure pour 1000 € de moyens de consommation auprès de la section II. En retour, les capitalistes de cette section peuvent achever le renouvellement de leur capital constant.
Dans l’exemple ci-dessus, l’échange entre les deux sections se fait sur la base 2 000 c2 = 1.000 v1 + 1.000 pl1. Le capital constant de la section II se renouvelle par l’échange contre le capital variable et le plus-value de la section I assurant par la même occasion la reproduction de la force de travail ouvrière et de la bourgeoisie en tant que classe. Si nous schématisons le résultat pour lui donner un caractère général, l’échange entre les deux sections, dans le cadre de la reproduction simple se fera sur la base suivante :
c2 = v1 + pl1
En conséquence :
1o) Au sein de la section I, le capital constant a été entièrement renouvelé. L’échange s’est déroulé à l’intérieur de la section I, la section des moyens de production.
2o) La classe ouvrière et la classe capitaliste de la section I se sont reproduites comme classes.
3o) Dans la section II, par l’intermédiaire de l’échange avec la section I, la classe capitaliste a pu reproduire son capital constant.
Si dans la section I, le capital constant, le capital variable et la plus-value ont été reproduits, il nous reste à voir comment s’accomplit cette reproduction dans la section II (mis à part le capital constant que nous avons vu en 3o).
Marx décompose la section II, moyens de consommation destinés à la consommation individuelle, en deux sous-sections :
Sous-section a) : Moyens de consommation nécessaire, qui servent à reproduire la force de travail prolétarienne et à la consommation des capitalistes.
Sous-section b) : Moyens de consommation de luxe consommés seulement par la classe des capitalistes.
La reproduction du capital variable de la sous-section IIa s’effectue en son sein et se comprend aisément. Les ouvriers de la sous-section IIa dépensent leur salaire en achat de moyens de consommation nécessaires, c’est-à-dire dépensent l’équivalent de la valeur de leur force de travail dans la sous-section IIa . Par la même occasion, les capitalistes de cette section récupèrent le capital variable qu’ils ont avancé.
Par contre, les capitalistes de la sous-section IIb, celle des produits de luxe ne récupèrent pas directement le capital variable avancé à leurs ouvriers, ceux-ci achetant des moyens de consommation nécessaires auprès de la sous-section IIa. Avec l’argent obtenu, les capitalistes de la sous-section IIa peuvent ensuite se procurer des biens de luxe auprès de la sous-section IIb. Celle-ci récupére ainsi le capital variable avancé aux ouvriers.
Dans notre exemple, la section II se décompose dans les deux sous-sections suivantes :
IIa : 1 600 c + 400 v + 400 pl = 2 400 Moyens de consommation nécessaires.
IIb : 400 c + 100 v + 100 pl = 600 Moyens de consommation de luxe.
En ce qui concerne les ouvriers de la sous-section IIa, nous l’avons vu, ils achètent 400 € de moyens de consommation nécessaires et les capitalistes retrouvent 400 € de capital variable qu’ils peuvent de nouveau avancer pour le prochain cycle productif. Les ouvriers de la sous-section IIb achètent 100 € de moyens de consommation nécessaires et la classe capitaliste de la sous-section IIa se fournira en produits de luxe pour une valeur de 100 € auprès de la sous-section IIb.
Les échanges entre les deux sous-sections ne sont pas cependant encore terminés. La classe capitaliste de IIb doit s’approvisionner en moyens de consommation nécessaires et la classe capitaliste de IIa a besoin, pour satisfaire sa consommation en moyens de luxe, d’acheter une masse supplémentaire de ces moyens auprès de la section IIb.
Dans notre exemple, la classe capitaliste de la sous-section IIb achète pour 60 € de moyens de consommation nécessaire. Avec l’argent reçu, la classe capitaliste de la sous-section IIa peut acheter 60 € de moyens de consommation de luxe, ce qui porte sa consommation totale d’objets de luxe à 160. La classe capitaliste consomme 40% de la plus-value sous forme de moyens de consommation de luxe. Dans la section I les capitalistes consomment donc 400 € de moyens de luxe, qu’ils obtiennent par l’échange entre les deux sections de la production capitaliste dans le cadre c2 = v1+ pl1 examiné précédemment.
L’échange global entre la section I et la section II se décompose donc ainsi :
c2 (a) = v1+ 3/5 pl1
(1 600 c2 = 1.000 v1 + 600 pl1)
et
c2 (b) = 2/5 pl1
(400 c2 (b) = 400 pl1)
Ces équations sont valables dans le cadre de notre exemple où la classe capitaliste consacre 40% de la plus-value à la consommation de moyens de consommation de luxe et 60% à celle de moyens de consommation nécessaires. De manière plus générale si nous appelons a la part consommée par la classe capitaliste en moyens de consommation nécessaires, et (1-a) la part consommée en objets de luxe, nous obtenons le résultat général suivant. Dans le cadre de la reproduction simple l’échange entre les deux grandes sections définies plus haut s’accomplit sur cette base :
c2 (a) = v1+ pl1a
c2 (b) = pl1(1-a)
Dans la section II, la classe capitaliste de la sous-section IIa consomme 160 de moyens de consommation de luxe obtenus par l’échange avec la sous-section IIb et 240 € de moyens de consommation nécessaires.
Enfin la classe capitaliste de la sous-section IIb consomme 40 € de moyens de consommation de luxe et 60 € de moyens de consommation nécessaires.
Sur un plan plus général, les échanges entre les deux sous-section IIa et IIb peuvent être schématisées ainsi :
v2 (b) + pl2 (b) a = pl2 (a) (1-a)
En résumé, le schéma de la reproduction simple qui se caractérise par le fait que la classe capitaliste consomme à des fins individuelles l’intégralité de la plus-value, se présente ainsi :
I 4 000 c + 1 000 v + 1 000 pl = 6 000 Moyens de production
IIa 1 600 c + 400 v + 400 pl = 2 400 Moyens de consommation nécessaires
IIb 400 c + 100 v + 100 pl = 600 Moyens de consommation de luxe
et les grands échanges entre les sections et sous-sections se caractérisent par les égalités suivantes :
c2 = v1 + pl1 pour l’échange entre la section I et la section II.
v2 (b) + pl2 (b) = pl2 (a) (1-a) pour l’échange entre la sous-section IIa et la sous-section IIb.
4.3 Les schémas de reproduction : la reproduction élargie
Si la consommation à des fins individuelles de la totalité de la plus-value par la classe capitaliste caractérise la reproduction simple, par contre l’accumulation d’une partie de la plus-value définit la reproduction élargie. Nous reviendrons plus tard sur le caractère de la signification des schémas de reproduction. Précisons toutefois que la reproduction simple est uniquement un moment de l’analyse théorique de la reproduction du capital[34] et n’a donc pas d’application réelle ; le but de la classe capitaliste n’étant pas la consommation de la plus-value mais la production maximum de celle-ci et donc aussi son accumulation afin d’extraire toujours plus de surtravail au prolétariat. Quelle que soit l’évolution du comportement de la classe capitaliste vis-à-vis de la consommation individuelle, son mobile déterminant, sa passion, reste l’accumulation, l’amour de la production pour la production, la recherche sans trêve du maximum de plus-value. Ceci n’exclut pas que la société ne se retrouve pas à la fin d’une année avec une production dont la valeur serait identique voire moindre que celle de l’année précédente. Non seulement il est de la nature de la production capitaliste qu’il puisse en aller ainsi, mais il doit en aller régulièrement ainsi, aux phases d’expansion succédant la dépression et la crise.
Dans le schéma de la reproduction élargie donc, une partie de la plus-value est consacrée à l’accumulation, tandis que l’autre partie est destinée à la consommation de la classe capitaliste. Cette accumulation implique que dans les deux sections définies plus haut, un capital constant additionnel et un capital variable additionnel soient mis en action.
Par rapport à la reproduction simple, les nouvelles conditions entraînent un bouleversement complet des échanges entre les deux sections.
Si les relations d’échange entre la section II se définissaient dans la reproduction simple par l’égalité C2 = v1 + pl1, étant donné que la plus-value était entièrement consommée, il n’en va plus de même désormais. C2 doit alors entre obligatoirement inférieur à v1 + pl1, sinon l’accumulation ne peut avoir lieu. C’est-à-dire que la valeur du capital constant de la section II doit être plus petite que la valeur du capital variable et de la plus-value de la section I. .
Dans les présentations traditionnelles qui sont faites des schémas de la reproduction élargie, l’on discute généralement le dernier exemple de Marx ou bien les deux derniers exemples lorsque l’on s’intéresse plus particulièrement à ce problème (ce qui n’est pas le cas de Rosa Luxemburg). D’après Rosa Luxemburg, le dernier exemple de Marx[35] baptisé effectivement 2o exemple dans le livre II du Capital est le « véritable schéma, le schéma fondamental dont il se sert exclusivement jusqu’à la fin tandis que le premier n’était qu’un essai, une construction provisoire » (p. 169).
En réalité, pour bien comprendre les difficultés liées à l’interprétation des schémas de la reproduction, il faut considérer également le premier schéma, que Marx utilise et qu’il appelle Schéma a, tandis que les deux derniers schémas, qui sont généralement pris en considération et appelés Ier exemple et 2ème exemple doivent être reliés au premier. Nous montrerons donc que les 3 schémas doivent être compris comme des moments particuliers d’une recherche inachevée et dans laquelle il serait erroné de voir le 3ème schéma (2ème exemple) comme le schéma définitif ou le nec plus ultra de la pensée de Marx dans ce domaine. Comme nous l’avons déjà souligné, et ce n’est pas un des moindres mérites de Rosa Luxemburg que de l’avoir rappelé :
« Il est de fait que le deuxième livre du Capital n’est pas une oeuvre achevée comme le premier. Il est resté incomplet, c’est une juxtaposition de fragments plus ou moins élaborés et d’esquisses telles qu’un savant les note pour lui-même, mais la mise au point en fut toujours freinée et interrompue par la maladie... Il est de fait que Marx estimait selon le témoignage d’Engels que ce dernier chapitre « avait un besoin urgent d’être remanié ». Engels écrivait encore qu’il « n’offrait qu’une solution provisoire du problème » »
(Rosa Luxemburg, Anticritique, p. 148, t. 2)
Il est donc important de voir le cheminement de Marx et d’exposer les 3 schémas, inégalement développés, dans les brouillons du livre II. Marx se propose tout d’abord d’examiner la reproduction élargie du capital à l’aide du schéma suivant, qu’il dénomme schéma a.
4.3.1  Schéma a
Schéma a
I 4 000 c + 1 000 v + 1 000 pl = 6 000 8 252
II 1 500 c + 376 v + 376 pl = 2 252
Ce qui différencie ce schéma de celui de la reproduction simple, ce ne sont pas les déterminations quantitatives telles que la grandeur de la valeur du produit (ici 8252 au lieu de 9000).
« Ce qui est changé, ce n’est pas la quantité, c’est la détermination qualitative des éléments de la reproduction simple, et cette modification est la condition matérielle de la reproduction subséquente sur une échelle élargie. » (Marx, Le Capital, Livre II, p. 841, Pléiade t. I)
Marx suppose que la moitié de la plus-value aussi bien dans la section I que dans la section II est accumulée, tandis que la moitié de la plus-value est consommée.
La reproduction du capital constant de la section I (4 000 c ) ne présente aucune différence par rapport à la reproduction simple. Les capitalistes de la section I achètent pour 4 000 € les éléments matériels permettant de reconstituer le capital constant usé. Pour le renouvellement du capital constant de la section II il faut, tout comme dans la reproduction simple, procéder à un échange avec la section I. Cet échange du capital constant de la section II se fait contre la fraction du capital de la section I qui se transforme et est dépensé comme revenu : le capital variable et la moitié de la plus-value (v1 + ½ pl1).
« Comme la moitié de 1.000 pl I ( = 500 ) doit être accumulée sous l’une ou l’autre forme pour être investie comme capital argent additionnel, c’est-à-dire transformée en capital productif additionnel – (1000 v + 500 pl) I seulement sont dépensés comme revenu. La grandeur normale de II c à faire figurer ici est, par conséquent, 1 500 seulement. Nous n’avons pas besoin d’étudier ici l’échange entre 1500 I (v + pl) et 1500 II c, puisqu’il a été examiné comme procès de la reproduction simple. Nous n’avons pas davantage à considérer les 4000 I c, puisque leur réarrangement en vue de la nouvelle reproduction (cette fois elle a lieu à échelle élargie) a également été vu dans l’étude du procès de la reproduction simple. » (p. 152, t. 5, ES)
Il reste à examiner la reproduction de 500 pl1 et de 376 v2 + 376 pl2, c’est-à-dire la partie de la plus-value de la section I destinée à l’accumulation et le capital variable et la plus-value de la section II. Dans la section II, tout comme dans la section I la moitié de la plus-value est accumulée, soit 188. Celle-ci se décompose en 150 de capital constant et 38 de capital variable, la composition organique du capital restant inchangée et égale à 4. Le capital variable est donc égal au ¼ du capital constant. Dans ses brouillons, Marx commet donc une petite erreur de calcul qui explique que nous ne reprenions pas les mêmes chiffres. Il confond en effet le rapport du capital variable à la plus-value accumulée, qui dans notre exemple est de 1/5 avec le rapport du capital variable accumulé au capital constant accumulé, soit ¼ .
« Comme nous avons supposé qu’au sein de II la moitié de la plus-value doit être aussi accumulée, 188 sont à convertir en capital, dont I / 4 en capital variable, ce qui fait 47 (mettons 48 pour faciliter nos comptes) ; restent 140 à convertir en capital constant. »
(Marx, p. 152, ES t.5, Capital)
Marx n’a jamais aimé ces « maudits chiffres », et comme le rappelle Engels, s’il connaissait bien l’algèbre, il a toujours eu des difficultés avec l’arithmétique. Cette petite erreur de calcul n’aurait même pas à être mentionnée si elle ne témoignait une fois de plus de l’état des brouillons du livre II, de leur inachèvement, du fait que Marx n’en était qu’au début de sa recherche et du fait que les schémas souffrent, en conséquence, de quelques imperfections. Fidèle à cette tradition qui veut que les communistes ne sachent pas compter, Rosa Luxemburg recopie sans hésiter les mêmes erreurs. Cependant, désormais le parti communiste dispose d’une nouvelle arme qu’il a arraché aux mains de l’ennemi de classe : la calculette électronique[36] : Ah ! si Marx avait connu la calculette, au lieu d’être une vieille barbe du dix-neuvième siècle !
Si, avant de les compter, nous revenons à nos moutons, c’est-à-dire à nos schémas, nous pourrons constater avec le lecteur, s’il n’est pas trop endormi, que le capitaliste de la section II se procure donc des moyens de production auprès de la section I tandis qu’ils avancent le capital variable – nous ne tenons toujours pas compte des problèmes monétaires – . En ce qui concerne le capital variable de la section II, sa reproduction n’est pas complètement décrite par Marx. En effet, le texte du « Capital » se poursuit par une digression sur un problème monétaire, et Marx ne revient plus sur la question.
De la même manière, l’accumulation de 500 pl I n’est pas envisagée dans « Le Capital », du moins, dans le schéma dont nous discutons ici, c’est-à-dire le schéma a.
Marx va donc laisser en plan son exemple, puis étudier deux autres schémas que l’on connaît traditionnellement sous le nom de schémas de la reproduction élargie. Comme nous le montrerons, le schéma A ne pouvait conduire Marx qu’à des difficultés insurmontables, en l’empêchant d’exposer correctement la reproduction élargie du capital. Marx passe donc à un second schéma appelé Ier exemple.
4.3.2 Le schéma « 1er exemple »
Dans celui-ci la valeur de la production totale lors de la première année est la même que dans le schéma de la reproduction simple mais les déterminations qualitatives entre les deux sections sont modifiées. Le Schéma « Ier exemple » est donc le suivant :
![]()
I 4 000 c + 1.000 v + 1.000 pl = 6.000 Total
II 1 500 c + 750 v + 750 pl = 3.000 9.000
Par rapport au schéma a, la composition organique du capital de la section II a été modifiée, si bien que le capital variable nécessaire pour mettre en mouvement le capital constant double. La composition organique qui était de 1500 / 376 soit 4 est désormais égale à 1500 / 750 soit 2. Par contre elle demeure inchangée dans la section I.
La valeur de la production dans la section I demeure donc identique alors que dans la section II elle est portée de 2252 à 3000 ; la valeur de la production totale s’élevant de 8252 à 9000. Dans la section I, les capitalistes accumulent la moitié de la plus-value. Par conséquent, 500 pl se décomposent en 400 c (capital constant) et 100 v (capital variable additionnel destiné à mettre en mouvement ce capital constant additionnel). Ce capital constant supplémentaire est acheté par les capitalistes de I au sein de leur propre section. C’est-à-dire que parmi la masse de marchandises représentant la plus-value destinée à l’accumulation, la classe capitaliste de I trouve les éléments matériels permettant d’accroître le capital constant et donc d’accumuler un capital constant additionnel qu’elle achète pour une valeur de 400. La valeur totale du capital constant s’élève alors à 4 400 dans la section I.
Marx, qui auparavant a affirmé, tout comme dans le schéma a, que « le remplacement de (1000 v + 500 pl) I par 1500 II c est un procès de la reproduction simple qui a déjà été discuté à propos de cette dernière », envisage ensuite l’accumulation de moyens de production additionnels. Les capitalistes de la section II achètent alors 100 de moyens de production. Ce capital constant supplémentaire, la classe capitaliste de la section II se le procure auprès de la section I. Pour mettre en action le capital constant additionnel, la section II doit également accumuler un capital variable additionnel qui, compte tenu de la composition organique du capital dans la section II se monte à 50.
De son côté, la classe capitaliste de la section I obtient 100 en argent qui vont constituer la forme argent du capital variable additionnel dont elle a besoin. Les capitalistes de la section II ont du prélever pour leur accumulation 150, (100c + 50 v) sur leur plus-value, le solde, c’est-à-dire 600 ( 750 – 150 ) étant destiné à leur consommation.
![]() A l’issue
de l’accumulation nous obtenons alors le schéma suivant .
A l’issue
de l’accumulation nous obtenons alors le schéma suivant .
I (4.000 c + 400 c) + (1.000 v + 100 v) + (1.000 pl + 100 pl) = 6 600 Total
II (1 500 c + 100 c) + ( 750 v + 50 v) + (750 pl + 50 pl) = 3 200 9800
L’emploi d’un capital variable additionnel entraîne la création d’une plus-value additionnelle égale à la valeur du capital variable dans la mesure où le taux d’exploitation de la force de travail est égal à 100%.
Si la reproduction élargie du capital se poursuit sur les mêmes bases, c’est-à-dire si dans la section I la moitié de la plus-value est accumulée tandis que l’autre moitié est dépensée comme revenu, l’on capitalise 550 pl dans la section, soit 440 de capital constant et 110 de capital variable.
D’autre part, pour que l’échange se réalise pleinement entre la section I et la section II, il faut que le capital constant à remplacer et à accumuler soit égal à v1 + ½ pl1 soit 1 100 + 550 = 1 650. Or, le capital constant à renouveler ne vaut que 1 600. Les 50 restant doivent être prélevés sur la plus-value de la section II, donc parmi les 800 pl.
De plus, pour faire fonctionner ce capital constant additionnel, un capital variable additionnel de 25 doit également être prélevé sur la plus-value. La plus-value restant à la disposition de la classe capitaliste II est donc 800 – (50 + 25) = 725.
Par ailleurs, pour que les nouveaux ouvriers de la section I puissent trouver les moyens de consommation équivalent à leur salaire (110), il est nécessaire que la section II accumule un capital constant d’une même valeur de 110.
« Il faut éventuellement puiser ces 110 dans 725 II pl (…) il reste donc 615 pl. Mais, si la section II transforme ces 110 en capital constant additionnel, elle a besoin d’un nouveau capital variable supplémentaire de 55. ; celui-ci doit à nouveau être tiré de sa plus-value ; si on le déduit des 615 II pl, il reste 560 pour la consommation des capitalistes II (...) » (Marx, Capital, L.II, Editions sociales, T.5, p.157)
Par conséquent, sur ces 800 de plus-value de la section II, 160 (50 + 110) ont été convertis en capital constant additionnel et 80 (25 + 55), en capital variable additionnel. Comme on peut le constater, et Rosa Luxemburg ne manquera pas de le souligner, Marx, dans la présentation de ce deuxième schéma, place l’accumulation de la section II dans la dépendance de l’accumulation et de la dépense du revenu dans la section I. Ce n’était pas le cas dans le schéma A où Marx postulait dès l’origine un taux d’accumulation égal dans chaque section.
A la suite de cette nouvelle accumulation, nous obtenons le schéma suivant :
![]()
I (4 400 c + 440 c) + (1 100 v + 110 v) + (1 100 pl + 110 pl) = 7 260 Total
II (1 600 c + 110 c + 50 c ) + ( 800 v + 55 v + 25 v) + ( 800 pl + 80 pl) = 3 520 10 780
Marx fait la constatation suivante:
« Si les choses doivent se dérouler normalement, l’accumulation doit se faire plus rapidement en II qu’en I, parce que, sinon, la fraction de I (v + pl) qui doit être convertie en marchandises II c croîtrait plus rapidement que les II c contre lesquels seulement elle peut s’échanger. » (idem. t. 5, p. 157)
En réalité, le taux d’accumulation de la plus-value est plus bas dans la section II que dans la section I. Si ce taux s’élève effectivement de 0,2 la première année à 0,3 la deuxième année, il se stabilise ensuite à cette hauteur et demeure donc inférieur au taux d’accumulation de la section I qui est de 0,5.
Marx généralise donc ici un phénomène passager qui l’intrigue. Marx était parti sur la base d’un échange entre les deux sections identique à celui de la reproduction simple, et donc tel que la totalité du capital variable et de la plus-value consommée de la section I équivaille au capital constant à renouveler dans la section II. Mais il s’aperçoit progressivement que cette égalité ne peut être réalisée que dans certaines conditions qu’il va définir. Nous reprendrons plus tard ces problèmes, de manière plus détaillée ; contentons-nous ici de souligner que l’on voit au travers de ces remarques qu’il s’agit de travaux de recherches, de brouillons qui ne sauraient être le point le plus avancé que Marx aurait atteint à l’issue de son travail, s’il avait pu l’achever.
Si l’on poursuit l’accumulation sur les mêmes bases, on obtient :
![]()
I 5 324 c + 1 331 v + 1 331 pl = 7 986 Total
II 1 936 c + 968 v + 968 pl = 3 872 11858
.. etc.
4.3.3 Le schéma « 2ème exemple »
Après avoir considéré le progrès de la valeur de la production pendant plusieurs années, Marx aborde l’étude de son deuxième exemple.
La première année, la valeur de la production y est égale à la valeur de la production dans le schéma de la reproduction simple, mais bien sûr les rapports entre les deux sections sont modifiés. Marx suppose une composition organique identique dans les deux sections.
![]()
I 5.000 c + 1.000 v + 1.000 pl = 7.000 Total
II 1 430 c + 285 v + 285 pl = 2.000 9000
Dans ce schéma, pour la première fois c2 n’est pas égal à v1+½ pl1[37]. Par conséquent, si les capitalistes accumulent la moitié de la plus-value et consomment l’autre moitié, pour que l’échange soit possible entre (v1+½ pl1) et c2, il est nécessaire de prélever sur la plus-value de la section II une valeur de 70, la section II augmentant ainsi d’autant son capital constant. Pour mettre en mouvement ce capital constant additionnel, il faut un capital variable égal à 14 – c’est-à-dire 70/5, puisque la composition organique du capital (c/v) est ici de 5 -
Par ailleurs, si les capitalistes de la section I accumulent la moitié de la plus-value, l’accroissement du capital constant de la section I sera de (500*5)/6 = 417c, lesquels doivent être mis en mouvement par un capital variable additionnel de 83 v.
Dans la section II, une accumulation de capital constant d’une même valeur de 83 peut être réalisée et pour ce capital constant additionnel un capital variable de 17v sera également accumulé. Là encore Marx fait dépendre l’accumulation de la section II de l’accumulation dans la section I :
« Les 83 v retirent de II pl une somme d’argent équivalente, qui sert à acheter des éléments de capital constant et s’ajoute donc à II c. L’augmentation de 83 en II c entraîne une augmentation d’un cinquième de 83 (= 17 ) en II v. »
( Marx, ES, t. 5, p. 163)
Par conséquent, lorsque s’ouvre le procès de production nous avons le résultat suivant :
![]()
![]() I (5.000 c + 417 c) + (1.000 v + 83 v) = 6 500
I (5.000 c + 417 c) + (1.000 v + 83 v) = 6 500
5 417 c 1.083 v
II (1 430 c + 70 c + 83 c ) + ( 285 v + 14 v + 17 v ) = 1 899
![]()
![]()
1 583 c 316 v
A la suite du procès de production, le schéma devient :
![]()
I 5 417 c + 1.083 v + 1.083 pl = 7 583 Total
II 1 583 c + 316 v + 316 pl = 2 215 9 798
Dans la section I, le capital avancé est passé de 6.000 à 6 500, augmentant de 1/12 et dans la section II, il est passé de 1 715 à 1 899, soit une augmentation de environ 1/9.
Si l’on continue le processus de production sur la même base, c’est-à-dire en accumulant dans la section I la moitié de la plus-value et en consommant à des fins individuelles l’autre moitié, l’on obtient la 3ème année :
![]()
I 5 869 c + 1 173 v + 1 173 pl = 8 215 Total
II 1 715 c + 342 v + 342 pl = 2 399 10 614
![]() Et à la
fin de la 4ème année :
Et à la
fin de la 4ème année :
I 6 358 c + 1 271 v + 1 271 pl = 8 900 Total
II 1 858 c + 371 v + 371 pl = 2 600 11 500
Les schémas s’interrompent sur des considérations sur le progrès de l’accumulation du capital total. Le capital de la section I étant passé de 6.000 (5.000 + 1.000) à 7 629 (6 358+1 271), tandis que celui de la section II s’élevait de 1 715 (1 430 + 285) à 2 229 (1 858+371), l’ensemble du capital augmentait de 7 715 à 9 858.
Comme nous avons pu l’indiquer, Marx ne prend que lentement conscience – nous reviendrons là-dessus – du fait que l’échange entre v1+pl1x ( où « x » représente la part de la plus-value consommée à des fins individuelles) et II c ne s’insère que partiellement dans le cadre de la reproduction simple. Dans le cadre du schéma précédent, il remarquait que seulement une partie du capital de II c entrait dans le cadre de la reproduction simple.
« Quant à II c (= 1430 ), son remplacement à valeur égale doit être tiré, toutes choses égale d’ailleurs, de I(v+pl), afin que la reproduction simple puisse avoir lieu en II. En tant que tel, nous n’avons pas à l’étudier ici. Il n’en est pas de même pour les 70 II pl complémentaires. Ce qu’est, pour I, un simple remplacement de revenu par des moyens de consommation, un échange de marchandises en vue de la simple consommation, est pour II un procès d’accumulation directe, une transformation d’une fraction de son surproduit en capital constant, à partir de moyens de consommation. Pour II, il ne s’agit pas seulement ici – comme dans la reproduction simple – d’une pure reconversion de son capital constant de la forme marchandise en sa forme naturelle. » (id, T. 5 p. 162, ES)
Marx en vient à la fin des divers schémas analysés, à essayer de tirer quelques conclusions sur l’échange de c2 en cas d’accumulation.
1o) Tout d’abord c2 peut être égal à v1+pl1x et par conséquent c2 est inférieur à v1+pl1. « Il doit toujours en être ainsi sans quoi il n’y aurait pas accumulation en I. » (Marx, t. 2, p. 854)
2o) v1+pl1x > c2. Dans le cas où v1+pl1x est supérieure à c2, l’échange entre les deux sections implique que l’on ajoute à c2 un capital constant supplémentaire de manière à rendre égales les deux grandeurs. Cela entraîne également un accroissement du capital variable destiné à mettre en mouvement le capital constant additionnel que l’on aura obtenu après l’échange entre les deux sections. L’ensemble de ces capitaux additionnels est pris sur la plus-value de la section II, il constitue une accumulation.
3o) v1+pl1x < c2. Dans ce cas où v1+pl1x est inférieur à c2, la section II n’a pas complètement reproduit son capital constant par l’intermédiaire de l’échange avec la section I, aussi doit-elle combler son déficit en achetant du capital constant auprès de la section I. Cela ne nécessite pas une nouvelle accumulation de capital variable pour la section II, étant donné que grâce à cette opération, le capital constant est seulement reproduit sur la base précédente. Marx, par contre, n’envisage pas les conséquences de ce type de rapport sur la section I. Si Marx a montré que c2 devait toujours être inférieur à v1+pl1, il établit à cette occasion une autre limite absolue ; si l’on veut qu’il ait la possibilité d’une reproduction élargie, il faut que v1+pl1x soit inférieur à c2+pl2. Nous avons donc les inéquations suivantes :
c2 < v1+pl1
c2 + pl2 > v1+pl1x
Inégalités que nous pouvons systématiser ainsi :
v1+pl1x - pl2 < c2 < v1+pl1
C’est-à-dire que la valeur du capital variable et de la plus-value consommée de la section I diminuée de la plus-value de la section II doit être inférieure au capital constant de la section II lequel doit lui même être inférieur à la somme du capital variable et de la plus-value totale de sa section I.
Tout au long de cet exposé, nous avons, répétons-le, négligé les problèmes monétaires, sur lesquels nous aurons à revenir, mais qu’il n’est pas utile d´étudier ici, pour les questions que nous traitons en premier lieu.
L’exposé de Marx sur la reproduction élargie s’achève donc pratiquement sur ces considérations. Alors que le chapitre sur la reproduction simple contenait 13 sous-chapitres, celui sur la reproduction élargie n’en contient que 4. Alors que Marx avait, par exemple, analysé dans le cadre de la reproduction simple – et avec les difficultés que l’on verra – des questions comme la reproduction de la matière monétaire ou du capital fixe, ces points sont à peine mentionnés dans le chapitre consacré à la reproduction élargie. Les schémas destinés à étudier cette dernière sont comme nous le verrons plus en détail, loin d’être « au point », et constituent des ébauches qui n’ont pas trouvé un terme. Bref, loin d’être un livre achevé, le livre II du capital est resté, et tout particulièrement dans cette partie, à l’état de brouillon.
5. L’assaut révisionniste.
5.1 Tugan-Baranovsky
Le révisionnisme, en la personne de Tugan-Baranovsky, va chercher à s’emparer des schémas du livre II pour les insérer dans sa tentative systématique de falsification et de démolition du programme communiste afin de transformer le prolétariat en un jouet du capital.
Tugan-Baranovsky affirmera que les conclusions que l’on peut tirer du livre II du capital en ce qui concerne les théories des crises sont en contradiction avec celles présentées dans le livre III. « La théorie des débouchés qui forme le fond du troisième livre du Capital est en contradiction complète avec les schémas de la reproduction du capital social donnés dans le livre II. » (Tugan-Baranovsky, Les crises industrielles en Angleterre, p. 203)
Tugan-Baranovsky s’empressait alors de faire remarquer que le livre II a en fait été écrit après le livre III ; et de conclure que les brouillons du livre II constituaient le travail le plus mûri de Marx. Cependant, d’après Tugan-Baranovsky, Marx n’avait pu, avant sa mort, mettre à jour les soi-disant nouvelles perspectives qu’offraient ses schémas. Ce cuistre pouvait ainsi déclarer : « l’analyse de Marx est resté inachevée, et il n’a pu en tirer lui-même les conclusions générales. Ses célèbres schémas sont restés privés de leur couronnement logique, comme un corps complètement étranger dans le système harmonieux du marxisme. Comme les déductions logiques qui en résultent et que Marx a complètement négligées sont en contradiction manifeste avec les idées qu’il professait avant la construction de ses schémas, il n’est pas étonnant que l’école de Marx se soit trouvée impuissante à continuer l’œuvre du maître et que le problème des débouchés soit resté sans solution. » (idem, p. 203)
Pour Tugan-Baranovsky, la conception des crises qui était développée par Marx dans le livre III se situait dans la ligne de Sismondi et voyait la cause des crises dans la sous-consommation des masses ; mais l’étude des schémas de reproduction montre désormais que l’on peut remédier aux défauts de la théorie classique, en l’occurrence représentée par Say et Ricardo.
« La théorie de Say-Ricardo est absolument juste du point de vue théorique ; si ses adversaires se donnaient la peine de calculer en chiffres comment se répartissent les marchandises dans l’économie capitaliste, ils comprendraient aisément que la négation de cette théorie recèle une contradiction logique . » (id)
Si la théorie des débouchés des classiques était à rejeter parce qu’elle ignorait que la valeur des moyens de production transmise au produit doit être comptée dans la valeur des marchandises (c’est-à-dire qu’elle ignorait la reproduction du capital constant), désormais grâce aux schémas de reproduction l’on pouvait fournir une théorie complète des débouchés, et Tugan-Baranovsky se pensait investi de cette mission qui devait révéler aux masses médusées les véritables secrets de l’accumulation, secrets que les chefs du parti communiste de la génération précédente (Marx et Engels) n’avaient pu définitivement percer.
Mais la théorie de Tugan-Baranovsky n’était guère qu’une simple continuation vulgaire de la théorie de Ricardo-Say.
D’après Tugan-Baranovsky, les schémas de reproduction montraient, à condition que certaines proportions entre et à l’intérieur des sections soient respectées, que l’accumulation pouvait se dérouler de manière illimitée. La production fournissant à la production son principal et croissant débouché ce n’est donc pas la faiblesse de la consommation des masses qui pouvait empêcher la réalisation de la production capitaliste. Bien plus, si une certaine proportion était respectée entre les divers moments de la production capitaliste, celle-ci pourrait se trouver ses propres débouchés, même si la consommation venait à diminuer.
« L’accumulation du capital social conduit à une réduction de la demande sociale de biens de consommation qui va de pair avec une augmentation de l’ensemble de la demande sociale de marchandises. Il se peut donc que l’accumulation du capital s’accompagne d’un recul absolu de la consommation sociale. Un recul relatif de la consommation sociale – par rapport au montant général du produit social – est en tous cas inévitable. »
(Tugan-Baranovsky, cité par Mattick).
Tugan-Baranovsky poussait le paradoxe jusqu’à affirmer que la reproduction du capital social serait tout à fait possible même s’il ne restait plus qu’un seul ouvrier pour assurer la mise en mouvement du capital constant, du moment qu’une certaine proportionnalité était respectée.
« Il n’est pas bien difficile de construire un nouveau schéma ...(qui montre)...avec évidence que le remplacement le plus large d’ouvriers par des machines n’est pas en mesure par lui même, de rendre une machine quelconque superflue et inutile. Supposons que tous les ouvriers jusqu’au dernier, soient remplacés par des machines, alors cet ouvrier unique mettra en mouvement toute la masse colossale des machines et avec leur aide, produira de nouvelles machines et les moyens de consommation de la classe capitaliste. La classe ouvrière disparaîtra mais cela ne rendra nullement difficile la réalisation des produits de l’industrie capitaliste. Les capitalistes auront à leur disposition une grande masse de moyens de consommation et tout le produit social d’une année sera englouti par le production et la consommation des capitalistes l’année suivante. Si les capitalistes, dans leur passion de l’accumulation veulent restreindre leur propre consommation elle-même, cela est encore parfaitement réalisable. Dans ce cas la production des moyens de consommation des capitalistes est réduite, et une très grande partie du produit social consistera en moyens de production destinés à l’extension ultérieure de la production. On produira par exemple du charbon et du fer qui iront à l’extension ultérieure de la production du fer et du charbon. La production élargie du charbon et du fer de chaque année successives engloutira le charbon et le fer produits l’année précédente, et ainsi de suite à l’infini jusqu’à ce que soient épuisées les réserves naturelles des minerais en question. » (Les crises industrielles en Angleterre ; p. 212)
Les crises, de ce fait, ne pouvaient s’expliquer que par une rupture dans la proportion entre les sections. L’argent n’étant considéré que comme un moyen d’échange, si une crise éclatait c’est que d’un coté l’on avait affaire à une surproduction qui trouvait son complément, d’un autre coté, dans une sous-production. Il suffirait de rétablir la proportionnalité entre les capitaux pour enrayer la crise.
Cependant, celle-ci étant donnée, l’anarchie de la production capitaliste devait se reproduire périodiquement. Toutefois l’on pouvait admettre qu’une meilleure connaissance de l’économie bourgeoise, une maîtrise plus grande de l’Etat et une planification accrue pourrait atténuer les crises, réduisant ainsi à néant les perspectives catastrophiques et révolutionnaires du mouvement communiste.
« L’opinion répandue et adoptée jusqu’à un certain point par Marx, que la misère des ouvriers qui constituent la grande majorité de la population, rend impossible la réalisation des produits de la production capitaliste toujours en extension à cause d’une demande insuffisante – cette opinion doit être considérée comme fausse. Nous avons vu que la production capitaliste crée pour elle-même un marché – la consommation n’est qu’un des facteurs de le production capitaliste. Si la production sociale était organisée de manière planifiée, si les dirigeants avaient une connaissance parfaite de la demande et le pouvoir de transférer librement le travail et le capital d’une branche de la production dans une autre, - lors, aussi réduite que puisse être la consommation sociale, l’offre des marchandises ne pourrait dépasser la demande. »
(cité par RL p. 266 t. I D’après l’édition allemande. Tougan-B.)
En même temps que l’on renouait avec une vision idyllique du procès de l’accumulation capitaliste l’on réhabilitait par la bande les théories « harmonistes » de Say et son école. Bien plus, s’enfonçant encore plus avant dans l’économie vulgaire, Tugan-Baranovsky récusait toujours plus la théorie prolétarienne de la valeur pour lui substituer la théorie subjectiviste archi vulgaire de la valeur utilité.
5.2 Le programme communiste comme critique de l’économie politique
Le programme communiste ne se situe pas dans la simple continuité de l’économie politique classique, il est avant tout critique de cette science, qui a atteint avec Ricardo et Sismondi son point le plus haut. A partir de 1830, le développement de la lutte des classes entraîne la dégénérescence de l’économie politique classique qui se transforme en économie politique vulgaire.
« Je fais remarquer une fois pour toutes que j’entends par économie politique classique toute économie qui, à partir de William Petty, cherche à pénétrer l’ensemble réel et intime des rapports de production dans la science bourgeoise, par opposition à l’économie vulgaire qui se contente des apparences, rumine sans cesse pour son propre besoin et pour la vulgarisation des plus grossiers phénomènes les matériaux déjà élaborés par ses prédécesseurs, et se borne à ériger pédantesquement en système et à proclamer comme vérités éternelles les illusions dont le bourgeois aime à peupler son monde à lui, le meilleur des mondes possibles. » (Marx, Le Capital, Livre I, p. 604 t. I Pléiade)
En conséquence le programme communiste ne se situe ni dans la ligne des théories disproportionnalistes de Say-Ricardo, ni dans celle des théories sous-consommationnistes d’un Sismondi. Toutefois, Marx soulignait que, sur la question des crises, Sismondi avait été plus loin que Ricardo. Si Ricardo est l’adversaire « le plus stoïque » du prolétariat, et s’il a mieux compris la « nature positive du capital », Sismondi lui « a saisi plus profondément le caractère borné, la nature étriquée et négative de la production fondée sur le capital »... « Sismondi met en lumière non seulement l’existence de ces limites, mais leur création par le capital lui-même, qui s’enferme ainsi dans ses propres contradictions dont Sismondi sent qu’elles doivent conduire à l’effondrement du système. » (Marx)
Il est donc tout à fait faux d’affirmer, comme le fait Lénine dans sa polémique contre les populistes, que :
« les classiques ont formulé cette thèse parfaitement juste que la production crée elle-même un marché, détermine elle-même la consommation. Sismondi n’a absolument rien compris à l’accumulation capitaliste et dans la vive polémique qu’il avait engagé avec Ricardo, c’est ce dernier qui a eu raison quant au fond. Ricardo affirmait que la production crée elle-même son marché, alors que Sismondi la niait et fondait sur cette négation sa théorie des crises... On sait que sur cette question la théorie moderne (le marxisme NDR) s’est entièrement ralliée aux classiques. »
(Pour caractériser... p.38 ES)
On a pu voir que, loin de se rallier aux classiques, la théorie révolutionnaire a entrepris une critique systématique de leur théorie des crises. Emporté par sa polémique contre les sous-consommationnistes russes, Lénine se retrouve incapable de restaurer l’orthodoxie révolutionnaire ; bien pis, il abonde dans le sens des théories les plus vulgaires et son jugement sur Sismondi devient par trop unilatéral, en ne montrant pas l’importance de son opposition à Ricardo.
« Si chez Ricardo l’économie politique va impitoyablement jusqu’à ses dernières conséquences, et trouve là son terme. Sismondi parfait cette conclusion en exposant les doutes qu’elle éprouve à son propre sujet. » (Marx, Critique de l’économie politique, Pléiade I, p. 315)
Il ne faudrait pas en conclure que Marx est un adepte de Sismondi et du sous-consommationnisme, sous prétexte qu’il ne s’est pas rallié à Ricardo. Contrairement à ce que prétend un Tugan-Baranovsky par exemple, la théorie révolutionnaire ne pouvait s’affirmer que sur les ruines de la science économique bourgeoise et ce n’est pas dans le socialiste petit-bourgeois, utopiste et réactionnaire, Sismondi que le programme communiste pouvait puiser son arsenal théorique destiné à abattre le vieux monde.
Bien au contraire, c’est en menant une critique radicale de l’économie politique ricardienne et des doutes qui surgissent sur la base de celle-ci, exprimés par Sismondi, que se constitue le programme communiste. Aussi, si Sismondi « juge fort bien les contradictions de la société capitaliste... il ne les comprend pas et ne peut donc pas comprendre le processus de leur solution. » (Marx)
Il est également tout aussi faux de prétendre, comme le fait Paul Mattick, adepte d’une théorie de la baisse du taux de profit inspirée de Grossmann et donc défenseur d’une théorie ricardienne contre-révolutionnaire, que Marx aurait deux théories de la crise, l’une basée sur la baisse de taux de profit, l’autre sous-consommationniste.
« Nous l’avons vu. Marx fait découler la crise, d’une part, de la baisse du taux de profit propre à l’accumulation, indépendamment de tous les phénomènes de crise qui se manifestent à la surface de la société, d'autre part de la sous-consommation ouvrière. (…). C’est à l’ambiguïté des formulations marxiennes qu’on doit les discussions qui ont eu lieu jusqu’à nos jours à propos des crises et de l’effondrement alors qu’il ne faut guère y voir autre chose que la propre incertitude de Marx. »
(P. Mattick. Crise et théorie des crises, Ed. Champ libre p. 28)
Nous commenterons plus tard les passages incriminés ; toujours est-il que, tandis que certains voient dans Marx des blancs hégéliens, d’autres y voient des blancs sismondiens, et ce dans la mesure même où les uns renoncent à la dialectique révolutionnaire, tandis que les autres renouent avec des conceptions ricardiennes. Si Mattick avait su restaurer convenablement la théorie communiste de la baisse du taux de profit au lieu de nous servir une mouture ricardienne, il se serait dispensé de voir des contradictions là où il ne saurait y en avoir.
Les thèses de Tugan-Baranovsky n’étaient qu’un retour aux conceptions ricardiennes déjà réduites à néant par le parti communiste. Marx ne pouvait certes pas accepter la thèse selon laquelle les produits s’échangent contre des produits et la production crée automatiquement son propre marché.
« Dire de cette production croissante qu’elle a besoin d’un marché de plus en plus étendu et qu’elle se développe plus rapidement que celui-ci c’est exprimer, sous sa forme réelle et non plus abstraite, le phénomène à expliquer... Il arrive un moment où le marché semble trop étroit pour la production... c’est ce qui arrive à la fin du cycle... le marché et la production étant des facteurs indépendant, l’extension de l’un ne correspond pas forcément à l’accroissement de l’autre. »
(Marx, T.2, p. 489)
Bien entendu il ne s’agissait pas pour autant d’un alignement des positions du parti communiste sur celles sous-consommationnistes, le conflit entre la production et le marché, entre les conditions dans lesquelles sont produits la plus-value et le capital et celles dans lesquelles ils sont réalisés n’étant pas séparables des conditions de la mise en valeur du capital et donc de la baisse du taux de profit.
Marx pouvait donc s’en prendre à Ricardo dans la mesure où celui-ci, du fait de sa fausse théorie de l’argent niait toute possibilité de crise. C’est justement le point essentiel de la rupture entre l’économie politique classique et le programme communiste : « la lecture du Capital et (s’il connaissait le russe) de l’ouvrage de Sieber aurait appris à M. Wagner ce qui nous sépare de Ricardo qui, pour n’avoir considéré le travail qu’en tant que mesure de grandeur de la valeur n’a découvert aucune relation entre sa théorie de la valeur et la nature de la monnaie. »
L’économie politique en tant que science était incapable de dépasser l’horizon bourgeois et de voir dans les catégories marchandes des produits historiques qui n’étaient pas éternels, n’avaient pas existé de tous temps, et donc étaient susceptibles également de disparaître avec une organisation supérieure de la société.
« L’économie politique classique n’a jamais réussi à déduire de son analyse de la marchandise, et spécialement de la valeur de cette marchandise, la forme sous laquelle elle devient valeur d’échange (...) La forme valeur du produit du travail est la forme la plus abstraite et la plus générale du mode de production actuel, qui acquiert par cela même un caractère historique, celui d’un mode particulier de production sociale. Si on commet l’erreur de la prendre pour la forme naturelle, éternelle, de toute production dans toute société, on perd nécessairement de vue le coté spécifique de la forme valeur, puis de la forme marchandise et, à un degré plus développé, de la forme argent, forme capital, etc. » (p. 604 Pléiade t. I Capital, Livre I)
L’économie politique transformait donc la marchandise et les rapports sociaux qui l’accompagnent en un produit (valeur d’usage), l’échange étant ramené à un simple troc, et niait ainsi non seulement la production capitaliste qui est production généralisée de marchandises mais aussi la production simple de marchandises.
Il est de la nature de la marchandise que la valeur d’échange qu’elle contient potentiellement et qui est indiquée idéellement par le prix, se réalise en argent ; c’est-à-dire que la valeur s’autonomise dans l’argent. Si le capitaliste doit obligatoirement vendre pour réaliser la valeur de la marchandise il n’est pas obligatoire qu’il trouve en face un acheteur ; la possibilité de la crise réside donc dans la possibilité d’une scission entre la vente et l’achat.
« La difficulté de transformer la marchandise en argent, de vendre, provient simplement de ce que la marchandise doit nécessairement être transformée en argent, alors que l’argent ne doit pas nécessairement être immédiatement transformé en marchandise, que vente et achat peuvent donc être disjoints. Nous avons dit que c’est cette forme qui inclut la possibilité de la crise, la possibilité que des moments qui vont l’un avec l’autre, qui sont inséparables, se séparent et soient, partant, violemment réunis, la possibilité que leur cohérence soit réalisée par la violence faite à leur autonomie respective. Et la crise n’est rien d’autre que la mise en oeuvre violente de l’unité de phases du procès de production, qui se sont autonomisées l’une vis-à-vis de l’autre. »
(Théories sur la plus-value, p. 608, t. 2, ES)
Par conséquent, si l’on cesse de considérer l’argent uniquement sous l’angle de sa fonction de moyen de circulation pour voir qu’il possède aussi la fonction de moyens de paiement et qu’avec elle naît la possibilité d’une crise dans la mesure où peut s’opérer une scission entre la vente et l’achat, les théories disproportionnalistes s’en vont à vau-l’eau.
« La fonction de la monnaie comme moyen de paiement implique une contradiction sans moyen terme. Tant que les paiements se balancent, elle fonctionne seulement d’une manière idéale, comme monnaie de compte et mesure des valeurs. Dès que les paiements doivent s’effectuer réellement, elle ne se présente plus comme simple moyen de circulation, comme forme transitoire servant d’intermédiaire au déplacement des produits, mais elle intervient comme incarnation individuelle du travail social, seule réalisation de la valeur d’échange, marchandise absolue. Cette contradiction éclate dans le moment des crises industrielles ou commerciales auquel on a donné le nom de crises monétaires. » (Le Capital, Livre I, Pléiade t.I, p. 681)
5.3 Le « milieu révolutionnaire », héritier de l’économie politique
Dans un article intitulé « L’accumulation des contradictions » (Revolutionnary Perspectives no 6) qui est tout sauf une critique sérieuse des positions de Rosa Luxemburg, la C.W.O. (Communist Workers Organisation – GB), cite un fragment de son oeuvre :
« Mais tant que la plus-value reste contenue dans la forme concrète de la marchandise, elle est inutilisable pour le capitaliste. Il est obligé après l’avoir fabriqué de la réaliser, et de la transformer dans sa forme de valeur pure, c’est-à-dire en argent. » (Rosa Luxemburg. L’accumulation du capital, t.I, p.26)
Vient ensuite ce commentaire méritant de figurer en bonne place dans le bêtisier du mouvement ouvrier : « Une fois de plus Luxemburg révèle sa confusion sur la nature de la monnaie. Ce n’est pas une « pure valeur » mais un cas spécial de la forme marchandise, la marchandise universelle avec laquelle on effectue les échanges entre toutes les autres marchandises. » (RP no 6, p. 22)
L’imbécile, qui n’a pas compris le premier mot de ce que dit Rosa Luxemburg (elle dit que l’argent est la « forme de valeur pure » et non la valeur pure, ce qui signifie que lorsqu’elle est réalisée en argent, la valeur est libérée de toute détermination particulière pour acquérir une forme universelle qui lui permet de continuer son procès afin de pouvoir à nouveau se valoriser, en se transformant dans les éléments du capital productif - moyens de production, force de travail-), nous ressert ici les vieilleries ricardiennes les plus éculées ; l’argent n’est plus considéré que sous sa fonction de moyen de circulation, niant ainsi toute contradiction entre la marchandise et l’argent et donc toute possibilité de crise.
Nous avons déjà montré dans notre no4[38] que la C.W.O. ignorait totalement la théorie communiste de la valeur. Aussi négligent-ils, en bons ricardiens qu’ils sont, la fonction monnaie universelle de la monnaie ; ici ils font abstraction de sa fonction moyen de paiement, ce qui leur interdit d’admettre aucune crise véritable qui affecte l’économie bourgeoise. Aussi finissent-ils leur charge contre Rosa Luxemburg par un argument qui n’a rien à voir avec le sujet mais qui, tout en montrant à quel point une flèche peut manquer sa cible, a tout au moins le mérite de faire savoir au prolétariat que l’humour de la C.W.O. est quasiment à la hauteur de celle d’un adjudant chef de carrière ; « l’or et non les super tankers agit comme monnaie pour des raisons de facilité et non parce qu’il est une pure valeur.» (id)
Pour bien nous faire voir qu’elle n’a rien compris aux contradictions du MPC, la C.W.O. poursuit son argumentation : « Après ce pur non sens (la C.W.O. veut certainement parler de ses conceptions NDR), la théorie de Rosa Luxemburg ne peut rendre compte correctement d’un système où l’Etat agit comme « capitaliste collectif » et où l’échange peut avoir lieu via des valeurs équivalentes et sans que chaque marchandise passe par le cycle M-A comme Marx aurait dit, présupposant l’existence « idéale » de la monnaie. Donc en Russie, par exemple, bien que le produit de la section II passe à travers le cycle M-A la masse de celui de la section I ne le fait pas, et l’Etat délivre des moyens de production en échange d’une production marchande équivalente. Si l’on nie que ce sont des marchandises, ou qu’elles contiennent de la plus-value réalisée et capitalisée sans assurer la forme monnaie, l’on nie le caractère marchand de la totalité de la production en Russie et donc l’on accepte le point de vue des staliniens selon lequel le capitalisme d’Etat égale le socialisme ». (id. P. 22)
En fait ce que le programme communiste nie, ce n’est pas le caractère marchand de la production, ou plus exactement le fait que la production soit une production capitaliste reposant sur l’exploitation du travail salarié, ni que le capital et la plus-value puisse être réalisée et capitalisée. Ce qu’il nie, de ce fait même c’est que l’Etat puisse partout et toujours assurer cette réalisation du produit social ; ce qu’il nie c’est que l’intervention de l’Etat permettrait la maîtrise de la loi de la valeur et donc supprimerait la contradiction entre la forme marchandise et la forme argent, permettant à la valeur de passer sans aucune difficulté de la marchandise à l’argent. Si la société bourgeoise était capable par l’intermédiaire de l’Etat par exemple, d’assurer la réalisation automatique du produit social, il en serait fini de la possibilité des crises. La loi de la valeur serait domptée, et abolies les perspectives qui en découlent : la crise catastrophique et le spectre de la révolution sociale qui se profile derrière. En abdiquant devant l’économie politique et ses mythes, en renonçant à la théorie communiste de la valeur pour en adopter un succédané ricardien, la C.W.O. non seulement est incapable de comprendre la nature des crises qui secouent périodiquement le mode de production capitaliste, mais encore elle est conduite à affirmer implicitement que la possibilité d’une crise n’existe pas dans les sociétés où l’Etat exerce un quasi monopole sur l’activité économique.
D’où vient donc la crise ? La C.W.O. répond, imperturbable : de la baisse du taux de profit. Si la C.W.O. se vautre avec délices dans la fange ricardienne dans sa théorie de la valeur et de la monnaie, sa conception de la baisse du taux de profit est en parfaite continuité avec ses prémisses ricardiennes. De même que Ricardo admettait une baisse du taux de profit conduisant à un état stationnaire dans lequel toute accumulation serait découragée, étant donnée la diminution progressive de la force productive du travail sous l’effet de rendements décroissants dans l’agriculture, de même la C.W.O., reprenant les conceptions du stalinien Grossmann, voit le taux de profit baisser sous l’influence d’une accumulation du capital constant plus rapide que l’accumulation du capital variable (et donc d’une hausse de la composition organique) indépendante de la plus-value et de sa production. Il s’ensuit une baisse graduelle dans le progrès de la productivité du travail. Cette baisse pourrait durer jusqu’à la nuit des temps si la plus-value ne se révélait pas à un moment donné insuffisante pour assurer l’accumulation.
En effet, dans l’interprétation de Grossmann, la part de la plus-value consacrée à l’accumulation est sans cesse plus grande tandis que celle destinée à la consommation s’amenuise dans le même temps. Aux rendements décroissants dans l’agriculture et à la hausse de la rente se substitue une théorie d’une baisse relative de la productivité du travail et d’une hausse de la composition organique entraînant des crises partielles, qui ne sont que des disproportions, disproportions entre la plus-value existante et le besoin supposé d’une augmentation de la composition organique et donc d’une masse croissante de capital constant et variable à accumuler. La théorie de Grossmann (nous y reviendrons) est non seulement incapable de restaurer convenablement la compréhension révolutionnaire des crises et des contradictions de la production capitaliste, mais elle abandonne même ouvertement le point de vue de Marx. Grossmann falsifie ce dernier avec un cynisme qui en dit long sur ses prétendues qualités intellectuelles.
Alors que chez Marx le taux de l’accumulation, c’est-à-dire la part de la plus-value accumulée est déterminée par le taux de profit, c’est-à-dire que plus le taux de profit sera élevé et plus le taux d’accumulation aura tendance à s´élever, le mouvement est chez Grossmann inversé, c’est-à-dire que le taux d’accumulation s’élève tandis que le taux de profit baisse, et ce à tel point que le taux de croissance de l’économie peut s’accélérer.
Grossmann falsifie la théorie de la surpopulation relative en prétendant que la hausse de la composition organique, la libération des ouvriers par la machine n’engendre pas une surpopulation relative. Il est vrai que dans son schéma, le capital variable peut croître au même taux et donc ne pas entraîner de tendance à la surpopulation relative, tandis que la composition organique du capital s’élève, cette période idyllique durant jusqu’à la crise. Dans la mesure où il admet, pour la phase de soumission réelle, une tendance à l’augmentation croissante de la part de la plus-value accumulée, il nie la nécessité pour le capital de développer une classe moyenne consommant une part croissante de cette même plus-value.
Bien entendu tout cela passe largement au-dessus de la tête de la C.W.O., toujours prête à se gausser de ce qui est juste et profond chez Rosa Luxemburg.
De même que Ricardo niait toute possibilité d’une crise générale en admettant la baisse du taux de profit, de même la C.W.O. nie la possibilité d’une crise générale et bavarde bruyamment sur une baisse du taux de profit qu’elle tente de nous expliquer au moyen de sottises ricardiennes.
Ce n’est donc pas la peine de reprocher à Mattick (disciple de Grossmann et donc maître à penser de la C.W.O. sur la question du taux de profit) de voir dans la Russie, par exemple, une société capitaliste dans laquelle les crises seraient maîtrisées, pour réintroduire en contrebande les mêmes conceptions. Il ne faut pas pour autant s’imaginer que les épigones dégénérés et crétinisés de Rosa Luxemburg, tels le C.C.I. déversent les flots de lumière sur la question. Confondant volontiers contradiction dialectique et incohérence, le C.C.I. puise allègrement dans l’arsenal bourgeois pour réfuter la baisse du taux de profit. Dans le plus pur style ricardien, il fait justement valoir que l’on voit pas très bien pourquoi la crise interviendrait sous prétexte que le taux de profit passe de 100% à 10% ou à 1%. Bref, le C.C.I. développe la nouvelle loi selon laquelle il suffit d’ajouter un zéro supplémentaire au dénominateur du taux de profit pour pouvoir écrire une ânerie supplémentaire et il est vrai qu’il use et abuse de cette découverte.
Nous reviendrons plus en détail sur les conditions qui font que la baisse du taux de profit induit des crises toujours plus vastes. Contentons-nous ici de rappeler contre ce qui est un argument ricardien de la plus belle eau (digne d’un Tugan-Baranovsky) que si la crise peut se développer, c’est parce que les conditions de la production et de la réalisation ne sont pas identiques. Rappelons donc ce que disait Marx sur la manière dont le capital cherche à surmonter les effets d’une baisse du taux de profit :
« Une partie des produits jetés sur le marché ne peut accomplir son processus de circulation et de reproduction que par une énorme contraction de ses prix, donc par la dépréciation du capital qu’elle représente. De même, les éléments du capital fixe sont plus ou moins dépréciés. A cela s’ajoute le fait que le processus de reproduction dépend de certaines conditions de prix préalablement données, donc qu’une baisse générale des prix l’arrête et le désorganise. Cette perturbation et cette stagnation paralysent la fonction de l’argent en tant que moyen de paiement, dont le développement est lié à celui du capital qui est fondé sur ces conditions de prix présupposées. La chaîne des obligations de paiement à échéance fixe est brisée en cent endroits ; la confusion se trouve encore aggravée par l’effondrement inévitable du système de crédit, qui s’est développé simultanément avec le capital, et elle aboutit ainsi à des crises violentes et aiguës, à des dévalorisations soudaines et forcées, à l’arrêt effectif du processus de reproduction et, par suite, au déclin total de la reproduction. » (Marx, Capital, LIII, t. 2, p. 1036, Pléiade)
Et, de manière plus générale :
« Comme la baisse du taux de profit correspond à une diminution du travail immédiat par rapport au travail objectivé qu’il reproduit et qu’il crée de nouveau, le capital mettra tout en oeuvre pour contrarier la baisse du travail par rapport au quantum de capital en général autrement dit, de la plus-value exprimée comme profit par rapport au capital avancé. Il tentera en outre, de réduire la part attribuée au travail nécessaire et d’augmenter encore davantage la quantité de surtravail par rapport à l’ensemble du capital employé, en conséquence, le maximum de développement de la puissance productive, ainsi que le maximum d’extension de la richesse existante coïncideront avec la dévalorisation du capital, la dégradation de l’ouvrier et un épuisement croissant de ses forces vitales. Les contradictions provoqueront des explosions, des cataclysmes et des crises au cours desquels les arrêts momentanés de travail et la destruction d’une grande partie des capitaux ramèneront, par la violence, le capital à un niveau d’où il pourra reprendre son cours. Ces contradictions créent des explosions, des crises, au cours desquelles tout travail s’arrête pour un temps, tandis qu’une partie du capital est détruite, ramenant le capital par la force au point où, sans se suicider, il est à même d’employer de nouveau pleinement sa capacité productive. Cependant ces catastrophes qui le régénèrent régulièrement se répètent à une échelle toujours plus grande et finiront par provoquer son renversement violent. » (Marx, Grundrisse, t.IV, p. 18)
Dans ces deux extraits sont réunis tout ce que les prétendus disciples nient. Crise catastrophique et non partielle, baisse du taux de profit qui entraîne la non-réalisation de la valeur et de la plus-value et donc effondrement de la production capitaliste qui doit se rétablir par des dévalorisations d’autant plus importante que la force productive du travail est développée.
Il faut donc toute la naïveté de la C.W.O. pour croire que de telles crises puissent être évitées par l’intervention de l’Etat.
Le misérable débat entre les néo-ricardiens de la C.W.O. et les néo-simondiens du C.C.I. se situe dans la lignée de l’économie politique, la vulgarité en plus, que le programme communiste a déjà critiquée. Cela en dit long sur la capacité du soi-disant milieu révolutionnaire à assurer ses tâches théoriques. Il est à craindre que lorsque le mouvement réel l’exigera, ces activistes forcenés se convertissent comme le firent les sectes au débat du mouvement ouvrier, en un obstacle pour l’émancipation du prolétariat.
5.4 Rosa Luxemburg
Pour en revenir à Rosa Luxemburg, ce n’était donc pas un de ses moindres mérites que d’avoir rappelé les contradictions entre la valeur d’usage et la valeur d’échange, entre la marchandise et l’argent, entre la production et la réalisation.
Il n’y a pas automatiquement transformation de la marchandise en argent, réalisation de la valeur, autonomisation de celle-ci sous forme argent. Là gît la possibilité d’une crise.
Si Rosa Luxemburg rappelait avec raison contre Tugan-Baranovsky et aussi malheureusement contre un Lénine, que la réalisation de la marchandise c’est-à-dire la réalisation de la valeur en argent n’était pas automatique, qu’elle constituait[39] pour parler comme Marx le « saut périlleux » de la marchandise ; dans le même temps, l’erreur de Rosa Luxemburg était de voir dans cette difficulté potentielle une difficulté permanente, d’identifier la possibilité et la nécessité de la crise. Par là elle retombait dans une logique de type sous-consommationniste.
« Mais ce qui transforme cette possibilité de la crise en crise, n’est pas contenue dans cette forme elle-même : ce qu’elle contient uniquement c’est qu’est présente là la forme pour une crise. » (Marx, TSPL, t.2, p. 608)
En en restant au niveau de la circulation, sans relier les fondements de la crise, et donc sa nécessité, au procès de production, Rosa Luxemburg ne restaurait pas dans sa totalité la théorie communiste des crises.
D’autre part, avec la généralisation de la production marchande, lorsque la marchandise devient un produit du capital et un moment du procès de la valeur, la contradiction entre la marchandise et l’argent se pose à un degré beaucoup plus élevé en tant que contradiction entre le capital marchandise et le capital argent. La réalisation de la valeur de la marchandise capital et donc de la plus-value qu’elle contient n’est pas une donnée automatique, la contradiction contenue dans ce passage est poussée à un niveau beaucoup plus élevée, elle affecte la totalité du produit social ( c + v + pl ) et non seulement pl ou toute autre partie du capital.
Les fondements de cette crise devaient être recherchés dans le développement contradictoire de la productivité du travail dans le mode de production capitaliste, dans le fait que celui-ci constitue désormais (dès que la phase de soumission réelle s’est affermie, et ceci est vrai en 1847 pour l’Angleterre) un rapport de production trop étroit pour développer les forces productives qui rentrent en conflit avec lui. Ce conflit se manifeste périodiquement dans des crises de surproduction toujours plus vastes. La possibilité de ces crises devait donc être recherchée au sein de la production capitaliste, dans la contradiction valorisation dévalorisation qui se présente sous l’aspect de la baisse tendancielle du taux de profit. Le capital, dans sa recherche du maximum de plus-value, de valeur extra, dans sa poursuite d’une valorisation maximum, se dévalorise, c’est-à-dire que la valeur contenue dans la marchandise, produit du capital, diminue. D’autre part, étant donné qu’il lui faut augmenter la productivité du travail pour accroître la plus-value relative, la masse des moyens de production, matière premières, bref l’équivalent du capital constant au sein de cette masse de marchandises toujours plus grande, augmente par rapport à la partie variable du capital, or c’est uniquement l’emploi de celle-ci qui permet l’extraction de plus-value, but exclusif de la production capitaliste.
Aussi fallait-il s’attendre régulièrement, lors de renversements dans le progrès de la productivité du travail, à des crises d’autant plus vastes que le degré de celle-ci était élevé. La possibilité de ce que ces crises se développent et prennent de l’ampleur se trouvait incluse dans les contradictions entre la forme marchandise et la forme argent, entre les conditions dans lesquelles les marchandises étaient produites et les conditions dans lesquelles elles étaient réalisées.
Tout cela, c’est-à-dire aussi bien la possibilité de la crise que son complément dialectique : les fondements de sa nécessité, Tugan-Baranovsky l’avait renié. En niant toute contradiction entre la marchandise et l’argent, en transformant celui-ci en un simple instrument des échanges, il transformait la marchandise en produit et la production capitaliste en production de valeurs d’usage, production qui verrait croître indéfiniment la production des moyens de production aux dépens de celle des moyens de consommation. Par conséquent, si la crise existait, elle ne pouvait venir que d’une mauvaise répartition des capitaux entre les deux types de production, répartition qui pouvait être de mieux en mieux maîtrisée grâce à une meilleure connaissance de l’organisation économique et à la planification de la production. Les crises qui surgissaient de telles disproportions ne pouvaient donc être que partielles et donc ne pouvaient pas ébranler très profondément le mode de production qui les suscitait, il s’agissait donc d’un retour pur et simple aux théories de Say-Ricardo.
6. Les crises et les disproportions
6.1 Un argument en faux-semblant : la composition du produit social.
Tugan-Baranovsky était parfaitement conscient de ce que ces théories étaient incapables d’expliquer une crise générale, aussi se livrait-il à des contorsions théoriques afin de montrer comment, de partielle, la crise pouvait devenir générale.
L’erreur de Ricardo n’était pas seulement de suivre le dogme d’Adam Smith et de décomposer le produit social en v + pl, capital variable et plus-value, et donc de ne pas tenir compte du capital constant (Sismondi d’ailleurs faisait la même erreur). Rosa Luxemburg rappelait avec justesse (contre Lénine qui se laisse aller à ce genre d’arguments contre Sismondi en feignant d’ignorer que Marx faisait le même reproche à Ricardo), que le problème qui est posé par Sismondi est celui de la contradiction entre la valeur d’usage et la valeur d’échange, l’obtention d’une demande solvable pour réaliser la production, et donc la possibilité d’une crise si les conditions de la production et de la réalisation ne sont pas identiques.
« Cependant si des critiques ultérieures de Sismondi, comme par exemple le marxiste russe Ilyine (Lénine) croyaient que cette bévue fondamentale dans l’analyse de la valeur du produit global justifiait le sourire triomphant avec lequel ils condamnaient la théorie sismondienne de l’accumulation comme caduque, comme un non sens, ils démontraient seulement par là leur propre incapacité à voir le problème traité par Sismondi. L’analyse de Marx, relevant le premier cette erreur grossière d’Adam Smith est la preuve que le problème de l’accumulation est loin d’être résolu par la seule prise en considération de la partie de la valeur du produit global qui correspond au capital constant. Une preuve encore plus frappante en est le destin actuel de la théorie de Sismondi elle-même. Par sa conception, Sismondi a été entraîné dans une controverse très vive avec les représentants et les épigones de l’école classique : Ricardo, Say et Mac Culloch. Les deux camps soutenaient deux points de vue parfaitement opposés : Sismondi affirmait l’impossibilité de l’accumulation, tandis que Ricardo, Say et Mac Culloch proclamaient sa possibilité illimitée. Cependant, à l’égard de la bévue de Smith, les deux parties avaient la même position : comme Sismondi, ses adversaires faisaient abstraction du capital constant à propos de la reproduction. »
(Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital, t.I, p. 161)
6.2 Disproportion et harmonie
Marx n’a jamais nié la possibilité de crises résultant de disproportion entre ou au sein des branches. Non seulement c’est pour lui une possibilité, mais même une nécessité, dans une société où le travail individuel doit, pour devenir travail social, recevoir la sanction du marché, et où les capitalistes produisent indépendamment des besoins humains, dans la seule perspective du profit.
Il est de ce fait inévitable qu’en permanence l’adaptation de la production aux besoins se fasse de manière anarchique et ne se réalise qu’à travers des à-coups et des crises qui démontrent que telle ou telle production est en surproduction alors que dans telle autre la pénurie s’installe. Bien plus, ces disproportions inhérentes à l’anarchie capitaliste peuvent affecter des parties beaucoup plus grandes de l’organisme social. Marx montrait ainsi que, de par leur nature, des disproportions entre la partie fixe et circulante du capital devaient se produire :
« Il s’y ajoute que les péréquations sont toutes fortuites et que si la proportion dans laquelle des capitaux sont employés dans les différentes sphères fait l’objet, par un procès permanent, d’une péréquation, la permanence même de ce processus présuppose aussi la permanente disproportion qu’il doit égaliser en permanence, souvent violemment. »
(Marx, Théorie sur la plus-value, p. 587, t.2, ES
« Comment, sur la base de la production capitaliste, où chacun travaille pour soi et où le travail particulier est forcé de se présenter en même temps comme son contraire, comme travail abstraitement général, et sous cette forme comme travail social, comment la péréquation et la cohérence nécessaire des diverses sphères de production, la mesure et la proportion entre elles pourraient elles se faire autrement que par la constante abolition d’une constante disharmonie ? Ce fait est encore admis quand on parle des péréquations de la concurrence, car ces péréquations présupposent toujours qu’il y a quelque chose à égaliser, donc que l’harmonie n’est toujours que le résultat du mouvement, aboutissant à abolir la disharmonie existante. »
( id, p. 630)
« Il va de soi qu’il peut y avoir surproduction dans certains sphères et sous-production dans d’autres ; des crises partielles peuvent donc résulter d’une production disproportionnée (mais la production proportionnée n’est jamais que le résultat de la production disproportionnée sur la base de la concurrence), dont une forme générale peut être une surproduction de capital fixe d’un coté et de capital circulant de l’autre. »
(Marx, Livre II, p. 485, éd. La Pléiade, t. 2)
Mais ce n’est pas de ces contradictions inhérentes à la production capitaliste que le programme communiste espère la venue de crises catastrophiques, mais d’une contradiction beaucoup plus importante qui ne se manifeste pas en permanence mais qui éclate régulièrement, provoquant des secousses toujours plus violentes.
6.3 Tugan-Baranovsky révise le communisme
En en restant à ce type de crises, Tugan-Baranovsky n’avait donc pas avancé d’un pouce par rapport à Ricardo-Say. Par contre, du point de vue de la théorie prolétarienne, il s’agissait d’une véritable régression, d’une rechute dans les pires aspects de l’économie politique. Non seulement Tugan-Baranovsky était entraîné à considérer l’argent sous l’angle de sa fonction de moyen de circulation et à ignorer celle de moyen de paiement, et, par conséquent, à nier toute contradiction entre la marchandise et l’argent, donc à nier la possibilité d’une crise, mais également cette rechute l’amenait à nier la production capitaliste et les contradictions qui jaillissent en son sein et qui nécessairement se résolvent violemment sous la forme d’une crise.
Tugan-Baranovsky ignorait donc la spécificité de la production capitaliste pour en faire un mode de production qui, moyennant quelques aménagements, pourrait devenir éternel.
Le MPC, en tant qu’il est production généralisée de marchandises est transformé en une production de valeurs d’usage dans laquelle la production des moyens de production se développe de manière autonome par rapport à celle des moyens de consommation.
Tugan-Baranovsky « oublie » que le but de la production capitaliste n’est pas de développer les moyens de production, ni même d’accroître la masse de ceux-ci par rapport aux moyens de consommation, mais d’extorquer le maximum de plus-value, et pour cela, il importe peu que l’on produise des moyens de production ou des moyens de consommation, ceux-ci ne servent ici que de support à la valeur d’échange et à la valeur extra, la plus-value. La production capitaliste, que les valeurs d’usage consistent en moyens de production ou en moyens de consommation ne vise qu’à la production du maximum de surtravail, afin d’obtenir toujours plus de plus-value, la production et la reproduction des rapports de production capitalistes, ce qui implique pour la classe ouvrière une exploitation sans cesse accrue, et l’épuisement, la dégradation, l’aliénation qui lui sont corrélatifs.
La section des moyens de production, sous son aspect de support de la valeur d’échange, ne possède pas de priorité, ni de spécificité par rapport à la section des moyens de consommation. Dans les deux sections règne la même production capitaliste et les capitalistes des deux sections servent le même maître : le capital, la valeur en procès qui cherche à se valoriser au maximum.
6.4 Tougan-Bararanovsky révise les schémas de reproduction
D’autre part, Tugan-Baranovsky présente des schémas extrêmement confus dans la mesure où il entreprend de décomposer la section des moyens de consommation en deux sections distinctes : la section des moyens de consommation destinés aux ouvriers et une section des moyens de consommation de luxe destinés à la consommation de la classe capitaliste[40].
Or, ce faisant, l’on dénature complètement la portée des schémas de reproduction. Marx ne faisait pas correspondre aux deux sous-sections qu’il introduisait dans ses schémas des classes sociales distinctes. En effet, si les moyens de consommation nécessaires sont consommés par la classe ouvrière, ils le sont aussi par la classe capitaliste, par contre les moyens de consommation de luxe sont, dans les schémas de Marx uniquement consommés par les capitalistes.
Il est donc faux d’identifier la section II ou du moins sa sous-section moyens de consommation nécessaires avec la consommation exclusive des prolétaires et, par conséquent, d’inscrire un trait d’égalité entre valeur de la production de la section II et valeur de la force de travail.
Les schémas décrivent à un degré d’abstraction très élevé les rapports que doivent avoir entre elles les deux grandes sections de la production sociale, la décomposition de celles-ci repose sur la distinction entre consommation productive et consommation à des fins individuelles et non sur une logique de classe ; en outre, à l’intérieur de la section II la distinction entre moyens de consommation nécessaire et moyens de consommation de luxe ne recouvre pas, nous l’avons vu, l’individualisation des deux classes en présence dans les schémas : la classe ouvrière et la classe capitaliste.
Ce n’est pas un hasard si la tradition révisionniste raisonne sur des schémas de ce type qui lui permettent de se livrer à toutes les manipulations possibles de la théorie. (cf. par exemple L. Von Bortkiewicz, grand maître entre autres de la C.W.O. qui, sur la base des schémas de Tugan-Baranovsky, entreprend de « corriger » - dans un sens ricardien bien sûr – la théorie de la transformation des valeurs en prix de production).
Ce qui caractérise les moyens de consommation de luxe, ce n’est pas qu’ils soient consommés par la classe capitaliste mais qu’ils ne jouent pas de rôle dans la détermination de la valeur de la force de travail. De fait, le communisme théorique n’a jamais exclu que les ouvriers participent à la consommation des moyens de luxe, et l’aristocratie ouvrière, dans la mesure où elle obtient un salaire égal ou supérieur à la valeur de la force de travail obtient une part décisive dans cette consommation de biens de luxe par les ouvriers.
Bien entendu, par construction (et cela nous montre, mais nous y reviendrons qu’il ne faut pas assimiler ipso facto les schémas à la « réalité »), les ouvriers ne consomment pas de moyens de consommation de luxe ; ceux-ci étant exclusivement destinés aux capitalistes. Mais si la fonction des schémas[41] était telle qu’il était justifié de poser le problème sous cet angle, dans l’analyse plus concrète de l’accumulation et de la consommation de la classe ouvrière. Marx montre que cette dernière peut consommer des moyens de consommation de luxe, mais également que cette consommation peut s’accroître à la suite d’une hausse générale des salaires ; ainsi dans les lignes consacrées à la reproduction simples dans la sous-section des moyens de consommation de luxe Marx notait que dans la phase d’expansion :
« Ce n’est pas seulement la consommation des subsistances nécessaires qui s’accroît ; la classe ouvrière (renforcée par toute son armée de réserve) participe elle aussi momentanément à la consommation de articles de luxe, d’ordinaire hors de sa portée, et des articles qui, en d’autres circonstances ne constituent pour la plupart des moyens de consommation « nécessaires » que pour la classe capitaliste. »
(Marx, p. 780, t. 2)
De même, si les ouvriers parviennent à arracher une hausse générale des salaires,
« (…) par suite de l’augmentation des salaires, la demande de subsistances des ouvriers augmentera sensiblement. A un degré moindre, leur demande d’articles de luxe augmentera, de même que la demande d’articles qui, naguère, n’entraient pas dans le champ de leur consommation.
Cet accroissement subit de la demande générale des moyens de subsistance fera sans doute immédiatement monter les prix. Par suite, une plus grande partie du capital social sera employée à produire les subsistances nécessaires, et une partie moindre à produire des articles de luxe ; les prix de ces derniers baisseront par suite de la diminution de la plus-value, donc la diminution de la demande des capitalistes pour ces articles. En revanche, si les ouvriers achètent eux-mêmes des articles de luxe, la hausse de leur salaire n’influe pas pour autant sur le prix des subsistances nécessaires ; elle permet tout au plus de remplacer les acheteurs d’articles de luxe. Les ouvriers consomment d’avantage d’articles de luxe, alors que les capitalistes en consomment relativement moins. Voilà tout. » (Marx, p. 716, Pléiade, Capital, Livre II)
Si la classe ouvrière, dans sa totalité, reçoit un salaire égal et même inférieur, si le rapport de force est défavorable, à la valeur de la force de travail, elle participe néanmoins à la consommation d’objets de luxe parce qu’une fraction de la classe ouvrière, sa partie la mieux payée, son aristocratie obtient elle un salaire égal ou supérieur à cette valeur. Par conséquent, indépendamment même des phénomènes qui feraient que, au détriment du nécessaire, les classes exploitées et asservies imitent dans certains aspects de leurs consommation (ce qui ne peut être que très fragmentaire), les classes supérieures, la classe ouvrière, à travers son aristocratie, peut consommer de manière durable – du moins dans les phases d’expansion – des moyens de consommation de luxe. Nous avons rappelé ailleurs[42] quels étaient les fondements matériels de cette aristocratie et par quels leviers le capital était à même de forger des chaînes dorées non seulement bien sûr à cette aristocratie, mais aussi dans une certaine mesure à la totalité de la classe, en échange de sa sujétion politique et idéologique.
Tout à fait méprisable est donc l’attitude du C.C.I. et du GCI (Groupe Communiste Internationaliste), par exemple, lorsqu’ils s’acharnent à combattre le communisme et sa théorie de l’aristocratie ouvrière en pratiquant l’amalgame et en se refusant à en découdre ouvertement avec cette théorie. Feignant d’ignorer (mais l’ignorance même feinte n’a jamais été un argument politique) que le concept d’aristocratie ouvrière ainsi que son rôle comme base sur laquelle peut s’appuyer le réformisme ont été développés par Marx et Engels, puis repris sans être toutefois entièrement restaurés par Lénine, ils polémiquent contre des théories sous-produits du stalinisme et assimilées pour la circonstance à la théorie communiste, cherchant par ce misérable biais à jeter un discrédit sur la théorie révolutionnaire qu’ils se gardent bien d’attaquer directement.
6.5 Tugan-Baranovsky ne rencontre plus de limites
Si Tugan-Baranovsky véhiculait des théories étrangères au prolétariat en matière de moyens de consommation de luxe, cet aspect n’est qu’un des moments de son reniement intégral des contradictions de la production capitaliste et de ses fondements intimes.
A ne considérer même que la consommation de la classe ouvrière, une régression de la consommation totale de celle-ci ne pourrait être qu’un cas particulier impliquant une baisse du salaire global telle que la masse des salaires versés à l’ensemble des ouvriers soit plus faible que lors du cycle de production antérieur, en dépit de l’augmentation de la masse salariale engendrée par l’emploi de nouveaux ouvriers. C’est-à-dire que le salaire individuel de la période d’origine multiplié par le nombre d’ouvriers employés serait plus élevé que le nouveau salaire multiplié par un nombre d’ouvriers plus grand. En d’autres termes la baisse du salaire individuel serait telle que la masse globale du salaire versé diminuerait malgré l’accroissement du nombre des ouvriers en activité.
Sans être à rejeter (et il est même tout à fait vraisemblable), ce cas ne peut intervenir que dans certaines périodes de l’accumulation capitaliste ; c’est pourtant dans cette seule perspective, celle d’une accumulation rapide du capital fixe, que se place Tugan-Baranovsky. Par contre, à considérer l’ensemble de la section II, c’est-à-dire en incluant la consommation individuelle de la classe capitaliste et des classes qui vivent de la plus-value (propriétaires fonciers, classes moyennes), l’hypothèse d’une diminution de la consommation méritait une étude plus approfondie. En tout cas, dans la période de prospérité de l’accumulation capitaliste, cette diminution de la consommation est une perspective qui est à rejeter, à supposer même que la valeur de la force de travail prolétarienne soit abaissée de telle manière que la valeur totale des salaires soit inférieure à celle de la période antérieure malgré l’augmentation de la population ouvrière, une partie croissante de la plus-value est consacrée à l’entretien d’une classe moyenne toujours plus vaste, dont l’augmentation relative par rapport à la classe ouvrière s’accomplit à travers une exploitation accrue du prolétariat.
De ce fait même, une diminution relative de la section II par rapport au secteur I, et nous reviendrons sur ces questions, en tant qu’elle traduirait une élévation de la composition organique serait à considérer sous un autre angle, dans la mesure où la valeur de la production de la section II n’est pas exclusivement destinée à la classe ouvrière mais inclut également la classe capitaliste et ses appendices.
D’autre part, pour avoir une vue plus exacte du tableau général de la production capitaliste, il ne faut pas oublier que nous avons affaire ici au seul capital employé dans les secteurs productifs de l’économie bourgeoise et que donc sont ignorés les capitaux utilisés dans les secteurs improductifs (commerce, etc.)
Poussé par le goût du paradoxe, Tugan-Baranovsky en vient à rejeter la production capitaliste elle-même et ce qui en fait son but exclusif : la recherche du maximum de plus-value.
Si le programme communiste pouvait admettre une diminution de la consommation totale – dans certaines conditions – il a toujours rejeté avec la plus grande énergie l’idée que le mode de production capitaliste puisse survivre longtemps à une diminution absolue du nombre d’ouvriers. Dans la mesure où une telle diminution signifierait assez rapidement (dès que le ressort de l’augmentation de la productivité et de l’intensité ne compenseraient plus la diminution absolue de la plus-value extorquée, du fait de la réduction du nombre des ouvriers) une diminution de la masse de la plus-value extorquée, le MPC s’acheminerait vers des crises d’une gravité exceptionnelle ; en fait l’on toucherait là à une des limites absolues de la production capitaliste, et par conséquent du progrès de l’automation dans le cadre de la société bourgeoise.
« Du reste, c’est seulement dans le mode de production capitaliste que doit s’accroître absolument le nombre des salariés, en dépit de leur diminution relative. Pour lui, des forces de travail sont en excédent dès lors qu’il n’est plus indispensable de les faire travailler de douze à quinze heures par jour. Un développement des forces productives qui réduirait le nombre absolu des ouvriers, c’est-à-dire permettrait en fait à la nation toute entière de mener à bien en un laps de temps moindre sa production totale, amènerait une révolution parce qu’il mettrait la majorité de la population hors du circuit. Ici encore apparaît la limite spécifique du mode de production capitaliste, et on voit bien qu’elle n’est en aucune manière la forme absolue du développement des forces productives et de la création de richesses ; mais au contraire qu’elle entre en conflit avec eux à un certain point de son évolution. On a un aperçu partiel de ce conflit dans les crises périodiques qui résultent du fait qu’une partie de la population ouvrière, tantôt celle-ci, tantôt une autre, se trouve superflue dans son ancienne branche d’activité. La limite de cette production, c’est le temps excédentaire des ouvriers. L’excédent de temps absolu dont bénéficie la société ne l’intéresse nullement. Pour elle, le développement de la force productive n’est important que dans la mesure où il augmente le temps de surtravail de la classe ouvrière et non pas où il diminue le temps de travail nécessaire à la production matérielle en général, ainsi, elle se meut dans des contradictions. »
(Marx, Capital, Livre III, ES, t.6, pp. 275-276)
Une diminution absolue du nombre d’ouvriers, ce qui aurait rapidement pour conséquence une diminution de la masse de plus-value extorquée par le capital entraînerait rapidement une crise ; une telle possibilité implique donc un progrès de la productivité du travail que le MPC est incapable d’atteindre. Comme le remarquait Boukharine, la composition organique du capital serait particulièrement élevée et, en regard de celle-ci, même si le taux de plus-value était particulièrement important, le taux de profit serait lui, tout à fait dérisoire. La productivité du travail serait phénoménale, de même que la masse de moyens de production et de consommation. Le travail d’un homme suffirait à entretenir l’espèce ! Dans un cas contraire, c’est-à-dire si la productivité du travail n’avait pu croître à la mesure du développement de la composition organique notre ouvrier serait le Robinson capitaliste, seul sur la planète, travaillant pour une immense machinerie lui pourvoyant juste de quoi reproduire sa force de travail et absorbant par l’accumulation la plus-value produite, la composition organique s’élevant d’autant.
Voilà l’admirable perspective que trace Tugan-Baranovsky au mode de production capitaliste, niant ainsi qu’il est justement un mode de production capitaliste et donc un mode de production qui correspond à un certain degré de développement des forces productives, développement qu’il est désormais incapable d’assurer plus avant sans que ces forces se rebellent contre lui.
6.6 La théorie communiste et la sous-consommation
Si Marx rejetait violemment les théories disproportionnalistes, il n’abondait pas pour autant dans le sens des théories sous-consommationnistes. Nous reviendrons plus en détail sur certains points relatifs à cette théorie, contentons-nous pour l’instant de souligner avec Engels que la sous-consommation est une caractéristique des sociétés de classe, par contre les crises de surproduction sont, elles, caractéristiques de la production capitaliste :
« Par malheur, la sous-consommation des masses, la réduction de la consommation de masse au minimum nécessaire à l’entretien et à la procréation n’est pas du tout un phénomène nouveau. Elle a existé depuis qu’il y a eu des classes exploiteuses et des classes exploitées. Même dans les périodes de l’histoire où la situation des masses était particulièrement favorable, par exemple en Angleterre au XVème siècle, elles étaient sous-consommatrices. Elles étaient bien loin de pouvoir disposer de la totalité de leur produit annuel pour le consommer. Si donc la sous-consommation est un phénomène historique permanent depuis des millénaires, alors que la stagnation générale du marché qui éclate dans les crises par suite de l’excédent de la production n’est devenue sensible que depuis cinquante ans, il faut toute la platitude de l’économie vulgaire de M. Dühring pour expliquer la collision nouvelle non pas par le phénomène nouveau de surproduction, mais par celui de sous-consommation qui est vieux de milliers d’année. C’est comme si, en mathématiques, on voulait expliquer la variation du rapport de deux grandeurs, une constante et une variable, non pas par le fait que la variable varie, mais par le fait que la constante reste la même. La sous-consommation des masses est une condition nécessaire de toutes les formes de société reposant sur l’exploitation, donc aussi de la société capitaliste ; mais seule la forme capitaliste de la production aboutit à des crises. La sous-consommation est donc aussi une condition préalable des crises et elle y joue un rôle reconnu depuis longtemps ; mais elle ne nous explique pas plus les causes de l’existence actuelle des crises que celles de leur absence dans le passé. »
(Engels. Anti-Dühring, ES, p. 324)
Par conséquent, il faudra chercher l’origine des crises de surproduction dans ce qui caractérise le nouveau mode de production, c’est-à-dire le mode de production capitaliste. Celui-ci est le règne de l’économie marchande généralisée, là où la force de travail elle-même devient marchandise (salariat), et où le but de la production n’est pas la production de valeurs d’usage, qu’il s’agisse de moyens de production ou de moyens de consommation, mais la création du maximum de surtravail, de plus-value.
« Il ne faut jamais oublier que dans la production capitaliste il ne s’agit pas de valeur d’usage mais de valeur d’échange et spécialement de l’augmentation de la plus-value. C’est là le moteur de la production capitaliste et c’est vouloir embellir les faits que de faire abstraction de sa base même dans le seul but d’évacuer les contradictions de la production capitaliste et d’en faire une production qui est orientée vers la consommation immédiate des producteurs. »
(Marx, TSPL, t.2, p. 590)
Par conséquent, c’est dans les contradictions internes de la production reposant sur le capital qu’il faudra trouver l’origine de la surproduction, c’est-à-dire dans les conditions de la production et de la réalisation de la plus-value et du capital :
« la mesure de cette surproduction c’est le capital lui-même, l’échelle existante des conditions de production et l’appétit effréné d’enrichissement et de capitalisation des capitalistes, mais ce n’est nullement la consommation, qui est entravée d’entrée de jeu, étant donné que la plus grande partie de la population, la population ouvrière ne peut élargir sa consommation que dans des limites très étroites et que d’autre part, la demande de travail diminue relativement dans la mesure même où le capitalisme se développe, bien qu’elle augmente absolument. »
(Marx, p. 587, TSPL, t.II)
Ainsi Marx, dans les mêmes chapitres où il abonde soi-disant dans le sens d’une théorie sous-consommationniste, les rejette en fait explicitement. Si, comme nous l’avons vu, Marx combattait violemment la théorie selon laquelle la production capitaliste crée automatiquement ses propres débouchés, il serait faux de voir là une allégeance à une théorie d’une absence de demande solvable qui viendrait d’autre chose que du développement contradictoire de la production capitaliste, c’est-à-dire d’autre chose que de la résolution périodique dans des crises toujours plus vastes, de la contradiction valorisation/dévalorisation, laquelle se présente sous la forme de la baisse du taux de profit.
« A un certain niveau de croissance, la manufacture (il s’agit donc ici de la phase de soumission formelle NDR) – et plus encore la grande industrie – (phase de soumission réelle, NDR), se crée son propre marché en le conquérant par ses marchandises. Le commerce devient le serviteur de la production industrielle qui ne peut exister sans l’expansion continue du marché. Dans la mesure où il ne fait qu’exprimer la demande existante, ce n’est pas le marché qui limite la production de masse : c’est la grandeur du capital employé et la productivité du travail. »
(Marx, Le Capital, Livre III, p. 1104, La Pléiade, t. 2)
Le capital, pour se valoriser au maximum, pour extorquer le maximum de plus-value à l’ouvrier productif doit en même temps se dévaloriser, c’est-à-dire que les éléments matériels dans lesquels s’incarne la valeur d’échange contiennent une valeur moindre étant donné la hausse de la productivité du travail. Il s’ensuit que toutes choses égales par ailleurs, la même valeur d’échange est contenue dans une masse croissante de marchandises. Assis sur la base de la loi de la valeur, le capital tend à la nier en développant la productivité du travail, productivité qu’il développe, nous l’avons vu, afin d’exploiter au maximum la force de travail prolétarienne.
D’autre part, afin justement d’élever cette productivité du travail et donc d’obtenir le maximum de surtravail, la composition organique du capital, c’est-à-dire le rapport du capital constant (moyens de production, matière premières) au capital variable (salaire) s’élève ; or la plus-value ne provient que de l’exploitation de la force de travail et donc de l’emploi du capital variable. Aussi ce mouvement contradictoire se traduit-il par une baisse tendancielle du taux de profit. Si les contre tendances à cette baisse ne jouent pas assez et donc si ce mouvement se traduit par une chute brutale dans le progrès de la productivité du travail, la baisse du taux de profit interdit alors toute nouvelle accumulation et par là même, réalisation, non seulement de la plus-value ou d’une partie du capital, mais tendanciellement, de la totalité de celui-ci.
Il s’ensuit la nécessité d’une brutale dévalorisation du capital, celle-ci se manifeste par une chute des prix ruineuses pour les capitalistes mais qui ramène le capital à un niveau où grâce à la destruction de la valeur d’échange que contiennent les marchandises l’accumulation pourrait redémarrer. Nous avons vu que cette dévalorisation se présente sous la forme d’une chute des prix, c’est-à-dire ici, de la destruction de la valeur d’échange, mais celle-ci peut avoir lieu en liaison avec ou grâce à la destruction des valeurs d’usage (l’arrêt des ventes entraîne le pourrissement des marchandises, les machines inutilisées se rouillent etc.), et lorsque le MPC a atteint un grand degré de maturité, nous avons déjà dit que cette destruction doit être systématiquement organisée si la classe capitaliste ne veut pas voir la société périr. Cette organisation sur une grande échelle de la dévalorisation du capital existant, la bourgeoisie la réalise dans les guerres impérialistes, guerres réactionnaires qui n’ont d’autres perspectives que le maintien en place d’un mode de production dépassé, mode de production qui ne peut exister qu’en tenant comme dans un étau le prolétariat, et qui n’a d’autre perspective à lui offrir, après avoir raccourci toujours plus la longueur de ses chaînes (quitte à en augmenter le placage doré), que l’holocauste d’une guerre impérialiste sans cesse plus meurtrière.
« Pour l’instant, disons simplement : s’agissant de la reproduction, tout comme pour l’accumulation du capital, il ne s’agit pas de remplacer la même quantité de valeurs d’usage dont se compose le capital, à son ancienne échelle de production ou à une échelle élargie (s’agissant de l’accumulation) mais de remplacer la valeur du capital avancé avec le taux de profit habituel (plus-value). Si donc par suite de quelque circonstance ou d’une combinaison de circonstances, le prix de marché des marchandises (de toutes, ou de la plupart d’entre elles, ce qui n’importe nullement) sont tombés bien au-dessous de leurs coûts de production, alors d’une part il se peut que la reproduction du capital soit contrariée, mais il est encore plus sur que l’accumulation s’arrête. La plus-value accumulée sous forme d’argent (or ou billets) ne pourrait être transformée en capital qu’avec perte. Elle reste donc inutilisée sous forme de trésor dans le coffre des banquiers ou sous forme de crédits, ce qui ne change rien à l’affaire. »
(Marx, TSPL, p. 590)
Ainsi, la crise du MPC est effectivement une crise catastrophique, qui concerne la totalité de la production capitaliste et non une partie, comme l’affirment les théories contre-révolutionnaires, qu’elles soient disproportionnalistes ou sous-consommationnistes. Sur le plan politique les unes conduisent au volontarisme au parti deus ex machina, car il paraît nécessaire d’adjoindre aux conditions objectives une dose de subjectivité afin que le prolétariat puisse s’emparer du pouvoir, d’où aussi le recours à divers expédients tactiques ; les autres conduisent au fatalisme, à la négation du parti et de l’organisation, au pacifisme et à l’abandon de la lutte des classes, le prolétariat n’étant pas capable de parvenir à une conscience de classe après laquelle il est toujours en train de courir. Pour la conception dialectique et révolutionnaire, l’émergence de la crise catastrophique signifie la polarisation des antagonismes, l’exaspération des conflits de classe, qui fait que ceux d’en bas ne veulent plus être gouvernés comme avant, mais aussi que ceux d’en haut ne peuvent plus gouverner comme avant. Elle implique que le prolétariat puisse et doive se constituer en parti politique distinct et opposé à ceux des autres classes, une préparation rigoureuse à l’inévitable guerre de classes, et par conséquent une lutte théorique et pratique sans faille, une organisation militaire systématique tendue vers l’insurrection, et la prise du pouvoir politique, qui ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat s’appuyant sur la violence révolutionnaire, et le recours inflexible à la terreur rouge.
7. La tentative de restauration de Rosa Luxemburg et ses limites
7.1 Rosa Luxemburg adoube Tugan-Baranovsky
Si Rosa Luxemburg allait combattre en communiste orthodoxe le révisionnisme de Tugan-Baranovsky, elle a aussi le tort d’admettre l’une de ses affirmations mensongères, à savoir la prétendue existence d’une contradiction entre le livre II et le livre III du Capital. Pour Tugan-Baranovsky le livre II constitue le point le plus haut atteint par Marx dans sa recherche, car il est écrit après le livre III, et il vient infirmer les théories des crises élaborées dans ce livre III. Rosa Luxemburg estimera elle, qu’il y a des contradictions entre les deux livres, mais elle s’efforcera de montrer que le livre II contient des schémas qui, d’une part sont imparfaits, le livre II étant inachevé, et qui, d’autre part, reposent sur des hypothèses méthodologiques qui les rendent incapables de restituer les processus véritables de l’accumulation.
Rosa Luxemburg admettait que l’on pouvait tirer des schémas la conclusion de la possibilité d’une expansion illimitée de la production capitaliste. Si pour Tugan-Baranovsky il s’agissait d’une idée que Marx n’avait pu, faute de temps, mettre au clair, et qu’il lui revenait pour la première fois de développer, par contre Rosa Luxemburg s’efforçait de montrer que cette nouveauté n’était qu’une réhabilitation vulgaire des théories de Say-Ricardo, l’abdication du programme communiste devant l’économie politique bourgeoise. Dans le même temps elle s’efforçait de réhabiliter le livre III par rapport aux schémas du livre II.
« Le schéma est en contradiction avec la théorie du processus capitaliste global et de son développement, telle qu’elle est exprimée dans le livre III du « Capital ». L’idée fondamentale de cette théorie est la contradiction immanente entre la capacité illimitée d’expansion des forces productives et la capacité limitée d’expansion de la consommation sociale basée sur les rapports de distribution capitaliste. »[43]
(Rosa Luxemburg, p. 18, t.2, Maspero)
« Certes d’après le livre II qui est la seule référence de Tugan-Baranovsky le marché est identique avec la production. Elargir le marché y signifie élargir la production car la production constitue à elle seule le marché... La contradiction indiquée dans le livre III n’existe donc pas d’après le schéma ». (Rosa Luxemburg, t.2, p. 21)
Rosa Luxemburg, afin de montrer la véritable théorie des crises qui se situe, de son point de vue, dans le livre III, est amenée à critiquer les schémas de reproduction de Marx. Comme elle accepte la perspective de Tugan-Baranovsky, d’une contradiction entre les deux livres, afin de préserver l’orthodoxie, elle essaye de montrer que les schémas ont de nombreux défauts et qu’ils ne peuvent pas rendre compte, du fait de leurs présupposés méthodologiques, de la totale réalité de l’accumulation capitaliste.
7.2 Rosa Luxemburg critique des schémas de reproduction
Rosa Luxemburg reprochait aux schémas, outre certaines imperfections « techniques » les points suivants :
1o) Ils ne résolvent pas correctement le problème de la reproduction de la matière monétaire dans la reproduction simple. L’introduction de l’or produit à des fins monétaires fait apparaître un déséquilibre que Rosa Luxemburg se propose de résorber en créant une troisième section, la section des moyens de circulation.
2o) Lorsque Marx prend en compte la circulation monétaire, le schéma de la reproduction élargie est « hérissé d’épines », et il devient défectueux avec la circulation de l’argent. Cependant, pour Rosa Luxemburg, les difficultés que rencontre Marx lorsqu’il expose les problèmes relatifs à cette circulation monétaire, lorsqu’il recherche les « sources d’argent » proviennent d’un problème plus profond et que Marx n’a pas mis en évidence : « d’où vient la demande solvable pour la plus-value ? » Dans ses schémas qui reposent sur l’hypothèse d’une société exclusivement composée d’ouvriers et de capitalistes, Marx ne peut correctement résoudre le problème des « sources d’argent » dans la mesure où le problème qui gît derrière ces difficultés et qu’il n’a pas individualisé est celui de la demande solvable pour réaliser la plus-value. Ce point constitue le leitmotiv de la théorie de Rosa Luxemburg, le point central de ses conceptions. Pour Rosa Luxemburg, il n’est justement pas possible de trouver cette demande solvable au sein d’un mode de production capitaliste pur, c’est-à-dire débarrassé des autres formes de production, donc au sein d’un MPC tel que le symbolisent les schémas. Pour pouvoir réaliser la plus-value, le MPC doit vivre en osmose avec le milieu pré-capitaliste, mais en même temps il le phagocyte, supprimant ainsi progressivement les bases nécessaires à son accumulation.
3o) La prise en considération de la productivité du travail entraîne une disproportion entre les deux sections de la production sociale. Rosa Luxemburg cherche à tenir compte des effets de l’augmentation de la productivité du travail laquelle implique un accroissement de la composition organique. En faisant varier cette composition organique, Rosa Luxemburg fait apparaître, dans le schéma de la reproduction élargie, un excédent de moyens de consommations dans la section II tandis que dans l’autre section, la section I, il y a un déficit de moyens de production.
4o) Le schéma exclut les sautes brusques de production, le développement inégal entre les différentes sections. Enfin, c’est ce que Rosa Luxemburg affirme notamment dans l’extrait ci-dessus, le schéma ne fait apparaître aucune crise hormis celles qui résultent d’une disproportionnalité dans la production, c’est-à-dire faute d’un contrôle de la société sur le processus de production.
Nous consacrerons des développements particuliers à la question de la reproduction de la matière monétaire, question dont la solution ouvre la voie a l’étude de la reproduction des capitaux employés improductivement, et s’il est un domaine où la confusion règne en maître au sein du mouvement communiste, c’est bien celui-là. Les lamentables analyses du C.C.I. ou de la C.W.O. dans leurs « explications » du rôle de la production d’armements sont là pour nous démontrer le long et dur chemin qui reste à parcourir pour que, ne fût-ce qu’une minorité, sans même parler du prolétariat, renoue avec les principes cardinaux du programme communiste.
Si Rosa Luxemburg pense pouvoir relever les difficultés que nous avons énumérées et donc s’il apparaît une contradiction entre les théories des crises telles qu’elles sont ébauchées dans le livre III et celles qu’on peut faire apparaître dans les schémas du livre II, cela est dû, selon Rosa Luxemburg, aux hypothèses sur lesquelles reposent ces schémas. C’est-à-dire que Marx expose le processus de la reproduction élargie au sein d’une société exclusivement capitaliste, et, dans le cadre de cette analyse, il n’est pas possible qu’il y ait d’autres crises que les crises de disproportion.
« Cette hypothèse (une société composée uniquement d’ouvriers et de capitalistes) est une abstraction théorique commode, parfaitement juste quand elle ne fausse pas les données du problème mais qu’elle aide à les exposer dans toute leur pureté. C’est le cas pour l’analyse de la reproduction simple du capital social total, là le problème repose sur les données fictives suivantes : dans une société à mode de production capitaliste, créant par conséquent de la plus-value, la plus-value entière est consommée par ceux qui se l’approprient, par la classe capitaliste. Comment s’effectuerait dans ces conditions la production et la reproduction sociales ? Si la manière même de poser le problème implique que la production n’a pas d’autres consommateurs que les capitalistes et les ouvriers, elle concorde parfaitement avec l’hypothèse de Marx : domination générale et absolue du mode de production capitaliste. Une fiction théorique recouvre théoriquement l’autre. L’hypothèse de la domination absolue du capitalisme est encore admissible par l’analyse de l’accumulation du capital individuel, telle qu’elle est exposée par Marx dans le livre I du « Capital » (...) lorsqu’il analyse par exemple le capital individuel et ses méthodes d’exploitation à l’usine, mais elle me semble gênante et inutile lorsqu’il s’agit de l’accumulation du capital total. »
(Rosa Luxemburg)
En effet, pour Rosa Luxemburg, Marx, dans le livre II, « expose le processus d’accumulation dans une société composée exclusivement d’ouvriers et de capitalistes dans un système de domination générale et absolue de la production capitaliste. ». Aussi, « son schéma ne laisse pas de place, à partir de ces prémisses, à une autre interprétation que celle de la production pour l’amour de la production. » (Rosa Luxemburg. L’accumulation du capital, t.2, p. 10)
Rosa Luxemburg se pose donc le problème de la cohérence entre le livre II et le livre III du Capital. Si une contradiction apparaît dans le schéma du livre II, cela est dû à ce que la méthode d’abstraction utilisée par Marx, si féconde par ailleurs, est inadaptée à l’étude de la reproduction élargie. Aussi, pour Rosa Luxemburg, Marx ne peut que rencontrer des difficultés dans l’étude des schémas de reproduction car il est impossible de répondre – et cela apparaît fort bien à propos des problèmes relatifs à la circulation monétaire – au sein de ceux-ci à la question de l’origine de la demande solvable nécessaire pour la réalisation de la plus-value destinée à l’accumulation.
7.3 L’« Economie » de Marx
Le tort de Rosa Luxemburg est d’avoir monté en épingle des problèmes « techniques » ou des erreurs de calcul, bien réelles dans la mesure où le livre II du « Capital » était inachevé, et d’avoir vu derrière eux des problèmes théoriques insurmontables qui nuisaient à la cohérence d’ensemble du « Capital ».
Or, si le « Capital » est resté inachevé, que dire alors de l’ensemble du projet de Marx, puisque son « Economie » devait compter, comme il est indiqué en 1859 dans l’Avant-propos de la critique de l’économie politique, six rubriques : « Le Capital, la propriété foncière, le travail salarié, l’Etat, le commerce extérieur, le Marché mondial. »
Si l’on se réfère à l’Introduction générale à la critique de l’économie politique (1857), on peut penser que c’est dans le dernier point : le Marché mondial, que devait être incluse une analyse exhaustive des crises. En effet, Marx trace, dans cette introduction, le plan de son étude. Ce plan recoupe tout à fait les rubriques évoquées plus haut.
«1o) Les déterminations qui dans leur généralité abstraite, s’appliquent plus au moins à tous les types de société (...)
2o) Les catégories qui constituent la structure interne de la société bourgeoise et sur lesquelles reposent les classes fondamentales. Capital, travail salarié, propriété foncière. Leur rapport réciproque, Ville et campagne. Les trois grandes classes sociales. L’échange entre celles-ci. Circulation. Crédit (privé).
3o) Synthèse de la société bourgeoise sous la forme de l’Etat. L’Etat considéré en lui-même. Les classes « improductives ». Impôts. Dette publique. Crédit public. La population. Les colonies. Emigration.
4o) La production dans ses rapports internationaux. Division internationale du travail. Echanges internationaux. Exportation et importation. Cours des changes.
5o) Le marché mondial et les crises. » (Marx oeuvres La Pléiade, t. I, p.263)
Par conséquent, ce n’est qu’avec le dernier point avec l’étude du marché mondial, dans lequel s’épanouissent toutes les contradictions de la société bourgeoise, que devait être explicitement développée la théorie des crises. Dans le Capital, resté inachevé, et qui ne forme qu’une des 6 rubriques qui devaient être étudiées, l’on ne considère que le genre des crises, la possibilité des crises, les tendances à la crise qui se manifestent dans le cycle de vie du capital, mais l’étude approfondie des crises n’était pas du ressort du Capital en général ni du livre III en particulier. Cela montre une nouvelle fois l’immense tâche qui attend le véritable mouvement communiste, qui devra renouer avec le fil rouge et entreprendre de mener à bien ce qui n’a été qu’ébauché, c’est-à-dire achever les 6 volumes de l’Economie, dont un seul n’a été que partiellement écrit. Cela ne pourra pas être un simple achèvement d’une oeuvre telle qu’elle aurait pu être, mais enrichie et confirmée par l’expérience historique de ces 100 dernières années. Mais pour ne serait-ce que balbutier une telle tâche, le mouvement communiste devra se débarrasser de gourous tels Grossmann (grand prêtre de la secte C.W.O., par exemple) qui affirmait de manière fantaisiste que Marx avait changé son plan et qu’à la place des 6 rubriques avait été rédigé le Capital qui, bien qu’inachevé, constituait donc un tout harmonieux, et non une partie d’un ensemble plus vaste.
7.4 Les livres du « Capital »
Ni le livre II, ni le livre III ne visaient donc à fournir une théorie des crises pleinement développée. Si Marx voulait publier ces deux livres ensemble, ils ne se situent pas au même degré d’abstraction. N’étant pas destinés à étudier particulièrement les crises et ne se situant pas sur le même plan, il est donc tout à fait normal que, sous l’angle des crises, il ne soit pas possible de faire apparaître les mêmes crises dans les schémas du livre II, qui reposent sur des hypothèses éliminant par définition certains types de crises, que dans le livre III, où est exposée la baisse tendancielle du taux de profit.
Rosa Luxemburg a eu le tort de s’aligner sur le révisionniste Tugan-Baranovsky et de voir dans les deux livres des contradictions alors que, d’une part, leur objet n’était pas l’étude des crises et que, d’autre part, ils ne se situent pas sur le même plan méthodologique.
Alors que le livre I et le livre II du « Capital » s’attachent à analyser le capital « en général », le livre III est consacré à l’étude des « capitaux nombreux », « du capital dans sa diversité ». Le livre I expose l’ensemble du procès de production capitaliste et le livre II, qui se situe au même degré d’abstraction, le procès de circulation. Si bien que les deux livres forment un ensemble dans lequel est exposé l’analyse générale du procès de production et de circulation. Par contre, dans le livre III il faut « rechercher et exposer les formes concrètes qu’engendre ce processus du capital considéré comme un tout. Dans leur mouvement réel, les capitaux s’affrontent sous ces formes concrètes au regard desquelles les formes que le capital revêt dans le processus immédiat de production et dans le processus de circulation apparaissent comme des moments particuliers. Les configurations du capital, telles que nous allons les développer dans ce livre, se rapprochent donc progressivement de la forme sous laquelle elles se manifestent à la surface de la société, dans la concurrence et dans la conscience ordinaire des agents de la production eux-mêmes, et enfin dans l’action réciproque des capitaux. » (Marx, in Pléiade, t. 2 p. 874)
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’ineffable Grossmann, le lien entre les livres du capital n’aboutit pas à reproduire la réalité au moyen d’un processus d’approximations successives allant de l’abstrait au concret, mais implique un changement de niveau, c’est-à-dire que les livres du capital ne se situent pas au même niveau d’abstraction et ne poursuivent pas, dans l’analyse du capital, la même finalité.
Cela, Rosa Luxemburg ne l’a pas compris, aussi voit-elle des contradictions là où il ne saurait y en avoir. Nous avons donc, d’un coté, les livres I et II du « Capital » qui étudient le capital « en général » et, d’un autre coté, le livre III qui examine l’action réciproque des capitaux et donc s’intéresse au capital « dans sa diversité ». C’est pour cette raison que, par exemple, ce n’est que dans le livre III que l’on peut tenir compte de la décomposition de la plus-value entre les différentes fractions de la classe capitaliste (ainsi que les propriétaires fonciers) qui se l’approprient.
Rosa Luxemburg n’a pas noté la différence méthodologique dans l’analyse du capital qui existe entre le livre II et le livre III. Elle est donc conduite à admettre l’existence de contradictions dans l’œuvre de Marx. Il est cependant inexact de penser, comme l’affirme le trotskiste Rosdolsky, que Rosa Luxemburg jugeait inadéquates les hypothèses de Marx lorsque l’on quitte l’analyse des processus économiques du point de vue du capitaliste individuel pour les analyses du point de vue du capital total. Rosa Luxemburg a, au contraire, toujours su montrer l’importance de la catégorie du capital total et l’enjeu méthodologique qu’il y avait à se placer du point de vue de la totalité, c’est-à-dire du point de vue du prolétariat révolutionnaire, dans la lutte contre le révisionnisme. Ce qu’elle reproche à Marx ce n’est donc pas sa méthode d’abstraction pour l’analyse du capital total mais pour l’analyse de l’accumulation du capital total, donc uniquement dans l’étude de la reproduction élargie.
« Si je considère par exemple la totalité du capital d’une nation en l’opposant à la totalité du travail salarié (ou de la propriété foncière ou si je considère le capital en l’opposant à la base économique générale d’une classe à la différence d’une autre classe, je le considère en général. »
(Marx, Grundrisse)
Aussi Marx procède, dans le livre II, dans le cadre d’une étude du « capital en général », du « capital en tant que tel » à l’analyse abstraite de la reproduction du capital total. Il est donc tout à fait en droit d’ignorer certains éléments qui doivent être méthodologiquement examinés ultérieurement.
« Nous n’avons à considérer ici que les formes empruntées par le capital au cours des différentes étapes de son évolution. Par conséquent, nous n’exposerons pas les conditions concrètes au sein desquelles s’effectue le véritable processus de la production. On supposera toujours que la marchandise est vendue à sa valeur. On ne tiendra compte ni de la concurrence ni du crédit, ni de la structure réelle de la société : celle-ci est loin d’être constituée uniquement par la classe des ouvriers et des capitalistes industriels ; consommateurs et producteurs n’y sont pas identiques. La première catégorie, celle des consommateurs (dont les revenus ne sont pas tous primaires, mais en partie secondaires, dérivés du profit et du salaire) étant de beaucoup la plus large, le volume de son revenu et la manière dont elle le dépense entraînent de très importantes modifications dans l’équilibre économique et particulièrement dans les processus de la circulation et de la reproduction du capital. Toutefois l’analyse de l’argent nous a déjà montré que celui-ci renferme en lui la possibilité des crises non seulement du fait de sa différence avec la forme naturelle de la marchandise mais à cause de sa fonction de moyen de paiement. Cela apparaît bien davantage quand on examine la nature générale du capital, même sans entrer dans le détail des rapports réels, qui constituent dans leur ensemble les conditions du véritable processus de la production. »
(Marx Oeuvres, ed. La Pléiade, t. 2 p. 460)
On peut mesurer ici la profondeur des critiques d’un Samuelson, par exemple, qui reproche à Marx de ne pas tenir compte du crédit dans ses schémas de reproduction alors que, à ce stade de l’analyse, Marx l’avait explicitement écarté. De cette manière, étant donné que le cadre de l’étude était celui du capital en général, Marx se devait d’ignorer certains aspects fondamentaux pour une compréhension plus approfondie des crises et de leur manifestation. Rosa Luxemburg en ne comprenant pas cela a cru voir des contradictions là où il n’y avait qu’un changement méthodologique dans l’analyse du capital, et en faisant cette erreur elle acceptait les présupposés du révisionnisme. Elle va donc être conduite à voir dans les schémas des lacunes théoriques là où tout au plus il y avait quelques erreurs de calcul qui auraient été rectifiées si Marx avait eu le loisir de mener à terme l’ensemble de l’ouvrage.
Dans cette première partie, nous avons essayé de réfuter les présupposés méthodologiques justifiant une prétendue contradiction entre le livre II et le livre III. Nous devons encore examiner une objection de Rosa Luxemburg : celle qui lie l’étude du capital total à l’existence d’une société capitaliste dans laquelle subsisteraient encore des formes de production pré-capitalistes. Cela nous conduit, en fait, à analyser la théorie des crises de Rosa Luxemburg, crises qui résultent, pour elle, d’une absence de demande solvable pour la plus-value à capitaliser.
8. La crise chez Rosa Luxemburg
8.1 Rappel des résultats obtenus précédemment
Dans le chapitre précédent, nous avons essayé de montrer que la prétendue existence d'une contradiction sur le plan de la théorie des crises entre le livre II et le livre III du capital était sans fondements. Cette thèse, soutenue par le révisionnisme pour abattre la théorie révolutionnaire et substituer à la perspective de la crise catastrophique du MPC celle d'un cours harmonieux de celui-ci, a été malheureusement acceptée également par Rosa Luxemburg dans l'espoir de remettre en selle la théorie révolutionnaire ; mais ce faisant elle imagine trouver des contradictions au sein du livre II du capital.
Or, "Le Capital" n'était qu'une partie d'un ensemble plus vaste, "l'Economie" composé de 6 ouvrages dont le dernier était, lui, explicitement réservé à l'analyse des crises. Par conséquent il ne fallait pas attendre du "Capital" une analyse particulière des crises, mais tout au plus, en fonction des aspects étudiés, des indications plus ou moins importantes pour l'appréhension de celles-ci . D'autre part, non seulement le livre II, tout comme le livre III, ne visaient pas à fournir une théorie développée des crises, mais encore ils ne se situaient pas l'un et l'autre au même niveau d'abstraction. Du fait de cette différence, les enseignements que l'on pouvait tirer quant à la théorie des crises n'étaient pas les mêmes.
Dans le livre II, pour des raisons méthodologiques tenant à l'analyse du capital, Marx avait fait certaines hypothèses qui impliquaient qu’il ne prendrait pas en considération – et ce n'était pas l'objet du « Capital », nous l'avons vu – certains aspects fondamentaux pour la connaissance des crises. Sans pour autant répondre complètement au problème des crises, le livre III – qui n'avait pas plus ce but que le livre II, du fait de son niveau d'abstraction: l'analyse du capital "dans sa diversité" – reprenait parfois des éléments fort utiles à la compréhension des crises, qui avaient été explicitement écartés du livre II. Par conséquent, nulle contradiction entre les livres II et III du Capital, mais une différence sur le plan méthodologique. Et s'il y a bien quelques imperfections dans les schémas de Marx, elles sont d'ordre technique – elles résultent de l'inachèvement de ce livre – et non d'ordre théorique.
8.2 Ce que la théorie de Rosa Luxemburg n’est pas
Il nous restait à voir une dernière objection méthodologique de Rosa Luxemburg. Celle-ci reproche, en effet, à Marx d'avoir analysé la société capitaliste sous sa forme pure, comme si elle était exclusivement composée d'ouvriers et de capitalistes. Par conséquent, Marx aurait commis l'erreur de ne pas tenir compte des relations que le MPC entretient avec d'autres formes de production. Ces relations sont fondamentales pour le MPC et notamment – c'est le fond de la théorie de Rosa Luxemburg sur l'accumulation – pour la réalisation de la plus-value. Répondre à cette objection revient en fait à critiquer la théorie de la réalisation de la plus-value telle que la développe Rosa Luxemburg, c'est donc ce point qu'il nous faut maintenant analyser.
Nous ne commenterons pas ici ce qui, pour certains, est la théorie de Rosa Luxemburg. C'est-à-dire que, tout comme Rosa Luxemburg elle-même, nous ne considérerons pas que les résultats développés dans le chapitre 25 de son oeuvre (qui en compte 32), soient le nec plus ultra de sa théorie. Comme elle aura l'occasion de l'opposer à ses critiques dans sa réponse : "Critique des critiques ou ce que les épigones ont fait de la théorie marxiste", sa conception se cantonne à un point de vue exposé au long de son ouvrage et qui peut se résumer par la question : "D'où vient la demande solvable pour la plus-value à accumuler ?"
En conséquence, nous ne discuterons pas ici les conclusions du chapitre 25 consacré aux contradictions du schéma de la reproduction élargie. Dans cette analyse, elle fait apparaître sous l'effet d'une hausse de la composition organique du capital une disproportion entre le secteur des moyens de production et le secteur des moyens de consommation, si bien qu'il existe une surproduction de moyens de consommation d'un côté et une sous-production de moyens de production de l'autre. C'est surtout ce résultat que vont contester, par exemple, O. Bauer ou A. Pannekoek. Mais, indépendamment de la valeur des réponses qui sont apportées, il faut noter que nous avons affaire là à une disproportion (sous production d'un côté, sur production de l'autre, crise partielle admise par les Say et les Tougan-Baranowski) et ce n'est donc pas sur ce type de crise que l'on pouvait fonder la perspective de la révolution communiste. Si des auteurs pseudo-marxistes comme Léon Sartre font de telles crises la base de leur conception, il n'en va pas de même chez Rosa Luxemburg.
8.3 La théorie des crises de Rosa Luxemburg
8.3.1 Le saut périlleux de la marchandise
Pour Rosa Luxemburg, le procès de production capitaliste a pour but la production de plus-value, cependant pour que celle-ci puisse être capitalisée c'est-à-dire accumulée, il faut auparavant que la plus-value ait revêtue la forme argent. Tout cela est à première vue, parfaitement conforme avec ce que Marx a toujours affirmé.
"Le procès de production... prend fin dès que les moyens de production sont transformés en marchandise dont la valeur excède celle de leurs éléments constitutifs ou renferme une plus-value en sus du capital avancé. Les marchandises doivent alors être jetées dans la sphère de la circulation. Il faut les vendre, réaliser leur valeur en argent, puis transformer de nouveau cet argent en capital et ainsi de suite....La première condition de l'accumulation, c'est que le capitaliste ait déjà réussi à vendre ses marchandises et à retransformer en capital la plus grande partie de l'argent ainsi obtenu." (Marx)
Pour Rosa Luxemburg, le problème de la réalisation du capital et de la plus-value revêt une acuité particulière lorsqu'on aborde la reproduction du capital total, plus exactement, lorsqu'on considère la reproduction élargie du capital total. En effet, d'après elle, dans le cadre de la reproduction simple, cadre il est vrai tout à fait théorique dans le MPC, il n'y a pas vraiment de difficulté pour se représenter le processus de reproduction ainsi que la réalisation du produit social qui lui est subordonné.
Dans la reproduction simple, donc, le capital ne rencontre pas de difficultés. Le capital constant usé doit être remplacé et ce renouvellement occasionne une demande pour cette fraction du capital, fraction formalisée par ‘c’ dans les schémas de reproduction. De même, l'équivalent du capital variable est reproduit sans problème. Les ouvriers ont reçu leur salaire et en le dépensant, ils réalisent la partie représentée par ‘v’ du produit social.
Si la demande pour les moyens de production usés permet la reproduction de l'intégralité du capital de la section I, la demande de moyens de consommation de la part des ouvriers ne permet la réalisation que d'une partie du capital de la section II. Pour que la reproduction simple soit complète il faut prendre en compte la demande de moyens de consommation fournie par la classe capitaliste qui, pour sa reproduction en tant que classe, dépense la totalité de la plus-value à des fins de consommation individuelle. Par conséquent, l'ensemble du produit social est réalisé. La classe capitaliste a dans sa totalité l'argent qu'elle a avancé pour les moyens de production, et elle se sert de celui-ci pour renouveler le capital constant usé au cours du procès de production. Les ouvriers, en dépensant leur salaire en achats de moyens de consommation permettent à la classe capitaliste de récupérer le capital variable avancé, tandis qu'ils réalisent la partie du produit social équivalent à ‘v’. Enfin, la plus-value est entièrement consommée par la classe capitaliste. Sa réalisation en argent ne pose donc pas de problème ; des capitalistes provient une demande solvable motivée par la nécessité de se reproduire comme classe. Il faut bien remarquer, si l'on ne veut pas faire de critiques injustifiées à Rosa Luxemburg, qu'elle ne se pose pas ici le problème de l'origine de l'argent nécessaire à la réalisation du produit social (que cette origine soit la production d'or, le crédit, …, ne nous intéresse pas ici). Elle ne pose cette question que pour essayer de mettre en évidence ce qui lui parait être une difficulté que rencontre Marx dans l'élaboration de ses schémas. Cette difficulté, en fait, révèle, pour Rosa Luxemburg, un problème beaucoup plus important : celui de la demande solvable pour réaliser la plus-value à capitaliser, problème qui est au centre de la conception de la crise de Rosa Luxemburg.[44]
Si, dans le cadre de la reproduction simple, le MPC ne rencontre aucune difficulté pour la réalisation de la plus-value, il n'en va pas de même quand on aborde la reproduction élargie. La reproduction simple était une fiction théorique qui se justifiait pour l'analyse de la reproduction. Mais elle ne correspond en aucun cas à une relation particulière du MPC, lequel a pour perspective la recherche du maximum de plus-value, l'accumulation de la plus-value pour l'obtention d'une plus-value toujours plus grande. Cette hypothèse fictive s'accordait fort bien avec cette autre hypothèse que la société était exclusivement composée d'ouvriers et de capitalistes, la consommation des classes improductives et des diverses fractions des classes dominantes étant comptée dans la consommation de la classe capitaliste prise comme un tout. Par contre, les choses ne vont pas aussi facilement avec la reproduction élargie.
Nous avons à faire ici avec une hypothèse qui correspond effectivement à l'essence de la production capitaliste. Dans ce cadre, une partie de la plus-value est accumulée ; cependant Rosa Luxemburg s'efforce de montrer que cette plus-value ne peut, avant de pouvoir être accumulée, trouver d'acheteurs solvables – si l'on demeure dans l'hypothèse d'une société exclusivement capitaliste, c'est-à-dire l'hypothèse retenue dans les schémas et, plus généralement, dans l'analyse théorique du capital – capables de permettre sa réalisation sous forme de capital argent.
Pour les autres parties du capital social, la réalisation s'opère sans difficultés – le raisonnement est le même que dans la reproduction simple –. Les moyens de production utilisés dans le processus de production devant être renouvelés, une demande solvable existe alors pour ceux-ci. Il en va de même pour les moyens de consommation nécessaires à la reproduction de la force de travail. En réalisant leur valeur, les ouvriers permettent aux capitalistes de récupérer le capital variable qu'ils avaient avancé. Pour la partie de la plus-value consommée à des fins individuelles par la classe capitaliste et les classes qui vivent de la plus-value, il existe également une demande solvable ; ces classes devant se reproduire comme classe. Il reste alors une partie de la plus-value à réaliser, la partie qui doit être accumulée. Celle-ci revêt la forme de moyens de production et de moyens de consommation. Pour pouvoir être accumulée elle doit auparavant être réalisée, c'est-à-dire qu'elle doit se dépouiller de la forme capital marchandise pour revêtir la forme capital argent. Ce n'est qu'alors qu'elle pourra se convertir de capital argent en capital productif pour effectuer un cycle de production sur une échelle plus vaste que la précédente. La réalisation de cette partie de la plus-value exige, comme pour les autres parties du produit social, une demande solvable. Il faut donc des acheteurs qui soient à même de considérer les moyens de production et de consommation sous l'angle de leur valeur d'usage. II faut que la marchandise trouve un acheteur. Or l'existence de celui-ci ne découle pas automatiquement de l'organisation sociale capitaliste. Au contraire, la production se fait de manière anarchique et nul vendeur ne sait s'il trouvera un acheteur pour sa marchandise.
"La valeur de la marchandise saute de son propre corps dans celui de l'or. C'est son saut périlleux. S'il manque, elle ne s'en portera pas plus mal, mais son possesseur sera frustré. Tout en multipliant ses besoins, la division sociale du travail a du même coup rétréci sa capacité productive. C'est précisément pourquoi son produit ne lui sert que de valeur d'échange ou d'équivalent général. Toutefois, il n'acquiert cette forme qu'en se convertissant en argent et l'argent se trouve dans la poche d'autrui. Pour le tirer de là, il faut avant tout que la marchandise soit valeur d'usage pour l'acheteur, que le travail dépensé en elle l'ait été sous une forme socialement utile ou qu'il soit légitimé comme branche de la division sociale du travail. Mais la division du travail crée un organisme de production spontané dont les fils ont été tissés et se tissent encore à l'insu des producteurs échangistes. Il se peut que la marchandise provienne d'un nouveau genre de travail destiné à satisfaire ou même à provoquer des besoins nouveaux. Entrelacé, hier encore, dans les nombreuses fonctions dont se compose un seul métier, un travail parcellaire peut aujourd'hui se détacher de cet ensemble, s'isoler et envoyer au marché son produit partiel à titre de marchandise complète sans que rien garantisse que les circonstances soient mûres pour ce fractionnement. (....)
L'organisme social de production, dont les membres disjoints – menbra disjecta – naissent de la division du travail, porte l'empreinte de la spontanéité et du hasard, que l'on considère ou les fonctions mêmes de ses membres ou leurs rapports de proportionnalité. Aussi nos échangistes découvrent-ils que la même division du travail, qui fait d'eux des producteurs privés indépendants, rend la marche de la production sociale, et les rapports qu'elle crée, complètement indépendants de leurs volontés, de sorte que l'indépendance des personnes les unes vis-à-vis des autres trouve son complément obligé en un système de dépendance réciproque, imposée par les choses." (Marx. Capital Livre I.1 chap.III. Ed. Garnier p.91-2)
8.3.2 Une réalisation impossible dans le cadre du mode de production capitaliste
Si l'on dit que ce sont les capitalistes qui achètent ces moyens de production et de consommation – et c'est effectivement ce que les schémas affirment – il n'y a pas dans ce cas accumulation du capital puisque c'est sous l'angle de la valeur d'usage que les marchandises sont achetées[45]. Il y a tout au plus accumulation, entassement de moyens de production et de consommation, mais pas accumulation de capital qui signifie recherche du maximum de plus-value, les capitalistes étant alors intéressés non par la valeur d'usage en tant que telle mais par la valeur d'échange, par la recherche du maximum de valeur d'échange extra, bref, de plus-value.
Tant que l'on a affaire à la reproduction du capital constant dépensé dans le processus de production, au renouvellement des moyens de production usés, cette demande solvable est cohérente du point de vue de la classe capitaliste. Il s'agit de remettre dans l'état antérieur l'appareil productif capitaliste ; aussi la demande de moyens de production avait-elle un sens pour les capitalistes. De même, en ce qui concerne la partie de la plus-value dépensée par les capitalistes pour se reproduire comme classe. Ce sont les besoins personnels des capitalistes qui engendrent une demande solvable dans la mesure où ceux-ci disposent du surproduit social. Pour la partie du capital social équivalent à ‘v’, au capital variable, il n'y a pas non plus, d’après Rosa Luxemburg, de difficulté pour la réaliser, les ouvriers dépensent leur salaire dans le but de reproduire leur force de travail.
Par contre, il est impossible de trouver au sein de la société capitaliste pure – c'est-à-dire telle qu'elle est schématisée par Marx – une demande solvable pour la plus-value à accumuler. Il faut, de plus, que cette demande solvable soit croissante à mesure que l'accumulation du capital progresse. Marx montre que la forme de circulation caractéristique du capital est A-M-A' argent - marchandise- argent incrémenté d'une plus-value, tandis que la forme de la circulation simple est M-A-M marchandise -argent- marchandise .
"La forme immédiate de la circulation des marchandises est M – A - M, transformation de la marchandise en argent et retransformation de l'argent en marchandise, vendre pour acheter. Mais à côté de cette forme nous en trouvons une autre, tout à fait distincte, la forme A – M - A (argent – marchandise - argent), transformation de l'argent en marchandise et retransformation de la marchandise en argent, acheter pour vendre." (Marx. Oeuvres . Pléiade T.l p.692)
"Dans la circulation M – A - M, l'argent est enfin converti en marchandise qui sert de valeur d'usage ; il est donc définitivement dépensé. Dans la forme inverse A – M – A, l’acheteur donne son argent pour le reprendre comme vendeur. Par l'achat de la marchandise, il jette dans la circulation de l'argent, qu'il en retire ensuite par la vente de la même marchandise. S'il le laisse partir, c'est seulement avec l'arrière pensée perfide de le rattraper. Cet argent est donc simplement avancé." (id. p.694)
"Le cercle M – A - M a pour point initial une marchandise et pour point final une autre marchandise qui ne circule plus et tombe dans la consommation. La satisfaction d'un besoin, une valeur d'usage, tel est donc son but définitif. Le cercle A – M – A, au contraire, a pour point de départ l'argent et y revient ; son motif, son but déterminant est donc la valeur d'échange." (id. P.695)
Dans le cadre de l'accumulation du capital total, lorsque Rosa Luxemburg examine le problème de la réalisation, la phase A - M est déjà accomplie, il faut maintenant réaliser M en argent, parcourir la phase M - A.
Si l'on dit que ce sont les capitalistes qui réalisent M, ils le font ici dans le cadre d'une formule M – A, c'est-à-dire la formule de la circulation simple et non celle de l'accumulation du capital. La marchandise doit satisfaire un besoin et son but est la valeur d'usage, or l'accumulation est de forme A - M et son but est la valeur d'échange.
8.3.3 Les relations avec les formes de production pré capitalistes
Par conséquent, la plus-value ne peut être réalisée au sein d'une société composée exclusivement de capitalistes et d'ouvriers. Tant qu'on se plaçait sous l'angle du capitaliste individuel, il était facile de concevoir qu'il puisse exister une demande pour sa marchandise - Marx démontre toutefois que celle-ci n'a rien d'automatique et qu'une scission entre la vente et l'achat est tout à fait possible. Par conséquent, la transformation de la valeur en argent, la réalisation de la valeur contient la possibilité d'une crise. Par contre, lorsqu'on se place du point de vue du capital total, la réalisation de la plus-value à capitaliser ne peut être obtenue, la demande solvable pour celle-ci faisant défaut. Tant qu'on reste dans le cadre des rapports de production capitalistes, il est impossible de réaliser la plus-value destinée à l'accumulation. La seule perspective qu'a le capital c'est de trouver des acheteurs solvables, acheteurs qui ne peuvent se trouver qu'en dehors de la production capitaliste et donc au sein des rapports de production pré-capitalistes aussi bien à l'intérieur de la nation capitaliste qu'à l'extérieur de celle-ci. Cette extension vers l'extérieur constitue une manifestation de l'impérialisme, manifestation organique du MPC. Il va de soi que le commerce extérieur inter-capitaliste ne peut être considéré comme une solution de la difficulté. Cela ne ferait que déplacer le problème d'un pays à l'autre pour le retrouver à une échelle plus grande dans la totalité du monde capitaliste. Ce ne sont donc que les relations que le MPC entretient avec les formes de production pré-capitalistes qui peuvent assurer la réalisation de la plus-value. Donc, pour Rosa Luxemburg ce n'est que dans les secteurs pré-capitalistes que l'on va pouvoir trouver des acheteurs pour la partie de la plus-value destinée à l'accumulation. Si l'achat par les capitalistes de la plus-value ne signifiait qu'une accumulation de moyens de production et de consommation, c'est-à-dire une accumulation de valeurs d'usage, cela impliquerait donc une perspective totalement absurde pour le MPC assoiffé de plus-value. En revanche, dès qu'intervient un pouvoir d'achat extérieur au MPC le problème peut trouver une solution.
Les acheteurs des formes de production pré-capitalistes peuvent eux, à la différence des capitalistes, sans changer l'orientation de leur mode de production, considérer le capital marchandise équivalent à la plus-value destinée à l'accumulation sous l'angle de la valeur d'usage. Eux seuls peuvent avoir besoin de cette masse de marchandises supplémentaires, et la demande solvable qu'ils dégagent permet la réalisation de la plus-value, permet à la plus-value de passer de la forme capital marchandise à la forme capital argent. A partir du moment où la plus-value est réalisée, où le cycle A-M-A' est enfin bouclé, la classe capitaliste peut se lancer dans l'accumulation du capital, réaliser son être et assouvir sa passion, la recherche du maximum de plus-value. L'accumulation de la plus-value pour la plus-value[46].
"Jusqu'à présent nous n'avons considéré la reproduction élargie que d'un seul point de vue, à savoir comment la réalisation de la plus-value est possible. C'était là la difficulté qui préoccupait exclusivement les sceptiques. En fait la réalisation de la plus-value est la question vitale de l'accumulation capitaliste. Si l'on fait abstraction, pour simplifier les choses, des fonds de consommation des capitalistes, on constate que la réalisation de la plus-value implique comme première condition un cercle d'acheteurs situé en dehors de la production capitaliste, nous disons bien d'acheteurs et non de consommateurs. En effet, la réalisation de la plus-value n'indique pas à priori la forme matérielle où s'incarne la plus-value. Ce qui est certain, c'est que la plus-value ne peut être réalisée ni par les salariés ni par les capitalistes, mais seulement par des couches sociales ou des sociétés à mode de production précapitalistes. On peut imaginer ici deux possibilités différentes de réalisation: l'industrie capitaliste peut produire un excédent de moyens de consommation au-delà de ses propres besoins (ceux des ouvriers et des capitalistes) elle vendra cet excédent à des couches sociales ou à des pays extra-capitalistes." (Rosa Luxemburg. L'accumulation du capital p.29 T.2)
La réalisation de la plus-value
"... est liée de prime abord à des producteurs et à des consommateurs non capitalistes comme tels. L'existence d'acheteurs non capitalistes de la plus-value est une condition vitale pour le capital et pour l'accumulation en ce sens elle est décisive dans le problème de l'accumulation du capital. Quoiqu'il en soit, pratiquement l'accumulation du capital comme processus historique dépend à tous les égards des couches sociales et des formes de société non capitalistes. La solution conforme à l'esprit de la doctrine de Marx est dans la contradiction dialectique selon laquelle l'accumulation capitaliste a besoin pour se mouvoir de formations sociales non capitalistes autour d'elle, qu'elle se développe par des échanges constants avec ces formations et ne peut subsister sans les contacts avec un tel milieu.
C'est en partant de là que l'on peut réviser les conceptions du marché intérieur et du marché extérieur qui ont joué un rôle si important dans les controverses théoriques autour du problème de l'accumulation. Le marché intérieur et le marché extérieur tiennent certes une place importante et très différente l'une de l'autre dans la poursuite du développement capitaliste; mais ce sont des notions non pas de géographie, mais d'économie sociale. Le marché intérieur du point de vue de la production capitaliste est le marché capitaliste, il est cette production elle-même dans le sens où elle achète ses propres produits et où elle fournit ses propres éléments de production. Le marché extérieur pour le capital est le milieu social non capitaliste qui l'entoure, qui absorbe ses produits et lui fournit des éléments de production et des forces de travail. De ce point de vue économiquement parlant, l'Angleterre et l'Allemagne constituent presque toujours l'une pour l’autre un marché intérieur, à cause des échanges constants de marchandises, tandis que les consommateurs et producteurs paysans d'Allemagne représentent un marché extérieur pour le capital allemand." (Rosa Luxemburg. L'accumulation du capital .T.2 p.42)
La plus-value enfin réalisée, le capital argent peut de nouveau être accumulé, la valeur peut se dépouiller de sa forme-argent pour revêtir celle de moyen de production et de force de travail pour pouvoir se valoriser au sein du processus de production grâce à l'exploitation du travail salarié. Cependant, à la fin du procès de production, se repose le problème de la réalisation de la plus-value lequel ne trouve une solution que dans les relations que le MPC entretient avec les formes de production pré-capitalistes. Mais ici, d'après Rosa Luxemburg, le MPC entre progressivement dans une contradiction insurmontable. Ces relations, indispensables au MPC, sont détruites par lui au fur et à mesure qu'il les recherche. En entraînant les formes de production pré-capitalistes dans son orbite, il les détruit et cette phagocytose réduit la base nécessaire à la réalisation d'une plus-value qui croît sans cesse avec l'accumulation capitaliste. Par conséquent, en devenant sans cesse plus pur, en se mettant à se rapprocher toujours plus du "modèle" décrit dans les schémas, le MPC voit s'approcher son effondrement. Ainsi s'annonce la catastrophe sociale prédite par Marx et son école, derrière laquelle se profile le spectre de la révolution prolétarienne.
"Voici donc le résultat général de la lutte entre le capitalisme et la production marchande simple : le capital se substitue à l'économie marchande simple après avoir installé celle-ci à la place de l’économie naturelle. Si le capitalisme vit des formations et des structures non capitalistes il vit plus précisément de la survie de ces structures, et s'il a absolument besoin pour accumuler d'un milieu non capitaliste c'est qu'il a besoin d'un sol nourricier aux dépens duquel l'accumulation se poursuit en l'absorbant. Vue dans une perspective historique, l'accumulation capitaliste est une sorte de métabolisme entre les modes de production capitaliste et pré-capitalistes. Sans les formations précapitalistes, l'accumulation ne peut se poursuivre, mais en même temps elle consiste dans leur désintégration et leur assimilation. L'accumulation capitaliste ne peut donc plus exister sans les structures non capitalistes que celles-ci coexister avec l'accumulation. L'accumulation du capital a pour condition vitale la dissolution progressive et continue des formations pré-capitalistes." (idem, p.89)
"L'hypothèse de base du schéma marxien de l'accumulation ne correspond donc qu'à la tendance historique objective du mouvement de l'accumulation et à son terme théorique. L'accumulation tend...à établir la domination absolue et générale de la production capitaliste dans tous les pays et dans toutes les branches de l'économie. Mais le capital s'engage ici dans une impasse. Le résultat final une fois acquis – en théorie du moins – l'accumulation devient impossible, la réalisation et la capitalisation de la plus-value deviennent des problèmes insolubles. Au moment où le schéma marxien de la reproduction élargie correspond à la réalité il marque l'arrêt, les limites historiques du processus de l'accumulation, donc la fin de la production capitaliste.
L'impossibilité de l'accumulation signifie du point de vue capitaliste l'impossibilité du développement ultérieur des forces productives objective de l'effondrement du capitalisme. D'où le comportement contradictoire du capitalisme dans la phase ultime de sa carrière historique : l'impérialisme." (idem. p.89)
9. Le marxisme vulgaire contre Rosa Luxemburg
9.1 Les réactions dans la social-démocratie
L'édition du livre de Rosa Luxemburg déclencha une vaste polémique dans la social-démocratie internationale.
L'enjeu, du côté des révisionnistes, n'était évidemment pas la sauvegarde de la théorie communiste des crises, mais son anéantissement. Aussi la critique, même au sein du PS allemand, prit-elle une tournure toute particulière, avec pour perspective la démolition de tout ce qui pouvait constituer une défense de l'orthodoxie révolutionnaire, même sous une forme affaiblie.
"Le compte-rendu publié par le Vorwärts du 16 février 1913 surprend par son ton et son contenu, même les lecteurs peu familiarisés avec cette matière, et il frappe d'autant plus que le livre critiqué présente un caractère purement théorique, ne contient de polémique contre aucun marxiste vivant, s'en tenant au contraire à une objectivité rigoureuse .
Ce n'était pas assez. Les autorités lancèrent une campagne, qui fut menée en particulier par l'organe central du parti, avec un zèle étrange contre ceux qui avaient parlé favorablement du livre.
Jamais que je sache dans la littérature du parti depuis ses origines, une oeuvre nouvelle n'avait connu un tel sort, et pourtant les maisons d'édition social-démocrates n'ont pas toujours publié que des chefs d’œuvre dans les dernières décennies. Ce qui est curieux dans cette opération, c'est que, manifestement d'autres passions que celle de la "science pure" ont été touchées par mon ouvrage."
(Rosa Luxemburg. Accumulation du capital, pp.139-140)
Rosa Luxemburg, surprise par le ton et l'ampleur des critiques publia une réponse "Critique des critiques ou ce que les épigone ont fait de la théorie marxiste". Parmi les critiques de l’époque, on trouve Otto Bauer, Pannekoek, Eckstein, etc.
Lénine désirait entreprendre une critique de Rosa Luxemburg, mais il n'eut pas le temps de mettre son projet à exécution. Tout au plus, peut-on noter une certaine concordance entre son opinion et les critiques que feront Bauer, Pannekoek et Eckstein.
Dans une lettre aux éditeurs du "Social-Démocrate", il écrit:
"Je viens de lire le nouveau livre de Rosa. Elle déraisonne d'une manière incroyable et se détourne de Marx. Je suis content que aussi bien Pannekoek que Eckstein et Otto Bauer aient rejeté unanimement son livre en avançant contre lui les mêmes arguments que ceux que j'avais déjà utilisés en 1899 contre les narodniks."
(Mars 1913)
En 1915 dans son livre sur Marx, il écrit:
"La théorie de l'accumulation du capital de Marx est étudiée dans un nouveau livre de Rosa Luxemburg. On trouve une analyse de son interprétation erronée dans l'article d'Otto Bauer dans Die Neue Zeit, 1913 et dans les articles de Eckstein dans le Vorwärts et de Pannekoek dans la Bremen BurgerZeitung."
S'il est, certain que Lénine ne partageait pas les vues de Rosa Luxemburg, il est exagéré de dire de ces quelques commentaires (ce que tend à faire un Mattick, par exemple) qu'il était d'accord avec tout ce qu'un Bauer pouvait écrire.
L'étude d'une très grande partie des critiques montre que leurs auteurs n'ont pas compris de quoi il s'agissait.
Que dire alors des nains qui s'agitent dans le soi-disant milieu révolutionnaire !!! Qu'il s'agisse des critiques comme la C.W.O. ou bien, ce qui est encore pire, des épigones comme le C.C.I., ce n'est qu'un même concert d'inepties.
Les critiques de Rosa Luxemburg, passés ou présents, affirment en général qu'il n'y a jamais eu de problème de la réalisation, que les schémas montrent qui achète la plus-value, que la production crée son propre marché, que les problèmes n'existent que dans la tête de Rosa Luxemburg, qui en outre n'aurait pas su compter et n'aurait jamais compris le fonctionnement des schémas de Marx .
9.2 Otto Bauer
Une partie des critiques de l’époque, tout comme l'ont été d'ailleurs les critiques ultérieures, est consacrée à l'analyse des objections qui découlent de l'introduction de l'augmentation de la composition organique dans les schémas. C'est à ce genre d'exercices que se livrent Bauer et Pannekoek. Bauer fut pratiquement le seul à penser qu'il était nécessaire de faire une réponse particulière au problème que posait Rosa Luxemburg, qu'il y avait là matière à une explication spéciale. Mais la réponse d'Otto Bauer était une révision complète de la théorie de Marx et lui permettait de prendre place parmi les docteurs "ès population" si férocement critiqués par Marx.
Rosa Luxemburg ne laissa pas passer l'occasion de lui appliquer une volée de bois vert anéantissant les "nouveautés" théoriques de Bauer.
Ce dernier, qui trouvait les schémas de Marx insuffisants et entachés d'erreurs entreprit "d'illustrer convenablement la pensée de Marx", et ce "pour la première fois"[47]. Mais les schémas de Bauer, loin d'améliorer le modèle ne faisaient que jeter un peu plus d'ombre sur cette question difficile. Cela faisait dire à Rosa Luxemburg qu'après les échantillons montrés par Bauer, elle préférait "s'en tenir à Marx", sans corriger "ses éléments arbitraires". Pour Bauer, la plus-value est réalisée graduellement au sein de la société. En ce qui concerne les moyens de production, ceux-ci se réalisent au travers des échanges qu'effectuent entre eux les capitalistes et, pour ce qui est des moyens de consommation, ils seront réalisés l'année suivante par les ouvriers, l'élargissement du champ de la production étant fourni par l'augmentation de la population. Ce n'est que de manière transitoire que la plus-value semble ne pas pouvoir se réaliser mais lorsque l'on envisage le processus sur plusieurs années successives, il n'y a plus alors de difficultés.
Rosa Luxemburg n'eut guère de mal à se débarrasser de la critique de Bauer. Outre le fait qu'elle exécute dans la meilleure tradition du communisme, la théorie de la population de Bauer elle pouvait ironiser sur ces conceptions, lorsqu'il croit que :
"...les formules de Marx ont un rapport avec les "années" et le brave homme s'efforce de populariser cette thèse en deux pages imprimées, en utilisant tout un arsenal de lettres latines et grecques. Mais les schémas de l’accumulation du capital construits par Marx n'ont aucun rapport avec les années du calendrier. Ce qui importe chez Marx ce sont les métamorphoses économiques des produits et l'enchaînement de ces métamorphoses; c'est l'ordre de succession des processus économiques dans le monde capitaliste : production – échange – consommation, puis à nouveau production – échange – consommation et ainsi de suite indéfiniment. Comme tous les produits passent nécessairement par la phase de l'échange, qui est le seul lien entre les producteurs, le moment où les marchandises sont réalisées en argent importe peu pour le profit, et pour l'accumulation, mais ce qui compte ce sont deux points essentiels; 1°) Il est impossible à l'ensemble de la classe capitaliste comme à n'importe quel capitaliste individuel d'entreprendre aucune extension de la production sans avoir de débouché élargi. Or le problème se posait ainsi : où la classe totale des capitalistes trouvera-t-elle des débouchés croissants qui seuls permettront l'accumulation?"
Pour ce qui est des moyens de consommation, Bauer, qui fait semblant de confondre les ouvriers nouvellement employés et ceux salariés lors de la production antérieure, n'a rien trouvé de mieux que de les faire réaliser par les ouvriers, oubliant que pour que ceux-ci puissent acheter des moyens de consommation pour reproduire leur force de travail, ils doivent auparavant recevoir de la part de la classe capitaliste sous forme de salaire l’équivalent du capital variable, ce qui implique qu'elle se lance dans l'accumulation et que donc, du point de vue de Rosa Luxemburg, elle ait réalisé la plus-value.
9.3 Sweezy
Là où l'on reste atterré, c'est lorsque Monsieur Paul Sweezy près de 30 ans plus tard ressort strictement les mêmes arguments que Bauer[48], arguments déjà critiqués par Rosa Luxemburg. Il est à se demander si M. Sweezy a pris la peine de lire autre chose que les premières pages de Rosa Luxemburg. Parmi les arguments que reprend Sweezy à Bauer figure un de ceux qui montrent à quel point nos auteurs s'éloignent d'une véritable réponse à Rosa Luxemburg.
"L'exportation massive de marchandises hors du monde capitaliste rendrait impossible l'année suivante la production à une échelle élargie; on ne pourrait se procurer ni les moyens de production nécessaires à l'extension de l'appareil de production ni les moyens de subsistance nécessaires à l'entretien de la population ouvrière accrue. Si cette partie de la plus-value disparaissait du marché capitaliste, l'accumulation n'en serait pas pour autant rendue possible, comme le croit Rosa Luxemburg, au contraire toute accumulation serait impossible."
Ce point de vue, Rosa Luxemburg l'avait critiqué de manière anticipée dans sa critique de Vorontsov. Le problème n'est pas de se débarrasser de la plus-value mais de la réaliser. A travers les échanges avec les formes de production pré-capitalistes, le capital marchandise peut se réaliser en capital argent à partir duquel va pouvoir avoir lieu l'accumulation capitaliste. Pour cela, il va de soi que l'on devra également acheter, lorsque le capital argent va se convertir en éléments du capital productif, des marchandises aux autres formes de production.[49] Cela, Rosa Luxemburg l'avait déjà rappelé contre Boulgakov dans l'accumulation du capital. Elle le répétera dans sa "Critique des critiques".
"Bien que Boulgakov ait reproduit avec enthousiasme les schémas marxiens de la reproduction, il montre ici qu'il n'a pas du tout compris le problème des sceptiques depuis Sismondi jusqu'à Nicolaï-on : il dénie au commerce extérieur le pouvoir de résoudre la difficulté, parce que celui-ci réintroduit dans le pays la plus-value écoulée "bien que sous une forme modifiée". En accord avec la conception fruste de Von Kirchmann et de Vorontsov, Boulgakov croit donc qu'il s'agit d'anéantir une certaine quantité de plus-value, de l'effacer du sol, il ne se doute pas qu'il s'agit de sa réalisation, de la métamorphose de la marchandise, donc précisément de la "forme modifiée" de la plus-value."
(L'accumulation du capital. P;281 T.l)
9.4 Grossmann
Henryk Grossmann a consacré de nombreuses pages à la critique de Rosa Luxemburg. Il rédigea entre autres deux articles particuliers, l'un sur la production de l’or dans les schémas de la reproduction de Marx et de Rosa Luxemburg, l'autre consacré à la réfutation de Bauer et Rosa Luxemburg à propos de l’introduction de la composition organique dans les schémas. Nous commenterons en temps voulu ces deux articles car aucun des deux ne vise la théorie centrale de Rosa Luxemburg.
De la même manière, dans son ouvrage principal: "La loi de l’accumulation et de l'effondrement du système capitaliste", il n'aborde pas directement la critique de cette thèse principale.
Il se contente de faire des critiques, souvent justes, des conséquences qu'induit la compréhension luxemburgiste du MPC et de son accumulation (crise constante indépendamment des phases du MPC, crises non reliées à la sphère de la production, etc.) ou alors il examine les différences entre sa conception de la crise basée sur une interprétation ricardienne de la baisse du taux de profit et la théorie de Rosa Luxemburg.
Là aussi nous reviendrons sur ces questions plus tard, notre préoccupation actuelle étant d'analyser la position fondamentale de Rosa Luxemburg: "d'où vient la demande solvable pour réaliser la plus-value à accumuler ?"
9.5 Mandel et la concurrence
Une des critiques les plus caractéristiques de la totale incompréhension de Rosa Luxemburg est faite par les marxistes vulgaires, universitaires en général.
Selon ceux-ci, l'erreur de Rosa Luxemburg serait de ne pas prendre en compte le mouvement de la concurrence dans l'analyse de la crise. L'un des représentants les plus achevés de cette critique est Monsieur Ernest Mandel en personne.
"L'erreur de Rosa Luxemburg consiste dans le fait de traiter la classe capitaliste mondiale comme un tout, c'est-à-dire, faire abstraction de la concurrence. Il est vrai que Marx, dans ses calculs du taux de profit du tome III du Capital, part également de la classe capitaliste comme un tout, et Rosa cite cette référence de façon triomphale pour confirmer sa thèse. Mais elle semble ignorer que dans son plan d'ensemble du Capital, Marx a précisé que les crises tombent en dehors du domaine du capital "pris dans son ensemble"; elles résultent précisément des phénomènes qu'il appelle ceux des différents capitaux, c'est-à-dire de la concurrence. C'est elle qui détermine toute la dynamique, toutes les lois de développement du capitalisme."
(Mandel. Traité d'économie marxiste. Tome 1 p.452.)
Poussant au comble du ridicule les erreurs de ses maîtres léninistes qui combattirent Rosa Luxemburg, le trotskiste Mandel ne fait que mettre en relief la décomposition théorique du trotskisme et son pillage contre-révolutionnaire du programme communiste[50].
Tous ces reproches montrent que ces critiques ne comprennent pas, d'une part, ce que Rosa veut dire quand elle parle d'impossibilité de réalisation de la plus-value dans une aire capitaliste débarrassée des formes de production pré-capitalistes et, d'autre part, qu'en faisant abstraction des phénomènes de la concurrence elle ne faisait rien d'autre que de considérer comme justes les présupposés théoriques de Marx dans l'analyse de l'accumulation.
" . . . . le mouvement réel de la concurrence est en dehors de notre plan, et notre seule tâche est d'exposer l'organisation interne du mode de production capitaliste, en quelque sorte dans sa moyenne idéale."
(Marx. Oeuvres. Pléiade T.2 p.1440)
Pour Marx la concurrence ne fait qu'exécuter les lois du capital, elle les rend obligatoires pour le capitaliste individuel sous peine de disparaître, mais la concurrence ne crée pas les lois internes du capital, elle ne fait que les réaliser, ce qui faisait dire à Bordiga que la loi de la concurrence est une des lois les plus secondaires de l'économie capitaliste.
"Nous n'avons pas à examiner ici comment les tendances immanentes de la production capitaliste se réfléchissent dans le mouvement des capitaux individuels, se font valoir comme lois coercitives de la concurrence et par cela même s'imposent aux capitalistes comme mobiles de leurs opérations.
L'analyse scientifique de la concurrence présuppose en effet l'analyse de la nature intime du capital. C'est ainsi que le mouvement apparent des corps célestes n'est intelligible que pour celui qui connait bien leur mouvement réel."
(Marx, Pléiade, Capital, L.I, T.1, p.853)
En en restant à la concurrence, on se place au niveau de compréhension de l'économie politique vulgaire qui reste à la surface des phénomènes économiques, sans en pénétrer l'essence[51].
"(…) dans la concurrence, tout paraît sens dessus dessous. La forme achevée des rapports économiques, telle qu'elle apparaît en surface, dans son existence concrète, donc aussi dans les représentations que s'en font, pour essayer de les comprendre, ceux qui personnifient ces rapports et qui en sont les agents, est très différente, voire juste l'opposé de sa structure interne, essentielle, mais cachée, et du concept qui lui correspond."
(Marx, Pléiade, Capital, L.III, T.2, P.998)
La concurrence est donc pour l’économiste vulgaire dans le camp duquel nous n'hésiterons pas à classer le marxiste vulgaire, le deus ex machina qui vient tout expliquer.
"C'est à la concurrence qu'il incombe d'expliquer toutes les absurdités des économistes, alors que ceux-ci devraient, au contraire, se charger d'expliquer la concurrence."
(Marx. Pléiade, Capital, L.III, T. 2 p. 1464)
D'un point de vue plus général, toutes les illusions sur la concurrence sont liées à la théorie vulgaire qui affirme que la valeur peut être créée dans la circulation. Aussi, à l'ultime étape de la déchéance du marxisme vulgaire, prendre en considération, à ce degré de l’analyse, les manifestations de la concurrence reviendrait à nier la loi de la valeur pour lui substituer une théorie de la valeur reposant sur la loi de l'offre et de la demande.
En aucun cas les arguments qui envisagent la crise d'un point de vue partiel ne peuvent être en accord avec la théorie communiste et sous cet angle Rosa Luxemburg ne pouvait pas être plus orthodoxe, elle qui, sut toujours se placer, comme le rappelait Lukàcs, du point de vue de la totalité.
Pour mieux nous fixer les idées sur l’origine de la concurrence et son rôle, nous pouvons analyser la formation du taux de profit. Dans ces passages, Marx y est extrêmement didactique.
"Ce n'est pas la concurrence qui crée le profit. Elle peut en faire baisser ou hausser le niveau, mais celui-ci s'établit lorsque l'égalisation est achevée. Et quand nous parlons d'un taux nécessaire du profit, ce qui nous intéresse, c'est le taux de profit qui, indépendamment des mouvements de la concurrence, règle au contraire celle-ci. Le taux de profit moyen se constitue lorsque les forces des capitalistes concurrentes s'équilibrent. La concurrence peut bien établir cet équilibre, mais non pas le taux de profit qui résulte de cet équilibre." (Marx. Pléiade, Capital, L.III, T. 2 p. 1464)
Si les yeux aveugles, les bouches muettes et les oreilles sourdes de la contre-révolution pouvaient voir, dire et entendre autre chose que l’idéologie bourgeoise, elles s'apercevraient que, pour Marx, la concurrence entre les capitalistes individuels est engendrée par la baisse du taux de profit. Ce dernier exprime les déterminations du capital total, du capitaliste collectif à la recherche de la valorisation maximum du capital laquelle est, en même temps, une dévalorisation de celui-ci. Cette contradiction se présente sous la forme de la baisse tendancielle du taux de profit.
"Adam Smith expliquait la baisse du taux de profit par l'accroissement du capital dû à la concurrence que les capitaux se font entre eux. Sur ce point, Ricardo lui rétorquait que la concurrence peut réduire les profits à un niveau moyen dans les différentes branches des affaires, ou bien en égaliser le taux, mais qu'elle ne peut pas abaisser ce taux moyen.
L'affirmation d'Adam Smith est juste en ce sens que c'est seulement dans la concurrence – dans l'action du capital sur le capital – que les tendances et les lois immanentes de celui-ci sont réalisées. Mais elle est fausse au sens où il l'entend, comme si la concurrence imposait au capital des lois venues de l'extérieur et qui ne fussent pas ses lois propres. Pour que la concurrence puisse abaisser de façon durable le taux du profit moyen dans toutes les branches de l'industrie, il faudrait que l'on conserve une baisse générale et permanente ayant force de loi antérieurement et extérieurement à la concurrence. Celle-ci exécute les lois internes du capital, elle les rend impérieuses pour le capitaliste individuel, mais ce n'est pas elle qui les forge : elle les réalise. Vouloir les expliquer simplement à partir de la concurrence, c'est avouer son incompréhension."
(Marx. Pléiade, Principes d’une critique …, T.2 p.275)
Ils devraient, aussi, savoir que la concurrence va s'exprimer de manière différente suivant les conditions du développement cyclique du capital, en fonction de l'évolution du taux de profit. Que se passe-t-il lors d'une crise de suraccumulation relative, lorsqu'une partie du capital doit être dévalorisée pour rétablir le taux de profit ?
Tout d'abord :
"Le taux de profit ne baisserait pas sous l'effet de la concurrence due à la surproduction de capital ; bien au contraire il y aurait lutte concurrentielle parce que la baisse du taux de profit et la surproduction du capital découlent des mêmes circonstances."
(Marx. Pléiade, Capital, L.III, T. 2 p. 1035)
Une partie du capital doit renoncer à agir comme capital et c'est la concurrence qui va déterminer quelle sera cette partie.
"Tant que tout va bien, la concurrence engendre, comme l'a montré l'égalisation du taux de profit général, la fraternité pratique de la classe capitaliste : elle se partage le butin commun proportionnellement à la mise de chacun. Mais, dès qu'il ne s'agit plus de partager le profit, mais la perte, chacun s'efforce de réduire sa quote-part à un minimum et de la mettre au compte du voisin. La perte est inévitable pour la classe capitaliste. Quant à la part que chaque capitaliste doit en supporter, c'est affaire de force et ruse, et la concurrence se change alors en une lutte de frères ennemis. L'opposition s'affirme entre l'intérêt de chaque capitaliste particulier, et l'intérêt de la classe capitaliste, tout comme, antérieurement, l'identité de ces intérêts s'était manifestée pratiquement dans la concurrence."
(Marx. Pléiade, Capital, L.III, T. 2 p. 1035)
Mais si la concurrence ne peut créer les lois du capital, cela ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle dans la production capitaliste. Comme Marx le notait dans le passage précédemment cité sur Smith, si elle ne produit pas les lois, elle les réalise. Le rapport entre les lois immanentes et la concurrence est un peu comme le rapport entre la production de la valeur et sa réalisation dans la circulation. Ici encore il existe une dialectique entre la création des lois du capital et leur réalisation, mais la dialectique n'est pas le fort du marxisme vulgaire. Le mouvement réel de la concurrence devait faire l'objet d'une étude particulière, qui ne pouvait intervenir qu'une fois dévoilée l’essence de la production capitaliste.
Donc, si l'argument ne nous est d'aucun secours pour comprendre pourquoi, du point de vue du capital total, l’accumulation capitaliste s'effectue, si, à ce degré d'abstraction, il est vain, voire dangereux, d'en appeler à la concurrence parce que cela obscurcit la compréhension des rapports de production capitalistes, il est, à un moment donné de l’analyse, nécessaire de la réintroduire pour montrer comment se réalisent les tendances de l'économie bourgeoise.
Aussi si, par exemple, la
"...concurrence ne montre pas (que) c'est la détermination de la valeur qui régit le mouvement de la production, (que) ce sont les valeurs qui se trouvent derrière les prix de production et, en dernier ressort, les déterminent. En revanche la concurrence met en évidence :
1°/ les profits moyens qui sont indépendants de la composition organique du capital dans les différents secteurs de la production, donc indépendants aussi de la quantité de travail vivant qu'un capital donné s'est appropriée dans un domaine d'exploitation déterminé. 2°/ la hausse et la baisse des prix de production à la suite d'une modification des salaires, phénomène qui, à première vue, est en complète contradiction avec les rapports de valeur dans les marchandises ; 3°/ les fluctuations des prix de marché qui réduisent le prix moyen des marchandises, au cours d'une période donnée, non pas à la valeur de marché, mais plutôt à un prix marchand de production qui s'écarte nettement de cette valeur de marché. Tous ces phénomènes semblent contredire la détermination de la valeur par le temps de travail, tout autant que la nature de la plus-value qui consiste en travail non payé. Ainsi, dans la concurrence, tout paraît sens dessus dessous." (Marx, Pléiade, Capital, L.III, T.2, P.997-998)
Inutile de dire qu'avec les marxistes vulgaires c'est la théorie révolutionnaire, qui se trouve véritablement mise sens dessus dessous .
9.6 Hausse des salaires et réalisation de la plus-value
Opposer à Rosa Luxemburg, l'argument de la hausse des salaires revient, dans le meilleur des cas, à limiter le problème. Il s'agit de plus d'un argument totalement étranger au programme communiste pour qui la tendance générale du MPC dans la phase de soumission réelle est d'abaisser le salaire relatif, ce qui est une autre façon de dire que le taux d'exploitation a tendance à s'élever. De ce fait, avec le développement du MPC, la masse de la plus-value à réaliser irait en augmentant et non en diminuant tandis que, d'un autre côté, les formes de production susceptibles d'assurer cette réalisation iraient en s'étiolant.
9.7 Boukharine
Boukharine, bien qu'il soit un contradicteur beaucoup plus fin que Monsieur Mandel, par exemple, tombe lui aussi implicitement dans l'argument de la concurrence que nous avons déjà dénoncé. Boukharine reproche à Rosa Luxemburg de confondre l'accumulation de l'argent avec l'accumulation du capital. Bien entendu, Sweezy qui n'a rien compris au débat mais est prêt à glaner des arguments partout où c'est possible s'empresse de reproduire cette critique. Dans la mesure où il n'y a pas stricte adéquation entre l'accroissement de la quantité d'argent en circulation et l’accroissement de la valeur de la production, Boukharine rejette l'explication luxemburgiste comme trop mécanique.
Pour Boukharine, il n'y a donc pas, d'un côté, un monceau de marchandises représentant la plus-value et qui fait face, d'un autre côté, à un tas d'or. Il objecte que la plus-value se réalise non pas simultanément mais successivement. Ainsi l’argent en circulant au sein de la classe capitaliste permet la réalisation progressive de la plus-value[52]. Le problème n'est pas d'augmenter dans ce cas la masse d'or produite en relation avec l’accroissement de la plus-value. L'accélération de la vitesse de circulation, le développement du système de crédit suffisent pour satisfaire les besoins de la classe capitaliste ; dans le cas contraire il suffirait, seulement d'augmenter légèrement la production de l'or.
"Aussi l'erreur fondamentale de la camarade Luxemburg consiste en ceci qu'elle considère le capitaliste collectif comme un capitaliste individuel, elle hypostasie le capitaliste collectif. C'est pour cela qu'elle ne comprend pas que le processus de réalisation est un processus graduel. C'est pour cela aussi qu'elle se représente l’accumulation du capital comme une accumulation du capital argent.
Mais c'est précisément, à notre avis, de cette erreur centrale et fondamentale de la camarade Luxemburg que découle aussi son type d'explication de l'impérialisme. En effet, si le capitaliste collectif est identifié au capitaliste individuel, alors naturellement le premier ne peut pas être à lui même son propre acheteur, et comme la supposition d'une production d'or correspondante crève les yeux par son absurdité, cet or ne peut être obtenu que de l'extérieur. Si enfin tous les capitalistes doivent réaliser d'un coup leur plus-value (sans qu'une seule et même somme passe d'une poche à l'autre ce qui est strictement défendu) il leur faut une "tierce personne"."
(Boukharine. L' impérialisme et l'accumulation du capital)
Paradoxalement, Boukharine reproche à Rosa Luxemburg tout le cadre théorique dans lequel Marx a raisonné. Toutes les hypothèses avec lesquelles Rosa Luxemburg a effectué son analyse sont celles de Marx. L'hypothèse d'une société exclusivement capitaliste. L'hypothèse d'une vitesse de circulation égale à 1, la prise en considération de la production d'or comme seule source de la monnaie, l'analyse du point de vue du capital total tout cela est de Marx, Rosa Luxemburg n'est ici qu'une disciple fidèle[53]. Le plus fort est que Boukharine nous dit qu'avec de telles hypothèses, Rosa Luxemburg aurait raison. Aussi, Boukharine glisse-t-il sur le terrain du capitaliste individuel, ce qui fait qu'il reprend la même démarche que ceux qui font valoir contre Rosa Luxemburg l'argument de la concurrence. En objectant à Rosa Luxemburg que la réalisation de la plus-value se fait graduellement Boukharine fait valoir des arguments qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet et qui de plus renforcent la position de Rosa Luxemburg. Que la vitesse de circulation soit variable, qu'elle soit égale à 1 ou 10, que se développent ou qu'existent d'autres moyens de paiement tels que le crédit, tout cela ne nous intéresse pas ici. Dans le cadre abstrait où le problème est posé, on a supposé qu'un capital argent égal à c + v est avancé (par commodité on suppose que la vitesse de circulation de la monnaie est égale à 1 mais on pourrait tout aussi bien effectuer le même raisonnement avec 1 / 10 (c + v ) si nous admettons que la vitesse de circulation de la monnaie est de 10). A la fin du processus de production, il est nécessaire de réaliser un capital dont la valeur est égale à c + v + pl. A partir de là, il est nécessaire que la demande solvable, et donc, toutes choses égales par ailleurs, la masse monétaire s'accroisse d'une valeur égale à pl.
Si la vitesse de circulation de la monnaie était de 10, l’accroissement de la masse monétaire devrait être de 1/10 de pl. Tout ceci ne va pas à l’encontre de Rosa Luxemburg mais même renforce sa position. Son objection de principe n'est pas réfutée tandis que la représentation de sa solution pratique acquiert une véracité plus grande. Sans modifier son point de vue global il est alors facile d'admettre que seule 1/10 de la plus-value a besoin d'être échangée dans le cadre des relations avec les formes de production pré-capitalistes pour permettre la réalisation de la plus-value totale. Toujours est-il que, dans le cadre où nous nous trouvons, il serait absurde d'envisager les variations de la vitesse de circulation ou toute autre échappatoire (argent du capital fixe, etc.). Tout cela, Marx l'avait explicitement rejeté dans son analyse. De plus, le problème posé par Rosa Luxemburg n'est pas un problème technique, à savoir trouver une plus grande quantité d'or, ou de monnaie, mais celui de la réalisation de la plus-value, le passage, pour la plus-value de sa forme marchandise à sa forme argent . Pour que la valeur puisse poursuivre son mouvement, au travers duquel elle se valorise, il faut qu'un de ses moments soit la forme capital-argent. Or, d'après Rosa Luxemburg, les capitalistes ne peuvent considérer les moyens de production et de consommation destinés à l’accumulation d'après leur valeur d'usage ; les acheter signifierait entasser des moyens de production et de consommation, mais, en aucun cas, réaliser le capital. Seules les formes de production pré-capitalistes, car leur production ne repose pas exclusivement sur la valeur d'échange, sur la recherche de la plus-value, peuvent avoir "besoin" de ces moyens de production ou de consommation et donc fournir une demande solvable permettant aussi leur réalisation (peu importe que le moyen de paiement soit de l'or ou un crédit international offert par le système capitaliste lui-même).[54]
9.8 Emmanuel
Last and least, Monsieur Emmanuel, grand stalinien devant L'Eternel a lui, un moyen infaillible pour réaliser la plus-value. Il suffit de menacer la classe bourgeoise d'être dépossédée du capital au profit d'une bureaucratie qui l’enfermerait dans des camps de travail : bref la lecture des romans de Soljenitsyne fournirait l'aiguillon suffisant pour que la classe capitaliste se décide à réaliser la plus-value ; il suffisait d'y penser !
Dans "Le profit et les crises", Monsieur Emmanuel consacre quelques dizaines de pages à Rosa Luxemburg. Il faut arriver aux dix dernières pages pour rentrer dans le vif du sujet, et à l’avant-dernière pour s'apercevoir que Monsieur Emmanuel a seulement entrevu le problème que posait Rosa Luxemburg.
Si la peur du goulag n'est pas suffisante pour obliger les capitalistes à réaliser la plus-value, Monsieur Emmanuel pense que ce serait folie que de ne pas le faire, et comme dans l'ensemble les capitalistes ne sont pas fous, ils réaliseront la plus-value. S'ils ne réalisent pas la plus-value il y aura une crise alors qu'il suffit seulement de la réaliser pour empêcher la crise: Voyant cela, la classe capitaliste ne peut que réaliser la plus-value. CQFD.
Si tout cela n'est pas encore suffisant pour inciter le capitalistes à investir, qu'à cela ne tienne ! Monsieur Emmanuel s'empare d’arguments éculés et cite l’aiguillon de la concurrence, l’accroissement naturel de la population et pourquoi pas, la hausse du salaire réel.
Noyé sous un flot d'inepties, le lecteur sursaute au détour d'une page. N'aurait-on pas là une apparence d'argument sérieux.
"Quand les trois premiers monceaux de marchandises seront vendus à l'intérieur du système, comme Rosa Luxemburg le suppose, une grande partie de la plus-value destinée à la capitalisation sera ipso facto déjà réalisée dans le chef de certaines entreprises alors que d'autres n'auront pas encore vendues les quote-part de leur produit correspondant aux trois premiers monceaux. La branche entière des articles de luxe aura, à ce moment, selon les hypothèses de Rosa Luxemburg, entièrement vendu son produit et réalisé la totalité de sa plus-value. Dans la branche des biens de consommation ouvrière, où l'accroissement d'année en année est relativement faible, le rapport des invendus aux vendus sera, au même moment si petit que compte tenu de l'inégalité du rythme des ventes dans les entreprises particulières, il sera nul pour un grand nombre d'entre elles. Les entreprises auront, à ce moment là, tout réalisé, d'autres entreprises auront bien entendu au même moment réalisé moins que la part leur revenant.
A un degré moindre, le même phénomène se produira dans le secteur I. Ce point passé, de vendeurs, les entreprises deviennent acheteurs. En tant que tels elles constituent justement cet élément moteur que Rosa Luxemburg cherche désespérément, cette "impulsion première", cette locomotive qui entraînera l'ensemble dans le processus de la reproduction élargie."
(Arrighi Emmanuel. Le profit et les crises).
Supposons, pour examiner plus avant l'argument d'Emmanuel qu'il y ait un tel rapport entre le secteur des moyens de production et le secteurs des moyens de consommation de luxe. Supposons donc que les capitalistes de la section I achètent des moyens de consommation de luxe aux capitalistes de la section II lesquels avec l’argent obtenu renouvellent le capital constant usé et peuvent également augmenter leurs capacités de production. Si le secteur des moyens de production a une production de 6000 qui se décompose en 4000 c + 1000 v + 1000 pl et que nous pouvons le découper en deux sections, l'une produisant des matières premières et l’autre des machines, nous obtenons alors le schéma suivant :
1a - 2000 c + 500 v + 500 pl = 3000 (machines)
1b - 2000 c + 500 v + 500 pl = 3000 (matières premières)
Nous avons donc supposé que la classe capitaliste de la section 1 qui dispose d'une plus-value de 1000 en dépense la moitié en achat de moyens de consommation de luxe. Elle se procure cet argent par exemple en empruntant à la banque. Par conséquent, 500 € sont versés au secteur II qui peut acheter des marchandises pour la même valeur au secteur 1 .
Supposons que le secteur des moyens de consommation de luxe n'utilise que des matières premières et donc n'emploie pas de machines. Dans ce cas, 500 € vont se diriger vers le secteur 1b. Comme il est supposé que c et v sont réalisés sans difficulté, désormais la totalité de la section 1b aura réalisé la valeur de sa production et, par voie de conséquence, la plus-value créée dans cette même section. Disposant de 500 €, la classe capitaliste de 1b va rembourser l’argent emprunté à la banque, emprunt qui s'élève pour elle à 250 €. Avec les 250 € restant la classe capitaliste peut, acheter des machines, en supposant qu'elle n'emploie ni matières premières ni capital variable supplémentaire. Dans ce cas, la moitié de la plus-value, de la section 1a sera réalisée. Par conséquent, une partie de la plus-value, l'autre moitié de la plus-value, de la section 1a n'est pas réalisée. Cependant l'on pourrait imaginer de diviser à nouveau en deux sous-sections la sous-section 1a et ainsi de suite. A chaque fois une moitié de la plus-value de la section 2a ne sera pas réalisée. Elle ne le serait qu'après une infinité d'opérations. Mais la vitesse de circulation de la monnaie qui détermine le nombre d'opérations que l’on peut réaliser n'est pas égale à l’infini, de ce fait une partie de la plus-value resterait à réaliser. D'autre part ce processus requiert une division du travail tout à fait particulière. Le problème que se pose Rosa Luxemburg perdrait un peu de son ampleur, mais il n'en serait pas pour autant résolu, tout en imposant des contraintes très spéciales à l'économie bourgeoise.
10. Au delà de Rosa Luxemburg : Les positions du programme communiste
10.1 La structure du Livre II.
Le fondement de l'erreur de Rosa Luxemburg est de ne pas avoir bien vu le saut qualitatif qui intervient dans le circuit du capital quand on quitte le point de vue du capitaliste individuel pour se placer sur le plan du capital total.
Nous avons vu que le livre I et le livre II se situaient au même niveau d'abstraction, c'est-à-dire celui du "capital en général", qu'ils examinaient le processus de la production capitaliste considéré comme un tout en tant qu'unité du processus de production et du processus de circulation. Le livre I s'attachant à analyser "la production capitaliste comme processus individuel et processus de reproduction: production de la plus-value et capital" (Marx) ; tandis que dans le livre II est exposé "le processus de circulation du capital" à partir des prémisses développées dans le livre I. Des 3 sections que comporte le livre II, les deux premières se situent au niveau du capital individuel et la troisième (celle qui contient l'analyse de la reproduction du capital) sur le plan du capital total.
"Dans la première comme dans la deuxième section, il s'agit toujours du capital individuel, du mouvement d'une partie isolée du capital social. Cependant, les circuits des capitaux individuels s'enchevêtrent et se conditionnent, et c’est précisément ainsi qu'ils constituent le mouvement du capital social dans son ensemble. De même que, dans la circulation marchande simple, la métamorphose totale d'une marchandise apparaîtra comme un chaînon de la série des transformations du capital social, de même la métamorphose du capital individuel apparaîtra désormais comme un chaînon de la série de transformations du capital social. Nous avons maintenant à examiner le processus de circulation des capitaux individuels qui est dans sa totalité, une forme du procès de reproduction en tant que composants de l'ensemble du capital social, donc le procès de circulation de l'ensemble de ce capital social."
(Marx. Capital L.II, Pléiade, t. 2, p.508)
Le circuit du capital individuel qui est examiné dans la première section du livre II ne prend pas la forme A-M-A’ lorsque l'on étudie les schémas de reproduction, mais une forme M-A-M', forme qui masque certaines particularités du capital argent et notamment dissimule la possibilité d'une scission entre la vente et l’achat et donc la possibilité que le capital marchandise ne se réalise pas en argent. D'autre part, en quittant le champ du capital individuel pour celui du capital total, le circuit A-M-A' nécessite un saut qualitatif quant à sa présentation.
10.2 Le circuit du capital individuel.
Nous avons déjà un peu parlé dans le chapitre précèdent du circuit du capital. Nous ne reprendrons ici que ce que Marx appelle le premier circuit du capital, c'est-à-dire la forme de circulation sous laquelle le capital est apparu dans le livre I, la forme A-M-P-M'-A’ (capital argent, capital marchandise, production, capital marchandise avec plus-value, capital argent avec plus-value).
Nous l'avons vu, la forme A-M-A' constitue la forme générale du capital telle qu'elle apparaît dans la circulation. Dans cette formule, l'argent est le point de départ et le point de retour. Le but de ce procès est donc la valeur d’échange et, plus précisément, la plus-value. Il n'y a aucune différence qualitative entre les deux extrémités du circuit, la seule différence est quantitative et celle-ci constitue la plus-value. Mais la plus-value n'est pas créée dans la circulation, par la vente de la marchandise au-dessus de sa valeur, mais dans le procès de production par l'exploitation de la force de travail. C'est ce que traduit la forme développée A-M-P-M'-A’ . En passant successivement de la forme argent à la forme marchandise puis en s'incrémentant d'une plus-value dans le procès de production pour donner un nouveau capital marchandise lequel se réalise ensuite en capital argent, la valeur se valorise. Dans ce mouvement, la valeur passe d'une forme à l’autre en s'accroissant, en se valorisant. Si, maintenant, nous faisons abstraction du procès de production dans lequel se crée la plus-value, dans lequel la valeur est reproduite et accrue, pour nous intéresser aux extrémités du circuit nous pouvons constater que dans l’acte A-M l'argent se convertit en moyens de production et force de travail. La valeur passe de la forme argent à la forme marchandise, le capital argent se convertit dans les éléments du capital productif.
« En tant qu'aboutissement de A – M, la marchandise est destinée à se dissoudre, car elle entrera dans le processus de production pour y être consommée productivement. Si elle continue à exister comme marchandise, c'est qu'elle demeure disponible en tant que condition du processus soit parce qu'elle n'y est pas encore entrée, soit parce que le processus ne se réalise pas. » (Marx. Capital L.II, Pléiade, t. 2, p.520-521)
"Suivant le genre de marchandises que le capitaliste a l’intention de fabriquer, il transformera A en moyens de production et en force de travail d'un type particulier, conformes à son but. Mais la détermination générale est fonction du processus capitaliste dans sa totalité. A doit être changé en moyens de production et en force de travail, qu'elle qu'en soit la nature, c'est-à-dire prendre la forme matérielle du capital productif. Au contraire, M' - A' n'a pas ce contenu en dehors de la métamorphose simple de la marchandise en argent. M - A ne devient M' - A' que si l'on compare la valeur de M’ à M, et celle de A à A'. Toutefois, cette comparaison s'établit à l'extérieur de la circulation elle-même. Si M’ - le produit - se vend à sa valeur, cette vente est la réalisation à la fois de la valeur du capital avancé et de la plus-value qui s'y est agglomérée au cours de la production. La même valeur n'a qu'à parcourir la première métamorphose de toutes les marchandises : changer sa forme marchandise en forme argent. »
(Marx. Capital L.II, Pléiade, t. 2, p.522-523)
En fonction de l'activité spécifique du capitaliste, de la section de production dans lequel il investit le capital, l’argent se convertit en moyens de production et force de travail particulière. Par contre dans l'acte M'-A', la valeur sous forme de capital marchandise doit revêtir la forme argent, il faut que la valeur se réalise, passe de l'état de capital marchandise à celui de capital argent.
"Dans A –M, le capital doit adopter une forme d'utilité déterminée. Dans M' - A', il doit se défaire de cette forme d'utilité et reprendre la forme d'une valeur d'échange indépendante"
(Marx. Capital L.II, Pléiade, t. 2, p.521)
"Les phases et les métamorphoses de la circulation du capital sont à la fois interrompues et médiatisées par le processus de production, qui les divise pour ainsi dire en deux moitiés. La première moitié, A - M, en même temps qu'elle est une métamorphose formelle, constitue un moment de la métamorphose réelle de la valeur du capital : elle est transformation en capital productif. La seconde moitié, M' - A', est une métamorphose formelle pure et simple, comme celle de toute autre marchandise qui change sa forme primitive en forme monétaire. Dans la première moitié, le capitaliste retire de la circulation une marchandise ; dans la seconde, il rejette une marchandise dans la circulation. La valeur qu'il jette dans la circulation sous forme monétaire dans la première phase est inférieure à la valeur qu'il en retire sous la même forme à la fin de la seconde phase : la première fois, il retire de la circulation une valeur marchande moindre que celle qu'il lui rendra par la suite. Si, par conséquent, sous le rapport du changement de la forme, la première métamorphose est en même temps réelle alors qu'elle est irréelle dans la seconde, sous le rapport du changement de la valeur, la valeur avancée du capital passe dans la première phase de la forme monnaie à la forme usage, tandis que dans la seconde phase il y a réalisation non seulement de la valeur avancée, mais encore de la plus-value née au cours de la production."
(Marx. Capital L.II, Pléiade, t. 2, p.524-525)
Nous avons examiné ici le circuit du capital individuel, mais le problème prend une autre forme lorsque l’on envisage le circuit du point de vue du capital total.
10.3 Le circuit du capital total.
10.3.1 Du capital individuel au capital total
Nous avons vu, lors de l’exposé du circuit du capital individuel, que la réalisation du produit social n'était pas automatique, que le capitaliste, s'il ne vendait pas ses marchandises, risquait de perdre son capital, en tout ou en partie, suivant l'importance des ventes qu'il parvenait à effectuer.
Si sa plus-value pouvait en être affectée, cette perte pouvait atteindre aussi le capital avancé si bien que, à la limite, c'est la totalité du capital que le capitaliste ne pouvait pas réaliser. Comment le circuit du capital se présente-t-il lorsque nous l’envisageons sous l'angle du capital total ?
Nous avons déjà vu que, pour Rosa Luxemburg, il n'est pas possible, pour le capitaliste collectif, de trouver une demande solvable pour la plus-value à accumuler. Il est, en effet, d'après elle, impossible de généraliser au capital total le processus exposé pour le capital individuel. Il est vrai que le circuit du capital ne peut être exposé de la même manière suivant qu'il s'agisse du capital individuel ou du capital total. Cela ne signifie pas qu'il y ait une impossibilité absolue de réaliser la plus-value. Le problème est plutôt que le changement de plan, que le passage du capitaliste individuel au capital total entraîne un changement dans la forme du circuit. Tant qu'il s'agissait du capitaliste individuel, il était nécessaire de trouver un acheteur qui, sauf cas particulier, est une personne différente du vendeur. En d'autres termes, l’acheteur qui peut réaliser la valeur et la plus-value contenues dans la marchandise est généralement une autre personne que le capitaliste qui a produit les marchandises et qu'il cherche à réaliser en argent. Par contre, avec le capitaliste collectif, si l'on veut rester dans le cadre des rapports de production capitalistes, nous avons affaire au même personnage. La marchandise ou plus exactement le capital marchandise qui est entre ses mains, (que l'on note M' parce qu'il est accru d'une valeur supérieure par rapport aux éléments productifs qui constituaient le capital de départ), est le même que celui que le capitaliste doit acheter pour lancer un nouveau cycle d'accumulation. Il est, en tout cas, pour rester encore avec Rosa Luxemburg, de même valeur même si sa composition matérielle n'est pas identique. Le circuit du capital total ne se déploie pas en A-M-M'-A' condition pour que le cycle A'-M'-M''-A'' puisse exister, mais dans une succession de cycles A-M dans lesquels l’argent est toujours le moteur du mouvement, et donc le but demeure la plus-value, la recherche de la valeur d'échange pour la valeur d'échange. Aussi, s'il est possible pour le capital total d'effectuer le mouvement M'-A', c'est parce qu'en fait la classe capitaliste accomplit le mouvement A'-M'. Il y a réalisation de la valeur parce qu'il y a conversion de l’argent en capital productif et force de travail. Le procès prend la forme suivante:
A - M . . . . P .... M '
A ' - M '............P.......... M ' '
A ' ' - M ' '........ P.......... M ' ' '
A ' ' ' - M ' ' '...........P....
(etc.)
C'est toujours le capital argent qui donne l’impulsion du procès tout entier : la chasse au maximum de surtravail constitue le but de ce procès caractéristique de la production capitaliste.
"(…) C'est sous cette forme (de capital argent NDR) que tout capital individuel entre en scène et inaugure son procès de capital. Il apparaît donc comme le primus motor [premier moteur] qui donne l'impulsion au procès tout entier. (...)
De même, la production capitaliste suppose, tant du point de vue social qu’individuel, le capital sous forme monétaire ou capital-argent comme primus motor [premier moteur] pour toute nouvelle affaire à ses débuts et comme moteur permanent." (Marx, souligné par nous, Capital L.II, Editions sociales. T.II, p.10-11)
Le point de départ se situe dans le capital argent, un capital argent d'une valeur A' supérieure à A. Peu importent ici les moyens techniques (crédit, or...) qui permettent sa mobilisation, c'est lui qui donne l'impulsion de tout le procès.
10.3.2 Les interprétations ricardiennes de Mattick
Les remarques que nous faisons ici ne doivent pas être assimilées à la réponse, somme toute ricardienne, qui consiste à dire que la réalisation est assurée grâce à l’accumulation.
Un des représentants les plus achevés de cette tendance est Paul Mattick, disciple avoué du stalinien Grossmann.
"La production marchande crée son propre marché dans la mesure où elle est capable de convertir la plus-value en capital additionnel. La demande du marché concerne tant les biens de consommation que les biens capitaux.... Et seule la croissance du capital sous sa forme matérielle permet de réaliser la plus-value en dehors des rapports d'échange capital travail. Tant qu'il existe une demande convenable et continue de biens capitaux, rien ne s'oppose à ce que soient vendues les marchandises offertes au marché.(....)
L'élargissement du marché a pour préalable évident une production élargie, quand bien même celle-ci risque de ne pas trouver face à elle une demande correspondante. Pour conserver leur capital grâce au seul moyen dont ils disposent, donc pour l'augmenter, les capitalistes accumulent à un rythme accéléré. Or, cette accélération elle-même a pour effet d'étendre le marché, dans la mesure où elle stimule la demande de moyens de production." (Mattick, Marx et Keynes, Gallimard, pp.97-99)
Selon cette conception il existe toujours une "base stable" qui est le marché antérieur (donc en quelque sorte l’équivalent de c + v) tandis que l'élargissement du marché est réalisé par l'accumulation de pl. Si ce n'est pas possible, cela est dû au manque de plus-value et non à l'impossibilité en soi de réaliser la plus-value. Cette conception implique que la crise est une crise partielle. Cet aspect est d'ailleurs partagé par Rosa Luxemburg pour qui c + v sont réalisés sans difficulté. La divergence entre les deux écoles porte sur la plus-value. Dans un cas il y a manque de plus-value pour assurer l'accumulation, la crise résulte du procès de production, que les problèmes de réalisation existent ou non.
"A supposer que le problème de la réalisation n'existât point, disait Marx en substance (??!! NDR) le processus d’accumulation ne rencontrerait pas moins ses limites historiques étant donné qu'il anéantit sa propre source d'existence (et le secret de son développement) par suite de la baisse du taux de profit que provoque l'élévation de la composition organique du capital." (idem, p.101)
Dans l’autre cas, la plus-value ne trouve pas de demande solvable et ne peut être réalisée. La crise surgit dans le processus de circulation, indépendamment du procès de production. Dans un cas, on met en avant la nécessité de la crise sans en montrer la possibilité, dans l'autre, on met en relief la possibilité sans en montrer la nécessité[55]. Dans un cas, on privilégie le processus de production sans montrer comment la crise se réalise au niveau du processus de circulation, dans l'autre, on privilégie le processus de circulation sans montrer comment la crise naît dans le processus de production. Dans un cas, on développe une conception ricardienne de la crise, dans l’autre, une conception sismondienne, bref, on retombe dans l'économie politique, alors qu'il s'agit d'en faire la critique.
10.3.3 De la possibilité à la nécessité des crises
Si A' en se transformant en M' permet, en même temps, la réalisation de M' en A', si la conversion est, en même temps, réalisation cela ne signifie pas pour autant qu'elle se fait automatiquement. C'est l'un des grands mérites de Rosa Luxemburg d'avoir rappelé les contradictions que Marx met en relief dans le passage de la marchandise à l'argent.
"D'abord, à ne considérer que la nature de la marchandise, rien ne s'oppose à ce qu'il y ait sur le marché surabondance de toutes les marchandises – excepté l'argent – donc que toutes descendent au-dessous de leurs prix. Précisément, il s'agit du moment de la crise : admettre la nécessité, pour telle marchandise, de prendre la forme de l'argent, c'est admettre que cette nécessité existe pour toutes les marchandises. Et s'il y a difficulté pour telle marchandise d'accomplir cette métamorphose, la même difficulté peut exister pour toutes les marchandises. Loin d'exclure la possibilité d'un engorgement général, la nature générale de la métamorphose des marchandises, qui implique la séparation de l'achat et de la vente aussi bien que leur unité, en contient bien plutôt les germes." (Marx, Matériaux pour l’Economie, Pléiade, T.2, p.471)
La réalisation n'est pas inévitable dans la mesure où la conversion ne l'est pas.
"L'offre de toutes les marchandises peut, à un moment donné, être supérieure à la demande de toutes les marchandises parce que la demande de la marchandise universelle, l'argent, la valeur d'échange, est supérieure à celle de toutes les marchandises particulières, ou parce que l'incitation à convertir la marchandise en argent, c'est-à-dire à réaliser sa valeur d'échange, l'emporte sur l'incitation à la retransformer en valeur d'usage." (Marx, Matériaux pour l’Economie, Pléiade, T.2, p.472)
Ce faisant la production capitaliste est paralysée et la crise éclate. La conversion de A' en M' ne s'effectue pas et, par conséquent, la réalisation de M' en A' n'est pas accomplie. La crise de surproduction générale s'affirme, la totalité du capital tend a ne pas poursuivre son procès. Donc, contrairement aux perspectives d'une crise partielle, telles que les conçoivent aussi bien les luxemburgistes que les léninistes, le programme communiste affirme que la crise de surproduction est générale et catastrophique. Ce n'est pas une partie de pl qui ne peut se réaliser, mais c'est la totalité du capital (c + v + pl) qui tend à ne plus fonctionner comme capital. De même que ce n'est pas la seule partie de la plus-value à accumuler qui doit agir comme capital mais l'ensemble du capital, qu'il s'agisse du capital nouveau ou du capital antérieur, de même la crise peut affecter la totalité du capital social.
Bien entendu, cette surabondance n'est que relative, elle n'existe qu'à un certain niveau de prix. Ce niveau de prix détermine dans quelle proportion la plus-value ou une partie plus ou moins grande du capital avancé ne va pas être réalisée, ruinant ainsi le producteur et le commerçant. La crise est, en même temps, le rétablissement d'une unité brisée, mais un rétablissement violent. Plus le processus de valorisation/dévalorisation est avancé, plus la productivité du travail est grande, plus la contradiction entre la valeur d'usage et la valeur d'échange est développée et plus doit être étendue la dévalorisation brutale du capital (par baisse ruineuse des prix, destruction de capital, etc.)
Mais avec la métamorphose du capital marchandise en capital argent, avec la réalisation du capital nous ne faisons que mettre en évidence la possibilité de la crise.
"Du reste, les autres économistes (Stuart Mill par exemple) ne font pas mieux en cherchant à expliquer les crises par les simples possibilités de crises contenues dans la métamorphose des marchandises, mettons dans la séparation de l'achat et de la vente. Ces déterminations expliquent bien la possibilité de la crise, mais nullement leur réalité, le pourquoi du conflit entre les phases du processus, conflit dont la nature est telle que seule une crise – un mouvement violent – puisse révéler leur unité interne. Cette séparation est visible dans la crise ; elle en est la forme élémentaire. Expliquer la crise par sa forme élémentaire revient à expliquer la crise, l'existence de la crise en l'énonçant sous sa forme la plus abstraite, autrement dit à expliquer la crise par la crise."
(Marx, Matériaux pour l’Economie, Pléiade, T.2, p.468-469)
Si donc nous n'avons fait que montrer la possibilité de la crise, il importe d'en rechercher les fondements, dont l'effectuation est rendue possible avec la contradiction qui existe entre le capital marchandise et le capital argent. Cette nécessité de la crise, son pourquoi, sont alors à rechercher au sein du procès de production, dans le procès valorisation/dévalorisation, c'est-à-dire plus formellement dans la baisse tendancielle du taux de profit. Dans le cycle A'-M' c'est un nouveau cycle de valorisation qui débute avec la conversion du capital argent en éléments du capital productif. Mais, en même temps, c'est la réalisation, c'est la fin de l'ancien cycle productif avec la réalisation du capital marchandise en capital argent. La conversion et la réalisation du capital vont dépendre du rapport A'-A / A c'est-à-dire du taux de profit.
Si la valorisation du capital se révèle insuffisante, le nouveau cycle de valorisation du capital qui débute par A’-M' ne s'effectue pas, par la même occasion la réalisation de M' en A' ne peut s'accomplir, la crise éclate. Il s'agit d'une crise de surproduction générale, la totalité du capital tend à ne plus poursuivre son procès.
C'est donc au sein du processus de production, dans la contradiction valorisation / dévalorisation que l'on recherchera l'origine de la crise. Lorsqu'une baisse brutale du taux de profit intervient dans le processus de production, la classe capitaliste doit avant de pouvoir reprendre le cycle d'accumulation et d'exploitation rétablir le niveau antérieur de la productivité du travail, rétablir le taux de profit.
Ce rétablissement ne peut être accompli que par une dévalorisation brutale du capital existant, dévalorisation qui signifie une baisse des prix ruineuse pour la classe capitaliste. Ces violentes secousses au sein du processus de production paralysent la fonction de l'argent en tant que moyen de paiement. La scission potentielle entre le capital marchandise et le capital argent (contradiction que le système de crédit a porté à son comble) devient une réalité, aboutissant ainsi à des crises violentes dont l'étendue et la profondeur sont en relation avec le niveau des forces productives déjà atteint.
"La création de cette plus-value constitue le processus de production immédiat qui, comme nous l'avons dit, n'a d'autres limites que celles que nous venons d'indiquer. Dès que toute la quantité de surtravail que l'on peut extorquer est matérialisée en marchandises, la plus-value est produite. Mais cette production de plus-value n'achève que le premier acte du processus de production capitaliste, le processus immédiat. Le capital a absorbé une quantité déterminée de travail non payé. A mesure que le processus se développe, qui s'exprime dans la baisse du taux de profit, la masse de la plus-value ainsi produite s'accroît immensément. Vient alors le second acte du processus. Il faut que toute la masse des marchandises, le produit total, aussi bien la partie qui représente le capital constant et le capital variable que celle qui représente la plus-value, se vende. Si la vente ne s'opère pas ou bien qu'elle ne s'opère que partiellement ou à des prix inférieurs aux prix de production, il y a bien eu exploitation de l'ouvrier, mais elle n'est pas réalisée comme telle pour le capitaliste : elle peut même aller de pair avec l'impossibilité totale ou partielle de réaliser la plus-value extorquée, voire s'accompagner de la perte totale ou partielle du capital. Les conditions de l'exploitation directe et celles de sa réalisation ne sont pas les mêmes ; elles diffèrent non seulement de temps et de lieu, mais même de nature."
(Marx. Capital, L.III, Pléiade, T.2 p.1026)
10.4 La crise générale de surproduction
Comment, en cas de crise, se rétabliront les conditions pour que le capital puisse de nouveau poursuivre le procès d’exploitation du travail ?
"Dans tous les cas l'équilibre se rétablirait par la mise en friches, voire la destruction de capitaux plus ou moins importants. Cela s'étendrait en partie sur la substance matérielle du capital, c'est-à-dire qu'une partie des moyens de production, capital fixe et capital circulant cesserait de fonctionner et d'agir comme capital; un certain nombre d'entreprises cesseraient leur activité. Et, bien que le temps s'attaque à tous les moyens de production (la terre exceptée) et les détériore, l'arrêt de leur fonctionnement aurait ici un effet bien plus fortement destructeur.
« La destruction principale , dans sa forme la plus aiguë, frapperait le capital en tant qu’il possède le caractère de valeurs, donc les valeurs des capitaux. La partie de la valeur-capital qui n'a que la forme de simples titres sur des parts futures dans la plus-value où le profit, en fait, la forme de créances sur la production sous des aspects divers, se trouve dépréciée dès qu'il y a baisse des recettes sur lesquelles elle est calculée. Une partie de l'or et de l'argent en barre reste inexploitée, ne fonctionne pas comme capital. Une partie des produits jetés sur le marché ne peut accomplir son processus de circulation et de reproduction que par une énorme contraction de ses prix, donc par la dépréciation du capital qu'elle représente. De même, les éléments du capital fixe sont plus ou moins dépréciés. A cela s'ajoute le fait que le processus de reproduction dépend de certaines conditions de prix préalablement données, donc qu'une baisse générale des prix l'arrête et le désorganise. Cette perturbation et cette stagnation paralysent la fonction de l'argent en tant que moyen de paiement, dont le développement est lié à celui du capital qui est fondé sur ces conditions de prix présupposées. La chaîne des obligations de paiement à échéance fixe est brisée en cent endroits ; la confusion se trouve encore aggravée par l'effondrement inévitable du système de crédit, qui s'est développé simultanément avec le capital, et elle aboutit ainsi à des crises violentes et aiguës, à des dévalorisations soudaines et forcées, à l'arrêt effectif du processus de reproduction et, par suite, au déclin total de la reproduction. » (Marx, Capital L.III, Pléiade, T.2, p.1036)
Donc lorsque le procès valorisation/dévalorisation engendre, ce qu'il fait périodiquement, une baisse dans le degré d'exploitation du travail, il s'ensuit une baisse brutale du taux de profit. Celle-ci paralyse le mouvement de réalisation de la valeur capital et de la reconversion en capital nouveau de la valeur et de la plus-value contenues dans le capital marchandise. La totalité du capital est en crise (c + v + pl) et le processus de production ne pourra redémarrer qu'à travers une dévalorisation brutale du capital rétablissant le taux de profit et les conditions d'exploitation de la force de travail.
Quand Rosa Luxemburg développe sa conception partielle de la crise, elle affirme que seule la partie de la plus-value à capitaliser pose un problème pour être réalisée dans le cadre des rapports de production capitalistes considérés comme un tout. Dans la mesure où elle fait de telles affirmations, elle nie, en fait, l’existence de la production capitaliste. Pas plus le capital constant que le capital variable ne peuvent être considérés comme étant achetés par les capitalistes (nous verrons que les ouvriers dans le cas du capital variable n'ont rien à voir avec cette affaire), pour leur seule valeur d'usage. Ce qui assure leur réalisation est, tout comme pour la plus-value, qu'ils puissent de nouveau fonctionner comme capital donc que l’argent se reconvertisse dans les éléments du capital productif pour produire un maximum de plus-value.
Ce n'est pas que sous l’angle de la valeur d'usage que l’on doit envisager la reproduction du capital constant usé, ce serait passer à coté des importantes conclusions que tire le programme communiste du processus de "métempsycose" de la valeur telle qu'elle s'opère dans le procès de production lorsque le capital transmet sa valeur (ou une partie de celle-ci) au produit.
Pour le capital il est nécessaire que la valeur du capital fixe soit transmise le plus rapidement possible. La machine, par exemple, ayant en plus de l'usure due à son usage un autre type d'usure due à son inaction (« qui s'arrête se rouille » dit un proverbe allemand). De plus, la machine subit un processus d'obsolescence. Tous ces éléments poussent le capital à augmenter le temps d'utilisation des machines que ce soit par l’allongement de la journée de travail ou le développement du travail par équipes dont l'aboutissement est la promotion du travail de nuit. On se rappellera que les dernières grèves qui ont éclaté dans l'entreprise Michelin avaient pour but de sauvegarder les samedis de la classe ouvrière. Les patrons de Michelin désirant augmenter le temps d'utilisation des machines pendant une durée plus grande de la semaine. On se rappellera aussi que l'accord de diminution du temps de travail à 35 heures au sein du groupe BSN ( Gervais-Danone, Kronembourg, etc.) s'accompagne d'un aménagement du temps travail destiné à un allongement du temps d’utilisation des machines. La hausse relative des salaires et donc la diminution apparente du taux de plus-value n’entraîne pas d’augmentation de la valeur des produits, bien au contraire la valeur du capital constant qui sera transmise au produit le sera sur une période plus brève, gage d’une diminution de la valeur des marchandises. Dans la mesure où elle intervient sur la détermination de la valeur de la force de travail, cette baisse de la valeur des marchandises assurera une augmentation de la masse et du taux de la plus-value. Il est vrai que cette augmentation n’aura d’effet qu’au niveau social et qu’elle n’aura donc qu’une retombée partielle sur BSN. Par contre, en abaissant la valeur individuelle des marchandises produites par le groupe au-dessous de leur valeur sociale, il lui sera tout à fait possible de recueillir des surprofits.
Grâce à ceux-ci, BSN pourra très bien supporter une hausse relative des salaires accordée aux ouvriers (ce qui n’exclut pas qu’il profite de la flexibilité dans le volume du travail vivant ainsi obtenue pour le réduire, en installant des machines supplémentaires, ce qui est favorisé par la hausse des salaires. L'armée de réserve ainsi gonflée pourra faire pression sur l'ensemble de la classe ouvrière). Une telle mesure ne peut donc être généralisée sinon elle entraînerait une diminution brutale de la masse de plus-value créée et donc une baisse brutale du taux de profit. Elle ne peut exister que parce que les entreprises du groupe BSN occupent, dans bien des cas, une place où elles sont en mesure d'obtenir et d'accroître les surprofits qu'elles réalisent en s'appropriant une partie plus grande de la plus-value sociale tout en contribuant moins à sa création. Du fait de cette position particulière, il est alors possible de placer la classe ouvrière de l'entreprise dans une situation plus favorable que la moyenne de la classe ouvrière.
Mais la crise ruinera ces ultimes tentatives de dégager une aristocratie ouvrière et, le salaire des ouvriers de BSN sera ramené au salaire moyen que l'on obtient dans une branche pour une semaine de travail de 35 heures. Cela équivaudra à abaisser, dans un premier temps, encore plus le salaire au-dessous de la valeur de la force de travail ; celle-ci nécessitant comme l'a montré la phase de prospérité, des semaines de travail de plus de 40 heures pour être reproduite dans des conditions qui, déjà du point de vue social étaient inférieures à la moyenne. La réduction générale du temps de travail a, depuis quelques années déjà, signifié une baisse de salaire pour des parties importantes de la classe ouvrière et ce phénomène est accentué par la crise.
Depuis la seconde guerre mondiale, période particulièrement faste pour le capital, période où son triomphe sur le prolétariat n'a jamais été aussi vaste, période marquée par l'accroissement effréné de l'exploitation du prolétariat, la proportion d'ouvriers, devant travailler de nuit (mais ce mouvement atteint aussi les classes moyennes[56]), ou soumis au travail posté n'a cessé de croître.
Comme la valeur du capital constant et du capital fixe entre les mains de la classe prolétarienne est désormais très élevée, comme, d'autre part, le travail associé est particulièrement développé (peu de prolétaires détiennent donc entre leurs mains une partie d'un mécanisme social où toutes les parties sont interdépendantes et peuvent donc le bloquer dans sa totalité), le despotisme du capital ne peut que s'accentuer pour s'assurer de la continuité du procès de production et assurer la surveillance de la bonne utilisation des machines. Celles-ci, ainsi que tous les aspects sociaux du travail font face au prolétaire et le dominent. Ce despotisme doit d'autant plus s'accentuer que la classe ouvrière oppose une résistance croissante qu'il faut briser[57].
La reproduction et donc l’accumulation du capital existant obéissent à la même motivation que l’accumulation de la plus-value : la recherche du maximum de plus-value. Il en va de même pour le capital variable. D'après le programme communiste (et nous reviendrons sur ce point important de la doctrine) la classe capitaliste a le monopole aussi bien de l’argent et des moyens de production que des moyens de consommation. Elle fait face a la classe prolétaire qui n'a d'autre marchandise que sa force de travail. En ayant le monopole des moyens de consommation, c'est donc avec le produit passé de son travail que la classe capitaliste salarie les prolétaires. Par conséquent, le rôle du prolétariat dans la réalisation du produit nouveau est nul .
"La classe capitaliste donne régulièrement sous forme de monnaie à la classe ouvrière des mandats sur une partie des produits que celle-ci a confectionnés et que celle-là s'est appropriés. La classe ouvrière rend aussi constamment ces mandats à la classe capitaliste pour en retirer la quote part qui lui revient de son propre produit. Ce qui déguise cette transaction c'est la forme marchandise du produit et la forme argent de la marchandise. Le capital variable n'est donc qu'une forme historique particulière du fonds dit d'entretien du travail que le travailleur doit toujours produire et reproduire lui-même dans tous les systèmes de production possibles. Si, dans le système capitaliste, ce fonds n'arrive à l'ouvrier que sous forme de salaire, de moyens de paiement de son travail, c'est parce que là le produit s'éloigne toujours de lui sous forme de capital. Mais cela ne change rien au fait que ce n'est qu'une partie de son propre travail passé et déjà réalisé que l'ouvrier reçoit comme avance du capitaliste."
(Marx. Oeuvres T.2 p.1069)
La production nouvelle, qu'il s'agisse de moyens de production ou de moyens de consommation est le monopole de la classe capitaliste et affronte le prolétaire dépouillé de toute propriété.
La réalisation de cette partie du produit social dépendra donc de la capacité qu'a la classe capitaliste à salarier l'ensemble de la classe ouvrière, elle dépendra dont de sa capacité à avancer le capital variable, cette capacité qu'il s'agisse du capital variable ou du capital constant, dépendra du degré de valorisation du capital, c'est-à-dire du taux de profit.
10.5 Crise et cycle
Rosa Luxemburg, tout en ayant eu le mérite de rappeler son importance, n'en reste qu'à un moment de la crise. Elle se borne à la contradiction capital marchandise / capital argent qui ne fait que donner la possibilité de la crise. Pour pouvoir fonder sur cette contradiction également la nécessité de cette crise, elle est conduite à la rendre permanente. Alors que, chez Marx, le cycle M’-A’ pouvait très bien s'accomplir sans heurts, Rosa Luxemburg est amenée à transformer une contradiction qui donnait la possibilité de la crise en une contradiction qui en fournit la nécessité permanente. Cette contradiction, le capital ne peut la dépasser que par ses relations avec les formes de production extérieures au MPC. En décrétant la crise permanente, elle s'inscrit dans une tradition de l'économie politique qui est en contradiction avec le programme communiste pour qui les crises constituent des explosions périodiques.
Pour le programme communiste, la crise n'est pas permanente, elle éclate périodiquement mais à un niveau toujours plus élevé.
"Il faut distinguer, écrit Marx, lorsque Smith explique la baisse du taux de profit par la surabondance de capital, accumulation de capital, il veut parler d'un effet permanent ce qui est faux. Par contre surabondance de capital transitoire, surproduction, crise, c'est quelque chose de tout à fait différent. Des crises permanentes ça n'existe pas." (Marx. Théories sur la plus-value. T.2 p.592)
"Trop de moyens de travail et de subsistance sont produits périodiquement pour qu'on puisse les faire fonctionner comme moyens d'exploitation des ouvriers à un certain taux de profit. Il est produit trop de marchandises pour qu'on puisse réaliser et reconvertir en capital nouveau la valeur et la plus-value qui s'y trouvent contenues, c'est-à-dire exécuter, dans les conditions de répartition et de consommation de la production capitaliste, ce processus soumis à des explosions périodiques."
(Marx. Oeuvres T.2 p.1041)
Rosa Luxemburg ne restitue donc que partiellement les contradictions de la production capitaliste. Elle en reste au processus de circulation sans montrer les relations intimes que la crise entretient avec le processus de production. Les contradictions se manifestent dans la sphère de la circulation par l'arrêt du processus d'accumulation et donc de réalisation du capital et de la plus-value. Ce faisant, Rosa Luxemburg, par ailleurs, brillante dialecticienne, ne développe qu'une conception unilatérale de la crise, sans montrer comment les contradictions de la production capitaliste se résolvent par des crises qui surgissent sur la base de celles-ci .
"Périodiquement, le conflit des forces antagoniques éclate dans les crises. Les crises ne sont jamais que des solutions momentanées et violentes des contradictions existantes, des éruptions violentes qui rétablissent pour un moment l'équilibre troublé." (Marx, id. p.1031)
De ce point de vue, Boukharine notait, fort justement, qu'il
"...ne faut pas voir seulement les contradictions mais aussi l’unité. Dans les crises cette unité s'affirme avec une force élémentaire, tandis que, selon Rosa Luxemburg elle est, en général impossible. En d'autres termes la camarade Rosa Luxemburg cherche dans le capitalisme des contradictions plates et formellement logiques, qui ne sont pas dynamiques, qui ne se résolvent pas, n'apparaissent pas comme des éléments d'une unité contradictoire, mais qui nient tout simplement cette unité. En réalité, nous avons affaire à des contradictions dialectiques, qui sont les contradictions d'une totalité qui se résolvent périodiquement et se reproduisent constamment et qui ne font sauter tout le système capitaliste comme tel qu'à un certain degré de développement, c'est-à-dire qui détruisent en même temps qu'elles même l'ancienne forme de l'unité."
(Boukharine. op. cité p.103)
10.6 Crise historique, crise finale
Ainsi, chez Rosa Luxemburg, la crise ne surgirait pas des limites inhérentes à la production capitaliste, limites qu'elle cherche constamment à dépasser pour les poser sur une échelle plus grande, mais de la rupture du métabolisme que le MPC entretient avec les formes de production pré-capitalistes. Le MPC ne serait donc pas un mode de production historiquement stable et donc ne pourrait jouer son rôle historique que pour autant que les formes révolues subsistent. La crise du MPC ne proviendrait pas du développement des contradictions internes, mais d'un principe extérieur à celui-ci. Tout cela est la plus parfaite négation de la dialectique de l'histoire.
Pour Marx,
"La production capitaliste tend constamment à surmonter ces limites inhérentes, elle n'y réussit que par des moyens qui dressent à nouveau ces barrières devant elles, mais sur une échelle encore plus formidable.
La véritable barrière de la production capitaliste, c'est le capital lui-même. Voici en quoi elle consiste: le capital et son expansion apparaissent comme le point de départ et le terme, comme le mobile et le but de la production; la production est uniquement production pour le capital, au lieu que les instruments de production soient des moyens pour un épanouissement toujours plus intense du processus de la vie pour la société des producteurs. Les limites dans lesquelles peuvent uniquement se mouvoir la conservation et la croissance de la valeur du capital – fondées sur l'expropriation et l'appauvrissement de la grande masse des producteurs – ces limites entrent continuellement en conflit avec les méthodes de production que le capital doit employer pour ses fins et qui tendent vers l'accroissement illimité de la production, vers la production comme une fin en soi, vers le développement absolu de la productivité sociale du travail. Le moyen – le développement illimité des forces productives de la société – entrant en conflit permanent avec le but limité, la mise en valeur du capital existant. Si le mode de production capitaliste est, par conséquent, un moyen historique de développer la puissance matérielle de la production et de créer un marché mondial approprié, il est en même temps la contradiction permanente entre cette mission historique et les conditions correspondantes de la production sociale."
(Marx. Oeuvres T.2 p.1032)
La crise, telle que se la représente Rosa Luxemburg est indépendante de l'histoire du MPC. Ce dernier ne connaît pas, selon elle, de crises spécifiques suivant sa périodisation historique mais une crise permanente, de même nature, quelle que soit l'étape du développement. Cette crise s'aiguise avec l'avance du MPC. Alors que pour la théorie révolutionnaire le MPC connaît des crises de suraccumulation absolue dans la phase de soumission formelle et des crises de suraccumulation relative dans la phase de soumission réelle du travail au capital (cf. CouC No 9)[58] pour Rosa Luxemburg, quelle que soit la phase de la production capitaliste, la nature de la crise est toujours la même.
Dans la mesure où elle ne met pas en relief l'origine des crises dans le processus de production (qui est unité du procès de valorisation et du procès de travail) elle ne peut donc restituer les crises relatives aux diverses périodes historiques du MPC. Qui plus est, le MPC ne peut, selon Rosa Luxemburg, atteindre la phase de soumission réelle, phase dont l'une des caractéristiques est que justement le MPC s'est débarrasse des autres formes de production pour aller de son propre pas.
"Tant que le capital est faible il cherche à s'appuyer sur les béquilles d'un mode de production disparu ou en voie de disparition; sitôt qu'il se sent fort, il se débarrasse de ces béquilles et se meut conformément à ses lois propres." (Marx. Oeuvres T.2 p.295)
La Gauche d'Italie avait justement défini à la réunion d'Asti le degré de pureté du MPC en fonction de la plus ou moins grande importance des classes et couches qui n'étaient pas soumises au travail salarié. Donc, pour Rosa Luxemburg, l'avènement de la phase de soumission réelle, c'est-à-dire la phase dans laquelle le MPC réalise son être, ne peut se développer[59].
Dans la logique de la conception de Rosa Luxemburg, il arrive un point où la crise est inévitable et irréversible : c'est une crise historique qui rend impossible toute solution, toute issue de sortie pour le MPC. Indépendamment de l'action du prolétariat, le catastrophisme Luxemburgiste prédit un point d'arrêt à partir duquel tout développement du MPC est impossible[60]. Pour le programme communiste, comme le notait Lénine : "Les révolutionnaires s'efforcent parfois de démontrer que la crise ne possède absolument aucune issue. Mais dans l'absolu il n'existe pas de situations qui n'offrent aucune issue."
Si la crise qui, dans une période révolutionnaire, a pour effet de polariser les antagonismes entre capital et prolétariat ne se traduit pas par la victoire du prolétariat, des dévalorisations massives du capital, d'autant plus grandes que les forces productives du travail sont développées permettent une cure de la société bourgeoise (depuis 1914 cette cure doit d'ailleurs être systématiquement organisée et s'achève par la guerre impérialiste). La théorie luxemburgiste, qui développe une théorie unilatérale des crises ne restituant partiellement qu'un aspect de la théorie communiste des crises, en la comprenant comme une crise partielle, permanente, irrémédiable, développe un catastrophisme gradualiste et fataliste étranger aux perspectives révolutionnaires prolétariennes.
11. Rosa Luxemburg et l’or dans les schémas de reproduction
11.1 L’inachèvement du Livre II
Dans les chapitres précédents, nous avons commencé une critique détaillée des positions de Rosa Luxemburg en montrant les limites et les insuffisances de sa conception qui s’apparente beaucoup plus à la tradition sismondienne et sous-consommationniste des crises qu’à celle du programme communiste.
Nous avons donc rejeté la théorie luxemburgiste dont le principal intérêt était de rappeler l’existence de la contradiction entre la marchandise et l’argent, contradiction qui rend possibles les crises. Contradiction qui était d’ailleurs niée par le révisionnisme, le marxisme légal et finalement aussi, malheureusement, par un Lénine.
La restauration du programme communiste sur la question des crises n’a pu être accomplie intégralement, et le débat qui eut lieu aussi bien au sein du camp prolétarien que contre le révisionnisme triomphant se présente le plus souvent, plus comme une réédition du débat entre Ricardo, Say et Sismondi, Malthus que comme la reprise des positions classiques du communisme.
La théorie de Rosa Luxemburg pêchait, de fait, par les mêmes défauts : conception de la crise qui en fait une crise partielle et non une crise catastrophique, conception de la crise qui en fait une crise permanente au lieu d’une crise périodique éclatant sur une base toujours plus élevée au fur et à mesure que se développe le MPC, conception de la crise qui se cantonne au processus de circulation au lieu de montrer les liens intimes qui unissent la mise en valeur du capital au sein du procès de production et les difficultés de la réalisation du produit social dans la sphère de la circulation. Rosa Luxemburg se contentait de rappeler les contradictions qui rendaient possible la crise sans rappeler celles qui la rendaient nécessaire et, par conséquent, sans montrer la dialectique qui unissait la nécessité et la possibilité de la crise. Ce faisant, Rosa Luxemburg se situait au niveau de l’économie politique et non de sa critique communiste[61].
Dans son étude serrée de l’accumulation du capital, Rosa Luxemburg devait aussi mettre en relief quelques imprécisions ou erreurs de calcul qui émaillent le « Capital » de Marx et qui tiennent au fait que seul le livre I a été achevé et publié du vivant de Marx. Les deux autres livres, et tout particulièrement le livre II, étaient des brouillons inachevés dans lesquels Engels essaiera de mettre de l’ordre pour les publier après la mort de Marx. Si Rosa Luxemburg, de son côté, a souligné l’inachèvement du « Capital », il faut également rappeler que le « Capital » ne constituait en lui-même que le premier volume d’une série de 6 qui devait former « L’Economie ».
La Gauche Communiste d’Italie avait également indiqué la différence entre l’état du livre I et des livres II et III.
« Pour la démonstration, il nous faut revenir à Marx et Engels. Cette fois, il ne s’agira plus des textes organiques et complets qu’ils ont composés en pleine vigueur et avec la fougue de ceux qui, n’ayant ni doutes, ni lacunes, balayent sans difficultés les obstacles. Le Marx auquel nous nous adressons maintenant, est celui dont parle son « exécuteur testamentaire » dans les préfaces presque dramatiques du 5 Mai 1885 et du 4 Octobre 1894 aux Deuxième et Troisième Livres du « Capital ». C’est un homme dont la santé décline et que les diverses attaques de la maladie contraignent à des arrêts d’activité pendant lesquels son anxiété annule les effets du repos. C’est pourquoi, comme Engels l’explique, les matériaux de ces deux livres se présentent, à sa mort, comme un immense amas de manuscrits dont les uns sont rédigés dans leur forme définitive, tandis que les autres se réduisent à des feuillets, des remarques, des notes, des extraits, des abréviations illisibles – promesses de recherches futures – où à des pages incertaines et de style hésitant. C’est que le travail fourni par cet organisme humain entre 1863 et 1867 est incalculable, en particulier celui qui a donné naissance au Premier livre de son oeuvre maîtresse, jailli d’une seule et vigoureuse coulée. Mais, dès 1864-65, les premières atteintes de la maladie se faisaient sentir et l’attention infaillible de son grand « aide » Engels en découvre les traces dans ses travaux inédits. La robustesse d’Engels ne résistera pas non plus au travail fastidieux de déchiffrage, relecture, dictée, remaniement du texte dicté, ordonnance des matériaux, entrepris après la mort de son ami avec la volonté bien ferme de ne rien ajouter du sien. Engels a prodigué généreusement ses veilles sur les pages de son ami et une inquiétante faiblesse des yeux le condamne pour plusieurs années à réduire son travail personnel, car il lui est désormais interdit d’écrire à la lumière artificielle. Ni vaincu, ni découragé, il présente ses humbles et loyales excuses à la Cause – « il n’avait pu faire autrement! » – rappelant avec modestie tous les autres domaines dans lesquels il a dû supporter seul le poids du travail. Un an après, il mourait.
Ce rappel n’est ni un hors d’œuvre ni un morceau à effet. Nous avons voulu seulement souligner que le souci de fidélité technique qui a dominé la compilation d’Engels a presque totalement privé les deux derniers livres de ces brillants chapitres de synthèse qui ramènent périodiquement, le lecteur à une vue d’ensemble et que l’on trouve dans le livre rédigé du vivant de Marx. Certes la plume d’Engels était capable de tels raccourcis; on lui en doit de nombreux et d’importants. Mais ne voulant pas faire de tels développements sous le nom de Marx, il se limite à l’analyse. » (Dialogue avec Staline)
Là où Rosa Luxemburg commet une grave erreur, c’est de voir dans les tâtonnements de Marx autre chose qu’une recherche inachevée et des erreurs de calcul, et d’y trouver l’indice d’un problème plus vaste, que Marx aurait ignoré. Le problème étant pour elle: « D’où vient la demande solvable pour réaliser la plus-value ? »
Nous avons consacré le chapitre précédent à réfuter ce qui constitue le point central de la théorie de Rosa Luxemburg, nous n’y reviendrons pas ici. Nous allons plutôt essayer de montrer que pour autant qu’il y ait une erreur dans le livre II du Capital, il s’agit plutôt d’une addition fausse que de la trace d’une contradiction qui remettrait en cause les fondements généraux du programme révolutionnaire.
Nous examinerons ici le problème posé par la reproduction de la matière monétaire dans le cadre de la reproduction simple et donc, par la même occasion, celui de la circulation de la plus-value - toujours pour ce qui est de la reproduction simple -. Le problème qui est posé ouvre la voie à l’analyse des difficiles problèmes monétaires de la production capitaliste, que ce soit le crédit ou les problèmes de la monnaie internationale et qui chaque matin frappent à notre porte sous le nom d’inflation ou de hausse du dollar.
Mais, comme à notre habitude, avant d’en arriver là, il faudra passer par le difficile réapprentissage de l’ABC de la théorie révolutionnaire. Nous nous contenterons ici d’exposer, d’un point de vue très théorique, les problèmes liés à la reproduction de l’or et à la circulation de la plus-value. Encore le ferons-nous, ici, seulement, pour le cas de la reproduction simple, qui n’est qu’un moment de l’analyse théorique du capital, dans la mesure où cette hypothèse, qui suppose la consommation de la totalité de la plus-value par la classe capitaliste, ne s’accorde pas avec la production capitaliste qui suppose l’accumulation de cette même plus-value. L’analyse de la reproduction simple n’en constitue pas moins un moment obligé pour véritablement comprendre l’accumulation du capital et le saut qualitatif qui peut être nécessaire dans les solutions aux divers problèmes dont nous parlerons sachant que le passage de la reproduction simple à la reproduction élargie n’est pas alors qu’une simple ré affectation des forces productives entre les secteurs de la production capitaliste.
Outre les problèmes monétaires, nous verrons que l’analyse de la reproduction de la matière monétaire conduit à la solution du problème de la reproduction des capitaux utilisés de manière improductive et donc permet d’expliquer, sans difficultés, la reproduction de secteurs comme l’armement sur lesquels aussi bien les épigones de Rosa Luxemburg que les marxistes universitaires de tout acabit sont prompts à fournir toutes sortes de divagations.
Dans le chapitre consacré à la reproduction simple, le plus élaboré des chapitres sur la reproduction du capital, Marx analyse la reproduction de la matière monétaire. Pour simplifier, on ne prend en compte qu’une seule composante de celle-ci : l’or.
L’argent donc, qui est aussi une matière de la monnaie, est écarté. Il faut bien remarquer également que nous avons à faire à l’or uniquement en tant que matière monétaire, aussi nous ne devons pas considérer l’or utilisé comme matière première, aussi bien dans le secteur I, secteur des moyens de production, que dans le secteur II, secteur des moyens de consommation destinés à la consommation individuelle.
L’analyse de la reproduction de la matière monétaire se situe à la 12éme division du chapitre sur la reproduction simple, qui en comprend 13. A titre de comparaison, le chapitre sur la reproduction élargie ne comprend que 4 divisions alors qu’il est très vraisemblable qu’il aurait du en posséder beaucoup plus que celui consacré à la reproduction simple. Toutefois, même en essayant de tracer la symétrie la plus grande possible entre les deux chapitres analysant la reproduction du capital, on peut constater que la reproduction de la matière monétaire dans le cadre de la reproduction élargie n’est pas envisagée. Tout au plus trouve-t-on dans le livre II quelques indications concernant ce sujet. Quant à la division consacrée à la reproduction simple de la matière monétaire elle est elle-même incomplète et vraisemblablement inachevée, une page du manuscrit de Marx ayant été égarée ou jamais écrite. C’est en se basant sur ce fait qu’Henryk Grossmann s’arrogera le droit d’extrapoler des fadaises, prétendant reconstituer la page manquante du manuscrit.
Marx n’a donc pas totalement achevé l’élaboration de la solution du problème de la circulation de la plus-value. La maladie puis la mort (les brouillons concernant cette partie du livre II datent de 1880) l’ont empêché de systématiser ses travaux, si bien que si l’on peut trouver dans son oeuvre les réponses aux questions concernant la circulation de la plus-value et la reproduction de la matière monétaire, elles n’ont pas été systématisées et s’y retrouvent plus ou moins éparses.[62]
Rosa Luxemburg y verra à tort, nous l’avons déjà dit, les signes d’une difficulté que Marx n’est pas parvenu à reconnaître et qui pour elle est le problème numéro Un pour l’accumulation capitaliste : la demande solvable pour réaliser la plus-value. En fait Marx, bien loin de buter sur les difficultés supposées par Rosa Luxemburg, ne faisait que chercher la réponse, d’un point de vue communiste, à une vieille question que se posait déjà l’économiste classique Adam Smith. Dans son ouvrage principal « Enquête sur la richesse des nations (1776), » un chapitre était intitulé: « De l’argent considéré comme une branche particulière du fonds national, ou de la dépense qu’exige l’entretien du capital national ».
Comment, d’un point de vue théorique, s’opère le financement de la production capitaliste, c’est-à-dire la part dévolue au capital argent ? Quelle fraction des forces productives de la société doit-on consacrer à la production et à la reproduction de ce financement ? Ce sont, entre autres, ces problèmes que les parties du livre II, dont nous avons parlé, voulaient résoudre.
11.2 La reproduction de la matière monétaire dans les manuscrits du livre II du « Capital »
Marx range la production de l’or dans le secteur I, c’est-à-dire le secteur des moyens de production
« La production de l’or appartient, comme celle des métaux en général, à la section I qui englobe la production des moyens de production. »
(Marx, Le Capital, L.II, Ed. Sociales, T.V. P.118)
Marx suppose, bien qu’il considère que ce chiffre est trop élevé par rapport à la valeur totale de la production figurant dans les schémas, que la valeur de la production s’élève à :
20 c + 5 v + 5 pl = 30.
Renvoyant à plus tard l’analyse de la reproduction du capital constant des productions d’or monétaire (20 c) (cette étude ne se trouve pas dans les manuscrits du capital. Peut-être figurait-elle sur une page égarée)[63]. Marx se tourne vers l’échange entre le capital variable et la plus-value de la section de l’or (5 v + 5 pl) (I)-or avec le capital constant de la section II (IIc) .
Pour plus de commodité nous rappelons que nous avons donc une partie de la section I dédiée à la production de l’or monétaire.
I or :
20 c + 5 v + 5 pl = 30 or
I (solde de la section des moyens de production) :
3 980 c + 995 v + 995 pl = 5 970 moyens de production.
II (Secteur des moyens de consommation)
2.000 c + 500 v + 500 pl = 3.000 moyens de consommation.
Les ouvriers de (I)-or achètent des moyens de consommation pour une valeur de 5 et les capitalistes de la section II achètent une partie de la production d’or pour une valeur de 2 dans le but de reconstituer une partie de leur capital constant. Ce faisant, une partie de l’or revient au secteur (I)-or et permet la reproduction d’une partie du capital constant de II (certes tout à fait minime : 1/1000e du capital constant (2/2000)). Les 3v restant sont thésaurisés par les capitalistes de la section II[64].
« Avec ces 5 v les travailleurs achètent des subsistances à II, qui achète des moyens de production à I, disons de l’or brut (élément de son capital constant) pour une valeur de 2 ; 2 v retournent alors aux producteurs d’or de I en monnaie ayant déjà appartenu à la circulation. (…)
Nous voyons que (…) même la reproduction simple, où l’accumulation au sens propre, c’est-à-dire la reproduction sur une échelle élargie, est exclue, implique nécessairement l’accumulation d’argent ou thésaurisation. »
(Marx, Capital, Livre II, Pléiade, T.2. p. 804 et 806)
Cependant dans le secteur II se pose un problème du fait que seule une partie de l’or sert à renouveler les moyens de production ; dans ce cas il risque de se produire un déficit dans l’échange entre IIc et I (v + pl). La thésaurisation de 3 or risque en effet de perturber les échanges, empêchant la reproduction complète de 2000 c II. Pour éviter ce déséquilibre, Marx transfère cette thésaurisation sur la plus-value ; elle va donc être à la charge de la classe capitaliste de la section II. L’argent (3 or) est donc reporté de IIc à IIpl tandis qu’une valeur marchandise correspondante passe de IIpl à IIc, une partie de la plus-value se trouvant alors thésaurisée sous forme argent.
Les capitalistes de la section I or consomment leur plus-value en achetant des moyens de consommation auprès de la section II. Comme nous nous situons dans le cadre de la reproduction simple, c’est la totalité de la plus-value de I or qui est dépensée en moyens de consommation. Les capitalistes de la section II peuvent alors, d’après Marx, faire emprunter deux destinations à cette somme qu’ils viennent de recevoir de la section I or. Soit ils achètent des moyens de production auprès de la section I, soit ils thésaurisent tout ou partie de celle-ci. Par conséquent, si nous suivons Marx dans les développements qu’il fait dans ce chapitre du livre II, même sur la base de la reproduction simple, il y a accumulation d’argent, thésaurisation.
11.3 Les objections de Rosa Luxemburg
Rosa Luxemburg pense que Marx a tort de ranger la production de l’or dans le secteur des moyens de production, car l’or en tant qu’argent « n’est pas du métal mais l’incarnation du travail social abstrait » (Rosa Luxemburg. L’accumulation du capital. T.l p. 82).
Par conséquent, l’or ne peut être rangé ni dans la section des moyens de production, ni dans la section des moyens de consommation. Il faut, propose Rosa Luxemburg, créer une troisième section : la section des moyens d’échange. Cette solution doit, en plus, résoudre de nombreuses autres difficultés qui apparaissent, selon Rosa Luxemburg, dans les schémas de Marx.
D’une part, elle permettrait d’équilibrer les échanges au sein du schéma ; l’introduction de l’or au sein de la section I déséquilibrant les schémas de la reproduction simple. D’autre part, toujours selon Rosa Luxemburg, la même erreur pousse Marx à faire thésauriser une partie de l’or et cette hypothèse est en contradiction flagrante avec celle de la reproduction simple qui implique justement qu’il n’y ait pas d’accumulation. Dernier point, le schéma de reproduction, une fois l’or monétaire rangé dans une troisième section vaudrait comme point de départ aussi bien pour le capitalisme que pour le socialisme si ce n’est que dans ce dernier, la troisième section « expression du mode de production anarchique du capitalisme disparaîtrait » ( R.L. id. p.85)[65]
Voici résumées les objections fondamentales de Rosa Luxemburg. Nous les examinerons de manière détaillée dans la suite de ce texte. On peut s’étonner du silence pudique qui entoure cette partie des critiques de Rosa Luxemburg ; un Boukharine, qui pourtant consacre un ouvrage entier à réfuter Rosa Luxemburg n’en souffle pas mot, tout comme bon nombre d’autres de ses critiques.
Seul Henryk Grossmann tentera d’apporter une réponse complète aux questions soulevées. Plus récemment, une autre stalinienne, Suzanne de Brunhoff, reviendra partiellement sur le sujet dans son livre « La monnaie chez Marx », (éd. Sociales).
11.4 Le matériel argent doit-il faire l’objet d’une section particulière ?
Pour Marx, et Rosa Luxemburg lorsqu’elle analyse le processus de circulation de l’argent se montre pleinement en accord avec lui, la classe capitaliste a le monopole de l’argent et elle doit l’avancer pour que se fasse l’accumulation capitaliste. La classe capitaliste doit donc posséder une réserve d’argent.
Rosa Luxemburg conclut alors :
« Il en résulte pour le processus de reproduction du capital social la nécessité de la production et de la reproduction du matériel-argent. Comme celles-ci doivent être également d’après notre supposition une production et une reproduction capitalistes – d’après le schéma de Marx dont nous avons déjà parlé, nous ne connaissons pas d’autre production que la production capitaliste – le schéma doit paraître en fait comme incomplet. Aux deux grandes sections de la production sociale : la production des moyens de production et la production des moyens de consommation, il faudrait adjoindre une troisième section : la production des moyens d’échange pour lesquels il est précisément caractéristique qu’ils ne servent ni à la production ni à la consommation, mais représentent le travail social dans une marchandise distincte, inconsommable.» (RL. p. 82)
En introduisant ainsi le problème, c’est-à-dire en laissant entendre que c’est la totalité de la masse monétaire qui doit entrer dans la section III Rosa Luxemburg s’attire les reproches de Henryk Grossmann[66]. Celui-ci fait justement remarquer que pour faire circuler le capital, il faut une certaine quantité de monnaie, qui pour un capital donné est déterminée par la vitesse de circulation, la masse des marchandises et leurs prix.
Si nous supposons que la production nationale est constituée de 1.000 tonnes d’acier à 5.000 € la tonne et de 500 tonnes de blé à 1.000 € la tonne, la valeur totale de cette production est 1.000 * 5.000 + 500 * 1.000 = 5.500.000 €. Si nous supposons que la vitesse de circulation est de 10, c’est-à-dire si nous admettons que la même quantité de monnaie réalise 10 fois sa valeur, qu’elle réalise 10 opérations d’échange en changeant de mains, il faut donc une masse monétaire de 5.500.000 /10 = 550.000 €.
Cette masse monétaire n’a a priori pas à entrer dans les schémas de la reproduction simple. Seule la partie usée de celle-ci doit être reproduite. C’est un peu comme le capital fixe de la société; seule la partie usée au cours du processus de production nécessite d’être reproduite ; aussi l’intégralité du capital fixe n’apparaît-il pas dans les échanges au sein des deux sections de la production sociale. Par ailleurs, il faut ajouter que la masse monétaire est toujours plus grande que celle que nous venons de définir. A la masse monétaire qui est utilisée lors du déroulement normal des échanges, il faut ajouter une masse de monnaie thésaurisée qui permet de faire face aux fluctuations qui surviennent aussi bien dans la masse des marchandises, que dans les prix ou la vitesse de circulation de la monnaie.
Si, par exemple, la vitesse de circulation tombait a 9, il faudrait pour faire circuler la même production une masse monétaire de plus de 610.000 €. La masse monétaire totale est donc égale à la masse de monnaie en circulation plus la monnaie utilisée comme trésor qui sert à éponger les fluctuations.
Pour Grossmann, tout cet argent ne doit pas apparaître dans le schéma et pour nous en convaincre, il prend l’exemple suivant : Il suppose une vitesse de circulation de 4 pour une masse de marchandises d’une valeur de 9.000 (ce qui correspond, cf. ci dessus, à la valeur de la production dans le schéma de la reproduction simple). Par conséquent, la masse monétaire nécessaire s’élève à 9.000/4 = 2.250. A cette masse monétaire en circulation, Grossmann ajoute une masse monétaire de 250 comme monnaie de réserve. La masse totale de la monnaie se monte donc à 2.250 + 250 = 2.500.
Grossmann fait alors semblant de croire que le raisonnement de Rosa Luxemburg, exposé plus haut, devrait la pousser à introduire dans la section III tout le matériel argent, soit 2 500. Or, Rosa Luxemburg, qui contrairement à ce qu’affirme Grossmann a très bien compris de quoi il retourne, ne prend en compte (et en cela elle suit Marx à la lettre) qu’une quantité d’or de 30 correspondant uniquement à l’usure de la masse monétaire totale.
Fort de cet artifice, Grossmann crie à l’illogisme et à la contradiction dans la pensée de Rosa Luxemburg :
« Rosa Luxemburg. . . en contradiction avec ses propres exigences. . . .ne range dans la 3eme section que l’or nouvellement produit (soit 30) aussi il ne s’agit pas de l’or dans son caractère d’intermédiaire pour la circulation, mais bien de l’or dans son caractère de marchandise. » ( ! ) (H.G. op. cit. p.94)
Tout le fond de l’argumentation de Grossmann est là ; pour lui, l’or nouvellement produit ne se distingue en rien des autres marchandises tandis que la masse monétaire, accumulée au cours des siècles, sert à la circulation des marchandises, mais, en tant que telle, elle n’entre pas dans les schémas. Grossmann en conclut que « la masse monétaire n’est pas, en général, introduite par Marx dans les schémas de reproduction, ni dans la section I, ni dans la section II ; le schéma ne prend en compte que l’or nécessaire au remplacement de la masse monétaire usée... Rosa Luxemburg ne fait entrer dans le schéma que l’or nouvellement produit aussi introduit-elle l’or comme marchandise et non comme moyen de circulation. Mais à peine a-t-elle fait cela que s’écroule la seule base économique qu’elle avait établie, à savoir le fait d’isoler l’or dans une troisième section particulière. (op.cit. p.95).
Grossmann conclut donc que l’or étant produit comme n’importe quelle marchandise il se range dans la section I. Mais, comme on peut le voir, Grossmann n’a pas réfuté Rosa Luxemburg. Fidèle à sa méthode qui consiste à commenter l’accessoire pour masquer l’essentiel, Grossmann falsifie la position de Rosa Luxemburg pour mieux la réfuter. Ce serait mal connaître Rosa Luxemburg que de supposer qu’elle ait si mal compris l’opinion de Marx et qu’elle propose comme solution de classer dans la troisième section tout le matériel argent. En effet, Rosa Luxemburg est parfaitement consciente que l’argent ne sert qu’à renouveler la monnaie usée, sans pour autant constituer la totalité de l’argent, circulant dans la société.
« Cette grandeur de valeur (choisie par Marx comme exemple) de 30 ne correspond manifestement pas à la quantité d’argent circulant annuellement dans la société, mais uniquement a la partie de cette quantité d’argent reproduite annuellement; par conséquent à l’usure annuelle du matériel argent ... » (id . p.83)
Que reste-t-il alors de l’argumentation de Grossmann une fois écartées ses tentatives de diversion ? Il demeure l’affirmation suivante, qui se révèle tout à fait inexacte : l’or nouvellement produit, d’une valeur de 30, doit être classé dans la section I car il ne se distingue en rien des autres marchandises, il ne sert pas de moyen de circulation. Mais nous l’avons vu, rien n’est plus faux : l’or est produit comme matériel argent pour remplacer la matière monétaire usée. Dans le chapitre consacré à la circulation de la plus-value dans le livre II, Marx expose qu’une partie de l’or sert à réaliser la plus-value (nous reviendrons d’ailleurs sur cette question). Si donc « une partie de la plus-value sociale existe directement en argent et ne saurait avoir d’autre forme » (Marx). Grossmann n’a pas répondu véritablement à Rosa Luxemburg et les objections de cette dernière demeurent intactes.
Passons d’un stalinien à l’autre. Si Suzanne de Brunhoff estime fondées les remarques de Rosa Luxemburg elle critique toutefois cette dernière, car « l’institution d’une troisième section, consacrée à la production des moyens de circulation, donne au contraire à la monnaie le caractère d’une troisième sorte de marchandises, donc d’une marchandise sur le même plan que les autres; isoler la production de l’or pour respecter le caractère spécifique de la monnaie, c’est au contraire abolir cette spécificité, qui oppose la monnaie à toutes les autres marchandises. » (La monnaie chez Marx. p.89)
L’argument fait sursauter. Si l’institution d’une troisième section place la monnaie sur le même plan que les autres marchandises, on ne voit pas très bien ce que ferait de plus le fait de la placer dans la première section. Si vouloir respecter le caractère spécifique de la monnaie, c’est abolir cette spécificité, ce n’est sûrement pas en abolissant cette spécificité que l’on pourra la respecter.
Suzanne de Brunhoff conclut : « Quand Marx inclut la production d’or dans la section I, c’est parce que le caractère monétaire de l’or «équivalent général» ne résulte pas de sa production comme marchandises. » (id. P.89)
Avec Suzanne de Brunhoff, nous n’avons pas avancé d’un pouce, elle n’a pas véritablement réfuté Rosa Luxemburg dont la position demeure intacte.
En fait, ce qui pose problème dans cette affaire, ce n’est pas tant la place de la production d’or que la nature des échanges et donc la nature de sa reproduction dans le cadre des schémas de reproduction qui recouvrent les deux grandes sections de la production capitaliste. Mais les schémas ne prennent pas en compte le capital dépensé de façon improductive, d’où les difficultés que Rosa Luxemburg relève tout en leur attribuant une importance démesurée. Pour simplifier son exposé, Marx considère que la matière monétaire est fournie par le producteur d’or. Le producteur d’or est le producteur d’or brut, qui peut revêtir les usages les plus variés, et pour une grande part il sert soit de capital constant de la section I quand il est utilisé dans la production des moyens de production (par exemple, l’industrie électrique ; la société française Souriau, pour ne prendre que cet exemple, qui travaille dans le domaine de la connexion électrique est l’une des premières consommatrices d’or industriel), que de capital constant de la section II quand il sert pour la bijouterie ou les prothèses dentaires. Par contre, et c’est le seul cas qui nous intéresse ici[67] quand il s’agit de le faire entrer dans le coffre des banques centrales, l’or ne sert ni de capital constant pour le secteur I, ni de capital constant pour le secteur II.
Par exemple, la production annuelle mondiale d’or se situe aux alentours de 1300 tonnes dont la moitié environ provient d’Afrique du Sud et 25% d’URSS. Très schématiquement, on peut fixer la répartition suivante entre les destinations :
- Bijouterie : 600 tonnes
- Monnaies médailles : 250 tonnes
- Industrie, Dentisterie : 250 tonnes
- Thésaurisation : 200 tonnes.
De cette production, seule la partie consacrée aux monnaies et médailles et dans une certaine mesure la partie thésaurisée, correspondrait au problème qui nous occupe, encore faudrait-il retirer la part consacrée aux médailles.
Marx dans son analyse considère le producteur d’or sous son seul angle de producteur de matière première quel que soit son usage, et dans la plupart de ceux-ci, du moins dans ceux qui rentrent dans le cadre des schémas de la reproduction simple tels qu’ils ont été définis, cet or sert de capital constant aussi bien au secteur I qu’au secteur II, d’où son classement dans le secteur I. Mais, dans le cas particulier qui nous occupe, lorsque l’or est destiné à servir au renouvellement de la masse monétaire usée, il est dans la nature des choses que cet or ne serve ni de capital constant pour le secteur I ni de capital constant pour le secteur II. Une partie des forces productives de la société doit être consacrée à l’entretien de la masse monétaire.
Ces dépenses sont, payées par la plus-value et Marx, dans son analyse des « faux frais » de la production capitaliste, conclut à propos de l’or nécessaire à la reproduction du matériel argent :
« Ces marchandises fonctionnant comme monnaie n’entrent ni dans la consommation individuelle ni dans la consommation productive (Marx fait ici référence aux physiocrates, NDR). Elles représentent du travail social fixé sous une forme où il sert de simple machine de circulation. Outre qu’une partie de la richesse sociale est ainsi condamnée à rester improductive, l’usure de la monnaie exige son remplacement continuel, c’est-à-dire la conservation d’une plus grande somme de travail social - sous forme de produits - en une plus grande quantité d’or et d’argent. Dans les nations où le capitalisme est très développé, ces frais de remplacement sont considérables, la partie de la richesse fixée sous la forme monétaire étant très importante. Comme marchandises monétaires, l’or et l’argent constituent pour la société des frais de circulation qui résultent uniquement de la forme sociale de la production. Ce sont des faux frais de la production marchande en général ; ils augmentent avec le développement de cette production, donc sur la base de l’économie capitaliste. C’est une partie de la richesse sociale qui doit être sacrifiée au processus de la circulation.»
(Marx, Capital, Livre II, Pléiade t.2 p.574-575)
Par conséquent, ici, Marx est tout à fait explicite : l’or en tant que matériel argent n’entre pas dans la consommation productive (c’est-à-dire qu’il ne sert pas de capital constant au secteur I) dans la consommation individuelle (il n’entre donc pas dans le capital constant de la section II). De ce fait, cette partie du capital de la société sort du cadre et des hypothèses définis dans les schémas de la reproduction simple.
Rosa Luxemburg a ici le tort de croire que ce problème est dû au rôle de l’équivalent général et que derrière ces difficultés se profile un problème beaucoup plus vaste que Marx n’aurait pas perçu.
Si nous prenons, par exemple, le cas de l’armement, nous lui trouvons les mêmes caractéristiques que l’or en tant que matière monétaire. Il ne peut être utilisé ni comme moyen de production ni comme moyen de consommation individuel. Dans la logique Luxemburgiste il faudrait créer une quatrième section : la section des moyens de destruction. (Rosa Luxemburg qui, comme nous le verrons consacre un chapitre entier au problème de la production d’armement ne souffle pas un mot sur cette question). Ce qui est vrai pour l’armement l’est également pour chaque dépense improductive (publicité, comptabilité) ou pour les moyens de consommation qui pourraient revêtir un caractère collectif (hôpitaux ou équipements des hôpitaux, des stades, etc.)
Le problème qui est posé ici ne révèle donc pas une difficulté ignorée, mais montre les limites dans lesquelles s’inscrivent les schémas de reproduction. Ils ne font qu’analyser les rapports entre les deux grands secteurs du capital productif. Le capital productif de plus-value engagé dans les secteurs produisant le capital utilisé de façon improductive au cours du processus d’ensemble de la production capitaliste n’est pas pris en compte dans les schémas. Il en va de même pour tous les secteurs dans lesquels le capital productif est engagé et qui ont aussi pour acheteur l’Etat ou ses agents. Mais il n’est nul besoin de créer un secteur de moyens de destruction pour les armements, un secteur des moyens d’abrutissement du peuple pour la publicité, un secteur des moyens de guérison pour le matériel des hôpitaux, etc. Or, les capitaux qui sont engagés dans les secteurs produisant ce type de marchandises ne figurent pas dans les schémas. Qui plus est, le capital engagé dans le secteur commercial ou les services improductifs, etc., n’y figure pas non plus.
Les schémas de reproduction n’incluent pas toutes les branches de production, une partie du capital produisant de la plus-value par l’exploitation du travail salarié des prolétaires n’y figure pas, et a fortiori la partie du capital qui est engagée dans les secteurs improductifs non producteurs de plus-value et qui obtiennent le profit moyen comme le capital commercial.
De la même manière, quand l’argent est dépensé comme revenu, que ce soit pour entretenir les armées, réaliser certaines dépenses pour la santé, l’enseignement ou les transports, par exemple, bref, pour l’entretien de l’ensemble de la société, la consommation qui est faite de ce revenu met en jeu des marchandises dont les secteurs producteurs n’apparaissent pas dans les schémas de reproduction. Qui plus est, n’y figurent pas non plus les secteurs consommateurs ou utilisateurs de ces marchandises.
Si l’ensemble des secteurs liés à l’utilisation improductive de capital sont absents des schémas de reproduction, il est normal que l’or, qui présente le caractère d’être une section des forces productives de la société utilisée de façon improductive pour permettre la circulation du capital, n’en fasse pas partie. De ce fait, en le réintroduisant dans les schémas de reproduction, il n’est pas étonnant qu’on perturbe ceux-ci puisqu’on a affaire désormais à une section de la production qui jusque-là n’entrait pas dans le champ des définitions retenues. Comme le notait Marx, ces dépenses improductives ne peuvent alors être rangées ni dans le secteur I ni dans le secteur II, étant en dehors des définitions des secteurs considérés. Pour simplifier l’analyse, Marx place l’or dans la section I en considérant l’or brut et en assimilant son utilisation comme matériel-argent à celles qu’il reçoit quand il est considéré comme moyen de production. Mais à partir du moment où est bien délimité le rôle de la production d’or comme matériel-argent, le problème de savoir s’il faut par extension le rattacher à la section I ou créer une troisième section est purement formel. Ce qu’il faut souligner, ce n’est pas tant sa place quantitative dans telle ou telle section mais sa place qualitative comme fraction du capital productif qui va être consommée de façon improductive au cours du procès de production et de reproduction du capital. La reproduction de ce type de capitaux est qualitativement différente de celles que nous avons examinées jusque-là. Dans la mesure où les dépenses sont supportées par la plus-value, cette reproduction a des affinités avec la reproduction des objets de luxe destinés à la consommation individuelle mais la nature des besoins satisfaits est, en général, très différente. Si Rosa Luxemburg eut l’intuition d’une difficulté réelle, elle en exagère cependant la portée et sa solution, au lieu de montrer les spécificités de cette reproduction, reste quantitative. Elle ne fait que déplacer le problème en créant une troisième section et, comme nous le verrons, de fait elle ne résout pas convenablement la question qui est posée avec la reproduction de cette fraction du capital. Sa démarche est toutefois beaucoup plus riche que celle de Grossmann et de Suzanne de Brunhoff qui nient le problème tout en essayant de le résoudre.
Nous avons déjà montré en raisonnant par l’absurde que la création d’une troisième section n’était pas une solution viable. En suivant cette logique on aboutirait à créer une multitude de sections. Par contre, peut-être parviendrait-on à un meilleur classement si l’on essayait de décomposer les capitaux suivant qu’ils seront échangés contre du capital ou contre du revenu.
Dans le cas d’un échange avec le capital, cela signifie que pour le capitaliste qui achète ce capital marchandise, il s’agira d’obtenir le profit moyen, même si la consommation de ce capital n’entraîne pas la création de plus-value. Par exemple, le capital utilisé par le capitaliste commercial (balances, présentoirs, caisses automatiques, etc.) n’entraîne pas la création d’une plus-value, le travail des employés de commerce n’étant pas productif. Il n’en demeure pas moins que pour le capitaliste du commerce l’argent qu’il a avancé aussi bien en moyens de production (dont la valeur n’est pas transférée au produit) qu’en salaires (capital qui ne crée ni valeur ni plus-value) doit rapporter le profit moyen.
Dans le cas d’un échange avec le revenu, cela signifie que pour l’acheteur il ne s’agit pas d’obtenir le profit moyen, l’achat est réalisé à partir de la plus-value dérivée des revenus primaires. Par exemple, les impôts qui proviennent, pour simplifier, des salaires et du profit des entreprises. Si nous prenons pour exemple les armements, ils seront achetés par l’Etat pour les armées. L’armée, dont les crédits proviennent de l’Etat, est donc entretenue par l’intermédiaire du revenu. Ici, il ne s’agit pas d’avancer du capital pour l’armement ou les soldats et de participer à l’obtention d’un taux de profit moyen. L’argent n’est pas avancé comme capital mais dépensé comme revenu. Les frontières entre les deux aspects sont dans une certaine mesure indépendantes de la nature des besoins satisfaits. On pourrait tout à fait imaginer qu’un capitaliste mercenaire se charge de l’armée et réclame pour cela le profit moyen du fait qu’il a avancé le capital pour acheter l’armement et payer les troupes. C’est, dans une moindre mesure, le cas de toutes les sociétés de surveillance et de sécurité. Un système identique a fonctionné pour les pompiers aux Etats-Unis où théoriquement les pompiers n’intervenaient que pour éteindre les incendies des maisons dont les propriétaires avaient versé une cotisation d’assurance. Bien entendu, dans ce domaine, les problèmes réels (incendie de San Francisco en 1908) se sont vite chargés de réduire à néant l’absurde logique capitaliste. Deux autres exemples montrent que les frontières sont tout à fait perméables. Premièrement celui des autoroutes qui peuvent être gratuites c’est-à-dire payées par le revenu, ou payantes et donc entretenues par des sociétés capitalistes qui réclament le profit moyen sur le capital avancé. Enfin de manière encore plus frappante, un ordinateur, par exemple, peut aussi bien être acheté par une entreprise pour réaliser la comptabilité, que par une administration. Le même ordinateur peut également appartenir à la section I s’il est utilisé pour diriger la production automatisée d’une entreprise ou tout aussi bien appartenir au secteur II des moyens de consommation quand il est acheté par un particulier.
L’or, pour autant qu’il rentre dans les coffres d’une banque dont le but est le profit et va servir à renouveler les monnaies usées, est acheté contre du capital et nous le rangerons dans ce secteur. On objectera que la rémunération du matériel-argent ce n’est pas le taux de profit moyen mais le taux d’intérêt. C’est tout à fait vrai ! mais pas pour autant qu’il représente une dépense de temps de travail pour le produire. Le taux d’intérêt ne fait qu’acheter la valeur d’usage supplémentaire qu’acquiert l’argent dans le cadre du MPC, qui est justement de pouvoir fonctionner comme capital et donc de pouvoir extorquer une plus-value.
« Dans les conditions de la production capitaliste, l’argent – pris ici comme expression particulière d’une somme de valeurs, monnaie ou marchandise – peut être converti en capital et se transformer ainsi en une valeur qui s’accroît ou fructifie par elle-même. Il crée du profit, autrement dit il permet aux capitalistes de soutirer aux travailleurs une certaine quantité de travail non payé – un surproduit et une plus-value – et de se l’approprier. En plus de sa valeur d’usage en tant qu’argent, il acquiert une valeur d’usage supplémentaire, celle de fonctionner comme capital. Sa valeur d’usage consiste alors précisément dans le profit qu’il produit, une fois converti en capital. A ce titre de capital potentiel, comme moyen de créer du profit, l’argent se fait marchandise, mais une marchandise d’un genre spécial. En d’autres termes, le capital en tant que tel devient marchandise. »
(Marx, Capital, Livre III, Pléiade t.2 p.1106-1107)
Pour autant que le capitaliste financier avance de l’argent pour l’ensemble de ses activités[68] il revendique le profit moyen. Par contre, sur le prêt ou l’emprunt d’argent, il verse un intérêt qui correspond à l’acquisition de la valeur caractéristique que prend l’argent comme il fonctionne comme capital.
Ce phénomène est masqué en France, par exemple, où les dépôts courants ne sont pas rémunérés mais où les services du banquier sont, par contre, gratuits. Le phénomène est différent dans les pays anglo-saxons où les dépôts peuvent être rémunérés mais, par contre, l’activité du banquier pour ses conseils, etc., est payante. Il n’y a pas, de ce fait, à distinguer ici le cas spécial de l’or pour autant que son prêt ou son emprunt donne lieu au paiement d’un intérêt. Par conséquent, les capitalistes financiers, pour autant qu’ils avancent un capital dans le cadre de leur activité obtiennent le profit moyen, tout comme le capitaliste commercial. Il ne faut pas pour autant, tout comme pour le capital commercial, en faire une variante particulière de capital industriel[69]. S’il obtient le profit moyen il n’en est pas pour autant créateur de plus-value ou de valeur[70]. Ce travail improductif constitue des frais de circulation qui viennent en déduction de la plus-value.[71]
Nous pouvons donc classer la matière monétaire permettant la reproduction simple de la masse monétaire en circulation, en renouvelant la monnaie usée dans une Section I bis qui pourrait s’intituler : moyens de production destinés à une consommation improductive s’échangeant contre l’argent agissant comme capital[72]. Par contre, pour l’argent prêté par le capitaliste financier tout comme pour l’argent emprunté, il recevra ou versera un intérêt dont théoriquement le taux est identique.
11.5 Les solutions de Rosa Luxemburg et de Grossmann
11.5.1 Rosa Luxemburg inclut une nouvelle section
Pour Rosa Luxemburg, un des principaux avantages de sa solution, outre le fait de souligner beaucoup plus correctement le rôle de la monnaie, était de rétablir un équilibre entre les deux grandes sections du capital productif, équilibre qui serait perturbé par l’introduction de l’or au sein des schémas. En effet, si la production d’or est rangée dans la section I et fait donc partie des moyens de production dont la valeur totale s’élève à 6.000, un déficit va surgir au sein de ce secteur.
L’or doit renouveler la masse monétaire usée et donc ne peut, de par sa destination matérielle, fonctionner comme capital constant. Par conséquent, en classant la production de l’or dans la section I, on introduit un déséquilibre dans les schémas en créant un déficit de capital constant. Si 20 de capital constant sont employés pour produire l’or, tandis que de la production totale de la section I une masse de 30 or ne peut plus être utilisée comme capital constant étant donné sa destruction, il va de soi que la valeur des moyens de production offerts s’élève à 5 970 alors que la valeur des moyens de production nécessaires au renouvellement du capital constant de l’ensemble des secteurs se monte à 6.000. Il s’ensuit un déficit de 30 c pour le capital constant. Déplacer la production dans le secteur II ne ferait que transformer le déficit des moyens de production en déficit des moyens de consommation sans résoudre le problème qui est posé. Pour Rosa Luxemburg il faut donc créer une troisième section pour préserver l’équilibre du schéma de la reproduction simple.
Rosa Luxemburg modifie donc le schéma de Marx en ajoutant une troisième section de manière à conserver les rapports entre les deux grandes sections de la production sociale. Elle obtient alors le schéma suivant :
4.000 c + 1.000 v + 1.000 pl = 6.000 Moyens de production
2.000 c + 500 v + 500 pl = 3.000 Moyens de consommation
20 c + 5 v + 5 pl = 30 Moyens de circulation.
11.5.2 Henryk Grossmann à la recherche du manuscrit perdu
Henryk Grossmann, l’un des rares, voire le seul qui ait essayé de répondre complètement aux objections de Rosa Luxemburg, s’en prend violemment à celle-ci, dans l’article précédemment cité. Il y attaque « la stérilité de la critique luxemburgiste », laquelle «purement verbale n’est sous-tendue par aucune réflexion profonde». Rosa Luxemburg non seulement n’aurait, d’après Grossmann, aucun argument positif contre les schémas de Marx, mais de plus elle n’aurait pas une seule fois cherché à présenter correctement ceux-ci.
Examinons de plus près ce qui vaut à Rosa Luxemburg ce chapelet d’injures.
Nous venons de voir que, pour elle, l’introduction de l’or dans les schémas créait un déséquilibre. Cependant, comme nous l’avons rappelé, dans les manuscrits de Marx, l’étude consacrée à l’échange de l’or à l’intérieur de la section I est absente. En toute continuité avec son analyse, Rosa Luxemburg conclut «elle n’aurait fait qu’accroître les difficultés». Pour Henryk Grossmann, une telle réflexion n’est qu’une manœuvre pour masquer les propres difficultés de Rosa Luxemburg. Si elle fait une telle déclaration, c’est parce qu’elle ressent le fait que la preuve qu’elle présente des «difficultés» du schéma de Marx n’est pas suffisante ; aussi va-t-elle en chercher une nouvelle dans la «seule volonté d’écraser dans la polémique l’adversaire».
Bien loin d’être de mauvaise foi, Rosa Luxemburg ne faisait que donner une conclusion logique à son raisonnement. Si, dans cette affaire, il y a une personne qui cherche n’importe quel argument pour « écraser l’adversaire », c’est bien Grossmann. Pour lui, toute la lumière serait venu de cette page manquante, aussi s’efforce-t-il de la reconstituer.
Nous allons suivre le long et fastidieux cheminement du docteur Grossmann dans sa recherche du manuscrit perdu. Tout le monde a son chemin de croix et le lecteur devra donc subir celui-là, mais une fois effectué, il sera démontré que Grossmann y tient plutôt le rôle de Judas ou celui de Ponce Pilate.
Nous connaissons déjà les premières hypothèses de Grossmann, à savoir que la masse monétaire utilisée pour la circulation est de 2 500. Il suppose également que la masse monétaire usée est de 1% de la masse totale, soit 25. Après avoir analysé la production de l’or comme un des faux frais de la production capitaliste, Grossmann conclut : « si 25 or sont perdus chaque année, la société doit, d’une année sur l’autre, soustraire de la production des marchandises une partie de son capital productif, de même taille pour remplacer cette perte et l’utiliser pour la production de l’or.» (op. cit. P. 99)
Par conséquent, d’après Grossmann, l’erreur fondamentale de Rosa Luxemburg serait d’avoir voulu ajouter la production d’or à la production des marchandises alors qu’il aurait fallu la retirer. Tout ce qu’a de mieux à dire Grossmann c’est que Rosa Luxemburg invente un problème parce qu’elle ne sait pas compter.
« Le fait de poser une addition là où il fallait une soustraction, cela seulement est à l’origine de toutes ses erreurs à elle (RL, NDR) et de ses contradictions quand elle traite de la production de l’or.» (id. P. 100)
Donc, pour Grossmann, la production d’or ne fait pas augmenter la production sociale mais la fait diminuer de 30 ; celle-ci, une fois la valeur de l’or retranchée, est alors d’après lui de 5 980 c + 1 495 v + 1 495 pl = 8 970 (9.000 – 30 ) tandis que, nous l’avons vu, elle est, chez Rosa Luxemburg, de 6.020 c + 1 505 v + 1 505 pl = 9.030.
Là encore, Grossmann atteint le comble de la superficialité ; plutôt que de s’attacher à montrer l’incohérence interne des schémas de Rosa Luxemburg, il critique son exemple. Pourtant, il va de soi que si l’on souligne les proportions entre les secteurs de production, on ne retrouvera pas forcément la grandeur totale antérieure. Le nombre 9000 n’est qu’un exemple ; il n’est nullement à respecter. Donc, ce n’est pas, a priori, parce que le produit social total s’élève à 9.030 plutôt qu’à 8.070 que la solution de Rosa Luxemburg est fausse. Seule compte la cohérence interne du schéma et l’explication qui en est donnée.
Revenons à la solution de Grossmann :
Si 1% de la masse monétaire (2 500) est usée, il ne reste plus entre les mains de la classe capitaliste que 2 475 (2 500–25), dont 1 650 pour les capitalistes de la section I et 825 pour ceux de la section II.
Le schéma se présente ainsi (cf. Grossmann op. cit. p. 104) :
I 4.000 c + 1.000 v + 1.000 pl = 6.000 (marchandises) 1.650 (argent)
II 2.000 c + 500 v + 500 pl = 3.000 (marchandises) 825 (argent)
![]()
![]()
9.000 2.475
Les frais relatifs à l’usure (25) sont ainsi répartis proportionnellement entre les deux fractions de la classe capitaliste, soit 16 2/3 pour I et 8 1/3 pour II. Il faut maintenant remplacer les 25 Or manquants. Pour cela, la classe capitaliste I avance 16 2/3 en argent au producteur d’or et la classe capitaliste II avance 8 1/3. La masse monétaire entre les mains des capitalistes de I et II n’est donc plus que de 2.450 (2.475–25). L’argent avancé va retourner aux capitalistes mais les sommes reçues sont différentes des sommes avancées car les producteurs d’or achètent pour 20 c à la classe capitaliste I et versent 5 v à leurs ouvriers qui achètent des moyens de consommation. Les capitalistes de I ont alors un excédent de 3 1/3 (20 – 16 2/3) et les capitalistes de II un déficit de 3 1/3 (5 - 8 1/3). Pour compenser ce déficit les capitalistes de I achètent des moyens de consommation pour une valeur de 3 1/3.
A l’issue de ces opérations, le schéma devient :
a) Production de marchandises :
I 4.000 c + 1.000 v + 980 pl (moyens de production) + 3 1/3 (moyens de consommation) et 1.650 (argent)
II 2.000 c + 500 v + 491 2/3 pl (moyens de consommation) et 825 (argent)
b) Production d’or :
20 c + 5 v
Grossmann se pose alors la question suivante : peut-il y avoir un échange sans reste entre 1980 (v + pl) I et 2000 c II ?
Il y a manifestement 20 en excédent dans la section II puisque le renouvellement du capital constant de la section II se fait intégralement par l’échange entre le capital variable et le plus-value de la section I. Nous voilà, par la même occasion, ramenés au point de départ et à l’objection de Rosa Luxemburg. Le schéma est déséquilibré par l’introduction de l’or et l’échange entre la section I et II ne peut se faire sans laisser d’excédent. Toutes les circonvolutions de Grossmann n’ont abouti qu’à ce piètre résultat qui est la reconnaissance implicite du bien-fondé des critiques de Rosa Luxemburg. Grossmann est pris à son propre piège. Pour en sortir, il n’a qu’une solution ; il faut qu’il adapte, à tout prix, le volume de la production de la section II, en diminuant la production dans ce secteur. Cette diminution de la production, il l’obtient en considérant que des moyens de consommation d’une valeur de 25 doivent être consommés par la classe capitaliste II. Celle-ci réalise donc une consommation forcée supplémentaire de 25 ce qui ne va pas, bien entendu, sans quelques entorses à la logique. Si nous suivons à la lettre Grossmann, cette solution tourne même au ridicule puisqu’une partie de la production qui devrait être supprimée (5) est en fait destinée aux ouvriers. Ils ont effectivement reçu l’argent correspondant à la valeur de leur force de travail et donc à la valeur de ces moyens de consommation nécessaires. Les capitalistes devraient donc entrer en conflit avec les ouvriers, leur reprendre l’argent ou se précipiter à la porte des magasins pour leur arracher les marchandises qu’ils viennent d’acheter, et, bien entendu, il faudra tout de suite après les licencier.
D’autre part, s’ils consomment les moyens de consommation correspondant à la reproduction du capital constant, une partie du capital fixe sera désormais inactive ce qui répond bien entendu au fait qu’une partie de la force de travail sera inemployée. Par ailleurs, des différences importantes existent dans la consommation de la classe capitaliste. La section II consomme 491 2/3 + 25 = 516 2/3 pour une plus-value de 500, nous ne sommes plus dans le cadre de la reproduction simple, mais dans celui de la «reproduction rétrécie», la classe capitaliste se mettant, au prix d’une indigestion et de problèmes sociaux à consommer son capital pour réduire la production. Dans ce cas, elle aurait pu s’éviter tous ces malheurs en ne cherchant pas à valoriser un tel capital. Quant à la classe capitaliste de la section II elle se contente d’une consommation de 983 1/3 (980 + 3 1/3) pour une plus-value de 1.000. Et Grossmann voudrait faire passer tout cela pour la reconstitution de la page manquante du manuscrit de Marx !
Toujours en suivant Grossmann, on devrait donc aboutir au schéma suivant :
a) Production de marchandises:
I 4.000 c + 1.000 v + 980 pl (moyens de production) + 3 1/3 (moyens de consommation) et 1.650 (argent)
II 1.980 c + 495 v + (491 2/3 pl + 25 ) (moyens de consommation) et 825 (argent)
b) Production d’or :
20 c + 5 v + 5 pl = 30
Conformément à la volonté de Grossmann, dans le secteur II, la production diminue de 20 c + 5 v ce qui entraîne ipso facto une baisse de la plus-value de 500 à 495. Comme le capital a été consommé il s’ajoute à l’ensemble de la plus-value restant à consommer (491 2/3).
Mais le schéma qui apparaît n’est pas celui prévu, mais le schéma suivant :
I 4.000 c + 1.000 v + 1.000 pl = 6.000 (moyens de production) et 1.650 (argent)
II 1.980 c + 495 v + 495 pl = 2.970 (moyens de consommation) et 825 (argent)
20 c + 5 v + 5 pl = 30 et 30 (argent)
![]()
![]()
9.000 2.505
Aucune explication n’est donnée de cette heureuse transition. Sans doute manque-t-il une page au manuscrit de Grossmann ! Plutôt que de chercher à la reconstituer complètement nous supposerons qu’à l’issue de la première année où la consommation de la plus-value par les différentes fractions de la classe capitaliste a déjà été décrite, chaque secteur de la production produit désormais en fonction du capital avancé, soit :
4.000 c + 1.000 v dans la section I,
1.980 c + 495 v dans la section II
20 c + 5 v pour la production d’or.
Donc, après une première année d’adaptation, dont les circonstances ne nous sont pas expliquées, et dont on aurait pu faire l’économie, la production se stabilise. Elle arrive alors à prendre la forme du schéma ci-dessus.
Au premier abord, le schéma paraît beaucoup plus satisfaisant que celui qui résulterait des explications embrouillées de Grossmann et, si l’on en croit celui-ci, le remplacement de la monnaie usée ne se fait pas au frais d’une seule des deux sections du schéma comme le dit Rosa Luxemburg. Cette dépense serait alors répartie proportionnellement entre les capitalistes des deux sections, c’est-à-dire proportionnellement à l’importance des capitaux avancés.
Examinons maintenant comment se font les échanges au sein du schéma.
L’échange entre les sections I et II se fait sur la base de 1980 II c = 1000 v (I) + 980 pl (I). Une partie de la plus-value (20) de la section I demeure sous la forme de moyens de production. Ces moyens de production sont achetés par le secteur de la production d’or pour reproduire son capital constant. Par la même opération, la section I obtient alors une masse monétaire de 20 qui vient s’ajouter à la masse monétaire de la section. Dans la section II, la classe capitaliste consomme la plus grande partie de la plus-value soit 485. Il reste donc une masse de moyens de consommation de 10. Ceux-ci vont être consommés par les ouvriers et les capitalistes de la section de la production d’or puisque le capital variable pour salarier les ouvriers s’élève à 5, tandis que la plus-value des capitalistes producteurs d’or se monte également à 5. En contrepartie, la classe capitaliste de la section II obtient une masse monétaire de 10 qui est ajoutée à la masse monétaire de ce secteur. La reproduction du capital, les échanges au sein du schéma se déroulent donc sans heurts et, par conséquent, la prise en compte de la production d’or ne déséquilibre pas le schéma. Aucun déficit ni excédent n’apparaît, ni dans la section I ni dans la section II. Sous cet angle, le contrat de Grossmann semble rempli, mais qu’advient-il de son autre affirmation selon laquelle les dépenses sont proportionnelles aux capitaux avancés ?
Comme la section II consomme, par rapport à la section I, une partie moindre de sa plus-value, les frais monétaires sont inégalement répartis: 20/1.005 (production d’or incluse) pour la section I et 10/495 pour la section II. Le rapport 10/495 étant supérieur à 20/1.005 la classe capitaliste de la section II est défavorisée ; les frais monétaires qu’elle supporte sont relativement plus importants. Qui plus est, au sein de la section I, le déséquilibre entre les producteurs d’or et les autres branches de la section I est patent puisque les premiers ne supportent – au nom de quel prodige ? – pas de frais monétaires. On pourrait se demander si Grossmann, quand il parle de dépenses monétaires proportionnelles, ne parle pas uniquement pour la section I et II, c’est-à-dire à l’exclusion du producteur d’or. Mais, même si nous mettons de coté celui-ci, les inégalités relatives subsistent : 20/1 000 et 10/495.
Les trois secteurs ont des frais monétaires différents (0/10, 20/1 000, 10/495), la classe capitaliste de la section II étant la plus défavorisée tandis que les producteurs d’or sont les principaux bénéficiaires de cette répartition. La masse monétaire à la disposition de la classe capitaliste est désormais elle aussi, inégalement répartie. Tant que Grossmann considérait que le capital de la section I était deux fois plus grand que le capital de la section II, il pouvait considérer, ce qui est son raisonnement, que la masse monétaire dans la section I était bien le double de la masse monétaire dans la section II. Mais maintenant le rapport n’est plus de 2 mais supérieur à 2 (6 000/2 970, voire 6 030/2 970 si nous incluons l’or) tandis que la masse monétaire reste dans le même rapport de 1 à 2. Ce qui avait été obtenu sur la base des conditions antérieures est maintenu ici sans justification alors que les bases du raisonnement ont été modifiées. Voilà la belle logique que Grossmann voudrait attribuer à Marx.
11.5.3 Rosa Luxemburg ne résout pas le problème qu’elle pose
Si Grossmann échoue piteusement, la solution de Rosa Luxemburg n’est pas meilleure ; mais elle, au moins, n’a pas essayé de nier le problème.
En créant une troisième section, la section des moyens d’échange elle transforme, nous l’avons vu, le schéma de Marx de la manière suivante:
I 4 000 c + 1 000 v + 1 000 pl = 6 000 Moyens de production.
II 2 000 c + 500 v + 500 pl = 3 000 Moyens de consommation.
III 20c + 5 v + 5 pl = 30 Moyens de circulation
Nous avons déjà critiqué une telle réorganisation au début de cet exposé : la création d’une troisième section ne peut avoir la justification théorique que lui donne Rosa Luxemburg au nom du rôle spécifique de la monnaie. Cette création résout-elle pour autant les problèmes plus technique liés à la cohérence interne des schémas, au bon déroulement des échanges entre les sections?
Dans la mesure où le déplacement de l’or dans une troisième section restaure pour les sections I et II les proportions qui avaient servies à l’étude de la reproduction simple, il est évident que désormais l’échange entre (v + pl) I et IIc ne présente plus de difficultés. Quant aux frais monétaires, ils sont proportionnels au capital de chaque secteur 20/1 000 pour la section I et 10/500 pour la section II. Cependant, tout comme chez Grossmann, le producteur d’or est exempté, sans explication, de frais monétaires; cette fraction de la classe capitaliste ne contribue en rien aux frais issus du procès de circulation.
Il existe une difficulté encore plus importante que, au prix des acrobaties que nous avons évoquées, Grossmann a évité ; c’est celle qui a trait à l’équilibre du schéma. Le producteur d’or se trouve dans l’impossibilité de renouveler son capital constant. Si les échanges entre la section I et la section II ne posent pas de problèmes, par contre, il manque 20c dans la production de la section I (6 000 contre 6 020 demandés) pour que le producteur d’or puisse reproduire le capital constant qu’il a utilisé. La même chose vaut pour le capital variable puisque la valeur de la production de moyens de consommation s’élève à 1 500 tandis que le capital variable avancé aux ouvriers se monte à 1 505. Enfin, la classe des capitalistes producteurs d’or se trouve également dans l’impossibilité de trouver l’équivalent matériel de sa plus-value, la totalité des moyens de consommation correspondant à la reproduction de la classe capitaliste étant déjà consommés. Par conséquent, aussi bien la production des moyens de production que la production des moyens de consommation se révèle insuffisante par rapport aux besoins globaux des trois secteurs. Un déficit apparaît dans la section I comme dans la section II. Le déséquilibre que Rosa Luxemburg a rétabli à l’intérieur des échanges entre la section I et II reparaît à l’extérieur avec la création d’une troisième section. Elle n’a fait que déplacer les difficultés de l’intérieur à l’extérieur du schéma de la reproduction simple sans pour autant avancer d’un pas vers leur solution.
11.6 Esquisse d’un schéma équilibré
11.6.1 Les hypothèses fondamentales pour un schéma cohérent
S’il est vain de nier le problème, comme essaye de le faire Grossmann, la création d’une troisième section spécifique ne le résout pas pour autant. Si un déséquilibre se manifeste, c’est, nous l’avons vu, parce que l’or en tant que monnaie, ne peut être réutilisé au sein du capital productif. La valeur de l’or ainsi produite fait partie des frais de circulation du capital, frais improductifs qui viennent en déduction de la plus-value. Des schémas incluant la reproduction de la matière monétaire doivent alors satisfaire aux conditions suivantes :
· Les frais monétaires doivent être déduits de la plus-value.
· Les dépenses doivent être proportionnelles pour chaque fraction de la classe capitaliste aux capitaux avancés.
· La valeur de la production de moyens de production et de moyens de consommation doit être suffisante pour satisfaire tous les besoins que ce soit la reproduction du capital constant des secteurs productifs ou la reproduction du capital constant de la section de la production d’or. Quant aux échanges internes ils doivent se dérouler sans difficultés.
Nous pouvons donc alors établir un schéma qui peut se présenter comme suit : (pour plus de commodité nous avons élevé le taux d’exploitation et, pour faciliter l’exposition, nous avons séparé le producteur d’or, tout en le rangeant dans la section I, section I b).
I a 4 000 c + 1 000 v + 1 020 pl = 6 020 (moyens de production)
I
I b 20 c + 5 v + 5,1 pl = 30,1 (or)
II 2 000 c + 500 v + 510 pl = 3 010 (moyens de consommation)
Pour chaque secteur et sous-secteur les frais monétaires sont respectivement de 20 pour la section I, 0,1 pour les producteurs d’or et 10 pour la section II. Il nous reste à voir comment les échanges se déroulent au sein des schémas.
11.6.2 Reproduction du capital constant.
11.6.2.1 a) Section Ia
Il n’y a pas de problème particulier ; le capital constant est déjà sous sa forme d’usage. Il se reproduit par des achats au sein de la section.
11.6.2.2 b) Section Ib
La classe capitaliste Ia a des frais monétaires qui s’élèvent à 20. D’un autre côté, le capital constant des producteurs d’or est de 20. En achetant, avec l’or produit, 20 de capital constant au secteur Ia, le capitaliste de la section de la production d’or renouvelle son capital constant tandis que le secteur I a récupéré une masse d’or de 20 qui lui permet de reconstituer sa masse monétaire. Cet échange se fait sur la base de 20 cII, contre 20 pl Ia. Le capital constant de la section Ib est obtenu par l’échange avec la plus-value de la section Ia. Les frais monétaires viennent en déduction de la plus-value de Ia. Nous ne précisons pas ici la grandeur de la masse monétaire car cela n’a aucune importance; nous considérons cependant que la totalité de l’or produit ne fait que reconstituer la masse monétaire usée, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de thésaurisation. Dans son exemple, Marx considérait une vitesse de circulation de 3 et une masse monétaire de 3 000 pour une production d’une valeur de 9 000[73]. Ici, sur la même base de 1% d’usure et d’une vitesse de circulation de 3, la masse monétaire s’élèverait à 3 010.
11.6.2.3 c) Section II.
Le renouvellement du capital constant dans la section II s’accomplit sur la base du classique IIc = (v + pl ) I.
Mais, ici, ce n’est pas la totalité de la plus-value qui est affectée à cet échange, mais la totalité de la plus-value moins la partie de celle-ci consacrée aux dépenses monétaires. L’autre partie de la plus-value (1 000 soit 1 020 - 20) est consommée à des fins individuelles et, par conséquent, est l’occasion d’une demande de moyens de consommation auprès de la section II.
11.6.3 Reproduction du capital variable.
11.6.3.1 a)Section Ia
Déjà vu, cf. § 1a
11.6.3.2 b) Section Ib.
La classe ouvrière dépense son salaire auprès de la section des moyens de consommation et, en se procurant des moyens de consommation, elle remet une valeur de 5 aux capitalistes de la section II qui supportent, pour renouveler la masse monétaire usée, des frais monétaires s’élevant à 10. La classe capitaliste de la section de la production d’or n’a pas besoin de voir refluer vers elle l’argent qu’elle a avancé pour salarier ses ouvriers dans la mesure où le produit social figure directement sous la forme argent. La classe capitaliste de la section II consacre une partie de sa plus-value à payer les frais du renouvellement de la masse monétaire. C’est en échange avec cette partie de la plus-value que se réalise l’échange entre la section II et la section Ib. Nous avons donc l’échange v (Ib) + pl (Ib) = xpl (II) où xpl représente la part, de la plus-value totale consacrée à la reproduction de la matière monétaire.
11.6.3.3 c) Section II.
Nous sommes ici dans un cas, déjà étudié lors de l’analyse de la reproduction simple. Il n’y a aucun problème nouveau particulier à signaler.
11.6.4 Consommation de la plus-value.
11.6.4.1 a) Section Ia
Déjà vu. Cf. § 1o) a)
11.6.4.2 b) Section Ib.
La classe capitaliste de la section Ib consomme sa plus-value en achetant des moyens de consommation à la section II. La partie de la plus-value que la classe des capitalistes producteurs d’or consomme s’élève à 5 tandis que le reste 0,1 représente la quote-part de cette classe aux frais monétaires qui incombent à l’ensemble de la classe capitaliste et qui sont payés sur la plus-value. Comme toutes les autres fractions de la classe capitaliste, les producteurs d’or ont à contribuer aux frais généraux de cette classe et ne peuvent se trouver exemptés sous prétexte qu’ils assurent la production d’or. Cette partie de la plus-value déduite, il reste, dans le cas de la reproduction simple, la partie de la plus-value destinée à la consommation individuelle. Avec cet échange, la section II obtient ainsi la totalité de la masse monétaire (10) qui lui est nécessaire pour reproduire la monnaie usée. Nous avons vu que l’échange entre Ib et II se faisait sur la base de (v + pl) Ib = plx (II). Nous avons vu l’échange pour v (Ib) et, maintenant, nous avons vu le même échange pour pl (Ib).
11.6.4.3 c ) Section II
L’échange entre la partie de la plus-value destinée à payer les frais de reproduction de la monnaie usée et le capital variable et la plus-value des capitalistes engagés dans la production de l’or a déjà été analysé. Une masse de plus-value de 10 a donc été affectée à cet usage. Il reste une masse de plus-value de 500 qui rentre dans le cadre classique, que nous connaissons déjà, de la reproduction simple. Cette plus-value est consommée entièrement, par la classe capitaliste.
11.6.5 Un équilibre global
Les échanges entre les diverses sections n’ont donc présenté aucune difficulté. Et, il est tout à fait facile de vérifier que la production de chaque section correspond bien aux besoins de l’ensemble de la société. Dans la section I, la valeur des moyens de production s’élève à 6 020, tandis que chaque section demande des moyens de production à concurrence de 4 000 + 20 + 2 000 = 6 020. Il en va de même pour les moyens de consommation: 3 010 pour une demande de 1 000 + 1 000 + 5 + 5 + 500 + 500 = 3 010. Quand au secteur de la production d’or, la monnaie produite doit représenter l’usure annuelle de la masse monétaire, chaque section participant à ces frais improductifs au prorata du capital avancé, ou, ce qui dans le cas présent revient au même, au prorata de la plus-value. Pour une production de 30,1 d’or, les besoins nécessaires pour renouveler la masse monétaire s’élèvent à 20 + 0,1 + 10 = 30,1. Dans tous les secteurs, le schéma est, bien en équilibre. L’introduction de l’or dans les schémas de la reproduction simple, quelle que soit la section à laquelle on la rattache, ne détruit pas a priori l’équilibre du schéma. Il n’est, donc nul besoin d’une troisième section spécifique. Ce qui par contre est nouveau du fait de la nature particulière de ses dépenses – frais improductifs liés au processus de circulation – c’est qu’ils viennent en déduction de la plus-value et que donc on assiste au sein du schéma à un échange entre la plus-value des diverses sections et la production d’or, donc la totalité de la plus-value n’est pas consommée à des fins individuelles, mais le caractère de la reproduction simple (pas d’accumulation nouvelle de plus-value) est cependant maintenu. Nous avons d’ailleurs vu que c’est vers cette plus-value que Marx oriente les dépenses liées à la reproduction de la masse monétaire.
11.6.6 La proportionnalité des frais de reproduction
Il nous reste à voir si les frais afférents à la reproduction de la masse monétaire sont bien, pour chaque section, proportionnels aux capitaux avancés.
Pour la classe capitaliste de la section des moyens de production, ils s’élèvent à 20/5 000 par rapport, au capital avancé et à 20/1 020 de la plus-value. Le rapport, est identique à 10/2 500 pour le capital avancé ou 10/510 pour la plus-value de la section II. Quant à la classe des capitalistes producteurs d’or qui doit comme tous les autres payer sa quote-part des frais de circulation, les dépenses représentent 0,1/25 du capital avancé et 0,1/5,1 de la plus-value. Par conséquent, dans les trois sections, les frais monétaires sont dans le même rapport.
11.6.7 Un regroupement possible
Si nous condensons le schéma de manière à ne faire qu’une seule section de la section des moyens de production et de la production d’or, sachant qu’il s’agit pour la production de l’or d’une partie des forces productives utilisée de façon improductive et non productive, ce qui n’ est pas le cas du reste de la section I, nous obtenons le schéma suivant :
I 4 020 c + 1 005 v + 1 025,1 pl = 6 050,1
II 2 000 c + 500 v + 510 pl = 3 010
L’introduction de l’or dans les schémas de la reproduction simple modifie le schéma étant donné qu’une partie des forces productives est dépensée de façon improductive et donc s’échange contre la plus-value des capitalistes. Mais l’équilibre entre les diverses sections demeure et les échanges se déroulent sans heurts. Ce point vaut aussi bien pour les échanges entre les sections du capital productif que pour ceux qui affectent la production d’or. Par conséquent, après avoir rejeté, pour des raisons d’ordre méthodologique, la création d’une troisième section nous pouvons également constater que sous l’angle logique, non seulement la solution de Rosa Luxemburg n’a rien apporté, mais elle s’est même révélée fausse.
11.7 Thésaurisation et reproduction simple.
11.7.1 Rosa Luxemburg et la thésaurisation
Rosa Luxemburg a, toutefois, un autre argument important pour justifier la création d’une troisième section :
« La tentative faite par Marx de faire entrer la production de l’or dans la section I (moyens de production) le mène d’ailleurs à des résultats dangereux. Le premier acte de la circulation entre cette nouvelle sous-section, que Marx appelle I mci (pour moyens de circulation, NDR), et la section II (moyens de consommation) consiste, comme d’ordinaire, en ce que les ouvriers de la section I mci, avec la somme (5v) reçue en salaires des capitalistes, achètent des moyens de consommation de la section II. L’argent employé à cela n’est pas encore un produit de la nouvelle production, mais un fonds de réserve des capitalistes I mci, fonds provenant du quantum d’argent se trouvant dans le pays, ce qui est tout à fait dans l’ordre. Or, Marx fait acheter par les capitalistes de la section II, à l’aide des 5 d’argent reçus d’abord par I mci, pour 2 d’or «en tant que matériel marchandise» et saute par conséquent de la production de l’argent dans la production industrielle de l’or, laquelle a aussi peu affaire avec le problème de l’argent que celle du cirage. Mais comme sur ces I mci 5v, il en reste toujours 3, dont les capitalistes de la section II ne savent que faire, étant donné qu’ils ne peuvent pas les utiliser en tant que capital constant, cette somme d’argent, Marx la fait thésauriser. Mais, pour ne pas faire apparaître par là un déficit dans le capital constant de la section II, qui doit être échangé entièrement contre des moyens de production I (v + pl), Marx trouve la solution suivante: « II faut que cet argent passe en totalité de IIc à IIpl. Peu importe que ce dernier existe sous forme de moyens de subsistance nécessaires ou de moyens de luxe, et qu’une valeur-marchandises correspondante soit transférée de II pl II c. Résultat: une partie de la plus-value est accumulée comme trésor. » Le résultat est assez étrange. Du fait que nous avons considéré uniquement la reproduction de l’usure annuelle du matériel argent, est apparue brusquement une thésaurisation de l’argent, par conséquent un excédent de matériel argent. Cet excédent apparaît, on ne sait pas pourquoi, aux dépens des capitalistes de la section des moyens de consommation, qui doivent se sacrifier, non pas pour élargir leur propre production de plus-value, mais afin qu’ il y ait suffisamment de moyens de consommation pour les ouvriers de la production d’or.
Cependant, les capitalistes de la section II sont assez mal récompensés de cette vertu chrétienne. Non seulement ils ne peuvent, malgré leur « abstinence », procéder à aucune extension de leur production, mais ils ne sont même pas en état de maintenir leur production dans les mêmes dimensions que jusqu’alors. (....) Ces résultats obtenus par Marx prouvent d’eux-mêmes que la production de l’or ne peut absolument pas être incluse dans l’une des deux sections sans briser le schéma lui-même.» (Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital, Petite collection Maspero,T.1 p.84-85)
Nous avons déjà montré que la production d’or dans les schémas de la reproduction simple ne les mettait pas en péril et que, donc, les échanges se déroulaient sans difficulté, et, tout particulièrement, qu’aucun excédent de capital constant n’apparaissait. Il nous reste, cependant, à voir le problème de la thésaurisation. Il consiste dans l’élimination de la thésaurisation. En effet, dans le cadre de la reproduction simple, il n’y a pas d’accumulation de matériel-argent et l’or produit ne doit donc servir qu’à renouveler la masse monétaire usée. C’est ce point que voulait également résoudre Rosa Luxemburg en créant une troisième section. Mais en faisant cela, c’est-à-dire en essayant d’éliminer la thésaurisation des schémas, elle s’attire les critiques de Suzanne de Brunhoff et de Grossmann.
11.7.2 La critique de Suzanne de Brunhoff
Pour Suzanne de Brunhoff, « l’erreur de Rosa Luxemburg (création d’une troisième section NDR ) va de pair avec l’inexactitude de l’interprétation du rôle de la thésaurisation de l’or produit. Rosa Luxemburg aurait le tort, de ne pas préciser la « fonction particulière de la thésaurisation », laquelle serait, suivant Marx, d’expliquer la présence de la masse monétaire servant à la circulation des marchandises. Pour appuyer ses dires, Suzanne de Brunhoff cite Marx :
« (…) il apparaît que, même dans le cas de la reproduction simple, même en éliminant l’accumulation au sens propre, l’accumulation d’argent, ou thésaurisation, est par contre nécessairement incluse ici. Ceci se reproduisant tous les ans, il est possible d’expliquer par là l’hypothèse dont on part pour analyser la production capitaliste, à savoir qu’au début de la reproduction une masse de numéraire, correspondant à l’échange de marchandises, se trouve entre les mains de la classe des capitalistes I et II. Cette accumulation a lieu même après déduction de la perte d’or due à l’usure de la monnaie en circulation. (Marx, Le Capital, Livre II T.5 Ed. Sociales p.120)
Ainsi, « loin de perturber l’équilibre général de la reproduction, cette thésaurisation en assure le maintien, au niveau secondaire où elle produit son effet.» (S. de Brunhoff, La monnaie chez Marx p. 91)
Considérons cependant les effets secondaires que cette thésaurisation produit.
S. de Brunhoff suppose qu’une masse d’or de 5 sur les 10 reçus par la classe capitaliste est thésaurisée. Par conséquent, dans la section II, 80% de l’or créé est consacré à la thésaurisation. Si l’on ne veut pas défavoriser la classe capitaliste de la section I, il faudrait que la proportion entre la monnaie thésaurisée et la monnaie obtenue soit identique à celle de la section I. Dans ce cas 80% des 20 or reçus, soit 16 devraient être consacrés à la thésaurisation dans la section I. Au total donc la masse monétaire thésaurisée devrait être de 24. Dans l’interprétation de S. de Brunhoff, il n’est pas fait mention de cette thésaurisation, pas plus que de la partie de l’or nouvellement produite destinée à remplacer la monnaie usée. C’est-à-dire que, sur la production de 30-or, nous ne connaissons que la destination d’une seule partie (les 10 destinés à la section II dont 2 réutilisés comme capital constant dans la section des moyens de consommation et 8 thésaurisés). Nous avons vu que dans le manuscrit de Marx il manquait une page. A la différence de Grossmann, S. de Brunhoff ne s’est pas préoccupée de la reconstituer ; aussi son exposé global demeure fragmentaire et incohérent. Mais, acceptons la perspective de S. de Brunhoff et admettons qu’une masse monétaire de 8, une masse de monnaie quelconque, soit thésaurisée chaque année. Si nous admettons donc qu’une partie de la masse monétaire nouvellement produite est utilisée à la reproduction de la masse monétaire tandis que l’autre est, thésaurisée, nous devons en déduire, qu’à un moment donné, il n’y avait qu’une quantité infime, voire pas de monnaie du tout, pour assurer la réalisation de la valeur du produit social. La valeur du produit social, dans notre exemple, est de 9.000. Si, chaque année, la masse monétaire s’accroît de 8, par exemple, cela signifie que l’année précédente elle était d’une valeur inférieure, par exemple de 2.992 si nous supposons qu’elle est aujourd’hui de 3 000 et qu’elle sera demain de 3.008. Chaque année antérieure, en supposant, qu’il y ait thésaurisation, ce qui est l’hypothèse admise, la masse monétaire est de plus en plus faible. Il s’ensuit que pour réaliser la valeur du produit social, la vitesse de circulation doit s’accroître sans cesse pour atteindre l’infini à l’origine du processus que l’on décrit. Quant à la vitesse pour déplacer Ia malheureuse pièce d’or qui doit passer de mains en mains pour réaliser le produit social elle approche la vitesse de la lumière ! Voilà le remarquable résultat que l’on prétend faire passer pour le nec plus ultra de la pensée marxienne !
11.7.3 La critique de Grossmann
Nous n’avons vu là que le passé. Si nous nous projetons, maintenant, dans l’avenir que constatons-nous ? La masse monétaire se gonfle, de période en période, et progressivement constitue une immense montagne d’or totalement inutile. Grossmann n’est d’ailleurs pas en reste puisqu’il reprend la même argumentation que S. de Brunhoff.
« Si, avec une approximation scientifiquement admissible, pour les périodes de l’antiquité et, du Moyen-Âge, en raison de l’absence d’un grand capital fixe (Grossmann assimile ici abusivement la thésaurisation nécessaire au renouvellement du capital fixe avec celle du matériel argent : la première bien sur ne déséquilibre pas le schéma – cf. Renouvellement du capital fixe. Marx Livre II – NDR) et de la constance relative de la technique, nous pouvons parler de la reproduction simple dans la production de l’or, même sur de plus longues périodes, peu à peu, tout de même, au cours des siècles, une réserve d’or devait s’accumuler. »
(Grossmann, Op. cit. p.103)
Avec Grossmann, l’interprétation « historique » de la « thésaurisation » atteint le comble de l’absurdité : ce qui n’est qu’une hypothèse méthodologique se voit attribuer une validité historique, comme si la reproduction simple embrassait toute l’histoire de l’humanité. Comme le souligne Marx, la reproduction simple n’est qu’un instrument méthodologique.
« La reproduction simple, à la même échelle, apparaît aussi comme une abstraction, en ce sens que, d’une part, en système capitaliste l’absence d’accumulation ou de reproduction à une échelle élargie est une hypothèse étrange, d’autre part, les conditions dans lesquelles s’effectue la production ne restent pas absolument identiques (et c’est pourtant ce que l’on a supposé) d’une année à l’autre. (....) Cependant, du moment qu’il y a accumulation, la reproduction simple en forme toujours une partie ; elle peut donc être étudiée en elle-même et constitue un facteur réel de l’accumulation. » (Marx, Le Capital, T.V., Editions Sociales, p.48)
En fait, il faut considérer le niveau de la production comme donné et l’argent nécessaire pour faire circuler le capital comme également donné. Prendre en compte l’origine du niveau atteint par la production n’a aucune valeur méthodologique, ce d’autant plus que la reproduction simple est une abstraction méthodologique.
Grossmann établit, à la différence de S. de Brunhoff, la distinction entre monnaie servant à renouveler la partie de l’or usée et la monnaie thésaurisée. Le remplacement de la perte d’or se fait grâce à 25 or. Comme la production d’or est de 30, une masse d’or de 5 est thésaurisée et la masse monétaire totale passe alors de 2500 à 2505. L’origine de cette thésaurisation se trouve dans la plus-value des producteurs d’or, laquelle « considérée socialement n’est pas consommable. Cette plus-value doit, par conséquent, être thésaurisée. »
Mais, si l’on suit le raisonnement de Grossmann, cette thésaurisation ne peut être le fait que de la classe capitaliste de la section II, étant donné que la plus-value de la section de l’or n’est dépensée qu’auprès de ce secteur en achats de biens de consommation. L’objection de Rosa Luxemburg demeure toujours valable : pourquoi la thésaurisation incombe-t-elle au seul secteur II ? D’autre part, nous retrouvons les mêmes contradictions que chez Suzanne de Brunhoff. Si 1% de la masse monétaire globale est usée, il faudra l’année suivante avancer un capital de 25,05, c’est-à-dire qu’il faudra utiliser une quantité croissante des forces productives de la société afin de produire de l’or. Chaque période de production, la part du capital constant et du capital variable nécessaires à la production de l’or s’accroît. En poussant à son comble le processus on aboutirait à ce que la totalité des forces de production soient employées à produire de l’or. La masse monétaire entre les mains de la section II s’accroît sans cesse et, l’on peut supposer comme chez Suzanne de Brunhoff, qu’il y a eu une époque où cette masse monétaire était nulle, tandis que la masse monétaire de la section I reste constante. De plus, si l’on voulait considérer que la production d’or reste sur les mêmes bases, soit 30, dans ce cas c’est la masse monétaire thésaurisée qui décroît. Au bout du compte, la thésaurisation disparaîtrait, et, comme d’après Grossmann : « c’est là (avec la thésaurisation, NDR) que se montre le génie de Marx », une telle solution aurait le prix de l’inconséquence.
11.7.4 Un schéma de la reproduction simple sans thésaurisation
En fait, Marx a, en d’autres lieux, pris une position beaucoup plus claire sur ce problème. Il n’y a pas de thésaurisation dans le cadre de la reproduction simple ; l’or nouvellement créé sert uniquement à compenser l’usure de la masse monétaire.
Dans le chapitre sur la circulation de la plus-value, Marx est formel en ce qui concerne la reproduction simple :
« En dehors de l’or et de l’argent nécessaires pour les articles de luxe, le minimum de la production annuelle doit compenser l’usure annuelle des monnaies métalliques résultant de la circulation monétaire. » (Marx. Capital L.II, Pléiade T.2 p.703)
« Les capitalistes qui ont pour spécialité la production d’or et d’argent et qui – dans l’hypothèse de la reproduction simple – ne produisent que dans les limites de l’usure annuelle moyenne et de la consommation moyenne de l’or et de l’argent jettent directement leur plus-value – que, selon notre supposition, ils consomment entièrement dans l’année sans en rien capitaliser – dans la circulation sous la forme argent, celle-ci étant pour eux la forme naturelle et non, comme dans les autres branches d’industrie, la forme convertie du produit. » (Marx. Capital L.II, Pléiade T.2 p.704)
Il est d’ailleurs très facile de faire disparaître la thésaurisation.
Dans le schéma présenté plus haut, la valeur du produit social (hors production de la matière monétaire) s’élève à 9 030. Si nous restons dans l’hypothèse de Marx d’une vitesse de circulation de 3, il est nécessaire que la masse monétaire soit de 3 010 (nous faisons abstraction de la masse monétaire qui doit faire face aux fluctuations). Si, pour suivre toujours Marx, nous supposons que la masse monétaire doit, chaque année, être renouvelée à hauteur de 1% du total, il est nécessaire de produire, à chaque période, une masse d’or d’une valeur de 30,1. Cette valeur est bien celle qui figure dans le schéma et, par conséquent, l’ensemble de la monnaie produite ne sert qu’à la reproduction du matériel argent. Toutes les difficultés qui surgissaient avec l’introduction de la thésaurisation dans la reproduction simple[74] sont ainsi levées.
Par conséquent, aussi bien sur le plan des principes, que sur celui de l’équilibre et de la thésaurisation, les objections de Rosa Luxemburg se révèlent fausses.
11.8 L’abolition du capital argent
Il reste à Rosa Luxemburg un dernier argument :
« Un exposé de la production de l’argent en tant que troisième section spéciale de la production sociale a encore une raison importante. Le schéma de la reproduction simple de Marx vaut comme base et point de départ du procès de la reproduction non seulement pour le mode de production capitaliste, mais – mutatis mutandis – aussi pour tout mode de production rationnel, par exemple pour le mode de production socialiste. La production de l’argent, par contre, disparaît avec la forme marchandise des produits, c’est-à-dire avec la propriété privée des moyens de production. Elle représente les « faux frais » du mode de production anarchique du capitalisme, une charge spécifique du régime de l’économie privée, qui se traduit dans la dépense annuelle d’une quantité de travail considérable pour la fabrication de produits qui ne servent ni comme moyens de production ni comme moyens de consommation. Cette dépense de travail spécifique du régime de production capitaliste, qui disparaît dans un régime de production rationnel, trouve son expression la plus exacte en tant que section spéciale dans le procès de reproduction général du capital social. A ce sujet, il est entièrement indifférent que nous imaginions un pays produisant lui-même de l’or ou le faisant venir de l’étranger. Dans ce dernier cas seulement l’échange permet cette dépense de travail social, qui était directement nécessaire à la production de l’or.» (Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital, Petite collection Maspero,T.1 p.85)
La disparition de l’or, en tant que matière monétaire, dès le passage à la phase inférieure du communisme, ne fait aucun doute, puisque la société sans classes se caractérise par l’abolition des catégories marchandes et, tout particulièrement, du salariat, prix de la force de travail. Néanmoins, il serait faux (et ce serait surtout mal comprendre l’ampleur du bouleversement social opéré par la révolution communiste) de n’y voir que la suppression d’un secteur en somme superfétatoire, qui peut exister dans la société capitaliste et ne plus exister dans la société communiste, en laissant par ailleurs intact le schéma d’ensemble d’organisation de la société. Non seulement un secteur comme l’or, matière monétaire, est tout bonnement supprimé, mais on assistera à une vaste réorganisation des forces productives de la société, impliquant aussi bien la suppression de vastes secteurs improductifs, que la suppression ou la diminution de certains secteurs productifs, dont l’utilité sociale pour le communisme est minime. Des secteurs improductifs comme la publicité par exemple, seront supprimés, et leurs travailleurs réaffectés à des emplois productifs. Des secteurs improductifs comme la banque et les caisses d’épargne, organismes de crédit, etc. seront réorganisés pour effectuer la comptabilité de la société communiste (par exemple gestion du bon de travail), mais la suppression des opérations mercantiles implique bien évidemment la réduction de la force de travail engagée et des moyens matériels mis en œuvres.
Quand au secteur productif, la Gauche Communiste d’Italie rappelait que 90% de la production capitaliste est anti-sociale au sens où elle ne prend en compte que les besoins tels qu’ ils se développent sur la base d’une société aliénée, et pas les besoins humains. Là encore certaines branches disparaîtront ou verront leurs activités considérablement réduites, mais, en revanche, d’autres branches seront développées pour satisfaire des besoins négligés ou insuffisamment satisfaits par le capital (en tout premier lieu l’agriculture). Dans l’établissement de ses mesures concernant le temps de travail dans la société communiste, le parti communiste aura donc à prendre en compte tous ces facteurs. D’une part, la suppression d’emplois productifs réaffectés au secteur productif, ainsi qu’un développement de l’automation, permettront de diminuer le temps de travail, mais, d’autre part, la prise en charge de secteurs négligés par le capital, la poursuite et l’achèvement de la socialisation du travail[75], exigeront une ré affectation de ces forces de travail.
C’est en prenant en compte tous ces paramètres, y compris la mise au travail de toute la part de la population en âge de travailler qui n’était pas employée dans le MPC, que le pouvoir prolétarien pourra fixer une durée du travail qui soit inférieure à ce qu’elle est actuellement dans le MPC.
Ce n’est donc pas l’apanage exclusif de l’or que de disparaître. La révolution arrêtera aussi la production de moyens de consommation individuels de luxe qui ne peut exister que parce que l’exploitation existe et que sur cette base les différenciations entre les classes sociales doivent s’affirmer.
« Au demeurant, le luxe est une nécessité absolue pour un mode de production qui, créant la richesse pour les non-producteurs, doit lui donner des formes telles que seule la richesse jouisseuse puisse se l’approprier.» (Marx, Grundrisse, Pléiade T.2 p.395)
Même si, au lendemain de la révolution, le salariat ne pourra pas être d’emblée aboli, le prolétariat décrétera immédiatement l’existence d’un salaire et d’un revenu maximums, il s’en suivra (et ce processus sera encore plus grand dès que les bons de travail[76] seront mis en place, ce à quoi s’attellera également dès le premier jour la dictature du prolétariat), la disparition de la base économique d’une partie de la production de luxe; les besoins et les mentalités qui s’étaient développées sur la base du MPC et qui sous-tendaient cette production mettront eux, plus de temps à disparaître mais les nouveaux rapports de répartition empêcheront qu’ils soient satisfaits. Prenons, par exemple, l’automobile, dont on parle beaucoup actuellement.
D’une part, on rassemblera au sein d’une seule entité l’ensemble de la production automobile, chose que les lois du MPC ont d’ailleurs déjà pratiquement poussé à son maximum puisque le marché mondial est désormais partagé par une poignée de constructeurs mondiaux.
D’autre part, en attendant de redéfinir la place de l’automobile dans la société et en partant de la constatation qu’elle a cessé d’être un moyen de transport toujours plus rapide et plus sûr, puisqu’il a fallu, devant le gaspillage et l’insécurité qu’impliquait ce mode de transport abaisser toujours plus la limitation de vitesse (ce qui n’empêche pas de payer chaque année l’équivalent d’une guerre civile pour pouvoir se transporter), les mesures immédiates que pourrait prendre le prolétariat (mesures qui d’ailleurs sont souvent préconisées par les experts les plus autorisés de la bourgeoisie) ressembleraient à celles-ci :
· Amélioration et développement systématique des transports collectifs.
· Arrêt de la fabrication d’automobiles et de motos rapides.
· Réduction de la vitesse sur les autoroutes, routes et dans les agglomérations.
· Réalisation de voitures optimisant la sécurité.
· Accélération des recherches et de la production de véhicules faibles consommateurs d’énergie.
· Accélération des recherches et de la production de véhicules utilisant l’énergie électrique et solaire.
· Accroissement de la sécurité, de la qualité, de la durée de vie des automobiles.
· Suppression de la vignette.
· Gratuité des autoroutes et ouvrages d’art.
· Gratuité des parcs à voiture et du stationnement.
· Accélération du passage des véhicules à l’essence sans plomb.
· Interdiction progressive de la circulation automobile privée dans les grandes villes.
· Contrôle annuel gratuit et obligatoire des véhicules de plus de 5 ans.
· Contingentement de l’essence si nécessaire.
· Suppression des assurances mercantiles et gratuité de l’assurance sociale tous risques.
· Renforcement de la répression pour les mauvais conducteurs.
· Sanctions se traduisant par des peines en temps de travail. Gratuité des cours de formation et de conduite.
· Difficultés accrues pour l’obtention du permis de conduire.
· Gratuité de la délivrance du permis de conduire et de la carte grise.
· Mise en jugement des principaux responsables de la politique automobile antérieure,
· Moratoire des crédits à la consommation pour l’achat d’automobiles.
· Interdiction de la vente de véhicules de particulier à particulier.
· Arrêt des courses automobiles et motocyclistes.
· Suppression du corps des contractuels, de la police de la route, etc. les tâches du maintien de l’ordre et de l’organisation du trafic étant effectuées par la milice prolétarienne constituée par rotation de la population en âge de travailler.
· Travaux publics améliorant la sécurité du transport routier.
· etc. etc.
Voici quelques mesures qui touchent plus précisément à l’automobile et que prendrait un pouvoir prolétarien. On peut voir, avec cette exemple, combien l’organisation des secteurs productifs eux-mêmes serait bouleversée.
Par ailleurs, si dans son argumentation, Rosa Luxemburg, du fait du niveau d’abstraction dans lequel elle se situe, reste cohérente. il ne faut pas oublier que le communisme n’a pas pour objet de comptabiliser la valeur en temps de travail, c’est-à-dire que ce qui constitue la substance de la valeur, le travail abstrait disparaît : or les schémas sont exprimés en valeur. De ce point de vue si les rapports entre les deux grandes sections de la production, sous réserve que l’on ne modifie pas la production (ce qui nous l’avons vu est impensable) restent identiques même lorsque l’on ne compte plus que le temps de travail concret pour produire telle ou telle marchandise, c’est uniquement dû au cadre théorique dans lequel Rosa Luxemburg évoque cette question. Dans la réalité, ce qui caractérise la valeur des marchandises qui est égale au temps de travail social moyen nécessaire à les reproduire, c’est que, dans le même temps, deux ouvriers créent une valeur différente suivant que leur force de travail est qualifiée ou non (travail complexe et travail simple) qu’ils se situent dans une branche d’industrie ou l’autre (l’intensité moyenne du travail peut différer d’une branche à l’autre) qu’ils se situent dans un pays ou l’autre (sur le marché mondial le travail plus productif compte aussi comme travail plus intense), d’une année à l’autre (avec le temps l’intensité moyenne du travail s’élève si bien que la valeur créé dans le même temps par ouvrier s’élève). Tous ces éléments qui sont à la base de la domination de la loi de la valeur dont la généralisation est l’œuvre du MPC se trouvent abolis avec la disparition du MPC :. Seule subsiste la comptabilité en temps de travail concret qui mesure chaque travail, indépendamment de tous les éléments que nous venons de voir plus haut par le seul temps de travail passé lors des divers travaux.
« Supposons, rien que pour faire un parallèle avec la production marchande, que la part accordée à chaque travailleur soit en raison de son temps de travail, le temps de travail jouerait ainsi un double rôle. D’un coté, sa distribution dans la société règle le rapport exact des diverses fonctions aux divers besoins ; de l’autre, il mesure la part individuelle de chaque producteur dans le travail commun, et en même temps la portion qui lui revient dans la partie du produit commun réservée à la consommation. Les rapports sociaux des hommes dans leurs travaux et avec les objets utiles qui en proviennent restent ici simples et transparents dans la production aussi bien que dans la distribution. » (Marx, Le Capital, Livre I, Pléiade, T.1, p.613)
Comme le soulignait Marx, la comptabilisation du temps de travail non seulement ne voit pas son rôle diminuer, mais au contraire celui-ci s’accroît dans la société communiste.
« La comptabilité, contrôle et synthèse idéale du processus, devient d’autant plus nécessaire que la production s’effectue davantage sur une échelle sociale et perd son caractère purement individuel ; donc plus nécessaire dans la production capitaliste que dans celle, disséminée, des artisans et des paysans, plus nécessaire dans la production communautaire que dans la production capitaliste. Mais les frais de la comptabilité diminuent avec la concentration de la production, à mesure que la comptabilité devient sociale. » (Marx, Capital, Livre II, Pléiade, T.2, p. 573)
Par conséquent, sous cet angle, c’est l’ensemble des schémas de reproduction, pour autant qu’ils unissent le travail abstrait et le travail concret qui disparaissent ainsi que le système mercantile.
Dans cette affaire la remarque la plus impayable nous vient du stalinien Grossmann. Celui-ci ne trouve rien de mieux que de proposer que le pays socialiste élargisse sa production en échangeant l’or produit contre d’autres marchandises. Il est vrai qu’on peut mesurer là tout l’avantage qu’il y a à construire le socialisme dans un seul pays ! On peut toutefois s’étonner de ce que Grossmann puisse avoir une influence sur le dit mouvement communiste mais il est vrai aussi que des groupes comme la CWO n’ont jamais véritablement engagé une restauration du programme communiste.
Que fera-t-on de l’or restant ?
Et bien on l’utilisera dans des applications industrielles ou pour certains moyens de consommation. Si la production annuelle économisée sur la production d’or destinée a la thésaurisation privée ou dans les banques centrales ou pour la fabrication de médailles et de certains bijoux de luxe, en général, compense l’accroissement de l’utilisation de l’or pour certains usages industriels, la production annuelle sera maintenue sur le même plan, sinon elle diminuera. A cela il faut ajouter que dans les coffres des banques centrales il y a quelques 40 000 tonnes d’or et la masse d’or entre les mains de particulier avec une valeur d’usage spécifique (bijoux, etc.) s’élèverait à près de 30 000 tonnes. On peut alors estimer à, disons 50 000 tonnes, soit près de 40 ans de production annuelle actuelle la masse d’or disponible pour une utilisation productive. Avec cela il sera toujours possible de fabriquer quelques latrines comme le recommandait Lénine qui voyait là la principale utilisation de l’or dans la société future.
11.9 Remarques complémentaires
Nous venons de voir que le dernier argument de Rosa Luxemburg n’apportait pas de fait nouveau pouvant remettre en cause les schémas de reproduction et la nécessité d’un classement spécifique pour la production de l’or à des fins monétaires. Par conséquent, aussi bien sur le plan des principes, que de l’équilibre des schémas ou de la thésaurisation, la perspective de Rosa Luxemburg se révèle incorrecte tout comme l’est son dernier argument. Celui-ci a toutefois le mérite de rappeler, aux ultra-révolutionnaires du Gci par exemple, que Rosa Luxemburg était parfaitement consciente du caractère non mercantile du communisme.
Il nous reste à faire ici quelques remarques complémentaires sur la reproduction du capital fixe dans la branche de la production d’or.
Nous avons, dans notre analyse, considéré le capital constant du producteur d’or comme un tout homogène, en fait il se compose de la valeur d’usure du capital fixe et du capital constant circulant. Or, pour renouveler ce capital fixe qui transmet entièrement sa valeur en, par exemple, dix périodes, il faut que soit constituée une provision d’argent égale à la valeur du capital fixe à remplacer. Le producteur d’or n’est nullement exempté de cette nécessité, aussi doit-il comme tous les autres capitalistes, thésauriser à chaque période l’argent correspondant à son capital fixe.
Quelles conséquences cela va-t-il avoir sur le schéma ?
Si nous supposons que 1/10 du capital constant dépensé est constitué par la valeur transmise par le capital fixe, le producteur d’or devra à chaque période constituer une provision de 2. Nous avons supposé que le capital fixe transmettait en intégralité sa valeur en 10 périodes, sa valeur totale est donc de 20. Si le producteur d’or retire de la circulation une valeur de 2 en or, la classe capitaliste de la sous-section produisant le capital fixe ne pourra pas reconstituer sa masse monétaire usée, d’autre part, elle devra stocker des moyens de production pour une même valeur de 2.
Bien sûr, nous pourrions supposer que, toutes les dix périodes, le capitaliste retrouverait l’argent nécessaire pour compenser la monnaie usée ; mais cette solution serait insuffisante, la classe capitaliste produisant le capital fixe se voyant obligée de constituer des stocks. Les frais monétaires ne seraient pas égaux sur une période, mais seulement au bout de 10, et il n’y aurait équilibre que tous les 10 ans ; celui-ci étant régulièrement rompu au début de chaque décennie. Pour obtenir une solution plus correcte, il nous faut supposer que la classe capitaliste de la sous-section produisant l’or, ne renouvelle pas tout le capital fixe en une seule fois, tandis qu’un fraction de cette sous-section renouvelle le capital fixe, l’autre en retire une somme équivalente pour constituer une provision en vue de renouveler le capital fixe ultérieurement. De cette façon, la valeur de l’or jetée dans la circulation est bien de 20. La classe capitaliste produisant le capital fixe reproduit alors, sans problème, et à chaque période, la monnaie usée dans la circulation. Des producteurs d’or renouvellent leur capital fixe pour une valeur de 2 tandis que d’autres retirent 2 en argent en vue de l’amortissement. Les échanges peuvent alors se dérouler sans heurts.
12. Accumulation du capital et militarisme : Rosa Luxemburg
12.1 Rosa Luxemburg et le problème des armements.
Le dernier chapitre de l'ouvrage de Rosa Luxemburg : "L'accumulation du capital" porte le titre: "Le militarisme, champ d'action du capital". Il convient d'abord de noter que, pour Rosa Luxemburg (et en ce sens elle se distingue aussi bien d'un Mandel que d'épigones crétinisés comme le C.C.I.), le militarisme n'est pas caractéristique d'une phase particulière du M.P.C. Comme elle le souligne:
"Il (le militarisme NDR) accompagne toutes les phases historiques de l'accumulation. Dans ce qu'on appelle la période de "l'accumulation primitive", c'est-à-dire du début du capitalisme européen, le militarisme joue un rôle déterminant dans la conquête du Nouveau Monde et des pays producteurs d'épices, les Indes ; plus tard, il sert à conquérir les colonies modernes, à détruire les organisations sociales primitives et à s'emparer de leurs moyens de production, à introduire par la contrainte les échanges commerciaux dans des pays dont la structure sociale s'oppose à l'économie marchande, à transformer de force les indigènes en prolétaires et à instaurer le travail salarié aux colonies. Il aide à créer et à élargir les sphères d'intérêts du capital européen dans les territoires extra-européens, à extorquer des concessions de chemins de fer dans des pays arriérés et à faire respecter les droits du capital européen dans les emprunts internationaux. Enfin, le militarisme est une arme dans la concurrence des pays capitalistes, en lutte pour le partage des territoires de civilisation non capitaliste."
(Rosa Luxemburg, Petite collection Maspero, p. 118, T.2, L'accumulation du capital)
En prenant cette position, Rosa Luxemburg est d'ailleurs en continuité avec sa logique qui voit dans la difficulté de la réalisation de la plus-value un phénomène permanent de l'histoire du mode de production capitaliste. Par conséquent, pour elle, non seulement l'avènement d'une phase de la production capitaliste où les marchés extra capitalistes auraient disparu n'est pas envisagée, mais encore elle est déclarée impossible puisque, dans ce cas, et même avant cette extrémité, le capital ne disposerait plus d'une demande solvable extérieure au M.P.C. suffisante pour réaliser la plus-value destinée à l'accumulation.
12.2 Les épigones à la dérive
12.2.1 Une théorie indigente
Cela ne gêne pas pour autant le C.C.I. et associés dont les positions sont à ce point illogiques qu'elles sont grotesques. Cependant, à la différence du C.C.I., la Fraction externe du C.C.I. (F.E.C.C.I) ne se contente pas de rabâcher des idioties qu'on a renoncé à démontrer et cherche au moins à affronter les contradictions qui deviennent toujours plus criantes. A côté du désert théorique du C.C.I., la prose de la F.E.C.C.I. fait figure d'oasis. D'un côté, le dogmatisme imbécile, arrogant et suffisant, de l'autre, la volonté de penser et de comprendre. Il est toutefois tout aussi difficile pour la F.E.C.C.I. qu'il l'est pour le C.C.I. de transformer un château de cartes en forteresse inexpugnable et le problème n'avance pas d'un pouce si ce n'est pour tomber dans d'autres contradictions.
Nous avons souvent souligné le formidable quiproquo qui a été érigé en "théorie" par le C.C.I. Pour cette secte, le capitalisme stagnerait depuis 1914, date à laquelle le monde est partagé entre les grandes puissances impérialistes. Reprenant la logique de l'analyse luxemburgiste, le C.C.I. affirme qu'il n'existe plus, du moins qualitativement, de marchés solvables extra capitalistes et, donc, que la plus-value ne peut être réalisée. Le mode de production capitaliste privé de débouchés, privé d'une demande solvable d'origine extra capitaliste, entre alors en décadence. En bonne logique luxemburgiste, s'il n'existe plus, du moins qualitativement, de demande solvable pour réaliser la plus-value, si les marchés extra capitalistes sont désormais insuffisants, il est alors STRICTEMENT IMPOSSIBLE de réaliser l'intégralité de la fraction de la plus-value destinée à l'accumulation. Etant incapable de réaliser la plus-value le capital se trouve dans l'impossibilité de l'accumuler.
Si nous suivons la logique luxemburgiste, c’est-à-dire la logique sur laquelle repose le raisonnement du C.C.I. et la théorie de la décadence, on est amené à conclure que décadence doit rimer avec effondrement immédiat de la production capitaliste puisque toute plus-value destinée à l'accumulation ne peut être réalisée et, par suite, accumulée. Elle ne pourrait exister que dans une hypothétique reproduction simple où toute la plus-value serait consommée et jamais accumulée. Aucune accumulation supplémentaire et donc, aucune croissance véritable ne sont alors possibles.
12.2.2 Une conception qui faisait illusion dans l’entre deux guerres
Une telle conception pouvait, à la limite, s'expliquer dans l'entre-deux guerre où, effectivement, la production capitaliste a stagné.
C'est à cette époque qu'un Trotski pouvait déclarer en tête du programme de transition que "les forces productives de l'humanité ont cessé de croître. Les nouvelles inventions et les nouveaux progrès technique ne conduisent plus à un accroissement de la richesse matérielle." (Trotski, Programme de transition)
C'est à cette époque aussi que certains courants de gauche fondent une analyse de la décadence du M.P.C. sur des thèses luxemburgistes en considérant que la plus-value a cessé d'augmenter. (Cf. par exemple, le texte de Jehan, de la Ligue des communistes internationalistes, groupe proche de "Bilan", réédité par "Jalons") :
"Il est certain que lorsque la masse de plus-value produite dans le monde, non seulement ne parvenait plus à s'accroître, mais au contraire décroissait, lorsque la masse de surtravail disponible ne correspondait plus aux besoins normaux des capitaux existants, lorsque le profit disparaissait et, avec lui, le mobile de la production capitaliste, il est certain qu'alors devait s'ouvrir la crise générale du capitalisme s'exprimant d'une part, par un approfondissement considérable du contraste fondamental entre la bourgeoisie mondiale et le prolétariat mondial et, d'autre part, par l'acuité des antagonismes entre les quelques grands groupes capitalistes constituant l'essentiel de l'économie mondiale."
(Le problème de la guerre, contribution à une discussion, par Jehan . Janvier 1936).
Comme on peut le constater, et comme le note, fort honnêtement, la F.E.C.C.I., le concept de décadence a une histoire et les fondements théoriques de sa justification ont été à géométrie variable et toujours plus battus en brèche par la réalité.[77] Car, avec la fin de la seconde guerre mondiale, le M.P.C. est entré dans une période d'accumulation pratiquement sans précédent depuis le passage à la phase de soumission réelle du travail au capital. Bien entendu, comme nous l'avons montré, une telle accumulation est inexplicable à partir du moment où la décadence est de fait définie par la non accumulation. Aussi les ancêtres du C.C.I. déduisaient-ils, avec une certaine logique et une non moins magistrale défaite théorique, que la troisième guerre mondiale était imminente[78] tandis que l'accumulation résultait, soi disant, de ce que le capital vivait sur ses réserves[79]. L'accumulation du capital, quel que soit son rythme, étant toujours une réalité 70 ans après que l'on ait décrété "théoriquement" son impossibilité, il ne reste alors plus rien des assertions du C.C.I.
12.2.3 Des arguments en trompe l’oeil
Quant aux misérables subterfuges qui servent d'explication à ce formidable écart entre les faits et la théorie (ce qui montre à quel point la secte C.C.I. a pris un caractère mystique) ils ne résistent pas à l'examen.
Voyons-les rapidement. Si l'on en croit le C.C.I. :
"la croissance économique (il arrive au C.C.I. de pousser son délire jusqu'à mettre des guillemets à croissance non pas pour signifier qu'il s'agit d'un concept plus proche de l'économie politique que du communisme prolétarien mais pour nier la réalité de l'importante accumulation capitaliste qui a eu lieu depuis 1945 NDR) depuis la fin de la IIe guerre a eu comme principaux champs d'expansion :
1o : La reconstruction consécutive à la guerre
2o : La production permanente et massive d'armements et fournitures militaires
3o : La meilleure exploitation des marchés anciens."
(C.C.I. "La décadence du capitalisme"- Brochure – p. 55)
12.2.3.1 L’exploitation des marchés anciens
Si, comme l'affirme par ailleurs le C.C.I., les marchés extra capitalistes ont – du moins qualitativement – disparu, on ne voit pas ce que peut bien signifier cette exploitation des marchés anciens. Soit il s'agit de marchés capitalistes et alors leur rôle est nul pour l'accumulation soit il s'agit de marchés extra capitalistes et on ne voit pas comment ce qui n'existe plus peut jouer un rôle quelconque. Le C.C.I. reconnaît d'ailleurs qu'on ne peut pratiquement rien en attendre.
"Contrairement à ce qui était au XIXe siècle, ce type de débouchés est devenu beaucoup trop restreint par rapport aux nouveaux besoins de l'expansion "naturelle"du capitalisme. Tout s'est passé comme pour ce nénuphar dont la surface double chaque jour: alors qu'il peut lui falloir un temps relativement lent pour démarrer sa croissance et parvenir à couvrir la moitié de l'étang dans lequel il se développe, il ne lui faudra plus qu'un seul jour pour atteindre d'un seul coup les dernières limites de son champ d'expansion.
Au début du siècle, la masse de débouchés dont avait besoin le capitalisme pour assurer une année de sa croissance était plus de 6 fois inférieure à celle que nécessite une année de production aujourd'hui... Mais simultanément les débouchés se sont rétrécis de façon vertigineuse." (o.p.c. p.57)
Le C.C.I. reconnaissant lui même que cet argument est insuffisant, il lui en reste deux pour nous expliquer comment avec des débouchés inexistants la production a pu progressivement représenter 2 puis 3 puis 4, 5 et aujourd'hui plus de 6 fois la production du début du siècle. Comment ce formidable accroissement de la production est-il possible alors qu'il n'existerait aucun débouché pour réaliser la plus-value ?
12.2.3.2 La guerre et la reconstruction
Pour répondre à cette question, le C.C.I. sort alors de son chapeau un autre argument miraculeux : la reconstruction. "Dans la destruction massive en vue de la reconstruction, le capitalisme découvre une issue dangereuse et provisoire, mais efficace, pour ses nouveaux problèmes de débouchés."(o.p.c. p.57)
Ici, nous touchons du doigt le caractère grand guignolesque de la représentation que se fait le C.C.I. du M.P.C. Dans son analyse, Rosa Luxemburg, qui elle, à la différence de ses épigones, avait compris quelque chose à la théorie révolutionnaire, affirme (et nous avons déjà montré en quoi elle se trompait) que la production capitaliste nécessite avant de pouvoir accumuler la plus-value extorquée au prolétaire, une demande solvable (des débouchés dirait le C.C.I.), demande qui ne peut être le fait des capitalistes mais uniquement de formes de production extra capitalistes.
Selon le C.C.I., ces formes ont, pour l'essentiel, disparu et ne peuvent donc plus jouer le rôle qui leur était dévolu. Quelle peut être alors la portée de l'argument de la destruction/reconstruction ?
Que, par la guerre, la production capitaliste soit, par exemple, ramenée d'un niveau 100 à un niveau 50 ne redonne pas pour autant un champ d'accumulation. Que la production capitaliste ait été violemment divisée par deux ne lui donne pas plus de marchés extra capitalistes qu'auparavant. Tout au plus y aurait-il, au début de ce processus, moins de plus-value à réaliser qu'avant mais, quel que soit son niveau, il n'y a pas plus de demande émanant des formes de production pré-capitalistes qu'avant.
En fait, reniant les principes les plus élémentaires du communisme, le C.C.I. se représente l'accumulation du capital comme une simple accumulation de valeurs d'usage. Tant d'usines, tant de maisons ont été détruites ; il y a donc une possibilité d'accumulation pour le capital par l'intermédiaire de leur reconstruction ; voilà la logique à la Jacques Bonhomme qui anime le C.C.I.
S'il était conséquent avec ses présupposés théoriques (mais la cohérence est une caractéristique de l'idéologie des lumières et donc appartient à la période ascendante du capitalisme et reste donc définitivement étrangère au C.C.I. !), le C.C.I. devrait se demander avec quelle demande solvable la plus-value a bien pu être réalisée avant de s'accumuler pour reconstruire les usines détruites ? Mais cette question recèle aussi le mystère sur lequel se fonde l'existence du C.C.I.
D'un côté, on affirme que la demande solvable pour réaliser la plus-value a disparu, de l'autre, on essaye d'"expliquer", à grand renfort d'acrobaties théoriques dignes des grands pitres, que cette demande solvable s'est manifestée – on a beau mettre des guillemets au mot "croissance", cela ne suffit pas pour en nier la réalité –. Il en résulte une dichotomie dans la pensée qui saute aux yeux de tout le monde, sauf du C.C.I., dont il est à croire qu'il a un penchant pour la schizophrénie.
12.2.3.3 Le crédit
Les grands prêtres de la décadence ne sont pas à un argument près. Quitte à effectuer des reculs théoriques, autant qu'ils tournent à la débâcle, tel semble le fond de leur pensée à moins qu'ils n'aient une pensée sans fond. Parmi les raisons qui permettent au capital d'accumuler figure maintenant le crédit ; autant dire que la classe capitaliste est capable de réaliser la plus-value grâce à une demande solvable provenant de la classe capitaliste. Si, dans la brochure invoquée plus haut, cet argument n'apparaît pas, il fait désormais partie de la panoplie de tout initié de la secte. On admet ici ce qui, jusque là, a été farouchement nié à savoir la possibilité de la réalisation de la plus-value destinée à l'accumulation. Tout ce qui faisait l'originalité de la position de Rosa Luxemburg, tout ce qui lui permettait d'affirmer la perspective d'une crise catastrophique et d'assigner une limite historique à la société bourgeoise est ici rayé d'un trait de plume. Toute la base théorique est ici réduite à néant. Si le MPC devait s'effondrer par manque de débouchés étant donné l'inexistence de marchés pré-capitalistes, le voici désormais debout, et pour longtemps, puisque, à travers le crédit, il est maintenant possible de fournir un débouché à la plus-value.
Cette admirable démonstration de l'éternité du MPC n'est pas le moindre des résultats auquel aboutit la rhétorique du C.C.I. Parti pour nous prouver la décadence du capitalisme, le voici parvenu à montrer sa vitalité et sa viabilité ; à la dialectique de la décadence se substitue la décadence de la dialectique.
12.2.3.4 La production d’armements
Reste l'argument que nous avons gardé pour la bonne bouche et qui nous permettra, en retournant au sujet central de ce chapitre, de revenir à un interlocuteur d'une autre dimension que le C.C.I., en l'occurrence Rosa Luxemburg. Il s’agit de l'argument selon lequel le développement du MPC s'explique en partie grâce à l'augmentation de la production d'armement.
Le bilan global des trois premiers arguments que nous avons examinés n'est pas des plus brillants pour le C.C.I. Non seulement sa théorie repose sur du sable mais les "justifications" se contredisent mutuellement ; leur seul point commun étant la vulgarité érigée en système de démantèlement non seulement de toute théorie révolutionnaire - comme nous le savons celle-ci est inaccessible au C.C.I.- mais même de toute réflexion rationnelle. Avec les théorisations sur l'économie d'armement, la confusion atteint son paroxysme. En fait, il nous faut être juste et ne pas nous laisser entraîner par une manière polémique de parler ; le délire du C.C.I. a ceci de caractéristique qu'il atteint des sommets dans tous les aspects de sa pensée. Avant d'examiner plus avant les conceptions du C.C.I. sur ce sujet il nous faut revenir à son maître penseur, Rosa Luxemburg.
12.3 Rosa Luxemburg brûle ce qu’elle avait adoré
12.3.1 Impôt et prix de la force de travail
Tout au long de son ouvrage "L'accumulation du capital". Rosa Luxemburg s'est refusée à voir dans la société capitaliste pure la possibilité qu'il puisse exister un agent économique capable de réaliser la plus-value destinée à l'accumulation. Elle a, par exemple, écarté ce que certains économistes appelaient les "tierces personnes", c’est-à-dire les classes qui ne relèvent ni de la bourgeoisie ni du prolétariat, en montrant qu'elles ne pouvaient prétendre jouer un tel rôle. Rosa Luxemburg dans le chapitre consacré au militarisme rappelle ses positions passées et continue à les soutenir; elle ajoute cependant qu'avec le militarisme existe une fonction économique particulière pour le capital.
"Le militarisme a encore une fonction économique importante. D'un point de vue purement économique, il est pour le capital un moyen privilégié de réaliser la plus-value, en d'autre termes il est pour lui un champ d'accumulation." (Rosa Luxemburg, Petite collection Maspero, p. 118, T.2, L'accumulation du capital)
Comment ce qu'elle a nié et qu'elle nie encore devient-il possible?
Rosa Luxemburg suppose en fait un abaissement du salaire au dessous de la valeur de la force de travail par le biais d'un impôt indirect, un impôt sur la consommation qui permettrait à l'Etat de récupérer une partie du salaire qui a été versé aux ouvriers. Si le salaire équivalait à la valeur de la force de travail, l'existence d'un impôt indirect aurait pour effet d'abaisser le salaire au dessous de la valeur de la force de travail tandis que la plus-value et le taux de plus-value augmenteraient en relation avec la baisse du salaire.
Nous avons vu plus haut que, dans la conception de Rosa Luxemburg, seule la plus-value à capitaliser posait un problème de réalisation. Ni le capital constant à reproduire, ni le capital variable, ni la plus-value consommée à titre individuel par les capitalistes ne sont concernés par le problème de manque de débouchés au sein des rapports de production capitalistes. En ce qui concerne ces fractions du capital total, Rosa Luxemburg estime qu'une demande solvable existe au niveau de l'ensemble de la société bourgeoise. Seules ces parties peuvent faire l'objet d'une demande qui, pour être effective, puisse aussi considérer ces marchandises sous l'angle de leur valeur d'usage. Le capital constant usé doit être renouvelé, les ouvriers en consommant leur salaire réalisent une partie du produit social tandis que les capitalistes récupèrent le capital variable qu'ils ont avancé. Enfin lorsque les capitalistes cherchent à se reproduire comme classe, la partie de la plus-value qu'ils consomment est achetée en considérant les marchandises sous l'angle de leur valeur d'usage puisqu'elles servent à leur consommation individuelle.
Nous avons montré, ci-dessus, les incohérences de la théorie de Rosa Luxemburg en soulignant que, du point de vue du capital total, aucune fraction n'était en soi réalisée, que ce n'était que l'accumulation qui permettait la réalisation et que celle-ci n'était pas automatique puisqu'elle dépendait du niveau du taux de profit, que le circuit du capital sur le plan du capitaliste individuel n'était, du même coup, pas strictement identique au circuit du capital total, etc. Il en découlait que, selon la conception du programme communiste, la crise affecte la totalité du capital et non pas seulement une partie (la plus-value capitalisée), et que la crise n'a pas un caractère permanent et graduel mais est périodique et brutale.
Ceci dit, et une fois ces positions classiques rappelées, la position de Rosa Luxemburg est logique avec sa propre hypothèse. Puisque l'argent du salaire reflue vers les capitalistes en réalisant les marchandises nécessaires à la reproduction de la force de travail, et si ce salaire peut être abaissé grâce aux impôts sur la consommation, alors l'argent que récupère ainsi l'Etat grâce aux impôts peut être dépensé ou accumulé comme on l'entend. En abaissant le salaire au dessous de la valeur de la force de travail, si rien n'est modifié il reste un reliquat de moyens de consommation dans le secteur. II. Si l'argent récupéré par l'intermédiaire des impôts sert à payer des fonctionnaires on peut admettre que la reproduction demeure identique. Ce qui autrefois était consommé par les ouvriers est désormais consommé par les fonctionnaires. Le taux d'exploitation a été augmenté et la partie consommée de la plus-value s'est accrue.
"Que deviennent les produits restants de la section II ? Au lieu d'être consommés par les ouvriers, ils sont distribués aux fonctionnaires de l'Etat et à l'armée. A la consommation des ouvriers se substitue, pour une quantité égale, celle des organes de l'Etat capitaliste. Dans des conditions de reproduction identiques, il y a donc eu transformation dans la répartition du produit total : une portion des produits destinés autrefois à la consommation de la classe ouvrière, en équivalent de v, est désormais allouée à la catégorie annexe de la classe capitaliste pour sa consommation. Du point de vue de la reproduction sociale, tout se passe comme si la plus-value relative s'était accrue d'une certaine somme, qui s'ajouterait à la consommation de la classe capitaliste et de ses parasites. Ainsi l'exploitation brutale de la classe ouvrière par le mécanisme des impôts indirects, qui servent à l'entretien de l'appareil de l'Etat capitaliste, aboutit à une augmentation de la plus-value, ou plutôt de la partie consommée de la plus-value ; il faut simplement mentionner que ce partage supplémentaire entre la plus-value et le capital variable a lieu après coup, c'est-à-dire une fois l'échange entre le capital et la force de travail accompli." (Rosa Luxemburg, Petite collection Maspero, p. 119-120, T.2, L'accumulation du capital)
Par conséquent, comme Rosa Luxemburg le dit elle même, jusqu'ici le problème de la réalisation de la plus-value destinée à l'accumulation n'a pas avancé d'un pouce. La plus-value réalisée parce que consommée a augmenté, mais la réalisation de la plus-value capitalisée n'est pas pour autant accomplie. Une partie du produit social, selon le raisonnement de Rosa Luxemburg, qui était autrefois réalisée par la classe ouvrière est maintenant réalisée à travers la consommation de la plus-value, la masse absolue correspondant à la plus-value destinée à l'accumulation, et donc la part relative du produit social qui reste à réaliser demeure inchangée.
12.3.2 Le rôle des armements
Selon Rosa Luxemburg, le problème changerait de sens si l'Etat au lieu de payer des fonctionnaires se met à produire des armements.
"(…) la consommation des organes de l'Etat capitaliste ne contribue en rien à la réalisation de la plus-value capitalisée, parce que cet accroissement de la plus-value consommée – même s'il se fait aux dépens de la classe ouvrière – se produit après coup. (...) cette opération de transfert n'implique aucunement la possibilité de la capitalisation, en d'autres termes elle ne crée aucun marché nouveau qui permette d'utiliser la plus-value libérée à produire et à réaliser des marchandises nouvelles. La question change d'aspect si les ressources concentrées entre les mains de l'Etat par le système des impôts sont utilisées à la production des engins de guerre." (Rosa Luxemburg, Petite collection Maspero, p. 120, T.2, L'accumulation du capital)
En d'autres termes, l'argent extorqué aux ouvriers est alors investi dans la production d'armements au lieu d'être dépensé en revenu. Par la même occasion, les rapports entre les sections du capital productif sont modifiés. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur quelques aspects des affirmations de Rosa Luxemburg.
Quand il s'agissait de montrer que Marx, en recherchant les "sources d'argent" pour réaliser la plus-value, se posait un faux problème qui masquait, selon elle, le vrai, c'est-à-dire celui de la demande solvable pour réaliser la plus-value, Rosa Luxemburg soulignait avec force toutes les échappatoires auxquelles Marx se refusait. Parmi elles, figure en bonne place celle qui suit. Laissons la parole à Rosa Luxemburg elle-même pour nous résumer l'argumentation de Marx.
« Marx s'efforce ensuite de trouver cette source de différents côtés. Tout d'abord, il examine de près la dépense des capitalistes de la section II pour le capital variable. Ce dernier existe assurément sous forme d'argent. Mais il ne peut pas être soustrait à son but, l'achat de la force de travail, pour servir à l'achat de ces moyens de production supplémentaires. "Ces allées et venues n'augmentent en rien l'argent engagé dans ce cycle. Il n'y a donc point là de source d'accumulation." Marx examine ensuite toutes les échappatoires possibles, pour les rejeter en tant que telles. "Mais halte! n'y aurait-il pas moyen de faire un petit bénéfice ?" s'écrie-t-il, et il examine si les capitalistes ne peuvent pas, au moyen d'une réduction des salaires de leurs ouvriers au-dessous du niveau moyen d'existence, arriver à épargner le capital variable et obtenir ainsi une nouvelle source d'argent pour des buts d'accumulation. Bien entendu, il rejette immédiatement cette idée. "Mais n'oublions pas que le paiement réel du salaire normal qui, toutes choses égales par ailleurs, détermine la grandeur du capital variable n'est pas un acte de bonté du capitaliste ; celui-ci ne peut faire autrement. Il est donc inutile de nous arrêter à cette explication." Il examine même les méthodes cachées en vue d'épargner le capital variable – système Taylor, falsification, etc. – pour arriver finalement à la constatation suivante : "C'est pratiquée par un moyen détourné, l'opération indiquée plus haut. Ici encore elle est à rejeter. " Ainsi, toutes les tentatives en vue de tirer du capital variable une nouvelle source d'argent pour l'accumulation n'ont donné aucun résultat (...)"
(Rosa Luxemburg, L'accumulation du capital, Petite collection Maspero, p. 128, T.1,)
Par conséquent, ce qui était pour Marx une échappatoire et considérée comme telle par Rosa Luxemburg dans le chapitre 8 de son livre, à savoir l'abaissement du salaire au-dessous de la valeur de la force de travail, devient dans le chapitre 32 un élément permettant de fournir un champ d'accumulation au capital.
Non seulement le recul théorique est patent, mais il est particulièrement grave. Pour Marx, la tendance à abaisser le salaire au dessous de la valeur est une tendance permanente du capital et n'a rien à voir l'existence ou non d'un secteur de l'armement. D'ailleurs, si Rosa Luxemburg était conséquente, elle devrait affirmer que n'importe quelle accumulation de l'Etat dans un secteur produisant de la plus-value constituerait un champ d'accumulation pour le capital et donc un moyen privilégié de réaliser la plus-value (pour autant que la plus-value accumulée provienne de l'abaissement du salaire). De cela aussi elle se garde bien préférant réaliser, à l' "abri" du silence, une construction théorique qui tient du château de sable. Si, pour la théorie révolutionnaire, l'abaissement du prix de la force de travail au dessous de la valeur est une tendance constante du capital, cette tendance est régulièrement remise en cause, ne serait-ce que par la lutte ouvrière, ou lorsque la prospérité capitaliste bat son plein et qu'une accumulation rapide du capital accroît l'emploi des ouvriers et donc tend à favoriser une hausse des salaires. Ce n'était donc pas sur un rapport aussi changeant, sur un fait économique aussi peu stable, puisqu'il varie au gré des rapports de force et des mouvements de l'offre et de la demande que l'on pouvait fonder une théorie de la réalisation de la plus-value dont, par ailleurs, on s'est efforcé de nier la possibilité[80].
Une des forces de l'analyse de Rosa Luxemburg est d'avoir essayé de respecter les hypothèses de Marx, d'avoir raisonné dans le cadre tracé par Marx, notamment en se plaçant du point de vue de la totalité. Ici, elle abandonne ce point de vue et, du même coup, fait une chute brutale dans l'économie vulgaire.
Donc, non seulement, Rosa Luxemburg ne peut fournir de justification valable à son tour de passe-passe mais, en admettant même que son point de vue soit valable, qu'y a-t-il de changé par rapport à la situation antérieure du point de vue du capital global ?
La part de la plus-value réalisée grâce à l'argent prélevé sur le salaire n'est, a priori (pour rester dans le cadre des hypothèses retenues par Rosa Luxemburg), pas plus grande que la différence entre le prix et la valeur de la force de travail. En d'autres termes, la masse de plus-value destinée à l'accumulation, et qui n'est pas réalisée, est strictement identique. En abaissant le salaire on a augmenté la plus-value. Une partie de cette plus-value, correspondant très exactement à la baisse du salaire, serait désormais réalisée en permettant une accumulation du capital. Mais, sur le plan du capital global, l'immense masse de la plus-value qui ne peut être réalisée l'est toujours et rien ne peut remédier à cet état de fait. Ce n'est sans doute pas très gênant pour Rosa Luxemburg, encore que le prétendu moyen privilégié pour réaliser la plus-value soit beaucoup plus limité que l'on pense à première vue, cela devient, par contre, insoutenable pour les épigones.
De l'armement, on ne peut rien attendre comme explication puisqu'il vient réaliser – en supposant même que Rosa Luxemburg ait raison, ce qui, nous l'avons vu, n'est pas le cas – une plus-value qui augmente en même temps qu'elle est réalisée, si bien que, du point de vue du capital total, le problème demeure strictement identique. La partie du produit social total, autrefois soi-disant réalisée par la dépense du salaire l'est, maintenant, par l'argent obtenu en abaissant le salaire qui, par la même occasion, est devenu plus-value.
12.4 Un schéma désarmant
Le reste du texte de Rosa Luxemburg est une suite de calculs embrouillés dans lesquels elle se perd. En effet, Rosa Luxemburg, en introduisant les armements dans son raisonnement, s'efforce également de montrer les conséquences de cela en illustrant ses conceptions à partir des schémas de reproduction. La production d'armements effectuée il faut encore la réaliser et donc qu'il existe une demande solvable pour cela. C'est l'Etat qui généralement est le principal débouché de cette production, mais il s'agit là d'une fonction différente. Si la production d'armement est une activité productrice de plus-value, en ce sens elle ne se distingue pas des autres marchandises, sa reproduction est, pour l'essentiel, réalisée par l'intermédiaire de la plus-value.
Comme nous l'avons vu à propos de la reproduction de l'or dans les schémas de reproduction, Rosa Luxemburg n'a absolument pas réglé le problème de la reproduction du capital producteur de plus-value utilisé de manière improductive au cours du processus de reproduction de la société bourgeoise. Elle, qui avait réclamé, sans fondements, une troisième section pour les moyens de circulation, se garde bien, alors que les présupposés du problème sont identiques, de vouloir créer une quatrième section consacrée aux moyens de destruction. Pourtant, pour l'essentiel, les armements en tant que produit final ne peuvent être assimilés ni aux moyens de production, ni aux moyens de consommation individuels. Ils sont plutôt caractéristiques de ce capital productif de plus-value dont la reproduction est assurée par la dépense de l'argent comme revenu par le représentant des intérêts généraux du capital : l'Etat.
Rosa Luxemburg ne pousse pas sa logique jusqu'au bout. Elle essaye, toutefois, d'exposer les modifications qui interviennent dans la reproduction du capital. N'ayant pas résolu les difficultés propres à cet aspect des choses, elle patauge dans de piètres considérations arithmétiques. A bien des égards ce dernier chapitre est celui de la désillusion. Un livre de haute tenue s'achève dans l'impasse et le reniement de ses propres présupposés.
Suivons-la dans son calvaire théorique. Pour cerner les transformations dans le procès de reproduction social elle part des schémas de Marx de la reproduction élargie qu'elle a auparavant longuement discuté.
I : 5 000 c + 1 000 v + 1 000 pl = 7 000 moyens de production.
II: 1 430 c + 285 v + 285 pl = 2 000 moyens de consommation.
Si les impôts sur les salaires sont de 100, tout se passe comme si les ouvriers n'avaient reçu que 1.185, les 100 obtenus par l'Etat favorisant la demande d'armements.
"Cette demande d'armements pour une valeur de 100 nécessite la création d'une branche correspondante qui doit avoir un capital constant de 71,5 et un capital variable de 14,25 en admettant une composition organique du capital identique, c’est-à-dire moyenne, à celle du schéma de Marx:
71,5 c + 14,25 v + 14,25 pl = 100 (armements)" (Rosa Luxemburg, L'accumulation du capital, Petite collection Maspero, p. 122, T.2,)
En abordant le problème de cette manière, Rosa Luxemburg ne pouvait que substituer une consommation d'armement par l'Etat, consommation réalisée par le biais de la plus-value additionnelle extorquée aux ouvriers par l'abaissement du salaire, à une consommation de moyens de consommation individuels par les ouvriers. Comme nous l'avons déjà dit, ce transfert d'argent des ouvriers vers l'Etat ne changeait rien à l'ensemble du problème puisque la masse de plus-value destinée à l'accumulation était identique et sa part dans le produit social constante. De son point de vue, le problème n'avait pas avancé d'un iota.
"On peut objecter immédiatement que le profit résultant de cette extension des débouchés n'est qu'apparent, puisque la diminution de la consommation réelle de la classe ouvrière aura pour conséquence inévitable un rétrécissement de la production des moyens de subsistance." (Rosa Luxemburg, L'accumulation du capital, Petite collection Maspero, p. 122, T.2,)
Rosa Luxemburg se voit contrainte d'admettre que "Le capital n'a fait que gagner d'un côté ce qu'il a perdu de l'autre.[81]" Bien sûr, par les moyens artificiels que nous avons décrits, la plus-value a augmenté et, en comparant deux situations qui ne sont pas comparables, Rosa Luxemburg a beau jeu de critiquer certaines apologies du militarisme mais ceci n'est là que pour dissimuler ses propres lacunes.
Rosa Luxemburg considère ensuite que la consommation des ouvriers doit être réduite de 100 ce qui se traduit par une diminution de 100 de la production des moyens de consommation.
« La réduction correspondante dans les deux sections se manifestera dans les modifications de la reproduction exprimées par le tableau suivant:
I. 4 949 c + 989,75 v + 989,75 pl = 6 928,5
II. 1 358,5 c + 270,75 v + 270,75 pl = 1 900
Et le produit social global sera:
6 307,5 c + 1 260,5 v + 1 260,5 pl = 8 828,5 »
(Rosa Luxemburg, "L'accumulation du capital", Petite collection Maspero, T.2, p.125)
Avant même de ne considérer que les rapports internes entre les deux sections, une fois retiré l'effet des dépenses d'armement, Rosa Luxemburg aurait mieux fait d'envisager le processus d'ensemble. Selon ses hypothèses, le premier effet des impôts est d`abaisser le salaire et donc, d'augmenter la plus-value. Le capital constant produit va demeurer strictement identique puisque le capital constant libéré par la diminution de la masse de moyens de consommation est maintenant utilisé pour produire des armements. En réduisant le salaire réel de 1/13eme environ et un diminuant la production de la section II de 100 et en créant un secteur d'armement dont la valeur de la production est également de 100, nous obtenons le résultat approximatif suivant :
I. 5 000 c + 922,2 v + 1 077,8 pl = 7 000
II. 1 358,5 c + 249,7 v + 291,8 pl = 1 900
Arm. 71,5 c + 13,1 v + 15,4 pl = 100
Soit un total de :
6 430 c + 1 185 v + 1 385 pl = 9 000
Si l'on retire de cette production totale, modifiée par la baisse du salaire, la production d'armements, nous obtenons bien :
6 358,5 c + 1 171,9 v + 1 369,6 pl = 8 900
Et si nous reprenons le raisonnement de Rosa Luxemburg (par ailleurs extrêmement douteux) visant à retirer de la production des moyens de production ceux qui sont consacrés à la reproduction du capital constant usé dans le procès de production d'armement le résultat devient:
6 307,5 c + 1 162,5 v + 1 358,5 pl = 8 828,5
Ce résultat ne correspond à aucun de ceux présentés par Rosa Luxemburg (6 430 c + 1 113,5 v + 1 285 pl = 8 828,5 et 6 307,5 c + 1 236 v + 1 285 pl = 8.828,5) qui, soit surestime la baisse des salaires, soit la sous-estime.
Rosa Luxemburg arrête là son analyse si bien que nous n'en savons guère plus sur la reproduction des armements et de leur effet global sur l'accumulation.
12.5 Les épigones sur le sentier de la guerre
Revenons maintenant au C.C.I. et à ses considérations contradictoires sur l'armement. Si, d'un côté, les armements fournissent des débouchés à la production (cf. "La décadence du capitalisme" p.61) au point que, par exemple, la reprise économique après la crise de 1929 serait "due exclusivement (sic) à l'économie d'armement, c’est-à-dire à la production de moyens de destruction"(p.59), d'un autre côté, nous apprenons que "l'armement n'est pas une solution aux crises"(p.84) et, donc, que les dépenses d'armements sont "pour le capital (NB) un gaspillage inouï, pour le développement des forces productives, une production à inscrire au passif du bilan définitif"(p.84). Du côté de la F.E.C.C.I. ce n'est pas mieux puisque, sous une publicité vantant la brochure citée dans ce texte, on peut lire "Sur la question de la production d'armements comme champ d'accumulation, notre fraction rejette comme vous (ils s'agit d'une réponse au groupe indien Kamunist Kranti, N.D.L.R.) la position de Luxemburg"( P.I. p. 30), dans le cadre du capitalisme "pur", "il ne peut être question de la militarisation comme champ direct d'accumulation..."
Comme les bons avions militaires les positions du C.C.I. et associés sont à géométrie variable. La F.E.C.C.I. a entrepris de penser, pour l'instant en se débattant dans les insurmontables contradictions de la théorie de la décadence, et elle ne fait que resserrer le nœud coulant qui l'étrangle. A toute cette agitation théorique il n'existe que deux issues : ou la F.E.C.C.I. rompra avec la théorie de la décadence ou, ce qui est pour l'instant plus probable, elle s'arrêtera de penser par elle-même. Dans un sens cela vaudrait mieux car les dernières productions recèlent des perles de grande valeur, comme celle qui explique la croissance depuis la dernière crise (80-82) par... les armements. A l'occasion, on apprend aussi que cette accumulation est inexistante[82] le prolétariat toujours plus exploité par le moloch capitaliste sera ravi d'apprendre que la plus-value qu'on lui extorque est fictive (il est vrai que le concept a tendance, par la même occasion, à disparaître du discours), que l'exploitation dont il est victime est également fictive et que les rapports de production capitaliste ne sont qu'une illusion à mettre, sans doute, sur le compte du fétichisme de la marchandise sinon de la décadence du capitalisme.
Des élucubrations du C.C.I., il ne reste donc rien de consistant et, après comme avant leur discours, nous sommes bien en peine de comprendre comment ce pauvre capitalisme décadent peut bien s'y prendre pour accumuler alors que les débouchés pour la réalisation de la plus-value ont disparu. Ont ils vraiment disparu ? La F.E.C.C.I. en doute ; du même coup, le capitalisme est il en décadence ? Oui, car ces marchés sont insuffisants ; aussi "la raison de la survie du capitalisme décadent ne doit pas être cherchée dans la perpétuation de l'existence des couches non capitalistes"(P.I. No 5). Dans ce cas où doit elle être cherchée ? Le lecteur ne le saura pas encore dans ce numéro de PI.
Dans ce débat où les dès sont pipés il ne faudrait pas s'imaginer que du côté des adversaires de Rosa Luxemburg on ait une plus grande compréhension des problèmes propres au mode de production capitaliste.
Si les épigones sont complètement dégénérés, il en va pour une bonne part de même des adversaires. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner qu'une fraction des opposants de Rosa Luxemburg n'avait en fait pas saisi quel était le problème qu'elle avait posé. La C.W.O. appartient à cette espèce d'imbéciles heureux qui s'en vont pourfendre Rosa Luxemburg avec des arguments ineptes qui, outre le fait qu'ils ne répondent pas au problème soulevé, témoignent des profonds dommages qu'ils font subir au programme communiste. La partie du texte consacrée à Rosa Luxemburg, parue dans le No 6 de "Revolutionary Perspective", qui traite des armements est de la même eau d'inspiration ricardienne vulgaire que le reste du texte. Si cela a au moins le mérite de la continuité – ce que peut envier le C.C.I. à la C.W.O. – c'est celui de la continuité dans la médiocrité et l'anéantissement systématique de la perspective révolutionnaire du communisme.
Comme nous l'avons vu, la position de Rosa Luxemburg, toute fausse qu'elle est, n'en a pas moins une certaine logique interne. Cette logique est passée largement au dessus de la tête de la C.W.O. qui se contente d'un ricanement idiot devant ce qu'elle croît être une erreur de Rosa Luxemburg. Le reste de l'argumentation tourne ensuite rapidement au massacre des positions de Marx et donc du programme révolutionnaire.
"Mais quelle nouvelle valeur Luxemburg a t-elle subitement découvert qu'elle n'avait pas vue auparavant? La réponse est qu'elle n'a découvert rien du tout. Luxemburg a confondu revenu (dans ce cas les impôts) avec la création de nouvelle valeur. Il est payé par les impôts (de ce point de vue elle a raison) mais ceci est le résultat de l'imposition de la plus-value déjà existante des autres industries.
Pour comprendre ce point nous devons comprendre ce qu'est le travail productif. Le travail productif, conformément à ce que dit Marx, est le travail qui produit de la plus-value (seul ce premier membre de phrase est effectivement "conforme"à ce que dit Marx, la suite est un ânerie ou un mensonge pur et simple et la fin glisse sur le terrain du ricardianisme vulgaire NDR) pour le capital pris comme un tout, c'est le travail dont le produit peut être incorporé dans un nouveau cycle de production, ou comme moyen de production (par exemple comme machine-outil) ou comme moyen de consommation (par exemple la nourriture ou les vêtements) qui sustentent la classe ouvrière."(Revolutionary perspectives No 6, P. 24)
On retrouve ici une vieille erreur commise par Ricardo et ses épigones pour lesquels les marchandises qui ne contribuaient ni à la formation du capital fixe ni du capital circulant ne pouvaient modifier le profit (nous paraphrasons ici Ramsay). Elle est ici particulièrement aggravée par toutes sortes de confusions qui laissent rêveur quant à la capacité de la C.W.O. à comprendre la première ligne de la théorie révolutionnaire et de la nature de l'exploitation dont le prolétariat, classe avec laquelle ils prétendent avoir à faire, est victime.
Selon leur point de vue, qui confond production de plus-value et consommation improductive de celle-ci, il suffit qu'une branche de production n'influence pas le taux de la plus-value relative pour être considérée comme improductive. De ce fait, aussi bien la production d'objets de luxe que la production d'armes serait improductive. Rien n'est plus étranger à la position du programme communiste pour qui est productif sur la base du MPC tout travail producteur de plus-value.
Toute marchandise produite sous l'égide du salariat ayant fait l'objet d'une avance de capital est donc le fruit d'un travail productif.
"Le travail productif est donc – dans le système de production capitaliste – celui qui produit de la plus-value pour son employeur, ou qui transforme les conditions objectives du travail en capital et leur possesseur en capitaliste, donc le travail qui produit son propre produit en tant que capital." (Marx, Théorie sur la plus-value. Editions sociales, P.464, T.1)
12.6 Les racines de la production d’armements
Si les théories propagées dans le milieu communiste n'ont aucune valeur, ni théorique, ni pratique, quels éléments la théorie révolutionnaire peut-elle avancer pour expliquer le développement de la production d'armement ?
La production capitaliste a pour but d'extraire le maximum de plus-value. Pour ce faire, avec le développement de la plus-value relative, elle dévalorise la valeur de la force de travail par l'accroissement de la productivité du travail. L'accroissement de la masse des valeurs d'usage qui s'ensuit pose à ce même mode de production capitaliste le problème de la réalisation de la valeur et de la plus-value qui y sont contenus sous un volume tendanciellement croissant. La nécessité de résoudre cette contradiction est à l'origine de l'accroissement d'une classe moyenne qui consomme sans produire. Dans la mesure où l'Etat, en récupérant une partie de la plus-value sous forme d'impôts, est à même d'orienter et de concentrer la demande dans une consommation improductive comme les armements, il facilite une limitation de l'accumulation qui devient nécessaire à mesure que la production capitaliste avance. Cependant, là encore, cette limitation de l'accumulation de la plus-value n'est pas particulière à l'armement. Ce rôle est tout aussi bien tenu par la production d'objets de luxe et toute la consommation des classes improductives.
Par conséquent, indépendamment de la base matérielle de la production capitaliste, c'est dans le développement des superstructures de la société bourgeoise que nous devons trouver des explications à l'accroissement de la production d'armements. Ce n'est pas ici que nous développerons ces éléments complexes – nous pensons notamment au rôle de ce qu'on appelle le "complexe militaro-industriel"aux Etats-Unis, ou aux liaisons entre recherche et armée ou encore au rôle de soutien à l'industrie nationale que peuvent jouer les dépenses d'Etat, etc.
Bornons-nous, en suivant Engels, à donner quelques indications sur le rôle de l'Etat dans la société capitaliste.
"L'Etat n'est donc pas un pouvoir imposé du dehors à la société; il n'est pas davantage "la réalité de l'idée morale", "l'image et la réalité de la raison", comme le prétend Hegel. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement ; il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en oppositions inconciliables qu'elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts opposés ne se consument pas, elles et la société en une lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de "l'ordre"; et ce pouvoir, né de la société, mais qui se place au-dessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger: c'est l'Etat."(Engels. Origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat)
Qu'est-ce qui caractérise cet Etat ? Notamment :
"...vient l'institution d'une force publique qui ne coïncide plus directement avec la population s'organisant elle-même en force armée. Cette force publique particulière est nécessaire, parce qu'une organisation armée autonome de la population est devenue impossible depuis la scission en classes... Cette force publique existe dans chaque Etat; elle ne se compose pas seulement d'hommes armés, mais aussi d'annexes matérielles, de prisons et d'établissements pénitentiaires de toutes sortes, qu'ignorait la société gentilice..."(idem)
La tendance de cette force publique est généralement de se renforcer
"Elle se renforce à mesure que les contradictions de classe s'accentuent à l'intérieur de l'Etat et que les Etats limitrophes deviennent plus grands et plus peuplés; considérons plutôt notre Europe actuelle, où la lutte des classes et la rivalité de conquête ont fait croire à un tel point la force publique qu'elle menace de dévorer la société tout entière, et même l'Etat."(idem)
Par conséquent, depuis longtemps le communisme théorique a prévu l'accroissement, avec le développement du MPC, des dépenses à caractère militaire ou de répression, elles s'expliquent par l'accentuation des contradictions de classes au sein des Etats, et des antagonismes entre Etats. Les progrès des communications, des transports, la formidable puissance développée par les armements ont désormais pour une bonne part transcendés les frontières, si bien que la remarque d'Engels vaut également désormais pour des pays qui ne seraient plus limitrophes. L'antagonisme entre les grandes puissances impérialistes a pour cadre permanent la planète, dont l'existence, comme le notait déjà Engels, est menacée. Deux guerres mondiales (et alors que la course aux armements a repris de plus belle avec les premières crises graves de l'après-guerre) ont déjà montré, ce que confirment chaque jour les guerres locales, comment les forces de la société ont été dévorées par les dépenses militaires. Nulle solution "pacifiste" ne peut intervenir dans le cadre du mode de production capitaliste. La seule classe de la société qui a les moyens d'écarter à jamais de l'humanité la menace de destruction totale, c'est le prolétariat, à travers la révolution communiste.
13. La reproduction des armements dans le cadre des schémas de la reproduction élargie du capital
13.1 La production et reproduction des armements
Comment dans le cadre des schémas de reproduction élargie, peut-on décrire la reproduction des armements?
Nous reprendrons en détail l'analyse de la reproduction élargie ultérieurement ; pour l'instant, nous nous contenterons de quelques remarques sur la reproduction des armements en considérant que si ces derniers permettent au capital de produire de la plus-value, ils sont reproduits par l'intermédiaire de la plus-value. En d'autres termes, dans la mesure où l'Etat les achète en dépensant l'argent comme revenu, pour doter l'armée par exemple, ils figurent dans cette catégorie de capitaux productifs de plus-value qui sont reproduits par la dépense de l'argent comme revenu par l'Etat.
Jusqu'ici nous avons considéré que cette reproduction avait un caractère improductif et nous avons assimilé les dépenses de l'Etat à de la plus-value. Il faut apporter ici une nuance à cette affirmation dans la mesure où l'Etat gère dans le sens des intérêts généraux du capital une partie des coûts de reproduction de la force de travail. C'est le cas pour l'enseignement, et d'autres dépenses sociales mais pour autant que le service militaire constitue la fin de l'éducation du prolétaire, l'ultime dressage qui doit le rendre taillable et corvéable à merci, sous un certain angle les dépenses d'armement interviennent dans la détermination de la valeur de la force de travail. Il serait métaphysique de s'interroger sur la part qui relève de la plus-value et la part qui entre dans la valeur de la force de travail. Ces exemples montrent, par contre, que la valeur de la force de travail reçoit une détermination sociale qui a été en s'accentuant avec le développement du MPC. Une certaine socialisation de la consommation, sous la forme capitaliste évidemment, en a été le résultat. Une part importante de la dépense du salaire n'est plus laissée à l'appréciation du prolétaire individuel mais constitue une consommation collective avec cependant le handicap majeur que l'orientation et l'importance de cette consommation est entre les mains de l'Etat de la classe ennemie. Il faut cependant, comme dans les autres domaines, souligner le caractère révolutionnaire de cette socialisation, qui est une des bases du communisme créées par le MPC.
13.2 Un schéma intégrant la production d’armements
13.2.1 Schéma d’ensemble
Supposons que le capital social de la société se répartisse ainsi:
I. 4 000 c + 1 000 v + 1 160 pl = 6 160 Moyens de production
II. 1 500 c + 375 v + 435 pl = 2 310 Moyens de consommation
Ia . 100 c + 25 v + 29 pl = 154 Armements
Nous supposons que l'impôt, dont nous avons vu qu'il ne pouvait avoir comme base stable que la plus-value dont il constitue une partie, (nous faisons abstraction des impôts qui constitueraient un élément du salaire social) sert exclusivement à l'achat d'armements. Le montant nécessaire des impôts s'élève à 154 et équivaut donc à la valeur de la production d'armements. Cette production d'armements nécessite une avance de capital constant de 100 et d'un capital variable de 25. Nous supposons que dans ce secteur la composition organique du capital est égale a la composition organique moyenne de la société. Il est important de constater que dans le secteur de l'armement une plus-value est créée et que donc le travail salarié qui a produit ces armements est un travail productif.
"Dans cette formulation, on admet déjà que seul le travail qui produit du capital est productif, que donc le travail qui ne fait pas cela, quelque utile qu'il puisse être – il peut d'ailleurs aussi bien être nuisible –, est, pour la capitalisation, du travail non productif, donc qu'il est improductif. D'autres économistes disent que la différence entre productif et improductif ne doit pas être mise en relation avec la production mais avec la consommation. C'est tout le contraire. Le producteur de tabac est productif, bien que la consommation de tabac soit improductive. La production en vue d'une consommation improductive est absolument aussi productive que celle en vue d'une consommation productive ; à supposer toujours qu'elle produise où reproduise du capital." (Marx, Grundrisse, t.1, p. 244, Editions sociales)
Dans le secteur des armements une plus-value de 29 a été créée qui vient s'ajouter à la plus-value des autres secteurs si bien que la plus-value globale est augmentée. Celle-ci s'élève à 1 624 et sans la plus-value de la section de l'armement, elle serait de 1 595. L'impôt de 154 repose sur l'ensemble de la plus-value, il concerne donc aussi bien la plus-value de la section des moyens de production que celle des moyens de consommation tout comme le secteur des armements. Chaque secteur paiera un impôt que nous supposons proportionnel au capital avancé et à la plus-value qu'il extorque de ses ouvriers. Cet impôt est de 110 dans la section I, de 41,25 dans la section II et de 2,75 dans la production d'armements; soit un impôt total de 154. L'Etat en adressant une demande de 154 au secteur de l'armement pour doter son armée, permet à ce secteur de reproduire la valeur et la plus-value contenue dans les armements.
13.2.2 La reproduction du capital constant dans le secteur de l’armement
Les capitalistes du secteur de l'armement sont ainsi à même tout d'abord de reproduire le capital constant qui a été dépensé lors de la production des armements soit 100 c. En renouvelant leur capital constant ils permettent aux capitalistes de la section I de reproduire une partie de la plus-value contenue dans les moyens de production. Tout comme pour les objets de luxe c'est par l'échange contre une partie de la plus-value de la section I que se réalise la reproduction du capital constant du secteur de l'armement.
Comme nous sommes dans le cadre de la reproduction élargie, la production d'armements s'accroît, et donc de la plus-value est accumulée dans ce secteur, comme dans les autres. En supposant un taux de croissance de 10%, le capital constant supplémentaire pour l'accumulation dans ce secteur est de 10. Le capital constant nécessaire à cette accumulation est obtenu dans la section I. Par conséquent, la demande totale de moyens de production adressée à la section I par le secteur de l'armement est de 110 (100 + 10). Cette demande permet au secteur de l'armement d'une part de renouveler le capital constant utilisé au cours du procès de production des armements, d'autre part de se procurer le capital constant additionnel destiné à l'accumulation dans ce secteur. Cette partie du capital comme l'autre est obtenue par un échange avec une partie de la plus-value de la section I. La masse totale du capital constant obtenu par le secteur de l'armement est égale aux impôts payés par le secteur des moyens de production. Tout se passe comme si, par le biais des impôts, l'Etat avait réquisitionné l'équivalent de 110 de capital constant pour les affecter à la production d'armements.
13.2.3 La reproduction du capital variable et de la plus-value destinée à la consommation
Il en va de même pour le capital variable. Celui ci s'élève à 25 et pour l'accumulation un capital variable supplémentaire de 2,5 est nécessaire soit au total une demande venant du capital variable de 27,5. A ces moyens de consommation il faut ajouter la part consommée par les capitalistes du secteur de l'armement; une partie de la plus-value est réservée à l'entretien de la classe capitaliste et ses agents. Dans le secteur de l'armement la masse de la plus-value consommée par les capitalistes est de 13,75, par conséquent les moyens de consommation qui seront consommés par le secteur de l'armement se montent à 41,25 (27,5 + 13,75) qui représentent une partie de la plus-value de la section II. Ici aussi l'échange concerne la plus-value de la section II. Quant au montant des moyens de consommation nécessaires au secteur de l'armement, il correspond également au montant des impôts payés par ce secteur.
13.2.4 La répartition des dépenses d’armement
Pour chaque fraction de la classe capitaliste la part de la plus-value consommée, accumulée ou dépensée en impôts est identique.
La classe capitaliste de la section I consomme une masse de plus-value de 550 soit 550/1 160eme de la plus-value (47% environ), la plus-value accumulée se monte à 500 et représente donc 500/1 160eme (43% environ) de la plus-value totale, enfin les impôts de la section I sont de 110 soit 110/1 160eme (10% environ) de l'ensemble de la plus-value.
Ces proportions se retrouvent dans la section II, puisque la masse de la plus-value consommée est de 206,25 soit environ 47% de la plus-value totale de la section II tandis que la plus-value accumulée est de 187,5 ou 43% environ de la plus-value. Les impôts quant à eux s'élèvent à 41,25 soit environ 10% de la plus-value de la section II. Donc aussi bien dans la section I que dans la section II les impôts sont proportionnels au capital avancé.
Cette même proportion est aussi respectée dans le secteur de l'armement qui lui aussi accumule, consomme et paie des impôts proportionnels au capital avancé et dans une proportion identique à celle des deux grands secteurs de la production sociale. Dans le secteur de l'armement la plus-value se décompose en 13,75 de plus-value consommée contre 12,5 de plus-value accumulée et 2,75 d'impôts ce qui correspond aux pourcentages que nous avons rencontrés plus haut.
Nous ne reprendrons pas ici l'analyse des autres aspects de la reproduction élargie, nous y reviendrons en d'autres temps. Retenons de ces exemples que la production d'armement est productrice de plus-value, que la reproduction et l'accumulation dans ce secteur se réalisent par l'échange contre la plus-value et qu'en conséquence les dépenses d'armement constituent une consommation improductive de plus-value. (Cette différence entre l'aspect productif de la production et improductif de la consommation est à l'origine de bien des confusions cf. C.W.O. par exemple, ci-dessus).
13.3 Les effets de la disparition des armements
De ce point de vue, il est bien clair que si le production d'armements disparaissait, on pourrait, en retenant les hypothèses extrêmes, soit diminuer le temps de travail de 154 unités soit, en supposant une reconversion de la force de travail et de moyens de production proportionnellement aux deux sections du capital productif, accroître la production dans les proportions suivantes:
I. 4 000 c + 1 000 v + 1 160 pl = 6 160 Moyens de production
+ 72,8 c + 18,2 v + 21 pl = 112 moyens de production additionnels
II. 1 500 c + 375 v + 435 pl = 2 310 Moyens de consommation
+ 27,2 c + 6,8 v + 8 pl = 42 moyens de consommation additionnels
A la section I vient s'ajouter une production supplémentaire de moyens de production de 112, tandis que, dans la section des moyens de consommation, la production s'accroît de 42. La plus-value dans le secteur I s'élève désormais à 1 181 contre 1 160 auparavant et dans le secteur II à 443 contre 435 précédemment. Sur le plan du capital global il n'y a cependant pas de différence puisque la plus-value totale est égale dans les deux cas à 1 624. La plus-value produite dans le secteur de l'armement est maintenant produite dans les deux grands secteurs de la production sociale.
Au total nous obtenons donc:
I. 4 072,8 c + 1 018,2 v + 1 181 pl = 6 272 Moyens de production
II. 1 527,2 c + 381,8 v + 443 pl = 2 352 Moyens de consommation
Donc dans un premier temps la production est simplement répartie autrement, la plus-value produite et la valeur de la production demeurant identiques. Par contre, dès que nous envisageons l'accumulation et le résultat obtenu l'année suivante nous pouvons constater d'importantes modifications.
Le taux d'accumulation de la plus-value s'élève, la plus-value qui était consommée de manière improductive dans la production d'armement est désormais consommée productivement, élevant ainsi le taux d'accumulation de la plus-value et le taux de croissance.
Quand il existait une production d'armement, le taux de croissance était, nous l'avons vu, de 10%. Maintenant que la production d'armement a été reconvertie de combien est le taux de croissance?
La masse des moyens de production disponible est de 6 272 tandis que la masse du capital constant à renouveler est de 4 072,8 + 1 527,2 soit 5 600 il reste donc 672 (6 272 – 5 600) destinés à l'accumulation soit un taux de croissance de 12% (672/5 600). Le taux de croissance a progressé de 20% en passant de 10% à 12%. Les forces productives se développent donc plus rapidement. Bien loin de favoriser la croissance de la production capitaliste, la production d'armement aurait plutôt tendance à la ralentir. Du même coup, voir dans la production d'armement une "explication"à la croissance de l'après ou de l'entre deux guerre laisse perplexe. Bien plus, nous pouvons voir à quel point de telles productions stérilisent les forces productives et quel développement supplémentaire, développement qui se traduira par un gain de temps et un accroissement de la production pour satisfaire les besoins humains, entraînera une réduction drastique des armements une fois assurée la domination de la société communiste. Il en va de même pour la croissance du capital variable et donc, toutes choses égales par ailleurs, pour le nombre des ouvriers employés. L'existence d'une production d'armement, loin de favoriser "l'emploi", tend plutôt à en freiner l'accroissement. Quant au taux d'accumulation de la plus-value, il était de 43% environ avec l'armement, il s'élève désormais à plus de 51%.
Le financement d'une production d'armement croissante et la perspective d'une accumulation et d'un taux de croissance accrus exigent donc une énorme aggravation de l'exploitation de la seule classe qui crée la plus-value: le prolétariat. Par contre, les chantres keynésiens sociaux-démocrates justifient la production d'armement dans la mesure où celle-ci entraînerait la croissance et résorberait le chômage. Ainsi, du même coup, non seulement on justifie la course aux armements et une production nuisible pour l'espèce humaine, mais encore on masque l'exploitation effrénée qu'une telle course entraîne pour le prolétariat. Que derrière le char réformiste le C.C.I. embouche la même trompette contre révolutionnaire ne saurait nous étonner ; le lecteur pourra, toutefois, à l'aide des exemples ci-dessus, se faire une opinion sur la valeur scientifique de la propagande impérialiste.
Du point de vue luxemburgiste, le problème de la réalisation de la plus-value est toujours identique pour la plus-value destinée à l'accumulation. Même si nous faisons abstraction de la plus-value accumulée dans l'armement, la plus-value à capitaliser soit 500 dans la section I et 187,5 dans la section II doit recevoir une demande extérieure au mode de production capitaliste si l'on veut, selon Rosa Luxemburg, réaliser la plus-value. Les données fondamentales de la réalisation ne sont pas modifiées. Il est encore plus difficile comme le pensent les épigones de Luxemburg, comme le C.C.I., de fonder une quelconque "explication" de la croissance sur la production d'armement. La plus-value étant consommée de manière improductive on ne saurait véritablement fonder l'accumulation et le développement capitaliste sur une telle base. Bien plus la possibilité d'une croissance de la production d'armement implique un grand développement de la plus-value dans les autres secteurs afin d'en supporter le poids tout en continuant l'accumulation.
Une forte croissance économique et une forte augmentation des dépenses d'armement ne sont pas forcément corollaires l'une de l'autre (pour donner ici un argument de type empirique, les pays vaincus de la dernière guerre, l'Allemagne et le Japon qui se sont vus limiter les dépenses d'armement à un niveau en général plus faible que les nations victorieuses n'en ont pas moins été les pays ou l'accumulation capitaliste a été des plus spectaculaires), la conjonction des deux événements témoigne plutôt de la colossale exploitation dont le prolétariat a été et demeure victime depuis la seconde guerre mondiale.
Il arrive parfois que le C.C.I. se représente l'accumulation capitaliste comme la construction d'un mur un jour, suivie de sa destruction le lendemain en arguant que dans les livres de compte la valeur a été doublée. Tant qu'on en reste au niveau du capitaliste individuel ce genre d'argument est exact mais replacé sur le plan du capital global, il relève de la folie furieuse. Cela reviendrait à dire que la valeur d'usage des marchandises nécessaires à l'accumulation est indifférente, qu'un mur en ruine aura le même débouché qu'un mur neuf, qu'une machine cassée produira aussi bien et même mieux tout en permettant la même embauche qu'une machine neuve etc. C'est ne pas voir que l'accumulation du capital est accumulation de plus-value et que cette plus-value doit revêtir des formes particulières (moyens de production, etc.) pour être effectivement accumulée.
14. Accumulation du capital et militarisme : Ernest Mandel
14.1 Ernest Mandel entre dans le troisième âge
Il est fréquent qu'avec l'âge et sous le poids de la vie et de sa réalité implacable, se manifeste, l'accoutumance aidant, une tendance au conservatisme, à l'acceptation des valeurs de la société présente et des idées reçues tandis que l'enthousiasme, la révolte, la capacité de remise en cause des choses et des hommes, la possibilité d'une vision nouvelle des phénomènes s'estompe au profit d'un pragmatisme fondé sur l'"expérience". L'esprit accompagne le corps dans son processus de vieillissement et de résignation.
Le "marxisme" d'Ernest Mandel échappe, en partie, à cette logique car il n'a jamais été jeune. D'emblée, il n'était que protestation contre toute tentative révolutionnaire, d'emblée il s'était fixé comme but de transformer le programme communiste en programme de réforme sociale du capitalisme, réalisé éventuellement à l'aide de moyens violents, programme qui confère au trotskisme passé à la contre révolution le rôle tenu par le centrisme – en moins à gauche – dans la social démocratie du début du siècle. A la différence près que si certains ont pu s'illusionner, à l'époque, sur la nature du centrisme, il n'y a pas de question à se poser sur le trotskisme aujourd'hui. Il est irrémédiablement caractérisé comme contre-révolutionnaire.
La crise du "marxisme" n'a pas épargné le trotskisme et fréquents sont les faits qui témoignent d'un éloignement toujours plus grand des principes fondamentaux de la théorie de Marx. En entrant dans son troisième âge Ernest Mandel entre dans la phase où son "marxisme"déjà galvaudé et corrompu, entre désormais en sénilité.
14.2 Ernest Mandel, chambre d’écho de l’économie vulgaire
Parmi les lieux communs largement répandus par l'économie politique figure l'idée suivante :
"Depuis la fin des années trente, la production d'armes joue un rôle accru dans l'économie impérialiste. Celle-ci en est actuellement à sa quatrième décennie de réarmement ininterrompu. Il n'y a pas l'ombre d'un signe annonçant que cette tendance à l'économie de réarmement permanente s'interrompe dans un délai appréciable. Elle constitue donc une des caractéristiques du troisième âge du capitalisme qu'il nous faut expliquer à partir du processus de développement socio-économique de ce mode de production lui même. Surtout il faut étudier dans quelle mesure des caractéristiques économiques précises, spécifiques du capitalisme contemporain et le différenciant des phases précédentes de la société bourgeoise, sont en rapport avec ce réarmement et si, en cas de prolongation de ce phénomène, elles continueront à déterminer l'époque historique du troisième âge du capitalisme."
(Mandel. Le troisième âge du capitalisme, pp 131-132)
Bien sûr, Ernest Mandel n'ignore pas que "la production d'armement ne constitue pas une nouveauté en tant que phénomène économique dans l'histoire du mode de production capitaliste." Mais la part relative de cette production dans le produit intérieur a augmenté et les dépenses annuelles mondiales auraient plus que triplé entre l'époque 1901-1914 et l'époque 1945-1955. Mandel en conclut triomphalement que la quantité s'est changée en qualité. Certes, la transformation de la quantité en qualité et réciproquement est une loi fondamentale de la dialectique mais on ne voit pas en quoi le triplement de quelque chose le change ipso facto en quelque chose de qualitativement nouveau, pas plus qu'un triple zéro ne change un cancre en bon élève.
Pour résoudre les difficiles problèmes liés à la production d'armement, Mandel recourt à un département III au sein de la production sociale : le département des moyens de destruction. Incidemment, Mandel souligne que le premier auteur qui a utilisé un tel procédé est Tugan-Baranovsky et non Marx. Loin de gêner Mandel, une telle constatation est, au contraire, le prétexte de digressions révisionnistes dans lesquelles il reproche à ce pauvre Tougan – qui fait presque figure d'orthodoxe en regard des propos de Mandel – d'avoir limité la section III au seul secteur des produits de luxe.
La perspective de Tugan-Baranovsky était déjà révisionniste puisqu'elle instituait une séparation plus accentuée que ne l'avait fait Marx entre les divers secteurs du capital productif. La distinction de Marx entre production de marchandises destinées à la consommation productive et production de marchandises destinées à la consommation individuelle évoluait au profit d'une séparation selon les classes sociales qui les consomment : classe ouvrière pour les moyens de consommation nécessaires, classe capitaliste pour les moyens de consommation de luxe.
Les objectifs de l'analyse de Marx étaient de cette manière insidieusement modifiés. Marx n'avait pas réservé les moyens de consommation nécessaires à la seule classe ouvrière mais à toutes les classes sociales et donc aussi aux capitalistes.
Quant à définition des moyens de consommation de luxe, ce n'est pas le fait qu'ils ne réapparaissent pas dans la procès de reproduction qui est un élément caractéristique (sous un certain angle c'est même inexact puisque une même valeur d'usage peut aussi bien servir de moyens de consommation de luxe comme de capital constant dans la production d'une autre marchandise – par exemple, Marx cite le cas du raisin qui peut entrer dans la fabrication du vin, ce peut être aussi le diamant qui peut être monté sur une bague, etc.). Ce qui leur confère une spécificité c'est qu'il s'agit de moyens destinés à la consommation individuelle qui n'entrent pas dans la détermination de la valeur de la force de travail.
Dans les schémas de reproduction qui visent à montrer que les concepts de capital constant, capital variable et plus-value sont à même d'expliquer de procès de l'accumulation capitaliste, seule la classe capitaliste consomme des objets de luxe. Mais la possibilité pour la classe ouvrière, ou du moins ses fractions les mieux payées : son aristocratie, de participer, ici et là, à cette consommation n'est nullement exclue par Marx. Si, pour les besoins de l'analyse, un département spécial doit être créé pour les armements c'est, comme nous l'avons montré plus haut, parce que ce type de production n'entre pas dans le champ des schémas de reproduction et non, comme l'affirme Mandel, parce que "au contraire des départements I et II, ... (le département III) ... produit des marchandises qui n'entrent pas dans le procès de reproduction des éléments matériels de la production (remplacement et élargissement des moyens de production et de la force de travail utilisés)" (Mandel, p.136, t.II, Le troisième âge du capitalisme).
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, sont en dehors de la définition des schémas de la reproduction notamment :
- le capital productif avancé dans les secteurs produisant le capital avancé de manière improductive
- le capital productif avancé dans les secteurs produisant le capital qui sera dépensé comme revenu, entre autres par l'Etat.
Si, une partie des capitaux productifs n'est pas prise en compte, par hypothèse, dans le cadre des schémas de reproduction, a fortiori les capitaux mettant en oeuvre du capital improductif n'y seront pas non plus. Les armements sont, dans la plus grande proportion, achetés par l'Etat qui centralise et coordonne ainsi la capacité de défense et d'attaque de la société contre une menace intérieure ou extérieure. La classe capitaliste se trouve ainsi, du même coup, armée contre son principal ennemi, le prolétariat, qui lui-même se trouve désarmé.
Ces armements sont donc, en général, achetés par le biais des impôts et, par conséquent, par une partie de la plus-value transformée en revenu de l'Etat. Dans le cas de l'entretien des armées et, plus particulièrement, de l'achat des armements, l'Etat n'avance pas l'argent comme capital. Il n'a pas pour but d'obtenir de l'armée une plus-value, ni même un profit moyen venant des secteurs productifs, mais il dépense l’argent comme revenu. Si l'armée était une entreprise privée il n'en irait pas de même. Le capitaliste qui avancerait l'argent pour cette armée mercenaire escompterait en obtenir, selon des modalités dont nous n'avons pas à nous soucier ici, un profit tel que son taux de profit soit égal au taux général de profit qui règle le taux de profit moyen obtenu dans chaque secteur. Dans ce deuxième cas, le capital avancé par le capitaliste participerait à la péréquation des taux de profit et, comme ce capital est improductif, ce taux en serait d'autant abaissé. Lorsque l'Etat assure l'entretien des armées il n'en va pas ainsi ; l'argent est dépensé comme revenu et n'entre pas dans le processus d'égalisation des taux de profit.
Du point de vue du prolétariat, les armements comme n'importe quelle marchandise sont l'occasion pour le capital d'extraire de lui le maximum de plus-value. Si l'on fait abstraction du commerce extérieur, ce secteur se révèle incapable de favoriser la production de plus-value relative puisque les armements n'ont pas d'influence sur la détermination de la valeur de la force de travail. Leur production s'effectue donc entièrement par des échanges au sein de la classe capitaliste ou de son pouvoir organisé : l'Etat, qui en général assure pour l'ensemble de la bourgeoisie l'organisation des armées. C'est donc l'impôt qui est régulièrement mis à contribution pour l'achat d'armements, à des entreprises qui peuvent appartenir à des capitalistes privés comme être propriété de l'Etat (arsenaux, par exemple). Etant donné l'importance de cette production pour la société bourgeoise c'est l'Etat qui, de toutes façons, en assurera le contrôle.
Les armements ne sont pas consommés de manière improductive au cours du processus de production. Quand ils ne s'usent pas au travers de l'exercice ou ne se périment pas sous l'influence du progrès technique, leur consommation réelle consiste dans la destruction de vies humaines et de richesses. S'il est vrai que toute consommation est destruction, une partie des armements (munitions, explosifs) se consomme en s'autodétruisant et en détruisant, sans que leur valeur d'usage soit véritablement réalisée, des marchandises destinées à la production ou à la consommation. En règle générale, les armements entrent dans la deuxième catégorie que nous avons définie ci-dessus, c’est-à-dire celle des capitaux productifs engagés dans des secteurs produisant des marchandises qui sont achetées par l'Etat, celui ci dépensant l'argent en tant que revenu et non en tant que capital. Ce qui revient à dire que l'Etat n'attendra pas de cette dépense un profit particulier.
14.3 Ernest Mandel, apôtre de la disproportion
Les armements peuvent-ils avoir une fonction économique particulière liée à leur valeur d'usage particulière ? Mandel nous a déjà répondu, sans preuves, qu'il y avait effectivement une telle possibilité puisque l'énorme masse des armements produits au cours du XXeme siècle entraînait, selon lui, une situation nouvelle dans le processus de l'accumulation capitaliste. Il va s'efforcer d'aller plus avant dans ses assertions en examinant la production d'armements dans ses rapports avec la difficulté de réaliser la plus-value. Pour cela, Mandel part des schémas établis par O. Bauer lors de sa polémique contre Rosa Luxemburg. Nous n'avons pas encore discuté cette partie du travail de Rosa Luxemburg qui est à l'origine de cette polémique.
Par un quiproquo qui peut paraître surprenant une très grande partie des théoriciens qui l'ont critiquée, voire même défendue, se sont contentés de considérer que le point central de l'argumentation de Rosa Luxemburg résidait dans le 25eme chapitre des 32 que compte "L'accumulation du capital". Dans ce chapitre, Rosa Luxemburg s'efforce, une fois de plus, de montrer que les schémas de Marx sont inachevés et qu’ils ne prennent pas en compte l'ensemble de la réalité sociale et donc qu'on ne peut tenir le bon déroulement des opérations sur le papier pour la preuve de la possibilité de la réalisation sans heurts de la plus-value.
En introduisant, d'une certaine manière, l'augmentation de la productivité du travail, en augmentant la composition organique du capital et le taux de la plus-value, elle fait apparaître entre les sections I et II une disproportion, un déficit de moyens de production faisant face à une surproduction de moyens de consommation. En transférant une partie de la production de II vers I, Otto Bauer a tenté de montrer que cette difficulté assimilée à une impossibilité de réaliser la plus-value disparaissait.
Indépendamment même des contradictions propres à l'analyse d'Otto Bauer, contradictions mises, en partie, en évidence par Rosa Luxemburg elle même, on ne réfutait pas là l'argumentation centrale de Rosa Luxemburg sur laquelle elle revient – et sur laquelle aussi, il est vrai, elle se replie – dans son "Anticritique". Une bonne partie des théoriciens adverses s'étant engouffrée dans ce type de critique à Rosa Luxemburg, voilà que des disproportions, c’est-à-dire des crises parfaitement admises et même les seules reconnues par des économistes comme Ricardo ou Say, des crises qui font apparaître une surproduction d'un côté et une sous production correspondante de l'autre, étaient assimilées à la difficulté de réaliser la plus-value. Le marxisme vulgaire (mais avec lui aussi des révolutionnaires) s'enfonçait toujours plus sur les chemins tracés par l'économie vulgaire.
Bien évidemment des disproportions, aussi bien à l'occasion d'une hausse de la composition organique que d'autres mouvements dans l'accumulation du capital peuvent et doivent se manifester. De ce point de vue, la production d'armements, comme de n'importe quel secteur, contribue aussi bien à l'existence de disproportions qu'au rétablissement de l'équilibre perpétuellement bouleversé par la dynamique de l'accumulation du capital. Marx n'avait pas fondé la perspective de crises catastrophiques du MPC sur la possibilité de disproportions qui sont, répétons-le, les seules crises reconnues par les courants qui justement nient la possibilité d'une crise générale au sein des rapports de production capitalistes. Ramener la théorie révolutionnaire à un tel niveau revient alors à l'abaisser au point le plus bas atteint aujourd'hui par l'économie vulgaire.
Ce n'était pas une des moindres erreurs des critiques – "erreur" qui montre dans bien des cas, comme celui d'Otto Bauer, à quel degré d'abjuration du programme communiste en était arrivée la social démocratie – que d'enfourcher le cheval de bataille de la disproportion. Enfin – et c'est aussi une confirmation de la déchéance de la pensée "marxiste" – cela montrait combien les critiques n'étaient plus intéressés que par l'aspect quantitatif des choses. Avec le débat sur la hausse de la composition organique au sein des schémas de reproduction, on tenait un exemple avec lequel les virtuoses du calcul arithmétique allaient pouvoir se livrer à leur exercice favori, délaissant ainsi l'objet principal de la position de Rosa Luxemburg.
La contre révolution n'allait pas, loin de là, favoriser une amélioration de la compréhension des choses. L'économie politique "marxiste" a continué à faire toujours plus siennes les positions de l'économie vulgaire. Le débat ayant pris les voies détournées de l'économie vulgaire, les principaux fossoyeurs du programme communiste se sont efforcés de tracer plus avant le chemin. Ce faisant, on s'est enfermé, bien sûr, dans une impasse, et on évolue toujours plus dans le grotesque.
Ernest Mandel n'a pas pu s'empêcher d'apporter sa pierre à cette construction surprenante où les concepts fondamentaux du programme communiste se retrouvent cul par dessus tête. Les développements de Mandel à partir du schéma d'Otto Bauer le conduisent à conclure que "l'armement permanent n'est pas en état de résoudre le problème de la réalisation de la plus-value qui apparaît dans le mode de production capitaliste à cause du progrès technique."(Mandel p. 145 t.2 Le Troisième âge du capitalisme)
Comprenez que l'armement permanent n'est pas apte à résoudre un faux problème posé par Rosa Luxemburg, faux problème lui même mal compris par Otto Bauer et baptisé impossibilité de réaliser la plus-value (il s'agit en fait d'une disproportion). A ce faux problème O.Bauer a lui même apporté une "solution"qui est un défi à la pensée rationnelle et sur la base de laquelle E. Mandel se livre à des considérations sur l'économie d'armement dont on peut imaginer l'intérêt.
Pour fonder son point de vue sur l'armement, Rosa Luxemburg avait été conduite à faire de l'économie d'armement un secteur financé par un impôt (cf. chapitre précédent)) qui abaissait les salaires des ouvriers au dessous de la valeur de la force de travail, tout comme il abaissait le revenu de la paysannerie. Pour être cohérente avec sa théorie elle ne pouvait faire autrement. La plus-value accumulée par ce biais était alors une fraction dérivée du revenu des autres classes. De ce fait, il n'existait pas de difficulté pour réaliser la plus-value. Cela a fourni l'occasion pour de nouvelles polémiques qui n'ont pas fait avancer la question d'un pouce, bien au contraire.
Mandel ne peut s'empêcher d'y ajouter son grain de sel, en déformant au passage un peu plus, si c'était possible, la théorie de Marx. Pour celle-ci, indépendamment de savoir quelle importance revêt tel ou tel secteur de la production sociale, la tendance du capital est d'abaisser le salaire au dessous de la valeur de la force de travail, et l'existence ou non de l'armement ne change rien à ce phénomène. En prétendant que l'économie d'armement joue un rôle particulier dans ce processus d'abaissement du prix de la force de travail au dessous de la valeur on fait des affirmations dont le fondement théorique est nul et dont on serait bien en peine d'apporter le premier élément de vérification pratique.
En ce qui concerne les effets de la production d'armements sur le taux de profit, ils sont assimilables à ceux des objets de luxe qui, comme les armements, ne peuvent favoriser la création de plus-value relative. Nous ne reprendrons pas ici cet aspect de la théorie. Sachons seulement qu'ils ne présentent alors rien de spécifique.
Deux aspects, cependant, méritent d'être soulignés : d'une part, il est très vraisemblable que le secteur des armements ait une composition organique du capital qui soit plutôt supérieure à la moyenne de celle de l'industrie (sous cet angle la production d'armement non seulement ne contribue pas à la hausse du taux de profit mais tend à en favoriser la baisse) ; d'autre part, le fait de travailler sur la base de commandes de l'Etat laisse penser que le temps de circulation du capital est particulièrement réduit (ce facteur, par contre, aurait, lui, tendance à favoriser la hausse du taux de profit).
Contrairement à ce qu'affirment les thèses ricardiennes d'un Kidron, par exemple (théoricien de International Socialism, scission du trotskisme de la fin des années 40 – un peu comme Socialisme ou Barbarie en France – ), le secteur de l'armement participe à l'établissement du taux de profit et l'influence, mais n'a pas de caractère particulier qui le différencierait – à l'exception peut être des éléments que nous venons d'évoquer – des autres secteurs qui n'ont pas d'effet sur la production de plus-value relative.
14.4 Ernest Mandel cherche son bâton de maréchal
Jusqu'ici Mandel n'a pu fournir véritablement, malgré toute sa bonne volonté, une base théorique à ses premières affirmations. Avec les "difficultés de mise en valeur du capital" il va essayer de parvenir à ses fins. Pour cela, il lui faut déjà faire une première manœuvre révisionniste en scindant l'excès de capitaux, la surproduction du capital, de la baisse tendancielle du taux de profit; c’est-à-dire en assimilant cette surproduction qui se manifeste régulièrement avec chaque crise (dont l'origine doit être cherchée dans un brusque retournement de la productivité du travail et donc dans une chute brutale du taux de profit) à une surproduction permanente, selon la méthode utilisée par les théoriciens staliniens.
"Une troisième contradiction fondamentale du mode de production capitaliste qui apparaît à un certain degré de son développement, c'est la difficulté de mise en valeur du capital global, c'est-à-dire l’apparition de capitaux excédentaires, qu'il n'est plus possible d'investir de manière rentable. Ceci est un fait, dans les pays capitalistes développés, depuis le début de l'époque impérialiste (capitalisme des monopoles). A notre époque, ce phénomène devient particulièrement aigu au cours des années 1913-1940 (1945). Et c'est seulement ici que la fonction spécifique de l'armement permanent – contrairement aux thèses qui y voient essentiellement un moyen de surmonter les difficultés de réalisation de la plus-value ou de freiner la chute du taux de profit moyen – prend sa pleine signification."( op.cit. p.170)
En guise de démonstration, Mandel nous offre en fait ici deux affirmations : la première, c'est qu'il existe en permanence des capitaux excédentaires, – sans compter que cette apparition est relativement indépendante de la baisse du taux de profit; en tout cas pour Mandel elle n'en est pas le corollaire – ; la seconde, c'est que ces capitaux excédentaires, "en jachère", sont remployés dans le secteur de l'armement. Du même coup, loin d'être un élément dont la reproduction repose sur la plus-value et qui, toutes choses égales par ailleurs, réduit l'accumulation et la croissance quand elle augmente, la production d'armement, chez Mandel, en permettant de mobiliser les capitaux excédentaires favorise l'accumulation du capital et la production de plus-value.
Or le phénomène de l'apparition d'un capital excédentaire par rapport aux possibilités de l'accumulation n'est pas, pour Marx, caractéristique d'une période de longue durée qui surgirait avec le capitalisme mûr mais de moments relativement brefs dans la vie du capital, moments qui sont toutefois l'aboutissement de son cycle : la crise.
Penser une surproduction de capital, l'existence d'excédents de capitaux, indépendamment de la crise et, donc, d'une chute brutale du taux de profit est une démarche, sans doute, originale mais qui, outre son caractère fantaisiste, n'a rien à voir avec le programme communiste. Il s'agit, de la part de Mandel, d'une concession aux théoriciens staliniens du capitalisme monopoliste d'Etat avec lesquels il entretient un flirt obscène mais qui n'est pas contre nature.
D'ailleurs Mandel a beau déclarer ces phénomènes indépendants de la baisse du taux de profit, les solutions qu'il avance, à travers les dépenses étatiques d'armement, montrent que le capital en jachère, subitement mobilisé, se met à rapporter de la plus-value ; le taux de profit s'en trouve relevé d'autant. Cette escroquerie intellectuelle accomplie, Mandel peut alors vanter les bienfaits, pour le capital, de l'économie d'armement et, par voie de conséquence, mais il n'ose pas insister là-dessus ce qui pourtant serait en continuité avec son point de vue, des dépenses étatiques.
Ainsi le miracle keynésien, devenu un mirage pour tous les penseurs bourgeois avec le retour périodique de grandes crises internationales affectant la production capitaliste, a fini par trouver grâce aux yeux de Mandel. Tandis que pour la théorie révolutionnaire surproduction du capital, mise en jachère du capital sont des concepts corollaires de la crise et donc des phénomènes qui reviennent périodiquement, ils restent, pour Mandel, des phénomènes permanents. Tandis que pour le programme communiste cette surproduction est violemment résorbée par une dévalorisation brutale du capital qui permet de ramener le niveau du profit et de la productivité du travail à un degré tel que le capital peut reprendre, s'il n'a pas été renversé à cette occasion, son cours catastrophique, pour Mandel le capital excédentaire prend douillettement pension au sein de l'Etat qui, bon garçon, le mobilise dans des activités aussi productives que la production d'armement.
Alors que, pour le communisme, il n'y a pas d'autre issue, du point de vue du capital, que la crise et pour finir la guerre, Ernest Mandel, en bon réformiste, vient de trouver la roue de secours du carrosse capitaliste : l'Etat. Si l'on veut bien écarter les acrobaties théoriques qui se terminent régulièrement par une mutilation du programme communiste, on peut constater que la démonstration mandélienne du rôle spécifique des armements dans la période récente du MPC n'a pas avancé d'un epsilon.
14.5 Ernest Mandel bat la campagne
L'un des maux qui guettent l'homme vieillissant, est une brusque absence momentanée d'irrigation du cerveau ; il s'ensuit une rupture dans le raisonnement intellectuel. Le "marxisme" d'Ernest Mandel, s'il n'a jamais vraiment échappé au délire, témoigne d'une nette accélération de ce processus.
Dans les schémas qu'il nous propose pour essayer de justifier certains de ses raisonnements, Mandel fait supporter à chaque fraction de la classe capitaliste, c’est-à-dire aux capitalistes des départements I, II et III, un impôt d'un taux égal, qui s'applique à la plus-value produite par chaque secteur. Chaque secteur supporte donc des dépenses proportionnelles à la plus-value produite. Puis, Mandel ajoute la plus-value nette du secteur de l'armement à la plus-value nette (c’est-à-dire la plus-value restant après déduction des impôts) de la section des moyens de production. Ce rapprochement, de la plus haute fantaisie, est alors l'occasion d'une véritable révolution théorique. Mais le saut est tellement périlleux que la théorie s'en trouve mise sans dessus dessous. En effet, une fois l'agrégation faite, Mandel constate que la plus-value nette des deux secteurs est – dans son schéma – sensiblement égale à la plus-value brute (donc y compris l'impôt) du seul secteur des moyens de production.
De ce cas particulier et de cette agrégation fortuite, qui font que la plus-value nette de la section III + la plus-value nette de la section I est à peu près égale à la plus-value brute de la section I, Mandel déduit (?) que
"l'armement permanent signifie une redistribution des profits dans l'intérêt des trusts de l'armement qui appartiennent presque tous au département I, et au détriment des trusts du département II. Si nous supposons que les trusts qui s'occupent de l'armement se réduisent tous à ceux du département I, la plus-value nette qu'ils réalisent dans le premier cycle (48.410 unités de valeur) est pratiquement égale à la plus-value brute du département I. Celle qu'ils réalisent dans le second cycle (50.100 unités de valeur) est supérieure à la plus-value brute du département I, tant dans le premier que dans le second cycle. A partir du second cycle les coûts capitalistes de l'armement furent donc exclusivement couverts par les capitalistes du département II, (...)" (Mandel. Le troisième âge du capitalisme, p.182-183, T2).
Nous nageons ici dans l'idéalisme le plus débridé ; la folie de Mandel devenant proportionnelle aux dépenses d'armements. Manifestement, son sujet lui est monté à la tête provoquant dans le cerveau de véritables explosions. Le discours passablement réformiste quitte ici complètement les rails qu'il s'était lui même donné. Car, d'une part, que viennent faire dans le département I les entreprises que l'on s'est évertué à ranger avec les arguments que l'on sait dans le département III ? Quelle justification peut il y avoir à un tel amalgame? D'autre part, le rapprochement fortuit de deux éléments, dont on dit, par ailleurs, qu'ils n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, constitue-t-il un raisonnement valable?
Le raisonnement de Mandel est à peu près de l'acabit de celui ci : supposons que l'Etat installe des pissotières de long des trottoirs ; ces pissotières seront payées aux entreprises de ce secteur par le biais des impôts que paient toutes les catégories de capitalistes. Regroupons la plus-value nette de la section II avec la plus-value nette du secteur des pissotières et constatons que cette somme est sensiblement égale à la seule plus-value totale de la section II (plus-value brute). La conclusion qui s'impose de ce bel exercice arithmétique est que la production de pissotières repose exclusivement sur le secteur I et que les pissotières représentent une formidable machine de guerre entre les mains des trusts de la section II envers ceux de la section I.
Mandel révèle alors ce qu'il est : un illusionniste dont les théories ne sont plus que des tours de bonneteau qu'il a de plus en plus de mal à manipuler sans qu'on crie à la supercherie.
15. Rosa Luxemburg et les disproportions dans les schémas de reproduction
15.1 Rosa Luxemburg, le révisionnisme et le programme communiste
Les théories de Rosa Luxemburg constituaient une réaction salutaire et généreuse contre la dégénérescence de la social-démocratie qui galvaudait toujours plus le programme révolutionnaire pour en faire un programme de réforme sociale. Cette même social-démocratie renonçant à démontrer le cours catastrophique du capital, cherchait à montrer comment les contradictions économiques et les antagonismes de classe, contrairement aux prévisions de Marx et Engels, s´atténuaient avec l´avancée de la production capitaliste. Cependant, la réaction de Rosa Luxemburg, elle-même, portait les stigmates de l´affaiblissement du tranchant révolutionnaire et de l´influence pathologique du chancre social-démocrate sur le corps du parti prolétarien.
Malgré ses efforts exemplaires pour combattre la maladie, celle-ci ne fut pas extirpée radicalement et quand, après l’ignoble trahison de la seconde Internationale, la grandiose tentative inaugurée par l’Octobre rouge de remettre sur le devant de la scène le programme communiste intégral échoua à son tour, elle gagna définitivement tout le corps social.
Qu’elle qu’ait été la chirurgie radicale pour régénérer l’organisme prolétarien, qu’elle qu’ait été la force de la transfusion produite par la révolution russe, l’insidieux travail de sape de la seconde internationale, la trahison exemplaire de ses chefs, furent tels qu’ils laissèrent les militants dévoués à la cause révolutionnaire suffisamment désemparés et inexpérimentés devant les ravages de la maladie. D’autant plus que les métastases de l’opportunisme et du révisionnisme figuraient dans la IIIème internationale, si bien que la maladie gagna le terrain au sein de cette dernière dès que le flux de la révolution internationale se brisa sur les récifs de la contre-révolution.
La nouvelle contre-révolution qui, alors, s’abat sur le prolétariat, contre révolution qui pèse encore sur nos épaules, est la plus terrible de son histoire. C’est celle où successivement deux de ses organisations internationales passent dans le camp ennemi en moins de 15 ans, c’est celle où ses traditions, ses concepts, sa théorie horriblement défigurés tombent aux mains de l’ennemi de classe. Les conséquences de cette défaite, dont l’ampleur ne sera jamais assez soulignée, n’ont pas toutes été tirées et le bilan, les leçons à retenir pour la reprise révolutionnaire, reste encore, pour beaucoup, à être exposé. Les lois de la dialectique enseignent que la défaite aura dû être d’autant plus profonde et exemplaire pour permettre la réémergence révolutionnaire sur des bases qui renouent avec le matérialisme historique, avec le socialisme scientifique dont l’acte de naissance remonte à 1847.
A partir de cette époque, le socialisme, selon les paroles d’Engels peut et doit être étudié comme une science, et servir de fondement à l’action libératrice du prolétariat en lutte pour son émancipation. Théorie du prolétariat, le communisme fait dès lors table rase de l’économie politique bourgeoise dont il montre qu’elle parvient à son apogée comme science vers 1830 quand la lutte des classes a atteint quelque ampleur tandis qu’apparaissent les premières crises de surproduction propres au mode de production spécifiquement capitaliste qui domine déjà l’Angleterre.
Dès le milieu du XIXè siècle, le communisme critique démontre que :
· avec la généralisation du machinisme sont fournies les bases économiques pour le dépassement des sociétés reposant sur des classes antagoniques.
· les rapports de production capitalistes dont le but limité est la mise en valeur du capital, la recherche du maximum de plus-value, au travers de l’exploitation de la force de travail prolétarienne, sont devenus trop étroits pour assurer le développement de la force productive du travail.
· ce conflit se résoudra périodiquement par des crises potentiellement toujours plus grandes : ces catastrophes sociales devant conduire à son renversement violent.
· l’humanité ne peut trouver une issue aux contradictions violentes dans laquelle la société bourgeoise se débat que par l’intervention révolutionnaire de la classe productive : le prolétariat.
· ce dernier, constitué en parti politique distinct et opposé aux partis des autres classes, doit s’emparer du pouvoir politique qui ne peut avoir d’autre forme que celle de la dictature révolutionnaire du prolétariat.
· la dictature du prolétariat est la phase de transition politique qui doit permettre l’instauration de la société sans classes, sans Etat : de la société qui abolit le travail salarié et les catégories marchandes : le communisme.
Cette puissante démonstration, falsifiée et niée progressivement par la seconde Internationale et ensevelie par le fer et le feu une fois l’écrasement du prolétariat consommé, ne pourra que ressurgir, d’autant plus lumineuse, quand sa nécessité et sa réalité s’imposeront. La tâche du parti communiste au sens historique du terme, c’est-à-dire de la seule expression du parti communiste qui peut perdurer dans la contre-révolution, c’est d’assurer par tous les moyens possibles, la défense de ce programme révolutionnaire afin de faciliter sa réappropriation par les générations suivantes.
Rosa Luxemburg, assassinée par la social-démocratie au cours de l’assaut révolutionnaire du prolétariat allemand, appartient bien à notre camp et nous la défendrons avec toute la vigueur nécessaire contre la charogne contre-révolutionnaire. Mais, sans renier sa lutte contre ceux qui finirent par l’assassiner, il faut reconnaître que Rosa Luxemburg est malheureusement restée à mi-chemin dans sa tentative de restauration et d’approfondissement de la théorie des crises. Nous avons, dans les chapitres précédents, critiqué en détail ses interprétations qui la font retomber dans l’économie vulgaire.
Nous avons ainsi montré que, contrairement à l’opinion d’un Tugan-Baranovsky, il n’y a pas de contradiction entre l’analyse du livre II et du livre III du « Capital ». Qu’en conséquence, il est vain, comme essaye de le faire Rosa Luxemburg, de rechercher des contradictions violentes dans le livre II du « Capital » afin de faire ressortir que seul le livre III, celui dans lequel Marx parle plus concrètement des crises (encore qu’il s’agisse, pour une part, d’un malentendu car le « Capital » n’est qu’une partie d’un ensemble beaucoup plus vaste que Marx projetait d’écrire et, au sein de cette « Economie », un livre entier devait être consacré aux crises) était en rapport avec l’esprit de Marx.
Ceci posé, une fois replacé chaque livre du « Capital » dans son contexte d’analyse, l’argumentation centrale de Rosa Luxemburg selon laquelle il n’existe pas de demande solvable pour réaliser la plus-value au sein du mode de production capitaliste tourne court.
Nous avons aussi montré comment le circuit du capital individuel A-M-A’ (Argent-Marchandise-Argent’) se modifie au niveau du capital total, l’argent restant toujours le premier moteur du cycle du capital.
Il reste alors que la crise catastrophique, générale et périodique du MPC repose sur la contradiction valorisation-dévalorisation du capital qui se présente sous l’aspect de la baisse tendancielle du taux de profit.
A l’opposé, la crise, selon la logique luxemburgiste est partielle (elle ne concerne qu’une partie de la plus-value), permanente (selon sa conception le problème de la réalisation se pose à chaque moment pour le capital) et confinée dans sa sphère de la circulation (il n’y a priori aucune relation entre les difficultés du procès de production et la réalisation de la plus-value. La difficulté supposée de réaliser une fraction de la plus-value du fait de l’absence de demande solvable est largement indépendante du mouvement de la production capitaliste).
Par contre, pour le programme communiste, si la crise se manifeste dans le procès de circulation, si l’existence d’une contradiction entre le capital marchandise et le capital argent rend la crise possible, sa nécessité (et la crise est la combinaison dialectique de sa nécessité et de sa possibilité) s’enracine dans le procès de production, dans le procès contradictoire de mise en valeur du capital, dans la nécessité de développer la productivité du travail sans tenir compte des limites imposées par le mode de production capitaliste et les buts limités de ce même mode de production : la valorisation maximum du capital, la recherche du maximum de plus-value.
La théorie générale de Rosa Luxemburg écartée, nous avons également montré comment les objections soulevées au sujet de la circulation monétaire, loin de révéler des contradictions insolubles dans la théorie de Marx, trouvaient facilement une solution et ouvraient la voie à des analyses sur la reproduction du capital employant du travail improductif ainsi que du capital consommé de manière improductive.
Parmi ceux-ci les armements, loin d’être, sous certaines conditions, un champ privilégié d’accumulation du capital assurant la réalisation du capital comme prétend le monter Rosa Luxemburg (mais elle n’y parvient pas) n’ont pas un caractère spécifique dans l’accumulation du capital qu’ils contribuent à limiter plutôt qu’à accélérer.
Tentative généreuse pour fonder la perspective catastrophique du cours du mode de production capitaliste, la théorie de Rosa Luxemburg reste en grande partie étrangère à la théorie révolutionnaire de Marx. Cédant à la pression du révisionnisme, elle accepte les postulats du révisionnisme comme identiques (du moins pour certains ouvrages de Marx) à ceux du programme communiste. Sa théorie intervient alors comme une correction à apporter à l’ensemble du socialisme scientifique pour lui faire retrouver sa perspective originale, à savoir la condamnation du cours catastrophique du MPC. Non seulement sa conception se révèle un échec mais elle conduit la théorie révolutionnaire vers de nouveaux écueils : en voulant la tirer des griffes du révisionnisme qui proposait une théorie des crises qui renouait avec les tendances de l’économie politique inspirées par Say et Ricardo (c’est-à-dire les tendances qui n’admettaient comme seule possibilité de crise que des disproportions) elle l’entraînait vers les théories adverses mais qui appartenaient également à l’orbite de l’économie politique, à savoir les thèses sous-consommationistes.
15.2 Les deux tendances de l’économie politique
15.2.1 Le programme communiste altéré
Ce n’est pas une moindre constatation que, sous l’impact du phénomène révisionniste, l’unité du programme communiste ait éclatée si bien que de critique radicale de la science économique il s’est mué en marxisme vulgaire. Sur le plan de la théorie des crises, on a vu se reproduire les deux tendances de l’économie politique : l’école de la disproportion et l’école de la sous-consommation. La ligne de fracture entre le révisionnisme et les réactions révolutionnaires de la gauche de la social-démocratie ne passe pas seulement entre ces deux tendances ; le phénomène est plus complexe. Si Rosa Luxemburg renoue avec la filière sous-consommationiste, Lénine se situe plutôt dans la lignée de l’école de la disproportion. En d’autres termes, quelle qu’ait été la profondeur de la réaction des gauches révolutionnaires au révisionnisme, le triomphe de ce dernier, et le fait qu’il ait affecté très tôt les principaux chefs du socialisme, a entraîné une profonde discontinuité et l’unité du programme communiste, en dépit de saines réactions, ne fut jamais retrouvée. Ce qui est dit des crises se retrouve également au niveau méthodologique où, là aussi, deux tendances renouant avec le matérialisme bourgeois ou l’idéalisme ont signifié l’éclatement du programme communiste.
15.2.2 L’école de la disproportion
Pour la tendance de l’économie politique à qui est associée le nom de Say, les crises ne peuvent exister que parce que la production n’est pas bien proportionnée. Si Say reste un économiste de seconde zone (la fameuse loi « les marchandises s’échangent contre les marchandises » a d’ailleurs été énoncée avant lui par James Mill - le père de John Stuart Mill-) cet aspect de ses théories a été pris au sérieux par un économiste d’un autre calibre puisqu’il s’agit de Ricardo : le plus grand économiste du XIXème siècle. Et, comme avec lui, l’économie politique a atteint son apogée en tant que science, nous dirons qu’il s’agit du dernier grand économiste. (Messieurs les prix Nobel vous arrivez trop tard, le communisme et la lutte de classe du prolétariat ont brisé votre carrière avant qu’elle ne commence. Vous êtes donc condamnés à patauger dans l’obscurantisme, la vulgarité érigée en principe, les théories à gages pour justifier le pouvoir de vos maîtres et, par la même occasion, vos prébendes).
Les théories de la disproportion reposent sur une conception de la monnaie particulièrement fruste puisque ne sont prises en compte que les fonctions de monnaie de compte et de moyen de circulation. Comme le diront les successeurs crétinisés des Ricardo et Cie, la monnaie est « neutre » ou elle constitue un « voile » au dessus de l’économie réelle des marchandises et des services. L’économie marchande est en fait ramenée à une économie de troc médiatisée par la monnaie. Les marchandises sont évaluées en argent, elles valent tant d’euros par exemple, c’est la fonction monnaie de compte de l’argent, et ce même argent sert de moyen de circulation en permettant aux marchandises de changer de mains, de passer du producteur au consommateur. Ce faisant, des producteurs différents ont échangés les marchandises qu’ils produisaient et l’existence de l’argent n’a en définitive fait que faciliter un processus qui s’apparente au troc où les producteurs échangent directement les marchandises. Ici l’argent n’a servi que de médiation pour effectuer un troc, l’existence de l’économie marchande et plus particulièrement de la société bourgeoise ne revêt aucune spécificité pour cette économie politique.
Supposons deux producteurs qui échangent régulièrement leurs marchandises. Une surproduction ne pourrait exister que si la production de l’un était supérieure à l’autre. En d’autres termes, l’un aurait trop produit et l’autre pas assez pour que l’équilibre soit atteint. Pour cette école, la crise de surproduction n’est pas générale mais partielle : elle affecte une partie de la production et trouve en elle les mécanismes correcteurs qui rétablissent l’équilibre. Si un producteur produit trop, la demande étant insuffisante pour ses marchandises, leur prix va baisser et le producteur adaptera sa production à la demande en diminuant celle-ci, une partie des capitaux quittant cette branche en dépression. De l’autre côté, la branche en état de sous-production voit ses prix monter. Elle attire des capitaux supplémentaires en quête d’un surprofit si bien que l’équilibre, un moment troublé, sera rétabli sous la simple influence des mécanismes du marché.
« L’absurdité de cette thèse apparaît encore plus clairement si on lui donne, à l’exemple de Say et de ses imitateurs, un vernis international. L’Angleterre, par exemple n’a pas surproduit, mais l’Italie a sous-produit. 1o) Si l’Italie, avait assez de capital pour remplacer le capital anglais qui lui arrive sous forme de marchandises ; 2o) Si elle avait placé ce capital dans la production d’articles particuliers qui ont besoin du capital anglais soit pour se reproduire, soit pour créer des revenus correspondants, il n’y aurait pas de surproduction. Autrement dit, il n’y aurait pas de surproduction réelle en Angleterre en relation avec la production réelle en Italie, mais une sous-production imaginaire en Italie, parce que : 1o on suppose en Italie un capital et un développement des forces productives qui n’y existent pas ; 2o on suppose tout aussi utopiquement que ce capital, qui n’existe pas en Italie, y est justement employé de telle façon que l’offre anglaise et la demande italienne, la production anglaise et la production italienne se complètent. En d’autres termes, il n’y aurait pas de surproduction si l’offre et la demande se balançaient, si la répartition du capital entre les divers secteurs de la production était telle que la production d’un article impliquât la consommation d’un autre, donc la sienne propre. Il n’y aurait pas de surproduction s’il n’y avait pas de surproduction. Mais comme la production capitaliste ne peut se donner libre cours que dans certaines sphères, dans des conditions données, aucune production capitaliste ne serait possible si elle devait se développer simultanément et uniformément dans toutes les sphères. (...)
Expliquer la surproduction par la sous-production revient à dire que, s’il y avait production proportionnelle, il n’y aurait pas de surproduction. Il en serait de même si l’offre et la demande s’équilibraient, si toutes les sphères offraient à la production capitaliste les mêmes possibilités d’extension : division du travail, machinisme, exportation vers les marchés lointains, production en masse, etc. ; ou encore si tous les pays qui commercent entre eux avaient la même capacité de production (de productions différentes et complémentaires). Or, s’il y a surproduction, c’est que tous ces pieux désirs restent inexaucés.
(Marx, Matériaux pour l’« Economie », La Pléiade, T.2, P.494-495).
Ricardo, mort en 1823, pouvait encore se bercer d’illusions sur la nature des crises car il n’en vit que les prodromes ; les premières grandes crises de surproduction datant de 1825. Par contre, ses successeurs se trouvaient toujours plus confrontés à des faits qui entraient violemment en contradiction avec les théories de l’harmonie sociale.
« Ricardo lui-même ne savait rien des crises à proprement parler, des crises mondiales, générales, issues du processus même de la production. Il pouvait expliquer les crises entre 1800 et 1815 par l’enchérissement du blé dû aux mauvaises récoltes, la dépréciation du papier-monnaie, des denrées coloniales, etc., le marché étant resserré à la suite du Blocus continental pour des raisons politiques et non pas économiques. Les crises postérieures à 1815, il pouvait les expliquer de la même façon : tantôt par une mauvaise récolte et une pénurie de grains, tantôt par la baisse du prix du blé – les causes qui ont provoqué la hausse pendant le Blocus ayant, selon sa propre théorie, cessé d’agir – tantôt enfin par le passage de la guerre à la paix et les « changements soudains » qui en résultèrent « pour le commerce ».
Les phénomènes historiques ultérieurs, particulièrement la périodicité quasi régulière des crises du marché mondial, empêchèrent les successeurs de Ricardo de nier les faits ou de les interpréter comme de simples accidents. » (Marx, Matériaux pour l’« Economie », La Pléiade, T.2, P.464-465)
La critique de la théorie ricardienne des crises et de la « loi des débouchés » est accomplie très tôt par le programme communiste. Il est de la nature de la production capitaliste de produire de manière disproportionnée. Le capitaliste produit pour le marché, sans tenir compte des besoins sociaux, et il ne reçoit la sanction du marché et de la demande qu’une fois la production effectuée. Il en résulte des déséquilibres permanents en même temps que jouent les tendances au rééquilibre pour préparer les bases de nouvelles disproportions. De telles crises ont d’ailleurs toutes les chances de se produire dans les rapports entre capital fixe et capital circulant du fait des différences dans le procès de reproduction. En effet, si le capital constant circulant transmet l’intégralité de sa valeur dans le procès de production et doit donc être reproduit intégralement il n’en va pas de même pour le capital fixe qui ne fait que transmettre une partie de sa valeur au produit. Que des déséquilibres surgissent de ces différences est inévitable dans la production capitaliste. Mais de telles crises n’ont qu’un caractère limité et ne peuvent expliquer les crises de surproduction universelles qui affectent le mode de production capitaliste.
« Il va de soi qu’il peut y avoir surproduction dans certaines sphères et sous-production dans d’autres ; des crises partielles peuvent donc résulter d’une production disproportionnée (mais la production proportionnée n’est jamais que le résultat de la production disproportionnée sur la base de la concurrence), dont une forme générale peut être une surproduction de capital fixe d’un côté et de capital circulant de l’autre.(...)
Cependant, nous ne parlons pas ici de la crise causés par une production disproportionnée, c’est-à-dire par une disproportion dans la distribution du travail social entre les différentes sphères de la production. Cet aspect du problème sera repris à propos de la concurrence des capitaux. Nous avons déjà dit à ce sujet que la hausse ou la baisse de la valeur marchande par suite de cette disproportion entraîne le transfert et le retrait du capital d’un commerce dans l’autre. Mais une telle égalisation implique son contraire et peut donc perpétuer la crise, qui peut à son tour constituer une forme d’égalisation. » (Marx, Matériaux pour l’« Economie », La Pléiade, T.2, P.485-486)
Si les théories de la disproportion nient les crises générales, c’est qu’elles reposent sur une conception extrêmement vulgaire de la monnaie et de la marchandise. En ramenant la marchandise au rang de produit, l’échange au rang du troc, en privilégiant l’unité dans le processus de vente et d’achat sans en souligner également la singularité, cette économie politique nie les particularités de l’économie marchande qui sont poussées à leur comble avec la société bourgeoise puisque l’ensemble du produit prend la forme marchande. Les contradictions que le programme communiste met en relief à propos de la marchandise prennent alors une dimension particulièrement importante. La quantité se transforme en qualité et les crises qui gisaient dans le rapport de la marchandise à l’argent sont désormais possibles au niveau de la société toute entière dont elles menacent les fondements. Le passage de la marchandise à l’argent ne constitue pas plus un passage évident que le passage de l’argent à la marchandise. La réalisation de la valeur, et de la plus-value dans la société capitaliste, contenue dans la marchandise, c’est-à-dire sa transformation en argent, constitue le « saut périlleux » de la marchandise. Cette réalisation permet à un travail particulier de revêtir un caractère universel. Ce passage, cette réalisation, n’est pas automatique et dans cette possibilité d’une scission entre la vente et l’achat de la marchandise réside la possibilité d’une crise. Comme nous l’avons déjà vu, sur le plan du capital global, réalisation de la valeur et de la plus-value et conversion de l’argent en éléments du capital productif sont des procès identiques et la généralisation des contradictions décelées dans l’étude de la marchandise rendent possible la surproduction générale, surproduction qui affecte l’ensemble du produit social.
« Cette apologétique consiste alors à donner une fausse image des rapports économiques les plus simples et surtout à n’en retenir que l’unité au sein de l’antagonisme.
Par exemple, si l’achat et la vente – ou le mouvement de métamorphose de la marchandise – représentent l’unité de deux processus, ou plutôt le passage d’un seul processus par deux phases opposées, s’ils constituent donc essentiellement l’unité de ces deux phases, ils n’en sont pas moins essentiellement séparation et particularisation. Or, vu le lien qui les unit, la séparation des moments doit paraître violente comme un processus de destruction. C’est précisément dans la crise que s’affirme leur unité de moments différents. L’autonomie qu’ils revêtent les uns vis-à-vis des autres se trouve brutalement détruite. La crise rend donc manifeste l’unité des moments séparés. Il n’y aurait pas de crise sans cette unité foncière des éléments d’apparence indifférents les uns à l’égard des autres. Mais notre apologiste refuse cette idée. Puisqu’il y a unité, il ne peut y avoir de crise. Ce qui revient à dire que l’unité d’éléments opposés exclut l’opposition.
Pour démontrer que la production capitaliste ne peut conduire à des crises générales, on en nie toutes les conditions et toutes les formes, tous les principes et toutes les différences spécifiques, bref, la production capitaliste elle-même. On démontre que, si au lieu d’être une forme particulière de la production sociale, le fruit d’un développement spécifique, le mode de production capitaliste était une économie des plus rudimentaires, les antagonismes et les contradictions qui lui sont propres n’existeraient pas et ne pourraient donc point éclater dans des crises. » (Marx, Matériaux pour l’« Economie », La Pléiade, T.2, P.467)
Plus d’un demi-siècle après, le révisionnisme au sein de la social-démocratie renouait avec de telles conceptions. Arguant de ce que Marx avait montré, contre l’économie politique classique, que le capital constant dépensé dans la production faisait partie de la valeur des marchandises (ce que cette économie politique ignorait), le révisionnisme prétendait que, du même coup, les données de l’étude de la reproduction du capital social avaient été bouleversées au point qu’il était possible de reprendre les mêmes analyses, mais enrichies de la grande découverte scientifique – au demeurant indéniable – de Marx concernant le capital constant. Les théories d’un Tugan-Baranovsky ou d’un Hilferding conduisaient donc à n’admettre que des crises de disproportions entre les grandes branches de la production capitaliste. Il suffisait alors de conquérir le pouvoir d’Etat, en l’occurrence l’Etat bourgeois et, grâce à une bonne planification, réguler, au mieux des intérêts de la nation et de la classe ouvrière, la production qui pourrait croître et embellir sans heurts tandis que sous le régime de l’initiative privée des capitalistes elle ne pouvait que se traduire par des crises. En renouant avec la tradition ricardienne, qui depuis l’intervention du prolétariat et de sa théorie s’était muée ouvertement en apologie de l’ordre existant et en économie politique vulgaire, le révisionnisme qui devait emporter toute la social-démocratie allait loin dans son reniement du programme révolutionnaire. Les crises, de catastrophiques, devenaient des accidents de parcours d’une gravité limitée. Leur solution ne consistait plus dans le renversement du capital et l’abolition des catégories marchandes mais dans la domination de la loi de la valeur par l’Etat bourgeois démocratisé. Il ne s’agissait plus de détruire l’Etat bourgeois au point qu’il ne subsiste déjà plus qu’un demi-état qui ne saurait être autre chose que la dictature du prolétariat, prélude à sa disparition complète, mais de rénover la machine bourgeoise tout en laissant subsister, voire renforcer, la bureaucratie, notamment celle destinée à « planifier » le monstre capitaliste, l’armée, la police et la justice. Deux guerres mondiales, la grande crise de 1929, tout comme, aujourd’hui, les nouvelles crises qui secouent régulièrement la production capitaliste n’ont pas ramené la social-démocratie sur des positions orthodoxes, elle s’en est au contraire toujours plus éloignée, rejetant un par un tous les oripeaux qui la rattachaient au programme communiste. Ces épisodes ont été pour elle l’occasion de perfectionner son discours et son expérience dans sa lutte acharnée contre le communisme révolutionnaire.
15.2.3 L’école sous-consommationniste
La seconde tendance de l’économie politique trouve avec Sismondi son plus éminent représentant. Elle indique les doutes de l’économie politique sur elle-même et sur l’avenir de la société bourgeoise. Sismondi met bien à nu les contradictions de la société :
« Le luxe n’est possible que quand on l’achète avec le travail d’autrui ; le travail assidu, sans relâche, n’est possible, que lorsqu’il peut seul procurer, non les frivolités, mais les nécessités de la vie.
La multiplication indéfinie des pouvoirs productifs du travail, ne peut donc avoir pour résultat que l’augmentation du luxe ou des jouissances des riches oisifs. L’homme isolé travaillait pour se reposer, l’homme social travaille pour que quelqu’un se repose ; l’homme isolé amassait pour jouir ensuite, l’homme social voit amasser le fruit de ses sueurs par celui qui doit en jouir ; mais, dés l’instant que lui et ses égaux produisent plus, et infiniment plus qu’ils ne peuvent consommer, il faut bien que ce qu’ils produisent soit destiné à la consommation de gens qui ne vivront point en égaux, et qui ne produiront point.
Ainsi le progrès de l’industrie, le progrès de la production comparée à la population, tend à augmenter l’inégalité parmi les hommes. Plus une nation est avancée dans les arts, dans les manufactures, et plus est grande la disproportion entre le sort de ceux qui travaillent et celui de ceux qui jouissent ; plus les uns ont de peine, plus les autres étalent de luxe, à moins que, par des institutions qui semblent contraires au but purement économique de l’accroissement des richesses, l’Etat ne corrige leur distribution et n’assure une plus grande part dans les jouissances à ceux qui créent tous les moyens de jouissance. »
(Sismondi, Nouveaux principes d’économie politique, Calmann-Lévy, p.106)
Mais, Sismondi ne comprend pas l’origine de ces contradictions et, par conséquent, ne peut en découvrir la solution. Il reste un petit bourgeois utopiste et réactionnaire qui ne fera en rien avancer la compréhension de la reproduction du capital. Développant une théorie où « le revenu de l’année passée (...) doit payer la production de cette année »[83] Sismondi ne peut comprendre l’accumulation et les crises propres au mode de production capitaliste.
« (…) c’est une quantité prédéterminée qui sert de mesure à la quantité indéfinie de travail à venir. L’erreur de ceux qui excitent à une production illimitée vient de ce qu’ils ont confondu ce revenu passé avec le revenu futur. Ils ont dit qu’augmenter le travail, c’est augmenter la richesse, avec elle le revenu, et en raison de ce dernier la consommation. Mais on n’augmente les richesses qu’en augmentant le travail demandé, le travail qui sera payé à son prix ; et ce prix, fixé d’avance, c’est le revenu préexistant. On ne fait jamais, après tout, qu’échanger la totalité de la production de l’année contre la totalité de la production de l’année précédente . »
(Sismondi, Nouveaux principes d’économie politique, Calmann-Lévy, p.129)
En niant toute possibilité de réaliser l’intégralité de la valeur, l’école de la « sous-consommation » ou de la « demande effective » est le pendant dialectique de l’autre tendance de l’économie politique. L’une met exclusivement en relief l’unité du procès de réalisation de la marchandise en argent, l’autre ne voit que la scission entre l’offre et la demande. Il s’ensuit que, pour les sous-consommationnistes, la réalisation de la valeur et de la plus-value est un problème permanent qui revêt une plus ou moins grands acuité suivant les circonstances.
« (...) si la production croît graduellement, l’échange de chaque année doit causer une petite perte, en même temps qu’elle bonifie la condition future. Si cette perte est légère et bien répartie, chacun la supporte sans se plaindre sur son revenu ; c’est en cela même que consiste l´économie nationale, et la série de ces petits sacrifices augmente le capital et la fortune publique. Mais, s’il y a une grande disproportion entre la production nouvelle et l’antécédente, les capitaux sont entamés, il y a souffrance, et la nation recule au lieu d’avancer » (Sismondi, Nouveaux principes d’économie politique, Calmann-Lévy, p.129)
Donc, pour cette école, une partie du produit social et non sa totalité comme le montre le programme communiste tend, en permanence, à ne pouvoir être réalisé. Pour la théorie révolutionnaire, c’est l’ensemble du capital, qu’il soit constant, variable ou qu’ils s’incarne dans la plus-value, qui ne peut être réalisé régulièrement. Si le divorce entre la vente et l’achat est possible, s’il résulte de la nature de la marchandise, si le passage de la marchandise à l’argent, la réalisation de la valeur et de la plus-value, constituent le saut périlleux de la marchandise, le passage de la nécessité à la liberté, la plus dure des transitions dialectiques, il ne fonde que la possibilité de la crise. En rester à ce niveau revient à expliquer la crise par la crise (cf. Marx, Matériaux pour l’Economie, Pléiade, T.2, p.468-469, citée p.105)
La crise n’est pas pour autant permanente et le développement « normal », « sain » de la production capitaliste montre que dans ce cas l’unité des deux phases du procès a prévalu par rapport à la possibilité de scission qu’ils contiennent. Régulièrement, cependant, cette unité est rompue et doit être rétablie violemment, surmontée par une crise. Sismondi ignore que la valeur de la production inclut le capital constant. Mais cet argument, employé par Lénine, ne doit pas cacher que Ricardo le méconnaît également et donc apporte peu de choses pour différencier les deux écoles. Leur opposition est tout autre, comme nous l’avons vu, mais Lénine se rattache par ses conceptions aux théoriciens des disproportions tandis que Rosa Luxemburg (nous avons eu l’occasion de voir en détail ses positions) reste dans la lignée de l’école de la sous-consommation. Les deux tendances en restent à une crise qui n’affecte qu’une partie du produit social. Les conséquences politiques de telles analyses ne sont pas neutres. Pour le léninisme qui sous estime l’importance des crises et leur capacité à ébranler la société bourgeoise, la volonté du parti, la subjectivité dans l’action révolutionnaire sont hypostasiées. Pour le luxemburgisme, la crise permanente rend le mouvement révolutionnaire fataliste et sous estime le rôle de la préparation révolutionnaire et l’action autonome du parti de classe.
Les tendances de l’économie politique qui reposent sur des théories de la sous-consommation vont cependant plus loin que les théories harmonicistes dans leur appréciation des crises et en insistant sur la possibilité de crises générales ils mettent le doigt sur des tendances justes. Il n’est pas obligatoire que production et marché correspondent. Le développement de la production s’effectue comme si elle n’avait pas de limite, alors qu’elle repose sur une base limitée puisque la production capitaliste a pour but la production d’un maximum de plus-value. Sans accepter les théories sous-consommationnistes comme un Tugan-Baranovsky le prétend, Marx montre ce qu’il y a de juste dans celles-ci.
« Imaginons une société composée uniquement de capitalistes industriels et de salariés. Négligeons en outre les variations de prix qui empêchent d’importantes parties du capital total de se remplacer dans leurs proportions moyennes et qui, étant donné la cohésion générale du processus de reproduction (particulièrement favorisé par le crédit), ne peuvent manquer de provoquer périodiquement une stagnation générale. Négligeons également les affaires fictives et les transactions spéculatives suscitées par le système de crédit. Une crise ne pourrait alors s’expliquer que par une production disproportionnée dans les diverses branches de l’économie et par un déséquilibre entre la consommation des capitalistes eux-mêmes et leur accumulation. Toutefois, dans l’état actuel des choses, le remplacement des capitaux engagés dans la production dépend surtout du pouvoir de consommation des classes non productives, tandis que le pouvoir de consommation des travailleurs est limité en partie par les lois du salaire, en partie par le fait qu’ils ne sont employés qu’aussi longtemps que leur emploi est profitable pour la classe capitaliste. La raison ultime de toutes les crises réelles, c’est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l’économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n’avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société. (Marx, Capital, L.III, La Pléiade, T.2, P.1206)
En d’autres termes, le capital tend à développer la productivité du travail, la force productive du travail comme si elles n’avaient pas de limites. La masse des valeurs d’usage tend à se gonfler et ce mouvement toujours poussé plus avant sous l’effet de l’accumulation menace rapidement la production capitaliste dont le perspective limitée est la mise en valeur du capital, la valorisation maximum du capital c’est-à-dire encore l’extraction du maximum de plus-value. Si la production capitaliste était capable de répartir correctement en fonction des besoins sociaux la production, si la productivité du travail accrue permettait l’abaissement du temps de travail et l’accroissement de la satisfaction des besoins matériels des grandes masses de la population, la production capitaliste pourrait éviter les crises mais elle ne serait pas la production capitaliste c’est-à-dire un mode de production dont le but est d’accroître pour une journée de travail identique le surtravail au dépend du travail nécessaire. Aussi les contradictions et les crises sont-elles inévitables.
« Dès que toute la quantité de surtravail que l’on peut extorquer est matérialisée en marchandises, la plus-value est produite. Mais cette production de plus-value n’achève que le premier acte du processus de production capitaliste, le processus immédiat. Le capital a absorbé une quantité déterminée de travail non payé. A mesure que le processus se développe, qui s’exprime dans la baisse du taux de profit, la masse de plus-value ainsi produite s’accroît immensément. Vient alors le second acte du processus. Il faut que toute la masse des marchandises, le produit total, aussi bien la partie qui représente le capital constant et le capital variable que celle qui représente la plus-value, se vende. Si la vente ne s’opère pas ou bien qu’elle ne s’opère que partiellement ou à des prix inférieurs aux prix de production, il y a bien eu exploitation de l’ouvrier, mais elle n’est pas réalisée comme telle pour le capitaliste : elle peut même aller de pair avec l’impossibilité totale ou partielle de réaliser la plus-value extorquée, voire s’accompagner de la perte totale ou partielle du capital. Les conditions de l’exploitation directe et celles de la réalisation ne sont pas les mêmes ; elles différent non seulement de temps et de lieu, mais même de nature. Les unes n’ont d’autre limite que les forces productives de la société, les autres la proportionnalité des différentes branches de production et le pouvoir de consommation de la société. Mais celui-ci n’est déterminé ni par la force productive absolue ni par le pouvoir de consommation absolu ; il l’est par le pouvoir de consommation, qui a pour base des conditions de répartition antagoniques qui réduisent la consommation de la grande masse de la société à un minimum variable dans les limites plus ou moins étroites. Il est, en outre, restreint par le désir d’accumuler, la tendance à augmenter le capital et à produire de la plus-value sur une échelle plus étendue. » (Marx, Capital L.III, La Pléiade, T.2, P.1026-1027)
Pour différer les contradictions il se développe alors, à mesure qu’avance le mode de production capitaliste, une classe moyenne improductive, classe qui achète sans vendre, et dont la fonction est de limiter l’accumulation du capital qui, laissée à son propre mouvement, conduit rapidement à l’exacerbation des contradictions propres à la société bourgeoise. Ici aussi, ce sont les représentants de cette tendance de l’économie politique qui ont mis en relief cette perspective, quoique parfois de manière réactionnaire, comme Malthus qui justifiait ainsi des classes dépassées par le développement économique.
Quels que soient les traits particuliers des analyses sous consommationistes qui pouvaient refléter des tendances justes, ces théories n’en étaient pas moins inconciliables avec le programme communiste. En soi, la sous-consommation des masses accompagne tous les modes de production basés sur l’exploitation des classes productives mais les crises de surproduction sont spécifiques de la production capitaliste.
Pour la théorie révolutionnaire c’est peindre le monde bourgeois sous des traits favorables que de voir dans les crises catastrophiques qui l’affectent des crises partielles alors qu’elles sont générales, qu’elles concernent l’ensemble du produit social. Il ne s’agit pas pour le programme communiste de faire tourner à l’envers l’histoire, de freiner les effets dévastateurs de la production capitaliste mais de faire éclater l’enveloppe capitaliste des forces productives pour les libérer dans le sens des intérêts de l´humanité socialisée.
15.3 Les modifications des schémas de reproduction
15.3.1 Rosa Luxemburg introduit la productivité du travail dans les schémas
Tugan-Baranovsky s’était appuyé sur les schémas du livre II du « Capital » pour y développer, le papier opposant peu de résistances à l’arithmétique, fût-elle la plus folle, une « théorie » où il était affirmé que le mode de production capitaliste pouvait se développer sans autre crise que celles résultant d’une disproportion entre les branches de la production. Tugan-Baranovsky poussait le paradoxe jusqu’à envisager une diminution de la consommation ouvrière globale, perspective qui en soi est loin d’être impossible mais reste soumise à des circonstances particulières, dans des proportions telles qu’il montrait qu’il ignorait l’essentiel de la théorie de Marx et, notamment, les effets du développement de la productivité du travail dans le mode de production capitaliste.
Rosa Luxemburg s’est systématiquement efforcée de faire douter des schémas de Marx, soulignant toutes les contradictions possibles. Mais, au lieu de montrer que ces imperfections résultaient de l’état d’avancement des travaux de Marx, elle y voit l’origine d’une contradiction propre à la société bourgeoise qui serait incapable de réaliser la plus-value en son sein. Nous avons déjà critiqué ces conceptions dans les chapitres précédents pour ne pas y revenir ici. Contre Tugan-Baranovsky, elle continue son offensive dans le chapitre 25 (« Les contradictions de la reproduction élargie ») de son ouvrage consacré à « L’accumulation du capital ».
« En examinant le schéma de la reproduction élargie sous l’angle de la théorie de Marx, on arrive à cette conclusion qu’il se trouve en contradiction avec cette théorie sur plus d’un point. »
(Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital, Petite collection Maspero, T.2, P.12)
Rosa Luxemburg commence par indiquer que les schémas ne tiennent pas compte de la productivité du travail et elle se propose de l’introduire.
« En corrigeant le schéma en ce sens, on obtiendra le résultat suivant : même par cette méthode d’accumulation, il y aura chaque année un déficit croissant de moyens de production et un excédent croissant de moyens de consommation. Tugan-Baranovsky, qui surmonte toutes les difficultés sur le papier, imagine tout simplement de construire un schéma aux proportions différentes, obtenant ainsi une diminution annuelle du capital variable de 25%. Comme le papier tolère parfaitement cette opération, Tougan en profite pour « prouver » triomphalement que même s’il y a régression absolue de la consommation, l’accumulation se poursuit sans aucune difficulté. Mais en fin de compte Tougan lui-même doit reconnaître que son hypothèse d’une diminution absolue du capital variable est en contradiction flagrante avec la réalité. Le capital variable s’accroît au contraire dans tous les pays capitalistes, il ne décroît que par rapport à une croissance encore plus rapide du capital constant. Cependant supposons, conformément à la réalité, une croissance annuelle du capital constant plus rapide que celle du capital variable, ainsi qu’un taux de plus-value croissant : nous aurons alors une disproportionnalité entre la composition matérielle du produit social et la composition en valeur du capital. Substituons dans le schéma de Marx à la proportion invariable de 5 à 1 entre capital constant et capital variable, une composition progressivement croissante du capital, par exemple de 6 à 1 la 2o année, de 7 à 1 la 3o année, de 8 à 1 la 4o année. Conformément à la productivité croissante du travail, supposons un taux croissant de plus-value : par exemple au lieu du taux immuable de 100%, conservons les chiffres choisis par Marx pour pl tout en diminuant graduellement le capital variable par rapport au capital total. Admettons enfin la capitalisation de la moitié de la plus-value (sauf pour la première année dans la section II qui, d’après l’hypothèse de Marx, accumule plus de la moitié de sa plus-value, 184 sur 285 pl). Nous obtenons alors le résultat suivant :
Première année.
I : 5 000 c + 1 000 v + 1 000 pl = 7 000 (moyens de production)
II : 1 430 c + 285 v + 285 pl = 2 000 (moyens de consommation)
Deuxième année.
I : 5 428 4/7 c + 1 071 3/7 v + 1 083 pl = 7 583
II : 1 587 5/7 c + 311 2/7 v + 316 pl = 2 215
Troisième année.
I : 5 903 c + 1 139 v + 1 173 pl = 8 215
II : 1 726 c + 331 v + 342 pl = 2 399
Quatrième année.
I : 6 424 c + 1 205 v + 1 271 pl = 8 900
II : 1 879 c + 350 v + 371 pl = 2 600
Si l’accumulation devait se poursuivre ainsi, il y aurait un déficit de moyens de production de 16 la 2o année, de 45 la 3o année, de 88 la 4o année. » (Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital, Petite collection Maspero, T.2, P.12-13)
15.3.2 Une énième disproportion
Le lecteur quelque peu attentif à ce qui est dit dans le chapitre précédent aura reconnu notre bonne amie la disproportion. En l’occurrence, un déficit de moyens de production fait face à un excédent de moyens de consommation. Comme l’indiquait Marx dans une citation antérieure, en supposant une société composée exclusivement de capitalistes et d’ouvriers, en supposant que les marchandises se vendent à leur valeur, en excluant le crédit et plus généralement en ne considérant la monnaie que sous ses fonctions de moyen de circulation et de monnaie de compte, la seule possibilité de crise ne peut être qu’une disproportion entre les branches de la production ou un décalage entre la capacité d’accumulation et l’accumulation effective des capitalistes. Or, ce sont sur de telles hypothèses que reposent les schémas de reproduction. Toute possibilité de crise générale y est écartée par définition. Ces schémas n’avaient pas pour but de mettre en relief la possibilité des crises (encore qu’à cette occasion Marx puisse examiner certains aspects du cycle du capital, comme la reproduction du capital fixe, par exemple) mais de montrer comment les catégories de capital constant, capital variable et plus-value permettaient de comprendre le processus de l’accumulation capitaliste, ce pour la première fois dans l’histoire de l’économie politique, ce domaine n’ayant pas réellement progressé depuis Quesnay.
« Dans la valeur du produit- marchandise de la section II, il reste encore à analyser les composantes v + pl. Leur étude n’a rien à voir avec la question la plus importante qui nous occupe ici : savoir si la décomposition en c + v + pl de la valeur de tout produit-marchandise du capitaliste industriel vaut également quoique se manifestant sous des formes intermédiaires différentes, pour la valeur du produit total annuel. » (Marx Capital L.II La Pléiade T.2 P.814)
Dans ses hypothèses de départ, Marx avait également écarté le progrès de la productivité du travail des schémas de reproduction.
« A supposer que, pour l’analyse de la reproduction sur une échelle constante, il faille admettre une productivité constante de toutes les branches de l’industrie (donc aussi, des rapports de valeur proportionnels de leurs marchandises). (...) (Marx, Capital, L.II, La Pléiade, T.2, P.799)
Par conséquent, introduire ce développement de la productivité, et ce d’une manière qui laisse à désirer, ne pouvait que créer des confusions à défaut de démonter les schémas de Marx.
15.3.3 Une crise sans conséquence majeure
Elaborés avec un haut degré d’abstraction théorique, les schémas de reproduction ne pouvaient donc laisser apparaître que de ces crises qui pour l’économie politique correspondent à des disproportions entre les capitaux et que le mouvement propre de l’économie capitaliste pallie. De manière plus dialectique, Marx montre, nous l’avons dit, que ces crises sont inévitables et, en même temps, trouvent leur solution dans l’accumulation qui prépare de nouvelles bases pour de nouvelles disproportions.
Ici, nous avons affaire à une disproportion qui résulte de la différence entre l’accumulation projetée en fonction d’une composition organique constante et l’accumulation effectuée avec un accroissement de la composition organique. Pour autant qu’un tel processus puisse déclencher des crises de disproportion il en fournit aussi la solution.
D’une part la hausse de la productivité, comme le note également Rosa Luxemburg, se traduit par un accroissement des valeurs d’usage pour une même valeur, d’autre part d’un point de vue méthodologique il est illicite de tenir compte d’un processus qui justement avait été écarté par avance à savoir le procès valorisation-dévalorisation du capital. Les schémas de Marx ne sont donc pas en contradiction avec la théorie de Marx. Ils ont un rôle particulier, spécifique dans sa théorie. Ils tirent leur importance du rôle qu’ils jouent pour la connaissance de la reproduction du capital Une fois définies les hypothèses qui les fondent, leur validité ne pose aucun problème.
Comme dans toutes les disproportions, le libre jeu du marché est un facteur qui favorise le rétablissement de l’équilibre troublé tout en posant à un niveau supérieur les fondements de nouveaux déséquilibres. Une hausse des prix dans le secteur des moyens de production qui connaît un déficit allié à une baisse des prix dans les secteur des moyens de consommation où règne une légère surproduction, facilitera le mouvement des capitaux et donc le rétablissement de l’équilibre perturbé.
Nous avons dit qu’il s’agissait d’une légère surproduction couplée à un déficit de même ampleur, d’une part, parce que, en général, les disproportions ne peuvent être considérées comme des crises générales, celles dont justement le programme communiste et lui seul démontre le processus et l’inévitabilité, et que, d’autre part, l’analyse de son caractère particulier montre que sa gravité ne peut que relativement s’atténuer avec le développement de la production capitaliste.
Si nous donnons une appréciation mathématique du déficit ou de la surproduction qui lui correspond, ce qui permet de les détacher de l’exemple particulier de Rosa Luxemburg nous obtenons alors le résultat suivant :
Prenons un taux d’accumulation et une composition organique égaux dans les deux secteurs, ce qui correspond en fin de compte aux hypothèses de Marx dans son dernier schéma (et aussi le schéma appelé « schéma a » - cf. chapitre 4 -).
Si nous notons « n » la composition organique et « d » l’accroissement de la composition organique (par exemple si la composition organique passe de 5 à 6, « n » vaut 5 et « d » vaut 1), le déficit de moyens de production comme excédent de moyens de consommation qui lui fait face est égal à la différence entre la plus-value potentiellement accumulée en capital constant sur la base de l’ancienne composition organique (soit pl’n / n+1 où pl’ est la part accumulé de la plus-value totale), et la plus-value réellement accumulée sous la forme de capital constant avec une composition organique en hausse soit pl’(n+d) / (n+d+1).
Le déficit est égal à :
[pl’ n /n +1] – [pl’ (n+d) / (n + d + 1)]
soit après simplification
pl’ d / (n+1) (n + d + 1 )
Par conséquent, plus la composition organique est élevée, donc plus la production capitaliste se développe, et moins cette disproportion, à supposer qu’elle se manifeste, aura d’incidence sur les fondements de la production capitaliste. Par contre, cette disproportion sera d’autant plus importante que la variation de la composition organique sera importante ; ce qui est logique puisque plus l’accroissement est rapide, brusque, plus il est susceptible de créer une perturbation d’autant plus importante.
Nous avons vu que la disproportion évoquée avait donc une gravité relative qui ne peut aller qu’en s’atténuant et que, comme toutes les disproportions, le libre mouvement des capitaux favorisait sa résorption. Par ailleurs, la production capitaliste connaît une certaine « plasticité ». Certains éléments matériels, certaines valeurs d’usage peuvent passer facilement de la consommation productive à la consommation individuelle. Des bâtiments, par exemple, peuvent facilement servir de support à une activité productive comme à l’habitat. Rien ne ressemble plus à une voiture particulière qu’une voiture de société. Les fruits, les légumes sont destinés soit à la consommation individuelle soit à devenir des matières premières et donc faire partie du capital constant de l’industrie agro-alimentaire notamment, indépendamment d’autres usages dans la chimie ou la parachimie. Si donc le passage de la consommation productive à la consommation individuelle est possible pour nombre de valeurs d’usage, il est encore plus aisé de déplacer le capital constant destiné au secteur II vers le secteur I et vice-versa. Nombre de machines outils usineront indifféremment des valeurs d’usage destinées à la consommation productive comme à la consommation individuelle. L’énergie électrique sera utilisée aussi bien par un secteur que par l’autre tout comme elle sera consommée individuellement. En d’autres termes, il existe d’une part des valeurs d’usage qui peuvent être utilisées aussi bien comme moyen de consommation destiné à satisfaire des besoins individuels que comme moyens de production. D’autre part, le capital constant destiné à l’une ou l’autre sphère de la production peut être, dans une certaine mesure reconverti d’une section à l’autre. Ces deux aspects qui confèrent à la production capitaliste une certaine « plasticité » favorisent les transferts de capitaux d’une section à l’autre et donc contribuent à la résolution de déséquilibres éventuels.
Outre cette plasticité, la production capitaliste est douée d’élasticité. Si les schémas définissent et doivent définir des relations rigides, à base d’égalités mathématiques, entre les diverses sections de la production sociale, ils ne prétendent pas pour autant donner une image complète de l’accumulation capitaliste. Par exemple, le capital fixe n’est pas augmenté proportionnellement à la durée du travail si celle-ci est allongée ; seules les dépenses en salaire et en matières premières le seront. Dans un secteur comme l’industrie extractive où les matières premières n’entrent pas dans le capital avancé puisque le procès de travail a pour objet le fruit de la nature (charbon, minéraux divers, etc.), le produit qui se développe proportionnellement au temps passé à la production ne nécessite pas pour autant des avances de capital en relation avec l’augmentation de la production.
« Nous arrivons donc à ce résultat général, qu’en s’incorporant la force de travail et la terre, ces deux sources primitives de la richesse, le capital acquiert une puissance d’expansion qui lui permet d’augmenter ses éléments d’accumulation au delà des limites apparemment fixées par sa propre grandeur, c’est-à-dire par la valeur et la masse de moyens de production déjà produits dans lesquels il existe »
(Marx, Capital, L.I, La Pléiade, T.1, P.1110)
Ces facteurs, et d’autres liés au progrès de la productivité du travail, favorisent donc le mouvement saccadé de la production capitaliste, l’accélération de l’accumulation, la tension des forces productives. Ils sont donc des facteurs qui peuvent concourir à la solution de notre problème, pour autant qu’il existe, en facilitant l’accroissement de la production dans le secteur I.
Un autre phénomène doit être évoqué. La production capitaliste n’existe pas sans stocks. Leur existence permet de réguler la production et de permettre les ajustements en fonction de l’accélération et du ralentissement de la production. A travers eux, donc, d’éventuelles disproportions dues à l’évolution de la composition organique trouveraient leur solution, tandis que l’existence de ces stocks constitue elle-même la source de disproportions et de spéculations inévitables sur la base de l’anarchie propre à ce mode de production.
« La forme capitaliste de la reproduction une fois abolie, on se trouve simplement devant le problème du volume de la partie du capital fixe qui dépérit et doit donc être remplacé en nature (le capital servant, dans notre exemple, à la création de produits de consommation). Or, ce volume change d’année en année. S’il est très grand une certaine année (supérieur à la mortalité moyenne, comme pour les hommes), il sera à coup sûr d’autant plus faible l’année suivante. La masse de matières premières, de produits semi-finis et de matériaux auxiliaires, nécessaires pour la production annuelle des articles de consommation – toute choses restant égales d’ailleurs – ne diminue pas pour autant. La production globale des moyens de production devrait donc augmenter dans un cas et diminuer dans l’autre. Le seul remède sera une surproduction relative continuelle ; d’une part, une certaine quantité de capital fixe produisant au delà de ce qui est directement nécessaire ; d’autre part, et surtout, un stock de matières premières, etc., dépassant les besoins annuels immédiats (cela vaut surtout pour les moyens de subsistance). Cette sorte de surproduction implique le contrôle, par la société, des moyens matériels de sa propre reproduction. Mais au sein de la société capitaliste, elle constitue un élément d’anarchie. »
(Marx, Capital, L.II, La Pléiade, T.2, P.802)
15.4 Henryk Grossmann bouleverse la disproportion
Il était, bien entendu, dévolu à Henryk Grossmann de commettre un article sans aucun rapport avec le problème. Grossmann est un peu le Ravel de l’économie marxiste vulgaire. Là où avec une idée on écrit un paragraphe, Grossmann écrit un livre, c’est dire que le thème est repris sur tous les tons et tous les instruments de l’art épistolaire sont mobilisés pour qu’il puisse jouer la même partition et ses variantes. Examinons le boléro de la médiocrité du Docteur Grossmann.
L’essentiel de son argumentation consiste à affirmer que les schémas de reproduction où les marchandises sont supposées vendues à leur valeur ne sont qu’une étape dans le « processus d’approximations successives » qui conduit des déterminations les plus abstraites aux représentations du monde concret. En l’occurrence, en en restant au niveau du schéma valeur, Rosa Luxemburg n’aurait rien démontré, du point de vue d’une éventuelle disproportion, puisque dans la réalité les marchandises ne se vendent pas selon leur valeur mais leur prix de production qui s’établit sous l’influence de l’égalisation du taux de profit entre les différentes branches de la production capitaliste.
« Quelle force de démonstration ont, pour la réalité, les conclusions de Rosa Luxemburg – la démonstration d’un excédent invendable de biens de consommation – que nous obtenons à partir d’un schéma dans lequel on ne prend en compte aucune valeur réelle ? Du moment que, étant donné la concurrence, la transformation des valeurs en prix et, par conséquent, une nouvelle division de la plus-value entre les diverses branches de la production industrielle qui provoque nécessairement un changement dans les relations de proportionnalité déjà existantes entre les sphères individuelles du schéma, il est tout à fait possible et vraisemblable que le « résidu de consommation » qui se trouvait jusqu’à présent dans le schéma valeur disparaisse alors, dans le schéma prix de production et vice-versa, qu’un équilibre original du schéma valeur se transforme postérieurement, à l’intérieur du schéma prix de production en une disproportion. » (Henryk Grossmann, Die Wert-Preis-Transformation bei Marx und das Krisenproblem)
Derrière la tête de Grossmann, il y a l’exemple de deux secteurs de la production capitaliste où la production entre le secteur I des moyens de production et le secteur II des moyens de consommation se répartirait ainsi :
I : 4 000 c + 1 000 v + 1 000 pl = 6 000
II : 2 000 c + 1 000 v + 1 000 pl = 4 000
Dans le secteur “I” le taux de profit est de 20% et, dans le secteur “II”, il s’élève à 33%. Au sein de la société le taux de profit général est de 25%. Si, au sein de chaque branche, il se forme un taux de profit moyen de 25%, une partie de la plus-value sera transférée de la section « II » vers le secteur « I ». L’espoir secret de Grossmann est que, par la même occasion, l’excédent de plus-value dans le secteur « II » disparaisse tandis que le supplément de plus-value dans le secteur « I » serait suffisant pour régler le problème symétrique du déficit de moyens de production.
De ce que nous avons pu voir sur les disproportions et leur nature, il est facile de montrer que les propos de Grossmann sont totalement dénués de fondement et étrangers au problème qui est posé, « problème » dont nous avons d’ailleurs longuement circonscrit les limites.
A partir d’une « situation d’équilibre », si l’on nous permet d’employer cette expression étrangère à la théorie communiste, que les marchandises soient vendues à leur valeur ou à leur prix de production peu importe, il n’est guère difficile de reproduire la disproportion qu’évoque Rosa Luxemburg puisque, nous l’avons vu, il suffit de supposer une accumulation de la plus-value avec une composition organique s’élevant plus rapidement que ce que la répartition sociale entre moyens de production et moyens de consommation autoriserait. Que les marchandises soient vendues à leur valeur ou à leur prix de production ne change rien et n’a rien à voir avec l’affaire. L’argumentation de Grossmann démontre une fois de plus sa superficialité sous couvert d’érudition.
16. La théorie des crises de Fritz Sternberg
16.1 Fritz Sternberg, épigone de Rosa Luxemburg
Rosa Luxemburg a fait des émules. Parmi ceux-ci, il faut citer, en bonne place, Fritz Sternberg. Ce professeur d'économie politique, né en 1895, jouera un rôle notable dans le SAPD [84] où il fait figure de théoricien d'un parti réformiste. A partir de 1933, il émigre aux Etats-Unis où il résidera jusqu'à la chute d'Hitler.
Sternberg affirme se placer résolument dans la lignée luxemburgiste:
"Le problème de la relation entre la reproduction élargie et l'irruption dans un espace non-capitaliste a été découvert méthodologiquement par Rosa Luxemburg. Notre position par rapport à ce livre, qui est de la plus extrême importance pour le développement ultérieur du marxisme, est la suivante. Nous considérons comme correcte et fondée sa critique des schémas marxistes sur tous les points fondamentaux. Nous sommes, comme elle, d'avis que l'impérialisme, c'est-à-dire l'avance du capitalisme sur des territoires non-capitalistes, est une nécessité immanente, puisque le capitalisme – si non seulement il est la forme prédominante mais également la seule forme économique dominante – doit disparaître en peu de temps."
(Sternberg P.62 L'impérialisme)
En fait, l'ensemble des restrictions et des remarques critiques qu'il apporte à Rosa Luxemburg montre sa totale incompréhension des positions de cette dernière. Ce n'est pas un des moindres paradoxes du débat sur le livre de Rosa Luxemburg que de constater à quel point les propos de son auteur ont été peu compris. Adversaires mais aussi épigones ont la plupart du temps échangé des arguments qui rarement prenaient en compte les véritables préoccupations de Rosa Luxemburg.
Dans l'Allemagne de 1926, date de la publication de l'ouvrage de Sternberg, "L'impérialisme", le communisme ne s'est jamais relevé de l'échec de l'insurrection de 1918-19 où Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ont été assassinés. Le mouvement révolutionnaire restera écartelé entre le réformisme du KPD qui fusionne rapidement avec l'USPD (un parti "centriste") sous la direction d'une Internationale communiste toujours plus opportuniste, et le KAPD, qui développe en réaction à l'opportunisme des théories anarchisantes qui n'ont rien à voir avec le programme communiste. Par ailleurs le KAPD, ou ce qui en est à l'origine, après avoir été un bref moment majoritaire dans les rangs ouvriers, sombrera très rapidement dans une division groupusculaire. En 1926, alors que la contre-révolution marque ses derniers points décisifs, ce n'est pas dans les rangs de la social-démocratie, fût-elle de "gauche", rouge du sang prolétarien qu'elle avait tout particulièrement fait verser, que l'on peut envisager trouver la moindre explication sérieuse des crises de la production capitaliste.
Nous ne discuterons pas ici des positions de Sternberg, dénuées de toute orthodoxie révolutionnaire, sur les salaires et la surpopulation. Sternberg s'imagine en effet qu'avec le mode de production capitaliste, qui ne repose pas sur la violence ouverte pour s'approprier le surtravail du prolétariat, il est nécessaire d'engendrer une surpopulation à cette fin. Tandis que, pour Marx, l'existence d'une surpopulation plus ou moins importante entraîne une divergence entre le prix et la valeur de la force de travail mais, en aucun cas, n'est nécessaire pour justifier la création de surtravail. Nous nous limiterons à la théorie des crises de Sternberg. De ce point de vue, celui-ci appartient à cette lignée de l'économie politique qui s'efforce de réconcilier le programme communiste et la théorie économique bourgeoise.
16.2 Sternberg, luxemburgiste de bas étage
Sternberg part de là où nous avons laissé l'exposé de Rosa Luxemburg. Il reprend, en effet, en les théorisant bien au-delà des thèses de Rosa Luxemburg elle-même, les schémas du chapitre 25 de l'"accumulation du capital" où Rosa Luxemburg, en augmentant la composition organique du capital, fait apparaître un déficit de moyens de production dans la section I et un excédent de moyens de consommation dans la section II.
Le but de Rosa Luxemburg était de faire douter de l'universalité explicative des schémas, de montrer que les résultats auxquels étaient parvenus les théoriciens harmonicistes (et notamment Tugan-Baranovsky) quant à l'absence de crises si les proportions entre les deux secteurs étaient maintenus, n'avaient pas une base aussi solide que ceux-ci voulaient bien le dire. Les remarques critiques de Rosa Luxemburg par rapport aux schémas n'avaient pas d'autre but. Ce qui, somme toute, n'avait, chez Rosa Luxemburg, qu'un caractère accessoire, devient chez Sternberg la base d'un échafaudage théorique rococo diamétralement opposé au programme communiste.
Rosa Luxemburg s'était refusée à considérer que le chapitre 25 de son ouvrage contenait l'essentiel de sa réflexion théorique sur la réalisation de la plus-value et les obstacles rencontrés, selon elle, par le capital dans ce procès. De nombreux critiques, qui n'avaient guère compris son argumentation centrale, s'emparèrent du schéma sur la reproduction élargie avec accroissement de la composition organique pour gloser sans fin. Avec Sternberg, nous avons affaire à un épigone qui n'a pas plus compris que les critiques les propositions de Rosa Luxemburg mais qui, naïvement fasciné par l'arithmétique des schémas, voit là le nec plus ultra des "preuves" que la production capitaliste engendre des crises. Grisé par le mouvement mathématique des schémas, Sternberg s'imagine que Rosa Luxemburg a fourni au monde la preuve de la perspective de la crise du capitalisme. Encore que cette crise n'advient nécessairement que lorsque le mode de production capitaliste n'a plus la possibilité de réaliser les marchandises sur les marchés extra-capitalistes.
Dans la représentation de Sternberg cela implique une comparaison entre ce qu'il appelle le capitalisme "pur", en l'occurrence les schémas de Marx du livre II consacrés à la reproduction du capital, et l'époque de l'impérialisme où subsistent des territoires non-capitalistes. L'impérialisme est défini par Sternberg comme l'expansion du capitalisme vers les territoires non-capitalistes. Sternberg développe donc une argumentation, disons néo-luxemburgiste, qui est une extrapolation théorique à partir de points de vue secondaires traités par Rosa Luxemburg.
"Rosa Luxemburg a ici raison sur tous les plans, puisque les industries des moyens de production présentent une composition organique plus élevée que l'industrie des moyens de consommation, puisque, en conséquence de l'accumulation, c augmente plus rapidement que v dans le "capitalisme pur", où pour les deux groupes d'industrie il est supposé un même taux d'accumulation, un échange complet est impossible si bien qu'il reste dans le secteur II un excédent de moyens de consommation qui est fondamentalement invendable. Ce n'est pas un hasard, car cela résulte avec une nécessité mathématique des conditions du problème. »
(Sternberg, P.71, L'impérialisme)
Donc, pour Sternberg, ce qui a été démontré est que, dans le cadre du "capitalisme pur", pour un taux d'accumulation égal entre les deux sections et une élévation de la composition organique, on en arrive à un excédent de consommation invendable dans la section II et, pour Sternberg, aucun adversaire de Rosa Luxemburg n'est parvenu à critiquer cela de manière satisfaisante.
Nous avons longuement vu ci-dessus en quoi tout ce qui concernait le chapitre 25 ne pouvait être considéré comme le point de vue théorique de Rosa Luxemburg et de l'expression de ses doutes quant à la possibilité de la réalisation de la plus-value destinée à l'accumulation. Et même s'il en allait ainsi, le type de crise qui apparaît dans le cadre des schémas de reproduction est parfaitement connu, puisqu'il est le seul type de crises admis par les économistes prétendant que les crises générales ne peuvent affecter la production capitaliste. Nous avons vu que les disproportions étaient inhérentes à la production capitaliste, mais que, quelle que soit leur gravité, elles ne pouvaient servir d'explication aux crises catastrophiques qui affectent périodiquement la production capitaliste.
Nous ne reviendrons pas en détail sur les considérations critiques que l'on peut faire sur les disproportions et l'introduction de la hausse de la composition organique dans les schémas de reproduction de Marx : nous renvoyons le lecteur aux chapitres précédents. Si nous reprenons rapidement les arguments développés dans le dernier chapitre traitant des crises sachons que, outre le problème méthodologique fondamental qui fait que les crises sont du type disproportion, c'est-à-dire excédent de marchandises d'un côté contre sous production de marchandises d'un autre côté, la solution et le retour permanents de phénomènes de ce type sont inscrits dans le processus de l'accumulation capitaliste. D'une part, en engendrant une baisse des prix dans les branches en surproduction, liée à une hausse des prix dans les branches en sous-production, la production se réorientera pour s'adapter aux nouvelles données du marché; d'autre part la production capitaliste possède une certaine élasticité et une certaine "plasticité" tout comme elle connaît l'existence de stocks. Tous ces facteurs favorisent l'adaptation et, en même temps, concourent au développement anarchique de la production capitaliste et donc, tout en permettant de les résorber, ils favorisent l'apparition de nouvelles disproportions. Par conséquent, en défendant finalement un point de vue "disproportionnaliste", Sternberg est, sur ce point fondamental, fort éloigné de la théorie de Rosa Luxemburg.
N'ayant pas du tout la même vision des choses, il n'est guère surprenant que Sternberg en vienne à critiquer Rosa Luxemburg avec le même étonnement (caractéristique de ceux qui n'ont rien compris à son argumentation) que bon nombre d'adversaires déclarés. Poursuivant sa logique, Sternberg en vient donc à considérer que Rosa Luxemburg a eu tort quand elle affirmait que la totalité de la plus-value destinée à l'accumulation ne pouvait être réalisée à l'intérieur du mode de production capitaliste. Selon lui, conformément aux "démonstrations" fournies par les schémas avec hausse de la composition organique, ce n'est qu'une partie de la plus-value qui ne peut être réalisée au sein du "capitalisme pur". Par la même occasion c'est tout le sens de l'expansion impérialiste qui est modifié.
Chez Rosa Luxemburg, la classe capitaliste, prise comme un tout, se trouve dans l'incapacité de réaliser la plus-value destinée à l'accumulation puisqu'elle ne peut considérer, lorsqu'elle la réalise, la marchandise pour sa valeur d'usage (c'est le propre de l'acheteur). Comme la fonction de la classe capitaliste est l'accumulation du capital, ce n'est que dans la perspective d'une valeur d'échange extra, d'une plus-value, qu'elle peut envisager un tel achat ; c'est-à-dire qu'elle n'achète une marchandise que pour en tirer une valeur d'échange supplémentaire (A-M-A' argent marchandise argent'). Par contre, le procès de réalisation suppose un échange selon une autre logique (M-A marchandise argent). Cette contradiction ne peut être résolue que par la demande extra-capitaliste qui permet à la plus-value destinée à l'accumulation d'être réalisée. Une fois en possession de l'argent, la classe capitaliste peut alors se préparer à l'accumulation avec pour seule perspective la plus-value.
Du point de vue de Sternberg, la demande des zones extra-capitalistes a pour fonction d'écouler le solde invendable de la section II mais aussi de le transformer en une offre de moyens de production pour la section I qui est déficitaire (le montant du déficit de la section I correspond à l'excédent de la section II). L'"expansion impérialiste"n'a pas pour fonction de réaliser la plus-value mais de résorber la disproportion en modifiant la composition de la production. Les marchés extra-capitalistes achètent des produits de la section II (moyens de consommation) et fournissent des marchandises relevant de la section I (moyens de production).
16.3 Sternberg sur son échafaudage
16.3.1 Sternberg et la sous-consommation
Pour être, dans les faits, un théoricien des crises reposant sur les disproportions, Sternberg se rattache cependant à la tradition intellectuelle sous-consommationniste. Nous avons vu que l'économie politique se divisait en deux tendances par rapport à l'explication des crises.
Le "marxisme", si on entend par là les idéologies qui se sont développées autour du nom de Karl Marx afin de mieux mystifier le prolétariat, s'est lui même divisé en ces deux tendances également éloignées du programme communiste.
Pour ce qui est des commentaires sur les fameux schémas élaborés par Rosa Luxemburg, nous avons déjà eu l'occasion de souligner à propos d'Ernest Mandel et de la production d'armement comment on aboutissait à un enchevêtrement inextricable d'arguments relevant aussi bien d'une école que de l'autre ; le tout dans la plus grande confusion conceptuelle et intellectuelle.
En se ralliant à la théorie sous-consommationniste, Sternberg développe toute une argumentation parfaitement vulgaire. Les difficultés supposées pour réaliser la plus-value sont compensées soit par la hausse des salaires (comme si la tendance du capital n'était pas de les abaisser ; ce qui n'exclut pas, et c'est le grain de vérité des conceptions sous-consommationnistes, la nécessité d'une classe moyenne dont la fonction est de consommer une partie croissante de la plus-value afin de favoriser la stabilité de la production capitaliste) soit au travers de l'augmentation de la population (thèse archi-vulgaire qui fait dépendre l'accumulation de l'accroissement de la population et non l'inverse). Viennent ensuite les arguments qui reposent sur la possibilité de trouver un exutoire, c'est-à-dire le commerce extérieur, qu'il se fasse avec les nations capitalistes ou avec les formes de production pré-capitalistes.
Comme Sternberg croit avoir trouvé avec les disproportions liées à la hausse de la composition organique la pierre philosophale qui fonde sa conception sous-consommationniste des crises, puisque c'est à cette tradition que se rattache sa vue d'ensemble, il reste conscient que, vu comme un tout, le commerce extérieur entre les nations capitalistes (pour autant que l'on considère qu'elle soient complètement capitalistes) ne change rien à l'affaire. Il arrive à la pensée de Sternberg ce qui arrive à toute pensée quand elle suit sa logique. Comme les bases en sont erronées et étrangères à toute perspective révolutionnaire, Sternberg élabore sur d'aussi faibles fondations un échafaudage théorique d'autant plus ridicule qu'il lui faut à toute force intégrer les faits qui à la fois lui échappent et à la fois sont remodelés et produits pour être intégrés dans sa théorie générale.
16.3.2 Sternberg et le commerce extérieur
Par exemple, Sternberg constate que le commerce extérieur se fait principalement entre les grandes nations capitalistes. Comme du point de vue du capital total un tel commerce extérieur n'offre aucune solution à la crise, Sternberg affirme alors qu'il permet de servir de relais pour les pays qui n'ont pas de colonies. Par exemple, l'Allemagne, moins avantagée (nous sommes en 1926) que l'Angleterre ou la France, réalise par son commerce extérieur avec ces pays des échanges qui vont impliquer, pour les puissances coloniales les plus fortes, des échanges accrus avec leurs colonies. Sous cet angle, elles servent de relais à des Etats capitalistes qui ne contrôlent pas directement autant de débouchés extra-capitalistes.
"En relation à notre problème on peut seulement dire que le commerce extérieur avec tous ces pays plus ou moins capitalistes peut influer dans le sens que nous avons ébauché, c'est-à-dire pour rendre possible dans un pays capitaliste particulier la reproduction élargie qui n'est possible que dans le capitalisme "pur", la possession de territoires non capitalistes propres n'est pas nécessaire car le commerce extérieur avec une série d'Etat qui se trouvent dans différents stades de développement capitaliste rend possible la reproduction sans crises catastrophiques. La lutte contre les crises qui deviennent toujours plus violentes, l'affaiblissement de celles qui éclatent en toute occasion, ne se limite pas pour elles aux pays qui ont de grandes possessions coloniales propres ou un grand espace non capitaliste interne. L'affaiblissement des crises ne se limite pas à l'Angleterre, la France ou la Russie, mais comprend également le pays qui sans posséder un grand espace non capitaliste interne dispose seulement dans une faible proportion de territoires non capitalistes propres c'est-à-dire de colonies: l'Allemagne.
(L'impérialisme Sternberg P. 119-120)"
Avec cette théorie, mais Sternberg se garde bien d'une telle conclusion, il devrait conclure que, du moins sur le plan global, et hormis la part des échanges qui correspond selon lui à un échange de produits différents entre les pays capitalistes développés, la structure des échanges devrait être du même type qu'entre les pays coloniaux et les pays capitalistes c'est-à-dire un échange de moyens de consommation contre des moyens de production.
D'un autre côté, avons nous dit, on reconstruit l'histoire. Pour Sternberg, l'impérialisme est cette phase historique où le capital se tourne vers les marchés extérieurs extra-capitalistes après avoir entamé les marchés pré-capitalistes nationaux. L'histoire du MPC n'est plus celle de l'évolution du procès de production avec le passage de la phase de soumission formelle du travail au capital à la phase de soumission réelle du travail au capital mais celle, reconstruite dans la logique théorique de Sternberg, de la course aux débouchés extérieurs du mode de production capitaliste. Qu'à l'occasion il en vienne à critiquer les théories monopolistes, parfois même avec des arguments qui peuvent retenir l'attention comme quand il montre que les pays capitalistes les plus développés n'étaient pas nécessairement les pays capitalistes les plus monopolisés et que la guerre a eu un grand rôle dans cette centralisation, ne doit pas faire oublier que les deux types d'argumentation sont aux antipodes du programme communiste.
De ce point de vue, nous retrouvons parfaitement la logique de type luxemburgiste dont le C.C.I. est le dépositaire moderne et dégénéré. Ce qui pouvait se soutenir en 1926, tout en étant déjà un reniement du programme communiste, devient grotesque en 1989. Outre la vulgarité de la méthode qui consiste à opposer l'épuisement interne des marchés pré-capitalistes à la recherche de territoires extra-capitalistes, l'inanité du raisonnement théorique conduit ceux qui l'utilisent à des explications toujours plus fantaisistes du cours du mode de production capitaliste. Pour Sternberg (et le raisonnement du C.C.I. est de la même veine) l'impérialisme, c'est-à-dire l'intervention des Etats capitalistes au sein des territoires extra-capitalistes, conduit à des guerres impérialistes. Si, dans l'époque antérieure (avant 1914), le capitalisme était démocratique il devient militariste et si, dans la guerre, prédominaient déjà les facteurs impérialistes ils ne peuvent que s'accentuer avec la prochaine puisque, avec l'extension de "l'espace sociologique"du capitalisme, les formes de production pré-capitalistes sont détruites et chaque pas dans la direction du "capitalisme pur" conduit vers la guerre impérialiste avec une nécessité mathématique.
16.3.3 Sternberg contre Marx
Là où Sternberg est plus conséquent et moins menteur que le C.C.I. c'est quand il affirme que toutes ces théories tournent le dos à Marx et que le développement réel du capitalisme infirme les prévisions de Marx et Engels.
Reprenant à son compte les évaluations de la social-démocratie sur l'atténuation des crises à la fin du XIXème siècle, Sternberg se contente de répliquer que c'est l'expansion impérialiste qui a permis, en obtenant les débouchés nécessaires à l'accumulation, cet état de fait (tout comme la hausse du salaire réel). Mais, avec la disparition progressive des débouchés, le capitalisme n'a d'autres perspectives que la guerre impérialiste et entre dans une phase de décadence.
Pour le programme communiste, le cours du mode de production capitaliste est un cours catastrophique, c'est-à-dire que régulièrement le développement de l'accumulation capitaliste se traduit par des crises générales de surproduction qui dévastent la société comme le ferait une catastrophe naturelle ; avec cette différence que les causes de ces catastrophes sont sociales et spécifiques de la seule production capitaliste. Si ce même programme communiste démontre que les crises du mode de production capitaliste ont tendance à s'aggraver, cette conception ne saurait être isolée de l'histoire réelle. Il ne faut pas, en effet, confondre la théorie générale et l'évaluation d'une période historique donnée.
Le cadre historique général, et au sein de celui-ci de nombreuses précisions seraient nécessaires, laisse apparaître que depuis 1847, période à partir de laquelle les crises décennales sont parfaitement identifiées, on peut distinguer quatre grandes périodes. Celle qui va jusqu'en 1880 environ et où le cycle décennal apparaît avec netteté, puis la période qui va jusqu'à la première guerre mondiale. Dans cette phase le marché mondial s'élargit et l'Angleterre voit émerger des concurrents qui lui disputent la suprématie sur le marché mondial. Après une phase de stagnation de la production en Angleterre, la croissance économique se relève et un cycle de 8-10 ans environ se dessine. Les théories social-démocrates sur le développement pacifique du capitalisme, sur l'atténuation des contradictions entre le capital et le travail et la possibilité de dompter le monstre capitaliste en s'emparant par la voie démocratique de l'Etat bourgeois s'effondrent en même temps que la Seconde Internationale alors que se déchaîne la première guerre mondiale. L'entre-deux-guerres est marqué par la plus grande crise économique de l'histoire du mode de production capitaliste (encore que l'étendue de la dévalorisation des crises de 1975 ou 1981 par exemple dépassent en valeur mais non par leur profondeur celle de 1929 ; par ailleurs la crise de 1987 constitue la plus grande crise financière de l'histoire) et l'issue n'en sera trouvée qu'avec la seconde guerre mondiale et ses 60 millions de morts. Après la seconde guerre mondiale, une des plus prospères et des plus rapides phases d'accumulation se met en place (la croissance est si forte que le taux de croissance moyen au XXème siècle est plus élevé qu'au XIXème bien que la période d'entre deux-guerres ait été marqué par une relative stagnation dans le progrès des forces productives) tandis que la durée du cycle est d'environ 6 ans. Les crises, au début de cette période, sont suffisamment faibles pour que la bourgeoisie, après avoir parachevé la contre-révolution sur le prolétariat, puisse croire pouvoir également s'affranchir des lois qui régissent la production capitaliste. Elle s'en va répétant que désormais, grâce à l'intervention de l'Etat, les crises disparaissent, si bien que nous n'avons plus en face de nous que des "récessions", c'est-à-dire un ralentissement de l'activité économique et non un recul marqué de celle-ci comme pour une crise. Le retour à des crises de plus grande ampleur, loin de faire changer le vocabulaire hypocrite des représentants du capital a eu pour conséquence, et cela arrive régulièrement quand on tente de changer les choses en changeant leur nom, que récession soit devenu synonyme de crise (il n'en est pas pour autant – sauf peut-être pour le C.C.I. – un concept conséquent du point de vue scientifique).
Les faits sont têtus. Lénine aimait répéter ce proverbe anglais, et la réalité se venge toujours des singeries bourgeoises et des économistes, cette catégorie d'idéologues particulièrement dégénérée.
Seul le parti communiste au sens historique du terme restera, durant cette période, fidèle à l'idée qu'à la relative prospérité reposant sur une exploitation inouïe du prolétariat, prospérité entrecoupée de féroces guerres coloniales et de crises de faible ampleur, succéderaient des crises plus graves qui viendraient ébranler la citadelle capitaliste et pousseraient le prolétariat à reprendre le chemin de la lutte révolutionnaire. Ce n'est un paradoxe que pour les imbéciles que de constater que si les dernières années ont vu la défaite du "marxisme", elles ont en même temps toujours plus confirmé la victoire théorique du parti communiste et de son programme : le programme de la société sans classes, sans Etat et sans argent, le programme de la dictature révolutionnaire du prolétariat.
Replacée dans un contexte historique la perspective communiste des crises s'impose d'elle même et 150 ans d'histoire du capitalisme moderne, depuis que la phase de soumission réelle du travail au capital s'est affirmée, ont bien montré l'existence de crises générales de surproduction et leur tendance à s'aggraver avec le développement de l'accumulation capitaliste. Nul besoin de mettre sur le compte des marchés extérieurs, comme le fait Sternberg, la prospérité relative du mode de production capitaliste à certaines époques ni l'existence de certains faits qui, paraît-il, tournent le dos aux théories de Karl Marx. Si nous voulons bien admettre que l'expansion coloniale ait eu un rôle dans la croissance de la production capitaliste à la fin du XIXème siècle, nous reconnaissons également que la perte des colonies en a eu un autre dans les progrès de l'accumulation dans la deuxième moitié du XXème siècle. Et dans un cas comme dans l'autre, l'idée mécaniste que des débouchés extérieurs aient été l'exutoire nécessaire pour réaliser une fraction de la plus-value est vide de sens. Elle l'est d'autant plus (c'est aujourd'hui le principal problème du C.C.I. qui se livre à des acrobaties théoriques du plus haut comique pour le résoudre) que, dans la deuxième moitié du XXème siècle, ces débouchés extérieurs sont censés s'être réduits comme un peau de chagrin[85].
Quelle que soit l'incidence des formes de production antérieures, le capital soumet toujours plus la société à ses lois. En détruisant ces formes de production, en devenant toujours plus "pur", non seulement le capital n'entre pas en décadence mais il réalise son être. Ce processus est en fait caractéristique de la phase de soumission réelle du capital où, tandis qu'il s'appuyait sur les anciennes formes de production pour prendre son essor dans la phase de soumission formelle du travail au capital, désormais le capital s'émancipe de cette base limitée.
Sternberg ne s'arrête pas là dans sa remise en cause de Marx et du programme communiste. Répétons que, toutefois, il est beaucoup plus honnête que le C.C.I. quand il affirme que ses positions n'ont rien à voir avec Marx, tandis que le C.C.I. s'efforce de faire passer sa camelote frelatée pour un produit orthodoxe et révolutionnaire. Trente ans plus tard, dans son ouvrage "le conflit du siècle", si Sternberg n'évoque guère sa théorie de la surproduction à base de disproportion due à la hausse de la composition organique, il reste cependant fidèle à sa conception sous-consommationniste et néo-luxemburgiste. En devenant toujours plus social-démocrates, en s'éloignant toujours plus du communisme, les positions de Sternberg ressemblent curieusement toujours plus à celles du C.C.I. auquel il sert (a servi?) de référence grâce à une collection de statistiques datant des années... 1950 pour fonder la décadence dans les années 1980.
Donc, non seulement Sternberg affirme que l'existence de marchés extérieurs a pu permettre un cours historique allant à l'encontre des prévisions de Marx quant à la tendance à l'aggravation des crises, mais, de plus, ces marchés extérieurs, de par leur importance dans le processus d'accumulation tout comme leur effet variable suivant les moments, réduisent à néant toute possibilité et théorie du cycle mais, également, ils auraient permis d'augmenter les salaires réels de la classe ouvrière, d'accroître les classes moyennes, de limiter la disparition de la paysannerie et donc d'offrir au capital un rempart social face à la révolution prolétarienne. De plus, pour Sternberg, la disparition de ces marchés extra-capitalistes, loin de signifier la réalisation des lois du capital comme le montre la théorie révolutionnaire, plongerait le mode de production capitaliste dans une phase de décadence où l'évolution de l'accumulation ne suivrait pas une ligne entrecoupée de ruptures profondes comme le voudrait la théorie de Marx, mais une courbe descendante où les crises (ou la crise) deviendraient quasiment permanentes. Sternberg en déduit des conséquences politiques logiques avec son point de vue. Le capitalisme allant de crise en guerre la socialisation des forces productives nécessaires pour que le socialisme soit possible risquent de s'évanouir. [86]
"Selon Marx chaque jour qui passe dans le capitalisme accroît la concentration des entreprises ; de ce fait, les conditions pour le mode de production capitaliste deviennent toujours plus favorables. Les procès de socialisation des moyens de production avance quotidiennement. (...) La possibilité de la révolution socialiste est tous les jours plus forte, gagne tous les jours en vraisemblance pour autant qu'elle dépend de la maturation des conditions objectives, de la socialisation. (...) La première guerre mondiale ne mit pas fin à la tendance à la maturation de la socialisation du capitalisme (...) Mais en aucune manière il ne doit toujours en être ainsi, au contraire, avec le développement des moyens techniques auxiliaires toujours plus importants il est possible qu'avec les nouvelles guerres impérialistes la destruction de capital prenne des dimensions colossales. Par conséquent, la ligne simple et directe du développement capitaliste que Marx a vue n'est pas suffisante.(...) Marx n'a vu qu'un aspect (...) En conséquence en opposition à la perspective de Marx sont possibles deux directions.(...) la série des guerres impérialistes (...) peut élever les états impérialistes actifs à la catégorie de Rome à travers les destructions et empêcher ainsi que les forces productives atteignent leur maturité, que la transition vers le socialisme se produise en tant que conséquence naturelle. (...) Selon Marx le danger pour une révolution socialiste était seulement qu'elle se produise trop tôt, qu'elle arrive avant que les forces productives soient suffisamment développées (...). Ceci est une erreur qui peut avoir les plus funestes conséquences : la révolution peut arriver trop tard."
(Sternberg. L'impérialisme P. 237, 238, 239, 240)
Voilà bien la logique fataliste dont l'envers dialectique est le volontarisme. Si, pour le C.C.I., la révolution est impossible dans la phase d'ascendance du capitalisme, elle risque d'arriver trop tard (en 1926) pour un Sternberg. Avant la décadence, les conditions objectives n'étaient pas réunies ; après la décadence, elles ne le sont plus. La révolution n'a été possible qu'un (grand) soir, mais, ce soir là, les "révolutionnaires décadencistes" dormaient et, c'est ainsi qu'est passée la locomotive de l'histoire dont il ne reste plus qu'à évoquer le sifflet ou le jet de vapeur au café du commerce.
Tous ces enfantillages reposent sur l'ignorance la plus crasse du communisme révolutionnaire. Nous reviendrons ailleurs sur la dialectique entre les forces productives et les rapports de production. Que cela ne nous empêche pas de remettre en mémoire du lecteur un extrait du travail de notre parti:
"Marx n’a pas envisagé une montée du capitalisme suivie d’un déclin, mais au contraire une exaltation simultanée et dialectique de la masse des forces productives contrôlées par le capitalisme, de leur accumulation et concentration illimitées, et en même temps de la réaction antagonique des forces dominées, représentée par la classe prolétarienne. Le potentiel productif et économique général continue à croître jusqu’à ce que l’équilibre se rompe: on a alors une phase révolutionnaire explosive, une chute brutale et de courte durée où les anciennes formes de production sont brisées et où les forces productives retombent, pour se réorganiser ensuite et reprendre une ascension plus puissante.
Dans le langage de la géométrie la différence entre les conceptions (…) s’exprime ainsi: la première courbe ou courbe des opportunistes (révisionnistes du type Bernstein, staliniens partisans de l’émulation, intellectuels «révolutionnaires» pseudo-marxistes), est une courbe continue qui «admet une tangente» en chacun de ses points, c’est-à-dire pratiquement qui procède par variations imperceptibles d’intensité et de direction.
La deuxième courbe avec laquelle nous avons voulu donner une image simplifiée de la «théorie des catastrophes» si décriée, présente à chaque époque des points qui en géométrie s’appellent des «sommets» ou des «points singuliers». En ces points la continuité géométrique, et donc la gradualité historique disparaît; la courbe «n’a pas de tangente», ou encore elle «admet toutes les tangentes» - comme lors de la semaine que Lénine ne voulait pas laisser passer.
Il est à peine besoin de noter que le sens général ascendant de la courbe ne prétend pas se rattacher à des visions idéalistes sur le progrès indéfini de l’humanité, mais à une donnée historique: l’accroissement continu et gigantesque de la masse matérielle des forces productives dans la succession des grandes crises historiques révolutionnaires." (Théorie et action dans la doctrine marxiste,1951)
Quant à la hausse des salaires ou la croissance des classes moyennes voilà autant de faits prévus par Marx qui voit dans l'augmentation de la productivité et de l'intensité du travail, dans le cadre de la phase de soumission réelle du travail au capital, la base matérielle pour, d'une part, augmenter le salaire réel et, d'autre part, assurer le développement d'une classe improductive dont la fonction économique politique et sociale est de permettre une plus grande stabilité de la production capitaliste. Ces éléments n'empêchent pas la théorie révolutionnaire de démontrer qu'avec le développement du capital croît également son ennemi mortel le prolétariat qui devient la force prépondérante voire majoritaire (aussi bien relativement qu'absolument) dans la société et dont la condition relative, empire en regard de la richesse accumulée sous forme de capital tandis que le procès d'accumulation accroît toujours plus l'insécurité de son travail pour le jeter dans la rue lors des grandes crises de surproduction qui affectent périodiquement la production capitaliste.
En conclusion, nous pouvons considérer en avoir terminé avec la critique de Sternberg, dont la théorie ne possède aucun intérêt pour la théorie communiste des crises ni d'ailleurs pour la théorie communiste en général. Nous reviendrons sur la théorie luxemburgiste avec l'étude des positions des fractions belges et italiennes de la gauche communiste au cours des années 1930.
17. Les théories des crises de Grossmann Mattick et le programme communiste
17.1 Le "milieu révolutionnaire"et Grossmann
Le XXIème siècle qui approche verra l'émancipation du prolétariat. Le petit-bourgeois démocrate ne peut que se moquer d'une telle prévision, et ce n'est pas l'état actuel du mouvement communiste qui pourrait lui faire rengorger son rire. Bien au contraire, il ne pourrait que l'amplifier.
Les sectes qui s'y agitent ressemblent à des roquets jappant après le Jaggernaut capitaliste. Bâtard de Yorkshire et de Chiwawa (le BIPR) ou Basset mâtiné de Canichon (le C.C.I.), les roquets les plus arrogants, qui se croient les chefs de la meute, se figurent que leurs jappements ont l'écho du tonnerre. Comme ils ne sont pas en reste pour renifler la piste de l'opportunisme, ils s'en vont l'un et l'autre, se flairant le cul et se cherchant des poux.
Leur querelle est d'une rare inanité. Par exemple, si nous en venons au sujet qui nous occupe, les racines des crises qui secouent périodiquement le mode de production capitaliste, le C.C.I. considère que l'origine des crises provient de l'absence toujours plus marquée de débouchés extra-capitalistes empêchant la réalisation de la plus-value et précipitant le mode de production capitaliste dans une phase de décadence dont, d'après les dernières innovations théoriques, nous vivrions l'ultime étape, celle de sa décomposition.
Quand ses adversaires fondent la "décadence du capitalisme" sur la théorie de la baisse du taux de profit de Grossmann-Mattick, il objecte que comme sur le plan politique Mattick a tort il ne peut avoir raison sur le plan économique. S'il y a un fond de vérité dans une telle argumentation, il ne dispense pas d'un effort scientifique pour réfuter les arguments de l'adversaire.
Il faut dire que le C.C.I. est coutumier du fait. Il suffit de lire la critique de Pannekoek faite par ses ancêtres d'Internationalisme. Dans cet article, censé argumenter contre la critique des fondements "philosophiques" du léninisme faite par Pannekoek, pas une ligne n'est consacrée au sujet. Le seul argument est de dire que Pannekoek a tort sur l'analyse de la révolution russe et donc qu'il a tort sur le plan "philosophique". Comme le C.C.I. n'en est pas à une contradiction près, il reprend pourtant volontiers à son compte des conceptions développées par Rosa Luxemburg ou par le social-démocrate Sternberg tout en jugeant erronées nombre de leurs positions politiques.
Le BIPR, tout aussi idéaliste, pense que bien qu'il soit en désaccord avec l'analyse politique de Mattick et a fortiori de Grossmann il est correct de reprendre à son compte leurs théories "économiques"et de conclure que de ce fait il est faux de relier les fondements théoriques avec les positions politiques.
Comme à notre habitude nous montrerons que si les théories qui fondent les conclusions politiques sont fausses il n'y a guère a se poser de question sur leur validité. De ce point de vue, la querelle entre le C.C.I. et le BIPR a une évidente solution : les fondements économiques de leurs positions politiques constituent une négation du socialisme scientifique et les conceptions politiques qui découlent de tels fondements tournent également le dos au communisme révolutionnaire.
Tout comme nous avons démontré que les théories économiques de Rosa Luxemburg s'éloignent suffisamment de la théorie de Marx pour réduire à néant les prétentions du C.C.I. à vouloir fonder sur elles une quelconque politique révolutionnaire, nous démontrerons qu'il en va de même pour les théories de Grossmann-Mattick sur lesquelles reposent l'édifice branlant de Battaglia-C.W.O. (BIPR).
Si, pour le C.C.I., la frontière qui marque le passage du capitalisme de sa phase ascendante à sa phase de décadence est somme toute bien définie – c'est au moment où les marchés extra-capitalistes sont tellement étiolés qu'ils ne jouent plus un rôle quantitativement suffisant pour réaliser la plus-value – il est beaucoup plus difficile de trouver une telle frontière dans les explications du BIPR. À ce niveau, il faut également distinguer les positions de Battaglia et de la C.W.O. quelles que soient leurs convergences récentes. Cela provient de ce que le BIPR tente de s'appuyer sur Marx et Engels pour fonder ses théories. Nous reviendrons plus en détail sur les conceptions développées par le BIPR. Auparavant, nous discuterons de l'interprétation qui semble commune aux divers partenaires du BIPR puisque la C.W.O. comme Battaglia ont récemment republié un texte de Mattick qui, lui-même, reprenait à son compte la théorie de Grossmann.
Entre autres absurdités nous trouvons sous la plume de Mattick l'affirmation que "la formulation de la théorie de la suraccumulation présentée ici, a été examinée pour la première fois par Henryk Grossmann qui considérait son travail comme une reconstruction de la théorie de l'accumulation de Marx laquelle, à son tour, est la théorie de la crise et de l'effondrement du capitalisme."(Mattick, Prometeo 11, P. 45)
Au fond de toutes ces idioties il y a donc un présupposé "théorique" : l'interprétation, reprise, dans son ensemble, par Mattick, de la baisse du taux de profit telle que la conçoit Grossmann. C'est donc ce thème qu'il nous faut examiner. Suivant la méthode que nous avons utilisée pour Rosa Luxemburg dont les théories servent de soubassement aux délires du C.C.I., nous examinerons les théories de Grossmann qui fondent les divagations du BIPR. En démontrant qu'elles sont étrangères au socialisme scientifique nous montrerons par la même occasion que l'ensemble des conceptions du BIPR ne repose sur rien. Les frères ennemis du "milieu révolutionnaire" n'ont rien trouvé de mieux pour leur servir de gourous que les frères ennemis de la contre-révolution, H. Grossmann et F. Sternberg. Dans le chapitre précédent, nous avons vu ce qu'on pouvait penser du social-démocrate Sternberg, en quoi ses théories étaient une négation du programme communiste et dans quelle mesure il était plus honnête que le C.C.I. quand il affirmait rentrer en contradiction avec Marx. Ce chapitre sera consacré aux théories du stalinien Grossmann, tout aussi éloignées de celles de Marx. Si le BIPR prétend faire reposer l'action révolutionnaire sur les théories de Grossmann il faut y voir là l'influence de la C.W.O., la conversion de Battaglia semblant plus tardive et moins raisonnée.
17.2 Grossmann et l’effondrement du système capitaliste
A chaque fois que nous avons eu l'occasion d'aborder les critiques de Grossmann envers Rosa Luxemburg, nous avons pu noter qu'elles étaient sans fondement et n'apportaient que de la confusion.
Nous avons ainsi réfuté les solutions qu'il tentait d'apporter aux problèmes de la reproduction monétaire dans les schémas de reproduction. De même, nous avons évoqué les "solutions" encore plus fantaisistes qu'il envisageait pour résoudre les disproportions entre le secteur I et le secteur II, en rapport avec les remarques de Rosa Luxemburg, du fait de la hausse de la composition organique du capital.
Toutefois, l'ouvrage principal de Henryk Grossmann reste "La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste". Dans ce livre, écrit en 1929, Grossmann développe son interprétation de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit et de sa relation avec l'effondrement du capitalisme.
Existe-t-il chez Marx une théorie de l'effondrement ? Telle est la question que se pose Grossmann du début de la deuxième partie de son livre. Après avoir passé en revue, dans la première partie du livre, les diverses interprétations révisionnistes sur le sujet, Grossmann en vient à argumenter contre Kautsky. Pour ce dernier l'expression d'"effondrement" vient de Bernstein et Marx n'a en aucun cas prononcé un tel mot qui puisse être interprété dans ce sens. Cette conception a été attribuée à Marx par les révisionnistes.
Grossmann va à l'encontre de Kautsky en argumentant très faiblement. Il fait remarquer que le fait de parler de salaire n'implique pas pour autant de parler de théorie du salaire et que donc le fait que Marx se contente de parler d'effondrement n'autorise pas à nier une théorie de l'effondrement. Il n'en demeure pas moins que pour Grossmann il y a bien effondrement du capitalisme chez Marx, l'effondrement étant pris dans le sens d'une crise qui devrait provoquer la mort du capitalisme. Grossmann cite dans la foulée un passage du livre III du "Capital" où Marx emploie ce mot.
"Nous savons d'ailleurs que, même à un faible taux, la masse du profit augmente avec la croissance du capital investi. Toutefois, cela nécessite en même temps la concentration du capital, étant donné que les conditions de la production exigent maintenant l'emploi massif de capitaux. Cela conditionne en outre la centralisation, c'est-à-dire l'absorption des petits capitalistes par les grands et leur dépossession.
(...) Ce processus ne tarderait pas à entraîner l'effondrement de la production capitaliste si des tendances contraires n'agissaient pas continuellement pour produire un effet décentralisateur parallèlement à la force centripète"
(Marx, Capital, L.III, La Pléiade, T.2, P. 1027-1028)
Comme on le voit Marx emploie ici le concept dans un cadre différent de celui des crises de surproduction. Il le fait à propos d'une tendance du capital qui, si elle se poursuivait sans que des contre tendances interviennent, engendrerait l’effondrement de la production capitaliste. Cet effondrement interviendrait sous l'effet d'une concentration et d'une centralisation du capital telles que la masse des producteurs directs ferait toujours plus face à une minorité capitaliste tandis que le feu vivifiant de la production, le taux de profit, en baisse mais compensé par la masse, ne pousserait pas la production capitaliste à sans cesse repousser ses limites.
"Le taux de profit, c'est-à-dire l'accroissement proportionnel du capital, est important surtout pour tous les rejetons de capitaux qui cherchent à se grouper de façon indépendante. Et, dès que la formation de capital aurait incombé à un petit nombre de gros capitaux bien établis pour qui la masse du profit compenserait le taux, on verrait s'éteindre le feu vivifiant de la production, laquelle tomberait en sommeil. Le taux de profit est la force motrice de la production capitaliste ; seul est produit ce qui rapporte du profit."
(Marx, Capital L.III, La Pléiade, T.2, P. 1041-1042)
Bref, le but de Grossmann est de montrer comment, si on laisse de côté les contre tendances, l'accumulation peut conduire à l'effondrement de la production capitaliste. Ainsi, la tâche que se fixe Grossmann est de montrer que le procès de reproduction capitaliste se meut dans des phases nécessairement descendantes et ascendantes qui se répètent périodiquement et qui conduisent finalement à l'effondrement du système capitaliste.
Avant de revenir sur le sujet – s'il y a lieu – notons que pour notre part nous n'avons pas toujours été d'une clarté absolue sur cette question. Dans certains numéros de CouC (cf numéro 8 p.18 – ici chapitre 2) les crises cycliques sont présentées comme le prélude de la crise catastrophique. En fait, pour Marx, la crise, de par sa nature, est catastrophique : c'est-à-dire que la société, pour des raisons sociales, propres à la production capitaliste, se trouve dévastée comme elle le serait par des catastrophes naturelles telles qu'un tremblement de terre ou une inondation. A l'instar des catastrophes naturelles, nous trouvons dans les crises de la production capitaliste des phénomènes tels que des marchandises entreposées et qui s'abîment, des usines qui ferment, des moyens de production inexploités tandis que, d'un autre côté, la force de travail inemployée s'accroît. Toutes ces choses se reproduisent (l'analogie a aussi ses limites. En effet il faut ajouter aux cas décrits, les violentes dévalorisations qui sont rendues nécessaires pour curer un mode de production capitaliste étouffant sous la surproduction) mais pour des motifs propres au mode de production capitaliste, lors des crises qui le secouent périodiquement. A intervalles réguliers, la production capitaliste connaît donc des crises catastrophiques. Ces crises, dans la mesure où la production capitaliste se développe et s'étend, se produisent sur une base toujours plus grande.
"L'inadéquation croissante du développement productif de la société aux rapports de production qui étaient les siens jusqu'alors s'exprime dans des contradictions aiguës, des crises, des convulsions. La destruction violente du capital, non pas par des circonstances qui lui sont extérieures mais comme condition de sa propre conservation, est la forme la plus frappante du conseil qui lui est donné de se retirer pour faire place à un niveau supérieur de production sociale.(...) Le stade suprême de développement de la puissance productive ainsi que le plus grand accroissement de richesse jamais connu coïncideront donc avec la dépréciation du capital, la dégradation du travailleur et l'épuisement systématique de ses capacités vitales. Ces contradictions conduiront à des explosions, des cataclysmes, des crises, dans lesquelles, par la suspension momentanée du travail et la destruction d'une grande partie du capital, ce dernier est ramené par la violence à un niveau où il peut reprendre son cours. Ces contradictions conduisent bien sûr à des explosions, à des crises dans lesquelles la suppression momentanée de tout travail et la destruction d'une grande part de capital ramènent ce dernier par la violence à un point où il est en mesure d'exploiter au maximum ses capacités productives sans être conduit au suicide. Pourtant, ces catastrophes périodiques sont vouées à se répéter à plus large échelle et conduisent finalement au renversement violent du capital"
(Marx, Grundrisse, Editions Sociales, T.II, P.237-238)
Pour Marx, donc il n'y a pas de crise conduisant à un effondrement économique irréversible du capital, d'où le socialisme pourrait surgir à la manière du fruit mûr qui tombe de l'arbre. A la conception opportuniste social-démocrate, où un capitalisme anarchique et mal maîtrisé doit laisser place à un Etat planifié domptant la société bourgeoise et la loi de la valeur, Grossmann substitue la perspective d'un effondrement de la société bourgeoise ouvrant une voie royale au socialisme, la retraite du capitalisme étant définitivement coupée. Dans les deux cas, on a affaire à une négation de la dialectique historique, du rôle révolutionnaire du prolétariat dans le dépassement de la société bourgeoise, qui, sans cette intervention, peut, au prix de crises dévastatrices, reprendre son cours catastrophique. Et, dans une perspective extrême, c'est la disparition de l'humanité, la destruction des antagonismes en présence, le capital et le prolétariat, qu'il faut attendre et non un effondrement majeur d'où surgirait immanquablement le socialisme. De telles conceptions sous-estiment le rôle révolutionnaire du prolétariat et de l'action révolutionnaire dans la transformation de la société. Elles conduisent à la passivité et au fatalisme, au repli sectaire, et atténuent la responsabilité du parti communiste et de l'action politique révolutionnaire, et le rôle de la préparation à une lutte féroce entre les classes, de la détermination, de l'audace nécessaires pour débarrasser l'humanité des sociétés de classes. Rares sont les grands moments où l'histoire offre de courtes périodes pour s'engouffrer dans la voie révolutionnaire, il importe de savoir les saisir et ces expériences ne seront pas sans fin quand pointe l'alternative décisive : "Communisme ou destruction de l'humanité".
17.3 Les présupposés des théories de Grossmann
Pour défendre ses conceptions, Grossmann s'appuie sur le schéma établi par Otto Bauer pour tenter de réfuter Rosa Luxemburg. Ces schémas étaient également l'occasion pour Bauer d'élucubrer sur des théories de la population qui tournaient le dos au socialisme scientifique. Grossmann évite soigneusement de se rallier à ces théories. Mais, les schémas de Bauer sont en soi, et contrairement à ce qu'affirme Grossmann, en parfaite contradiction avec les perspectives défendues par Marx dans le Livre II du Capital. Si les schémas de Marx présentent des défauts, moins qu'on veut bien le dire et pas toujours où on prétend qu'ils sont, les schémas de Bauer ne faisaient pas avancer le problème d'un saut de puce. Bien au contraire, ils sont à l'image de la théorie de Bauer : une négation de la théorie communiste.
Grossmann y voit néanmoins cinq avantages par rapport aux théories de Marx. Nous ne discuterons pas ici le bien fondé des arguties de Grossmann : cela sera repris plus tard, lorsque nous reviendrons sur les schémas de reproduction. Nous nous contenterons de résumer l'argumentation de Grossmann.
Les schémas de Bauer, si l'on fait abstraction de sa théorie de la population et de quelques erreurs comme le fait d'avoir posé un taux de plus-value constant en regard d'une composition organique croissante, n'ont, pour Grossmann, pas les défauts des schémas de Marx, tels que les a critiqués Rosa Luxemburg. Notamment :
· le progrès technique est pris en compte sous la forme de l'accroissement de la composition organique du capital
· les règles d'accumulation dans les deux secteurs sont fixes et claires ; le capital constant croît du double du capital variable : le capital constant s'accroît au rythme de 10% l'an, le capital variable au taux de 5% l'an.
· une part croissante de la plus-value est consacrée à l'accumulation.
· l'accumulation dans les deux secteurs se réalise de manière proportionnée, sans donc créer les déséquilibres mis en évidence par Rosa Luxemburg.
· le taux de profit baisse en relation avec la loi de Marx de la baisse tendancielle du taux de profit.
En partant du terrain d'Otto Bauer, Grossmann se propose donc d’indiquer quelles sont les tendances générales de l'accumulation capitaliste. Pour cela, il prétend qu'il faut adopter comme point de départ de l'analyse le cas le plus favorable que l'on puisse imaginer pour la production capitaliste à savoir une accumulation qui se produise sur la base d'un équilibre dynamique comme cela est décrit dans le schéma d'Otto Bauer.
« Si le taux d’accumulation croît en relation proportionnelle avec la croissance de la population, alors le capitalisme peut développer sans limites les forces productives et avec elles l’appareil de production. En conséquence le capitalisme ne s'effondrerait pas du fait de l'impossibilité objective de l'accumulation illimitée du capital mais serait détruit à travers la lutte politique des masses toujours plus éduquées au socialisme par leur action sur le plan politique et syndical.
Si la proportion mentionnée se maintient, alors il n'existe aucune limite objective, aucun point économique ultime du capitalisme, où il est inévitable que l'effondrement de la production capitaliste ait lieu. »
(Grossmann, La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste, Siglo XXI, P. 73)
Bien entendu, on retrouve derrière ces préoccupations le dilemme entre les fondements matériels de la révolution et l'action subjective du prolétariat. Question toujours mal posée et mal résolue. On a à la fois une sous ou sur évaluation des facteurs matériels et une sous évaluation ou sur évaluation des facteurs subjectifs. La conception dialectique et révolutionnaire montre que les crises ouvrent une polarisation des antagonismes, il ne s'agit pas d'une crise sans issue pour la production capitaliste, d'un point absolu à partir duquel toute solution est fermée à la classe capitaliste, mais de points relatifs, de crises profondes qui peuvent avoir une issue à moins que n'aboutisse l'intervention révolutionnaire qui, elle-même, peut prendre appui sur des crises dont la base est toujours plus vaste et l'intensité tendanciellement croissante pour une période historique donnée.
Pour être un facteur déterminant, les perspectives catastrophiques du cours capitaliste ne doivent pas laisser croire au prolétariat que le socialisme résultera sans autre forme de procès. Au contraire, la théorie révolutionnaire a toujours insisté sur la nécessaire préparation révolutionnaire du prolétariat, sur l'obligation de se forger une volonté inébranlable, d'être capable de faire preuve d'audace, d'initiative, de sens stratégique et tactique aigus, d'avoir une préparation militaire la plus avancée possible ; autant de facteurs qui impliquent que les principes généraux du communisme révolutionnaire soient toujours plus gravés dans l'esprit du prolétariat. L'expérience révolutionnaire n'a fait que confirmer l'importance de l'action subjective du prolétariat et de son action sur lui même comme l'a montré magistralement Trotski :
« Il est plus facile de faire après coup de la théorie sur une insurrection que de se l'assimiler intégralement avant qu'elle se soit accomplie. Le rapprochement de l'insurrection a provoqué inévitablement et provoquera des crises dans les partis insurrectionnels. De cela témoigne l'expérience du parti le mieux trempé et le plus révolutionnaire que l'histoire ait connu jusqu'à présent.(...)
La forte trempe du parti bolchevique se manifestait non dans l'absence de dissentiments, d'hésitations et même d'ébranlements, mais en ce que, dans les circonstances les plus difficiles, il sortait en temps voulu des crises intérieures et s'assurait la possibilité d'une intervention décisive dans les événements[87]. Cela signifie aussi que le parti, dans son ensemble, était un instrument tout à fait adéquat pour la révolution.(...)
Le bolchevisme a créé le type du véritable révolutionnaire qui, à des buts historiques incompatibles avec la société contemporaine, subordonne les conditions de son existence individuelle, ses idées et jugements moraux. Les distances indispensables à l'égard de l'idéologie bourgeoise étaient maintenues par le parti par une vigilante intransigeance dont l'inspirateur était Lénine. Il ne cessait de travailler au scalpel, tranchant les liens que l'entourage petit-bourgeois créait entre le parti et l'opinion publique officielle. En même temps, Lénine apprenait au parti à former sa propre opinion publique, s'appuyant sur la pensée et les sentiments de la classe qui montait. Ainsi, par sélection et éducation, dans une lutte continuelle, le parti bolcheviste créa son milieu non seulement politique mais aussi moral, indépendant de l'opinion publique bourgeoise et irréductiblement opposé à celle-ci. C'est seulement cela qui permit aux bolcheviks de surmonter les hésitations dans leurs propres rangs et de manifester la virile résolution sans laquelle la victoire d'Octobre eût été impossible. »
(Trotski, Histoire de la Révolution Russe, Editions du seuil, T.2, P.539, souligné par nous)
17.4 Accumulation et consommation de la plus-value
Grossmann s'imagine que le but de la classe capitaliste est d'accroître sa consommation. Si la classe capitaliste voit dans le schéma sa part relative dans la plus-value décroître, elle croît du moins jusqu'à un certain point, en termes absolus, et Grossmann de s'écrier :
"La part de la plus-value destinée à la consommation individuelle des capitalistes, si elle représente bien un pourcentage de la plus-value, relativement toujours plus petit – il descend de 75% la première année à 72,02% la quatrième année – croît cependant année par année, en termes absolus malgré l'accumulation croissante. Ainsi est établi le but et le motif de l'élargissement de la production par les capitalistes." (Grossmann, La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste, Siglo XXI, P. 74)
Alors que pour Marx, la classe capitaliste a pour fonction l'accumulation. Elle est rivée à cette tâche tout comme le prolétariat l'est à la production de plus-value. Si la psychologie de la classe capitaliste se modifie quand la production capitaliste s'affermit et s'impose et si nécessairement quand les classes se différencient, elles doivent s'affirmer également à travers leur mode de consommation, la justification de l'accumulation n'a rien à voir avec l'accroissement de la consommation de la classe capitaliste. L'accumulation est incluse dans le concept du capital, valeur qui cherche à se valoriser, argent bourgeonnant qui tend à s'accroître d'un incrément dont l'obtention repose sur l'extorsion de valeur extra, de survaleur. Cette piètre compréhension de l'accumulation capitaliste annonce d'autres catastrophes théoriques au cours desquelles tout ce qui peut ressembler à l'analyse marxienne va être jeté par dessus bord et perdu corps et biens.
17.5 Grossmann et le schéma de Bauer
Présentons rapidement le schéma général :
|
A |
C |
V |
PC |
AC |
AV |
VT |
PLC% |
PLA% |
TDP% |
|
1 |
200.000 |
100.000 |
75.000 |
20.000 |
5.000 |
400.000 |
75 |
25 |
33,3 |
|
2 |
220.000 |
105.000 |
77.750 |
22.000 |
5.250 |
430.000 |
74,05 |
25,95 |
32,6 |
|
3 |
242.000 |
110.250 |
80.539 |
24.200 |
5.511 |
462.500 |
73,04 |
26,96 |
31,3 |
|
4 |
266.200 |
115.762 |
83.374 |
26.600 |
5.788 |
497.524 |
72,02 |
27,98 |
30,3 |
|
5 |
292.600 |
121.550 |
86.213 |
29.260 |
6.077 |
535.700 |
70,93 |
29,07 |
29,3 |
|
6 |
321.860 |
127.627 |
89.060 |
32.186 |
6.381 |
577.114 |
69,7 |
30,3 |
28,4 |
|
10 |
471.234 |
155.130 |
100.251 |
47.123 |
7.756 |
781.494 |
64,63 |
35,37 |
24,7 |
|
20 |
1.222.252 |
252.691 |
117.832 |
122.225 |
12.634 |
1.727.634 |
46,63 |
53,37 |
17,1 |
|
21 |
1.344.477 |
265.325 |
117.612 |
134.447 |
13.266 |
1.875.127 |
44,33 |
55,67 |
16,4 |
|
25 |
1.968.446 |
322.503 |
109.534 |
196.844 |
16.125 |
2.613.452 |
33,96 |
66,04 |
14 |
|
30 |
3.170.200 |
411.602 |
73.882 |
317.200 |
20.580 |
3.993.404 |
17,97 |
82,03 |
11,5 |
|
34 |
4.641.489 |
500.304 |
11.141 |
464.148 |
25.015 |
5.642.097 |
0,45 |
99,55 |
9,7 |
|
35 |
5.105.637 |
525.319 |
0 |
510.563 |
14.756 |
6.156.275 |
0 |
104 (!) |
9,3 |
|
36 |
a) capital |
a) population |
|
|
nécessaire |
|
|
|
|
|
|
existant |
existante |
|
|
26.265 |
|
|
|
|
|
|
5.610.200 |
551.584 |
|
|
déficit |
|
|
|
|
|
|
b) capital |
b) population |
|
|
11.509 |
|
|
|
|
|
|
actif |
active |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.499.015* + 540.075 + 0 + 540.075 + 0 = 6.696.350 0 109,35%( !) 8,70% |
||||||||
|
|
c) excédent |
c) armée de |
|
nécessaire |
nécessaire |
|
|
|
|
|
|
de capital |
réserve |
|
561.620 |
27.003 |
|
|
|
|
|
|
117.185 |
11.509 |
|
déficit |
déficit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.545 |
27.003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Déficit total : 48.548 |
|
|
|
|
|
|
|
* 5.616.200 : 551.584 = 5.499.015 : 540.075 |
|
|
|
|
|
|||
|
Avec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A : |
Année |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C : |
Capital constant |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V : |
Capital variable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PC : |
Plus-value consommée individuellement par les capitalistes |
|
|
|
|||||
|
AC : |
Plus-value accumulée sous forme de capital constant |
|
|
|
|
||||
|
AV : |
Plus-value accumulée sous forme de capital variable |
|
|
|
|
||||
|
VT : |
Valeur totale du produit annuel |
|
|
|
|
|
|
||
|
PLC% |
% de la plus-value consommée |
|
|
|
|
|
|
||
|
PLA% |
% de la plus-value accumulée |
|
|
|
|
|
|
||
|
TDP% |
Taux de profit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Le capital constant croît de 10%, le capital variable de 5%. Cette croissance résulte de l'accumulation de la plus-value. Les échanges entre les deux secteurs de la production sociale, tout comme leur composition relative, s'ils jouent un grand rôle dans les considérations de Bauer, peuvent être ici, et quelles que soient les aberrations qu'ils contiennent, laissés de côté.
Les conséquences immédiates du schéma sont donc les suivantes : le taux de plus-value étant constant, la plus-value croît proportionnellement au capital variable. Par contre, le capital constant augmente plus vite, si bien que le taux de profit général baisse tandis que la part de la plus-value accumulée dans la plus-value totale s'accroît. En d'autres termes, le taux d'accumulation, la part de la plus-value accumulée par rapport à la plus-value totale, augmente. La contrepartie évidente est que la part de la plus-value destinée à la consommation des capitalistes diminue.
Bauer avait établi ses schémas sur quatre années. En poursuivant les tendances esquissées par Bauer, Grossmann continue les calculs sur 35 années jusqu'à ce que l'accumulation devienne impossible. Ce qui aurait été un argument supplémentaire pour montrer l'absence de validité du schéma de Bauer, se transforme en une schématisation du cours de la production capitaliste. Plutôt que de relever le manque de cohérence du schéma de Bauer, Grossmann s'imagine avoir trouvé le nec plus ultra de l'expression schématique de la crise du mode de production capitaliste.
17.6 Grossmann énième avatar de l’économie politique vulgaire
Et quelle crise ? En tout état de cause, elle est aux antipodes de celle prévue et décrite par le programme communiste. Par contre, nous le verrons en détail, elle s'assimile aux conceptions des économistes bourgeois les plus vulgaires, ceux de l'école de J.B. Say pour qui les crises ne pouvaient résulter que de disproportions entre les diverses branches de l'économie. Nous avons souvent dit que, si l'économie politique bourgeoise se séparait en deux tendances quant aux théories des crises, l'une disproportionnaliste et dont les principaux représentants sont à l'origine Say et Ricardo, l'autre, sous-consommationniste, avec Sismondi et Malthus, cette scission reparaît au sein du réformisme et du marxisme. Elles représentent les antinomies indépassables de la pensée économique propre au mode de production capitaliste. Pour autant que l'idéologie capitaliste ait pénétré le mouvement révolutionnaire, il n'est donc pas étonnant de voir nos frères ennemis se débattre dans les mêmes contradictions, d'un côté le C.C.I. héritier de la tradition sous consommationniste, de l'autre le BIPR dans la lignée des théories disproportionnalistes.
17.7 Taux de profit et taux d’accumulation
Qu'advient il donc à la longue dans le schéma de Bauer-Grossmann ?
Dans la mesure où l'accroissement du capital constant est plus rapide que celui de la plus-value, la part du capital constant accumulé augmente, si bien que la part de la plus-value destinée à la consommation personnelle de la classe capitaliste se réduit dans la même proportion. Vers la vingtième année, la consommation de la classe capitaliste commence à diminuer en valeur absolue et vers la trente cinquième année, la plus-value est insuffisante pour financer l'accumulation. En faisant dépendre l'accumulation de la masse du capital existant et non de la plus-value, ce qui est une première absurdité, on aboutit au résultat que nous venons de décrire, et que Grossmann baptise "surproduction". Or, jusqu'ici, il n'y a eu ni recul, ni même ralentissement de la production. Bien au contraire, tandis que le taux de profit baisse régulièrement, la valeur de la production augmente toujours plus. Quant à ce que les économistes bourgeois définissent comme le P.I.B. (capital variable + plus-value + capital fixe) il demeure constant quand on le calcule comme P.I.B par personne. Globalement, il s'accroît au même rythme que la force de travail, soit 5% (le capital fixe n'existant pas dans le schéma). Si on prenait en compte le capital fixe dont on n'a aucune raison de penser que le taux d'augmentation n'est pas au moins égal à celui capital constant dans son ensemble, on constaterait que le P.I.B. par personne lui aussi croît au fur et à mesure que le taux de profit baisse.
Inutile de dire que tout cela tourne systématiquement le dos à la théorie révolutionnaire. Pour donner simplement l'illusion de l'orthodoxie, Grossmann est conduit, en bon apôtre du stalinisme, à commettre des faux qui en disent long sur sa prétendue probité intellectuelle. Il est, par exemple, difficile de nier les relations contradictoires entre la baisse du taux de profit et l'accroissement du taux d'accumulation. Moins le capital retirerait du profit de l'accumulation et plus il accumulerait (relativement), telle est la théorie de Grossmann:
"Malgré le déclin du taux de profit, l'accumulation se poursuit selon un rythme toujours plus accéléré, étant donné que le volume de l'accumulation ne se développe pas en proportion du niveau du taux de profit mais en relation au potentiel possédé par le capital déjà accumulé." (Grossmann, La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste, Siglo XXI, p. 80)
Dans le même ordre d'idées, Grossmann s'était déjà empressé de nous présenter comme un immense progrès scientifique le fait que le schéma de Bauer impliquait qu'une part croissante de la plus-value était consacrée à l'accumulation.
Pour faire bonne mesure, Grossmann cite Marx : "La baisse du taux de profit et l'accumulation accélérée ne sont que des expressions différentes du même processus" et il prétend s'appuyer sur de telles phrases pour justifier son analyse. Pourtant si nous prenons la peine de lire la citation dans son entier, Marx ajoute :
"Elles expriment toutes deux le développement de la productivité du travail. De son côté, l'accumulation accélère la baisse du taux de profit, dans la mesure où elle implique la concentration du travail sur une grande échelle et, par suite, une composition supérieure du capital. D’autre part, la baisse du taux de profit accélère également la concentration du capital et sa centralisation par l’expropriation des petits capitalistes, du dernier des producteurs directs chez qui il y a encore quelque chose à exproprier. Ainsi, l'accumulation se trouve accélérée, quant à la masse, bien que le taux d'accumulation baisse avec le taux de profit."
(Marx, Capital, La Pléiade, T.2, p. 1024 – souligné par nous)
Donc bien loin de se comporter différemment du taux de profit, le taux d'accumulation, c'est-à-dire la part de la plus-value accumulée, tend à s’y conformer. Grossmann est pris ici en flagrant délit de mensonge. Non seulement il n'ignore pas la véritable position de Marx sur ce sujet, et celle-ci va strictement à l'encontre de ses pseudo-théories, mais il truque les citations pour leur faire dire l'inverse de ce qu'elles signifient. Voilà un bon maître pour le "milieu révolutionnaire" où, à défaut de défendre les positions du communisme révolutionnaire, on y sait parfaitement tronquer les citations. Grossmann et, nous le verrons, Mattick sont, à ce jeu là, des amateurs à côté du C.C.I. ou du BIPR.
Retenons donc que le taux d'accumulation de la plus-value a plutôt tendance à baisser avec la baisse du taux de profit et non plutôt tendance à augmenter comme le prétend Grossmann. Pour autant que le taux de profit soit la force motrice de la production capitaliste, il est logique que le taux d'accumulation, qui signifie notamment la recherche de profits par des capitaux nouveaux épouse les évolutions du taux de profit.
17.8 Suraccumulation et baisse tendancielle du taux de profit
La baisse tendancielle du taux de profit ne peut être complètement expliquée que si on la relie au procès de valorisation-dévalorisation du capital, c'est-à-dire au procès de développement de la productivité du travail dans le cadre du mode de production capitaliste. Le capital n'a qu'un but, parfaitement limité : la production d'un maximum de plus-value. Pour ce faire, donc pour valoriser au maximum le capital avancé, il devient nécessaire de développer la productivité du travail. Le développement de la productivité du travail et la dévalorisation du capital qui l'accompagne entrent en contradiction avec les buts limités du capital, la valorisation maximum de celui-ci, la recherche du maximum de plus-value. Donc, pour se valoriser, le capital est obligé de se dévaloriser ; ce faisant, la masse des marchandises s'enfle. Sous cette influence les forces productives se démultiplient. Périodiquement, la contradiction entre le développement des forces productives comme si elles n'avaient pas de limites et des rapports de production spécifiques reposant sur une base historique limitée, éclate et se résout par des crises dont le potentiel est d'autant plus important que la production capitaliste est plus avancée.
En cas de retournement dans le développement de la productivité du travail, le taux de profit baisse brutalement, la plus-value tend à baisser relativement au capital avancé, la crise de surproduction éclate. L'argent arrête son cycle et ne se transforme plus en capital, tandis que le capital-marchandise ne se réalise plus en argent. L'accumulation ne pourra reprendre qu'après une violente purge, par une dévalorisation brutale du capital qui ne résulte plus des progrès de la productivité du travail mais d'une chute brutale des prix et de la destruction d'une partie du capital existant. Cette brusque chute du taux de profit qui s'accomplit dans la crise est à distinguer de la baisse tendancielle du taux de profit qui accompagne l'accumulation et qui se présente d'un cycle à l'autre de la production capitaliste.
Nous venons de décrire rapidement la crise de suraccumulation qui se manifeste et marque l'issue du cycle, crise catastrophique qui met en question l'ensemble du capital social et menace d'autant plus la société que le mode de production est développé. Il n'en reste pas moins que l'une des conséquences du procès de valorisation-dévalorisation du capital devant les menaces grandissantes qu'il implique pour les rapports de production capitaliste sera de limiter l'accumulation et ses effets désastreux. De ce point de vue, la diminution du taux d'accumulation, et donc, la consommation d'une part croissante de la plus-value, (ce qui implique le développement d'une classe moyenne dont la fonction économique sera de consommer la plus-value et par conséquent, de favoriser la stabilité de la production capitaliste) tout comme la baisse du taux de profit s'imposent à la classe capitaliste afin de ralentir un moteur qui, laissé à ses propres tendances, s'emballerait. Donc, d'un côté, la production capitaliste signifie accumulation sans trêve ni merci, recherche effrénée du maximum de plus-value, valorisation maximum du capital, développement de la productivité du travail comme si elle n'avait pas de limites. D'un autre côté, étant donné ses buts limités, le capital pose devant lui des barrières qu'il essaie constamment de dépasser, des contradictions qu'il ne peut résoudre que par des crises catastrophiques et qu'il essaie de différer. Par là même, il reconnaît se limites historiques, ce dont témoigne la baisse tendancielle du taux de profit.
"Formulée en termes tout à fait généraux, la contradiction consiste en ce que le mode de production capitaliste implique une tendance au développement absolu des forces productives, sans tenir compte de la valeur et de la plus-value qu'elle renferme, et indépendamment des conditions sociales dans lesquelles la production capitaliste s'effectue ; tandis que, d'autre part, il a pour but la conservation de la valeur-capital existante et son expansion maximum (c'est-à-dire l'accroissement accéléré de cette valeur). Son caractère spécifique, c'est d'utiliser la valeur du capital existant comme un moyen d'accroître au maximum cette valeur. Les méthodes par lesquelles il atteint ce but impliquent : la baisse du taux de profit, la dépréciation du capital existant, le développement des forces productives du travail aux dépens des forces productives déjà créées.
La dépréciation périodique du capital existant – un des moyens inhérents au mode de production capitaliste pour arrêter la baisse du taux de profit et accélérer l'accumulation de valeur-capital par la formation de capital nouveau – trouble les conditions données où s'accomplit le processus de circulation et de reproduction du capital et s'accompagne donc d'arrêts brusques et de crises du processus de production.
La production capitaliste tend constamment à surmonter ces limites inhérentes ; elle n'y réussit que par des moyens qui dressent à nouveau ces barrières devant elles, mais sur une échelle encore plus formidable.
La véritable barrière de la production capitaliste, c'est le capital lui-même. Voici en quoi elle consiste : le capital et son expansion apparaissent comme le point de départ et le terme, comme le mobile et le but de la production ; la production est uniquement production pour le capital, au lieu que les instruments de production soient des moyens pour un épanouissement toujours plus intense du processus de la vie pour la société des producteurs. Les limites dans lesquelles peuvent uniquement se mouvoir la conservation et la croissance de la valeur du capital – fondées sur l'expropriation et l'appauvrissement de la grande masse des producteurs – ces limites entrent continuellement en conflit avec les méthodes de production que le capital doit employer pour ses fins et qui tendent vers l'accroissement illimité de la production, vers la production comme une fin en soi, vers le développement absolu de la productivité sociale du travail. Le moyen – le développement illimité des forces productives de la société – entre en conflit permanent avec le but limité, la mise en valeur du capital existant. Si le mode de production capitaliste est, par conséquent, un moyen historique de développer la puissance matérielle de la production et de créer un marché mondial approprié, il est en même temps la contradiction permanente entre cette mission historique et les conditions correspondantes de la production sociale."
(Marx, Capital, Livre III, La Pléiade, T.2, P. 1031-1032)
C'est dans ce sens que Marx montre que la baisse du taux de profit tout comme l'accélération de l'accumulation ne sont que des expressions différentes d'un même processus : le développement de la productivité du travail.
Le cycle de l'accumulation capitaliste est donc rythmé par des crises de suraccumulation qui se caractérisent par un retournement de la productivité du travail. A l'issue de ces crises qui menacent toujours plus la société bourgeoise, et pour une période historique donnée, une violente dévalorisation du capital est nécessaire pour que sur la base d'une nouvelle composition du capital, l'accumulation puisse reprendre et le taux de profit s'élever pour un nouveau cycle dont, tendanciellement (c'est-à-dire si des contre tendances ne jouent pas), la moyenne des taux de profit sera plus basse que la moyenne des taux de profit du cycle précédent. Il y a donc la baisse tendancielle du taux de profit d'un cycle d'accumulation à l'autre et la chute brutale du taux de profit en fin de cycle, caractéristique d'une crise de suraccumulation du capital.
D'une crise à l'autre, le taux de profit non seulement peut se relever mais il se relève conformément aux buts poursuivis pas le capital : la recherche de maximum de plus-value.
Ces éléments théoriques ne peuvent être abstraits de l'histoire de la phase de soumission réelle du travail au capital si l'on veut ensuite dire quelque chose de cohérent sur celle-ci. Ainsi, depuis la seconde guerre mondiale, une des périodes les plus fastes de son histoire s'est ouverte pour le capital. Il a connu les taux moyens de croissance les plus élevés, tout comme une énorme augmentation de la plus-value aussi bien dans son taux que dans sa masse du fait de la multiplication de la population soumise au salariat.
Cette période connaît également une croissance de la population mondiale particulièrement rapide – doublement de la population mondiale en moins de 40 ans – et il est prévu un nouveau doublement dans les quarante prochaines années, ce qui constitue la révolution démographique la plus importante depuis le néolithique. Les trente première années de cette période (1945-1975) contrairement à la nouvelle légende des "trente glorieuses", ont été entrecoupées de crise (tous les six ans environ) mais qui n'ont pas eu généralement de conséquences graves. Toutefois, d'un cycle à l'autre, le taux de croissance qui demeure ici un bon indicateur du développement contradictoire de la productivité du travail, a eu tendance à baisser. Par ailleurs, depuis 1975, des crises de plus grande ampleur ont eu lieu. L'ultime perspective de la production capitaliste ne pouvant être que d'offrir un nouvel holocauste mondial qui mettra en péril l'existence même de l'humanité.
17.9 Grossmann et Mattick épigones de Ricardo
Il n'est nul besoin d'être grand clerc pour constater que la perspective communiste est particulièrement éloignée de celle de Grossmann. Chez celui-ci, il n'y a pas de baisse du taux d'accumulation, aucune nécessité de développer, par exemple, une classe moyenne qui consomme une part croissante de la plus-value. Les effets contradictoires du développement de la productivité du travail ne sont pas pris en compte. Ils sont pourtant indispensables pour comprendre la signification de la baisse du taux de profit. Chez Grossmann, pas une ligne sur le sujet ; l'accumulation est accompagnée d'une baisse régulière du taux de profit qui pourrait se poursuivre jusqu'à la nuit des temps si les pseudo besoins en capital constant n'excédaient pas, à un moment donné, la totalité de la plus-value. Ici, nulle contradiction entre la production et la réalisation du capital ne vient marquer la crise. La nécessité pour le capital de réaliser la valeur avancée plus la plus-value en vendant la marchandise contre de l'argent est absolument indifférente dans la conception de Grossmann. Chez Marx, la chute brutale de la productivité du travail et la baisse du taux de profit se traduisent par l'arrêt du cycle capitaliste. Le capital cessant son mouvement, la contradiction éclate au niveau de la circulation quand la marchandise doit se réaliser en argent et quand, pour autant que l'on raisonne au niveau du capital total, l'argent doit se convertir en capital. Cet aspect fondamental de la théorie révolutionnaire et qui notamment la distingue des théories ricardiennes est absolument ignoré de Grossmann quand il n'est pas expressément combattu (cf. Mattick). La théorie de Grossmann-Mattick n'est plus alors qu'une variante modernisée de la théorie de la baisse du taux de profit de Ricardo.
Chez ce dernier, le taux de profit agricole détermine le taux de profit de l'industrie. Le salaire réel représenté par une certaine quantité de blé reste constant. Les fermiers capitalistes paient une rente aux propriétaires fonciers et obtiennent un profit à la suite de la mise en exploitation des terres. Sous la pression démographique des terres de plus mauvaise qualité sont mises en culture. Il s'ensuit une hausse de la valeur de la force de travail et donc une diminution de la plus-value tandis que la rente différentielle se gonfle réduisant le profit d'autant. A un moment donné, le taux de profit, pris entre le marteau du salaire et l'enclume de la rente tombe à un niveau si bas que l'accumulation est découragée.
"J'ai déjà dit que longtemps avant que cet état des prix soit devenu permanent, il n'y aurait plus de motif pour accumuler ; car on n'accumule qu'en vue de rendre cette accumulation productive ; et ce n'est que lorsqu'elle est ainsi employée qu'elle a un effet sur les profits. Il ne saurait y avoir d'accumulation sans motif, et par conséquent un tel état des prix ne peut jamais persister. Il est aussi impossible au fermier et au manufacturier de vivre sans profits, qu'à l'ouvrier d'exister sans salaire. Le motif qui les porte à accumuler diminuera à chaque diminution des profits, et il cessera entièrement quand ils seront tellement minimes qu'ils ne leur offriront plus un dédommagement suffisant de leur peine, et du risque qu'ils courent nécessairement en employant leur capital d'une manière productive."
(Ricardo, Principes de l'économie politique et de l'impôt , Calmann-Lévy, p. 92)
Si les causes de l'arrêt de l'accumulation sont différentes (dans un cas, celui de Ricardo, la plus-value diminue sous l'effet de la hausse du salaire et le profit est dévoré par la rente dans l'autre, celui de Grossmann, c'est la hausse de la composition organique présentée sous l'angle d'une accumulation de capital excédant progressivement la masse de plus-value créées) les conceptions sont parallèles. Et l'on ne s'étonnera pas de retrouver Ricardo parmi les partisans de la loi dite de Say, la "loi des débouchés" qui n'acceptent que les disproportions comme explication des crises, niant ainsi toute perspective de crise générale.
17.10 Une disproportion imaginaire
Qu'adviendrait-il si, au lieu de faire croître le capital constant de 10% la dernière année, on ralentissait l'accumulation à 5% ? Dans ce cas l'accumulation pourrait se poursuivre. L'accumulation n'est que (nous faisons abstraction du capital constant renouvelé) l'accumulation de la plus-value et elle n'est pas en relation directe avec le capital constant déjà accumulé. Le serait-elle que l'on ne voit pas en quoi le ralentissement de l'accumulation ouvrirait une crise de surproduction. Si dans une maison il y a à ravaler la façade, changer les papiers peints et la moquette, refaire la salle de bain, ces travaux peuvent être effectuées en une seule fois si les revenus sont suffisants. Par contre, si l'argent vient à manquer (nous faisons ici abstraction du crédit), certaines tâches seront laissées pour plus tard. La situation créée ne sera pas la meilleure possible mais constater que les besoins potentiels ne sont pas intégralement réalisés est un fait banal. Si un capitaliste juge utile d'acheter 10 machines et ne peut en acheter que 5, cela ne signifie pas pour autant que son entreprise est en crise mais que l'investissement, l'accumulation, est limité par le profit qu'il a réalisé. Du point de vue du capital total, nous retrouvons la même contrainte mais cela n'est en aucun cas un signe de crise. L'accumulation se ralentit, la force de travail employée croît plus lentement, la surpopulation peut donc augmenter mais cela ne définit pas scientifiquement la crise de suraccumulation.
La "crise" que fait apparaître Grossmann est purement artificielle. Pour autant qu'elle ait un atome de réalité elle trouve immédiatement sa solution dans un ralentissement de l'accumulation, dans la réduction du taux d'accumulation. Quant à sa nature, elle relève des crises reconnues par les économistes vulgaires. La conception de Grossmann ne tient en aucun cas compte de la contradiction indépassable entre la marchandise et l'argent. La "crise" n'affecte qu'une partie de la plus-value. Elle peut être assimilée à une disproportion (insuffisance du capital et de la plus-value existante par rapport à un besoin d'accumulation supérieur et imaginaire). Excès imaginaire d'un côté, insuffisance fantasmagorique de l'autre ; crise partielle affectant une partie réduite de la plus-value et donc absence de crise générale, catastrophique, affectant la totalité du capital ; absence de contradiction entre la production et la réalisation de la valeur et de la plus-value dans la définition de la crise ; nous voilà en plein ricardianisme à la nuance près que Grossmann met en place une disproportion particulière dans l'histoire des crises : la disproportion imaginaire. Ce qui, par contre, n'est pas imaginaire, mais plus dramatique, c'est qu'il existe des imbéciles qui voudraient fonder un mouvement révolutionnaire sur des conceptions plus proche du conte pour enfant que de la science.
17.11 Henryk Grossmann bouleverse le socialisme scientifique
Grossmann qui persévère dans son incompréhension des fondements de l'accumulation capitaliste, affirme qu'à partir de la 35ème année, dans le cadre des hypothèses actuelles, toute nouvelle accumulation de capital perd son sens pour la classe capitaliste, les fruits du système de production allant exclusivement à la classe ouvrière. Grossmann ne comprend pas la fonction de la classe capitaliste, tournée vers l'accumulation. Un système où l'accumulation du capital n'impliquerait pas la classe capitaliste ou plus exactement où elle ne représenterait aucun coût, ne signifierait pas la fin du mode de production capitaliste, mais au contraire la réalisation d'une de ses tendances. On se trouverait alors dans le cas le plus "pur", celui où le capital fait face au prolétariat, lui extorque le maximum de plus-value pour l'accumuler intégralement dans la recherche sans relâche du maximum de survaleur, dans la perspective d'une plus-value toujours plus importante dont l'obtention, loin d'en étancher la soif, la rend inextinguible.
A partir d'un théorie des crises aussi vulgaire, à partir d'une représentation de l'accumulation aussi pauvre, il n'est pas étonnant que Grossmann accumule les catastrophes théoriques. Chaque tentative pour y agréger, en les mutilant, les concepts de Marx engendre un monstre théorique toujours plus éloigné de toute perspective révolutionnaire.
Grossmann, moins innocent qu'on ne le prétend, s'est bien aperçu que ses conceptions sont en contradiction avec le point de vue de Marx. Si, dans un premier temps il nie l'évidence en tronquant les citations, dans un second temps, il se lance dans la réécriture du texte lui-même, le tout à partir de conjectures les plus fantaisistes où se trouvent mêlés Engels, le savant Samuel Moore – un ami de Marx et Engels – et les manuscrits non édités de Marx. C'est que Grossmann doit justifier pourquoi personne avant lui n'a aussi bien "reconstitué" la théorie de la baisse du taux de profit. Pourquoi dans ce cas, ce qui parait limpide aux yeux de Grossmann est resté ignoré du mouvement communiste? La réponse la plus simple tient évidemment dans le fait que la "théorie" de Grossmann est une horrible couillonnade qui a autant de rapport avec la théorie de Marx que peuvent en avoir les crottes de lapin avec le caviar. Mais Grossmann se doit d'expliquer pourquoi il lui revenait de se hisser sur les cimes de la science et de pouvoir contempler pour la première fois l'abîme où la production capitaliste menaçait de se précipiter. Ainsi, outre le retard et les mauvaises conditions dans lesquelles le livre III du capital a pu être publié, Marx était trop en avance sur son temps et se posait des problèmes que l'humanité ne pouvait résoudre. Voilà bien un point commun entre le C.C.I. et le BIPR nos deux frères ennemis! Ce pauvre Marx travaillait pour l'avenir, le socialisme n'étant pas possible à son époque. Comme la production capitaliste n'était pas assez développée le problème de la reconnaissance de son effondrement ne pouvait être complètement posé, et il fallait attendre Grossmann pour parvenir à une clarification complète.
"La question de l'effondrement du capitalisme fut génialement traitée dans tous les livres de l’œuvre centrale de Marx, mais elle devait ici aussi rester incomprise. Le capitalisme n'avait pas atteint une maturité telle que la question de l'effondrement et que le problème de réalisation du socialisme ne pouvaient avoir une réalité immédiate. Marx était si en avance sur son époque, que justement restèrent, en premier lieu, incomprises les parties de son oeuvre qui y faisaient référence, et la conception matérialiste de l'histoire trouve ici une nouvelle confirmation à propos de l’œuvre de Marx elle-même."
(Grossmann, La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste, Siglo XXI, p.129)
Outre ce genre d'affirmations qui montrent qu'en fait de matérialisme celui de Grossmann est purement bourgeois, Grossmann se lance dans des explications farfelues d'où il ressort fort bien que Grossmann et défenseurs associés n'ont rien compris à la baisse du taux de profit et nous en servent la énième resucée ricardienne.
17.12 Grossmann et la limite absolue de la baisse du taux de profit
Grossmann se pose ainsi le problème de la baisse du taux de profit. Pourquoi celle-ci se traduirait-elle par une crise en raison du fait que le taux de profit tombe de 9,7% à 9,3% ?
"Comment une relation en pourcentage, comme le taux de profit, un nombre pur, pourrait-elle produire l'effondrement d'un système réel! Comme si la chaudière d'une machine à vapeur pouvait exploser parce que l'aiguille du monomètre monte au plus haut. Pourquoi la classe capitaliste aurait-elle à se préoccuper de la baisse du taux de profit si la masse du profit augmentait ? La masse croissante du profit s'exprimerait dans une fraction toujours plus petite, le taux de profit tendrait vers zéro, comme point limite au sens mathématique, sans néanmoins pouvoir l'atteindre. Mais malgré cela les capitalistes et le système capitaliste pourraient se maintenir. Nous voyons vraiment dans le tableau que le système capitaliste pourrait exister malgré la baisse du taux de profit et que l'effondrement définitif dans la 35ème année n'a, en soi, rien à voir avec la baisse du taux de profit. Elle ne permet pas de comprendre pourquoi dans la 34ème année le système peut subsister avec un taux de profit de 9,7% et pourquoi, alors l'année suivante, il s'effondre avec un taux de profit de 9,3%. Le problème devient intelligible si nous mettons en relation l'effondrement non avec le taux de profit mais avec la masse de profit." (Grossmann, La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste, Siglo XXI, P. 130)
Les réserves émises par Grossmann se situent dans la lignée de Tugan-Baranovsky et là encore nous trouvons une grande communion de pensée entre le BIPR et le C.C.I. puisque pour ce dernier également on ne voit pas pourquoi le fait que le taux de profit passe de 100% à 10% où de 10% à 1% induirait une crise. Pour le C.C.I. il s'agit là d'arguments décisifs contre la baisse du taux de profit. Pour Grossmann cela induit des variations théoriques de son cru qui le conduisent à réécrire Marx. Si, au début, la théorie de Grossmann se présente comme une restauration de la théorie de Marx, à mesure que le discours se précise et qu'il lui faut enjamber les contradictions toujours plus évidentes entre sa théorie et celle de Marx le voilà qui est conduit à rejeter la théorie de la baisse du taux de profit après en avoir présenté une caricature. Avant de voir les réécritures de Grossmann, il importe donc de considérer toute la stupidité d'une telle présentation de la baisse du taux de profit où de bons apôtres ricardiens s'imaginent qu'il y aurait un point absolu à partir duquel le capitalisme s'écroulerait, ou, plus exactement, ne pourrait continuer car, même réduit à peu, aucun espace n'existe pour qu'éclate la moindre crise dans la production capitaliste. Ce point absolu n'existant pas dans la baisse du taux de profit telle qu'on la caricature ici, les uns en déduisent que la théorie de Marx n'a pas de valeur (c'est le cas de C.C.I.), les autres (comme Grossmann) qu'il faut l'amender en introduisant la masse du profit comme critère déterminant. Les uns comme les autres, nous l'avons rappelé, ignorent tout des contradictions entre la marchandise et l'argent qui seules peuvent expliquer que la crise est possible du fait que les conditions de la production et de la réalisation de la valeur et de la plus-value ne sont pas identiques. C'est ce qui explique que la crise éclate dans la sphère de la circulation, au niveau des banques et du commerce de gros.
"La création de cette plus-value constitue le processus de production immédiat qui, comme nous l'avons dit, n'a d'autres limites que celles que nous venons d'indiquer. Dès que toute la quantité de surtravail que l'on peut extorquer est matérialisée en marchandises, la plus-value est produite. Mais cette production de plus-value n'achève que le premier acte du processus de production capitaliste, le processus immédiat. Le capital a absorbé une quantité déterminée de travail non payé. A mesure que le processus se développe, qui s'exprime dans la baisse du taux de profit, la masse de plus-value ainsi produite s'accroît immensément. Vient alors le second acte du processus. Il faut que toute la masse des marchandises, le produit total, aussi bien la partie qui représente le capital constant et le capital variable que celle qui représente la plus-value, se vende. Si la vente ne s'opère pas ou bien qu'elle ne s'opère que partiellement ou à des prix inférieurs aux prix de production, il y a bien eu exploitation de l'ouvrier, mais elle n'est pas réalisée comme telle pour le capitaliste ; elle peut même aller de pair avec l'impossibilité totale ou partielle de réaliser la plus-value extorquée, voire s'accompagner de la perte totale ou partielle du capital. Les conditions de l'exploitation directe et celles de sa réalisation ne sont pas les mêmes ; elles différent non seulement de temps et de lieu, mais même de nature. Les unes n'ont d'autre limite que les forces productives de la société, les autres la proportionnalité des différentes branches de production et le pouvoir de consommation de la société."
(Marx, Capital, L.III, La Pléiade, t.2, p.1026)
"Malgré son autonomie, le mouvement du capital marchand n'est jamais rien d'autre que le mouvement du capital industriel dans la sphère de la circulation. Mais cette autonomie rend ses mouvements, dans une certaine mesure, indépendants des limites posées par le processus de reproduction, et pousse celui-ci au delà de ses propres limites. Par suite de sa dépendance interne et de son indépendance externe, le capital marchand en arrive à un point où la cohésion intérieure est rétablie de façon violente, par une crise. C'est ce qui explique que les crises n'éclatent pas d'abord dans le commerce de détail qui vise la consommation directe, mais dans les sphères du commerce en gros et des banques, qui mettent le capital argent de la société à la disposition du premier."
(Marx, Capital, L.III, La Pléiade, t.2, p.1075)
Si la contradiction entre la production et la réalisation fonde la possibilité de la crise, sa nécessité est fournie au sein du processus de production dans le développement de la contradiction valorisation-dévalorisation. Nul besoin de trouver un point absolu correspondant à on ne sait quel niveau le plus bas du taux de profit. Les crises éclatent quand la productivité du travail se retourne brutalement précipitant la baisse du taux de profit. Ces crises nécessitent des dévalorisations brutales qui à la fois expriment la crise et en constitue la solution. La crise ne provient pas, pour reprendre l'analogie de la chaudière du fait d'une baisse régulière de la pression qui à, un moment introuvable, se traduirait par un arrêt du fonctionnement mais quand alors que la pression est intense (recherche du maximum de plus-value) une brutale baisse de régime (baisse brutale du taux de profit, suraccumulation) empêche l'expulsion normale de la vapeur excédentaire (dévalorisation du capital sous l'effet du développement de la productivité du travail), ce qui engendre une surpression qui doit être extirpée violemment et par des voies différentes des voies habituelles (dévalorisation brutale du capital, baisse des prix, destruction du capital etc.), il s'ensuit une crise d'autant plus violente que la pression de la vapeur est intense et menace toujours plus l'intégrité de la chaudière. Devant de tels obstacles et leur répétition l'une des tendances du capital sera de limiter la pression dans la chaudière (baisse tendancielle du taux de profit).
17.13 Grossmann réécrit le « Capital »
Comme Grossmann n'a rien compris à ce processus il cherche un point absolu, ce qui est la négation de toute dialectique, à la baisse tendancielle du taux de profit. Il prétend l'avoir trouvé par le biais de la masse du taux de profit qui se révélerait insuffisante pour, à un moment (la 35ème année dans son schéma), assurer les besoins croissants de l'accumulation du capital. Pour fonder ses divagations, il commence (cf.17.7) par censurer Marx ; puis, il se voit contraint de le réécrire pour donner à sa théorie un semblant d'orthodoxie.
"Cette circonstance fut apparemment la cause de l'incompréhension de cet aspect fondamental de la doctrine marxienne, parce que le chapitre III de la première section du livre III du "capital"- dans lequel est traité la relation entre le taux de profit et le taux de plus-value et qui plus loin sert de base pour la déduction de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit – soit exposée "en une série de raisonnements mathématiques incomplets". Engels – qui fait cet avertissement dans la préface – se vit obligé, pour l'élaboration de cette partie, de recourir à l'aide de son ami Samuel Moore, qui se chargea de l’'élaborer’, ce pourquoi "le servait son ancien statut de mathématicien à Cambridge". Mais Moore n'était pas économiste, et en fin de compte le traitement de telles questions, même sous forme mathématique, sont des problèmes économiques. La forme dans laquelle sortit cette partie de l’œuvre rend crédible d’avance l'existence d'abondantes opportunités pour des méprises et des erreurs tout comme le fait que ces erreurs puissent en conséquence être facilement transmises au chapitre de la baisse tendancielle du taux de profit ne serait ce que par la consonance entre ces deux chapitres étroitement liés.
La probabilité d'erreur augmente jusqu'à la quasi-certitude quand on considère qu'il s'agit ici d'un mot, qui malheureusement modifie complètement le sens de l'exposition : la fin inévitable du capitalisme est attribuée à la baisse relative du taux de profit et non à la masse du profit. Ici en toute certitude, Engels ou Moore se trompèrent en l'écrivant !" (Grossmann, La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste, Siglo XXI, p. 129-130)
On pourra admirer la prudence cauteleuse avec laquelle Grossmann instille son fiel, comment il progresse dans l'insinuation pour préparer ses trucages et autres réécritures. En virtuose de la reptation venimeuse et lâche le voilà maintenant qui s'engage dans une note en bas de page pour porter un dernier coup à la théorie de Marx :
"La signification de la théorie marxienne gagnerait beaucoup en clarté si on introduisait une correction dans ce sens, pour lequel on se servira des passages suivants généralement connus « (...) à mesure que progresse le procès de production et d'accumulation, doit augmenter la masse de surtravail susceptible d'appropriation et appropriée et enfin la masse absolue du profit approprié par le capital social. Mais les mêmes lois de la production et de l'accumulation accroissent, avec la masse, la valeur du capital constant, en progression toujours plus rapide que le capital variable, que la partie du capital échangée contre du travail vivant. Les mêmes lois produisent donc, pour le capital social, une masse absolue de profits en hausse (et un taux de profit en diminution). ». Dans les mots mis entre parenthèse Engels ou Marx lui-même se trompe : il devrait dire de manière correcte "et en même temps une masse de profit qui décroît relativement". La masse de profit croît absolument et la même masse de profit décroît en terme relatif. Déjà de la seule construction de la phrase il résulte logiquement cette correspondance. Ceci ne peut se référer alors qu'à la masse du profit. Le taux de profit ne décroît pas de manière relative mais absolue." (Grossmann, La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste, Siglo XXI, p. 130)
Alors que le point de vue de Marx est parfaitement clair et recoupe tout ce qui est dit par ailleurs, Grossmann échafaude, sans vergogne, les explications les plus abracadabrantes pour tenter de justifier ses innovations théoriques et les mettre au compte de Marx alors que toute la théorie marxienne proteste contre de telles conceptions.
17.14 De la théorie de l’effondrement à l’effondrement de la théorie
17.14.1 De la surpopulation
Nous ne sommes pas au bout de nos peines quant aux turpitudes de Grossmann. Il faut également voir comment Grossmann truque sa présentation de l'effondrement du capitalisme. Il se livre à un tour de passe-passe qui lui permet d'accentuer la crise et la chute du taux de profit qui, selon lui, est le corollaire de sa théorie. Bien plus, ce n'est qu'au prix de ce genre de présentation qu'il peut, même en suivant son point de vue, parler, du bout des lèvres, de dévalorisation.
En effet, lorsque surgit le déséquilibre, créé de toute pièce, entre le besoin d'accumulation imaginaire et la masse de plus-value disponible pour satisfaire ce besoin, Grossmann fait porter le déficit d'abord sur la force de travail. Il suppose (en vertu de quelle logique? Nous ne le saurons jamais!) que l'accumulation en moyens de production passe avant celle en force de travail. Par conséquent, il aggrave artificiellement l'armée de réserve, qui, prétend-t-il, nous y reviendrons plus loin, se forme à cette occasion.
De son point de vue, nous avons, en fait, un besoin imaginaire et une masse réelle de plus-value qui ne sont pas en adéquation.
A partir de ce moment, pourquoi faire porter ce déséquilibre sur le seul capital variable ? Même en acceptant les prémices du raisonnement de Grossmann, pourquoi la classe capitaliste, même affamée comme le veut Grossmann et donc avec une raison passablement altérée, se mettrait-elle à n'accumuler que du capital constant sans accumuler parallèlement le capital variable nécessaire à la mise en oeuvre du premier ?
Quel capitaliste achèterait, par exemple, des machines et les matières premières pour réaliser un ouvrage pour ensuite s'apercevoir qu'il ne peut pas payer les salaires pour employer les ouvriers ?
Comme à son habitude, les conceptions de Grossmann ne sont que des constructions de l'esprit, généralement incohérentes, et dont il tente de masquer les énormes défauts par un discours fleuve, "érudit", où le moindre argument est ressassé jusqu'à endormir le lecteur dans l'espoir de lui faire oublier les invraisemblances accumulées et de le convaincre, par lassitude, que tout ce bric-à-brac a un quelconque rapport avec la théorie de Marx.
Suivons bien la pratique de Grossmann. Lors de la 34ème année, nous nous trouvons dans la configuration suivante[88] :
4.641.489 c + 500.304 v + 500.304 pl = 5.642.097
Le taux de profit pl/(c+v) est égal à 9,7%. La part de la plus-value consommée est progressivement tombée à 2,2% tandis que la part de la plus-value accumulée, le taux d'accumulation s'élève à 97,8 %.[89]
En masse, la plus-value se décompose donc en 11.141 de plus-value consommée contre 489.163 de plus-value accumulée. Celle-ci se décompose elle-même en 464.148 de plus-value accumulée sous forme de capital constant et 25.015 de plus-value accumulée sous forme de capital variable.
Cette accumulation va porter le capital constant à 5.105.637 et le capital variable à 525.319. La plus-value créée est du même montant soit 525.319. L'année suivante, en suivant la logique de Grossmann, le "besoin en plus-value" compte tenu du capital déjà accumulé sera de 10% du capital constant déjà accumulé soit 510.563 pour le capital constant et 26.265 pour le capital variable qui ne croît que de 5% l'an. Pour qu'une telle accumulation soit possible, il faut au moins une plus-value de 510.563 + 26.265 soit 536.828. Il s'agit du minimum de plus-value nécessaire puisque une telle masse ne permet pas d'assurer la consommation individuelle des capitalistes. Or la plus-value disponible est de 525.319. Nous avons vu qu'il suffisait, toutes choses égales par ailleurs de réduire proportionnellement l'accumulation pour que ce prétendu déséquilibre disparaisse de lui-même mais Grossmann, à la différence de capitalistes, n'est pas sans ressources. Au lieu de réduire proportionnellement l'accumulation en fonction de la plus-value réellement disponible il affecte celle-ci d'abord au capital constant.
Pour la nouvelle phase d'accumulation, la composition organique relative à la plus-value accumulée, la composition organique marginale est de 510.563 / 26.265 soit 19,43. Si nous rapportons cette composition organique à la plus-value disponible soit 525.319 nous obtenons la répartition suivante entre le capital constant et le capital variable: 499.605 c + 25.714 v. Mais Grossmann ne raisonne pas du tout ainsi. Il commence par utiliser toute une partie de la plus-value pour couvrir la demande de capital constant soit 510.563. Il défalque le capital constant accumulé de la plus-value existante soit 525.319. De cette opération (525.319 – 510.563) il reste une plus-value de 14.756 qui est employée comme capital variable. Puis Grossmann triomphe : il manque une masse de plus-value de 26.265 – 14.756 = 11.509 qui accumulée comme capital variable aurait permis d'accroître la force de travail employée. Donc une surpopulation apparaît, du fait du ralentissement brutal du capital variable accumulé.
17.14.2 De la surproduction
Le procédé pour faire naître un tel déséquilibre est, nous l'avons vu, du plus haut comique ; comme si des capitalistes allaient accumuler du capital constant sans se soucier du capital variable qui est nécessaire à son fonctionnement.
Mais Grossmann n'a pas fini de nous étonner avec des acrobaties théoriques qui défient les lois non seulement de la dialectique mais aussi du bon sens. Après avoir introduit de toute pièce le déficit de capital variable et l'excédent de capital constant, le voilà qui officialise, après la surpopulation, la surproduction de capital, le capital excédentaire.
Bien entendu Grossmann n'ose pas tirer la ficelle qu'il vient de manipuler. Il n'ose pas dire que puisqu'il manque un capital variable de 11.509, le capital en excédent c'est-à-dire le capital qu'il est impossible de faire fonctionner équivaut à 223.619, c'est-à-dire le capital constant que devaient mettre en oeuvre les 11.509 de capital variable sur la base de la composition organique marginale (19,43).
Une telle pratique, qui correspond à la logique de Grossmann aurait été par trop grossière et la supercherie comme le caractère fallacieux du raisonnement bien trop éclatants.
Avec ce qu'on peut appeler, son goût de la dissimulation, dont il fait souvent preuve, Grossmann noie le poisson du capital variable additionnel inemployé dans l'océan de la masse du capital total. Grossmann calcule donc la composition organique moyenne pour l'ensemble de la société lors de la 36ème année soit environ 10,18 (5.616.200 / 551.584) pour appliquer cette composition organique à la population productive employée soit 540.075 (525.319 + 14.756) ce qui nous donne un capital constant utilisé de 5.499.015 et un capital constant excédentaire de 117.185 (5.616.200 – 5.499.015 ou 11.509 x 10,18).
Et voilà par quels subterfuges Grossmann tente de mettre en évidence une surproduction ! Après avoir créé une pénurie artificielle de force de travail, il s'évertue à montrer que du même coup du capital constant reste inemployé. Après avoir mis en place une disproportion imaginaire comme fondement des crises, Grossmann, en adepte du raisonnement circulaire, organise une autre disproportion qui se traduit par un excédent de capital constant d'un côté et un déficit de capital variable de l'autre.
Notons qu'à partir de ce moment, Grossmann n'admet implicitement qu'une surproduction de capital constant. Ce qu'il appelle capital en excédent ne vise que le capital constant puisque le capital variable est quant à lui, au contraire, insuffisant. Tout cela encore n'a rien à voir avec Marx puisque la suraccumulation de capital concerne, chez lui, l'ensemble du capital, quels que soient ses constituants, donc aussi bien la plus-value que le capital constant ou le capital variable. Chez Marx, d'un côté l'argent reste inemployé et excédentaire, de l'autre les marchandises invendues s'entassent, les machines ne tournent plus, la force de travail reste sur le carreau.
17.14.3 De la dévalorisation
A l'issue de ces opérations, Grossmann introduit le concept de "dévalorisation" qui correspond chez Marx à une baisse de la valeur du capital et est un concept essentiel pour la compréhension des crises de la production capitaliste. Dans la théorie de Grossmann, il surgit en contrebande.
Si la situation décrite reste un phénomène qui persiste, il équivaudrait alors à une décomposition du mécanisme capitaliste, c'est-à-dire à sa fin économique. L'accumulation non seulement serait inutile pour la classe capitaliste, mais elle serait objectivement impossible, étant donné que le capital suraccumulé improductif, ne pourrait entrer en fonction et n'entraînerait ni valorisation ni un quelconque profit. On assiste à un chute brutale qui provoque une forte dévalorisation du capital.
Dans quelles conditions une telle dévalorisation peut-elle intervenir ? Que signifie t-elle dans un tel cas de figure, dans une telle conception théorique ? Grossmann ne va guère au delà du concept qu'il vient d'introduire en fraude. Une fois son forfait accompli, il fait diversion et engage la discussion vers d'autres voies.
17.15 La théorie de la surpopulation
Outre le concept de dévalorisation que Grossmann ne peut éluder tant il est présent dans l’œuvre de Marx mais qui surgit ici comme un cheveu sur la soupe, Grossmann se voit contraint de réviser intégralement la théorie marxienne de la surpopulation. En effet, ce n'est que lors de la 35ème année que se présente une surpopulation. L'une des conséquences de l'accumulation accélérée de la plus-value malgré la baisse du taux de profit est que la force de travail employée (pour un salaire supposé constant) augmente au rythme de 5% l'an, soit le taux d'accroissement du capital variable. L'idée que le taux d'accumulation augmentait alors que le taux de profit baissait était fantaisiste et contredisait ce que Marx avait écrit sur le sujet. Voilà désormais qu'elle entre en contradiction avec un autre point cardinal de la théorie de Marx, la théorie de la surpopulation relative. Grossmann qui, nous l'avons vu, a pu masquer le premier aspect en truquant les citations ne peut ici éviter l'obstacle. Qu'à cela ne tienne ! Grossmann se lance alors dans une reconstitution toute personnelle de la théorie de la surpopulation.
"(...) le déplacement des ouvriers, le surgissement de l'armée de réserve industrielle dont Marx parle dans le chapitre sur l'accumulation n'est pas causée (et ceci a été omis dans la littérature sur ce thème[90]) par le fait technique de l'introduction de la machine mais par la valorisation insuffisante qui apparaît dans une certaine phase avancée de l'accumulation. Si bien que la cause qui l'engendre trouve son origine exclusivement dans le mode de production spécifiquement capitaliste. Les ouvriers sont déplacés non parce qu'ils sont expulsés par les machines mais parce qu'à un niveau déterminé de l'accumulation le profit devient trop petit, par conséquent celle ci n'advient pas et le profit est insuffisant pour acheter les machines suffisantes etc." (Grossmann, La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste, Siglo XXI, p. 88)
Grossmann nie donc toute la conception de Marx, de la formation de l'armée de réserve industrielle avec la hausse de la composition organique du capital, pour n'admettre comme surpopulation que celle qui surgit avec la crise. Encore avons nous vu que sa conception n'avait pas de fondement et qu'il exagérait la croissance de la population en excédent. Par ailleurs, la solution de son problème montre que la théorie de Marx est la seule valide. En effet, quand l'ensemble de la plus-value est accumulé, donc quand la plus-value est insuffisante pour que la masse de la plus-value accumulée compense les effets de la hausse de la composition organique du capital, nous assistons à l'apparition d'une surpopulation, apparition qui n'est pas synonyme de crise comme Marx l'a démontré mais peut parfaitement rimer et rime avec accumulation du capital.
"La réserve industrielle est d'autant plus nombreuse que la richesse sociale, le capital en fonction, l'étendue et l'énergie de son accumulation, partant aussi le nombre absolu de la classe ouvrière et la puissance productive de son travail, sont plus considérables. Les mêmes causes qui développent la force expansive du capital amenant la mise en disponibilité de la force de travail, la réserve industrielle doit augmenter avec les ressorts de la richesse."
(Marx, Capital, L.I, Pléiade, t.1, p.1162)
Grossmann s'imagine qu'il y a lieu de distinguer le déplacement de force de travail dû à la machine, phénomène qui serait valable pour tous les modes de production qui connaissent ce procès de travail, de la surpopulation qui apparaît quand la plus-value serait insuffisante. Seule cette surpopulation serait imputable au mode de production capitaliste et serait l'essence de la théorie de Marx.
Or, rien n'est plus faux.
La théorie de Marx montre comment se développe contradictoirement la productivité du travail dans le mode de production capitaliste. Si le système reposant sur l'exploitation du travail salarié a permis de développer la force productive du travail, ce développement entre en conflit avec les buts limités qui fondent les rapports de production capitalistes : la recherche du maximum de plus-value.
Ce développement contradictoire s'exprime par la hausse du taux de plus-value, la hausse de la composition organique, la croissance du travail improductif, le développement du capital fixe, la baisse tendancielle du taux d'accumulation et du taux de profit. Cette baisse tendancielle se traduit également par une croissance de la surpopulation relative. Dans les phases d'expansion cette surpopulation est a la fois créée d'autant plus que la composition organique s'élève et donc que le potentiel productif s'accroît. En même temps le développement accéléré de la productivité du travail donne les moyens de résorber cette surpopulation par l'accélération de l'accumulation et la hausse de la plus-value dédiée aux travaux improductifs. Ce mouvement contradictoire se traduit par un brutal gonflement de l'armé de réserve lors des crises et une résorption d'autant plus lente que le taux de profit du cycle baisse tendanciellement d'un cycle productif à l'autre.
Il ne s'agit donc pas de deux aspects différents mais de la même expression capitaliste du progrès de la force productive du travail.
Dans une société communiste ce même progrès se traduirait non par le chômage, l'accroissement du surtravail, le développement du travail improductif mais par l'abaissement du temps de travail. La réduction du temps de travail est l'un des fondements de la politique révolutionnaire du prolétariat.
17.16 Grossmann et le cycle industriel
La théorie de Grossmann, comme nous l'avons montré repose sur le sable et n'est que poudre aux yeux. En liant l'accumulation du capital au volume du capital déjà accumulé et tout particulièrement au capital constant, il crée une pénurie artificielle de plus-value. Il introduit notamment une contradiction dans la théorie de Marx en prétendant que la baisse du taux de profit et l'augmentation du taux d'accumulation vont de pair alors que Marx soutient explicitement l'inverse. Pour Grossmann, c'est le début d'un long calvaire. Les contradictions les plus criantes avec la théorie doivent être gommées et les autres doivent être expliquées à toute force ce qui conduit Grossmann à des acrobaties théoriques pitoyables. Si Grossmann n'hésite pas à falsifier Marx, à le réécrire, il n'hésite pas non plus à employer un énorme chausse-pied, pour faire entrer la théorie de Marx, beaucoup plus vaste, dans la chaussure à clous étriquée qu'il fabrique, quitte à amputer tout ce qui pourrait dépasser et meurtrir le reste.
Grossmann ne peut esquiver, notamment, le fait que les crises aient, chez Marx, un caractère cyclique. Toute sa vie Marx chercha à en déterminer ou approfondir les fondements. La valorisation du capital est chez Grossmann une affaire réversible. Il ne s'agit pas de l'essence d'un mode de production particulier, c'est-à-dire le mode de production capitaliste, mais d'une opération économique qui peut revêtir des sens différents.
Pour Marx elle est le symbole de la valeur parvenue à l'autonomie, de la valeur qui cherche à s’accroître d'un maximum de survaleur, de plus-value. Cela suppose l'existence du travailleur libre, de l'ouvrier salarié qui en vendant sa force de travail aliène la capacité de celle-ci à produire une valeur extra au capitaliste qui personnifie le capital. Pour Grossmann l'affaire est beaucoup plus simple ou complexe, comme l'on voudra. Ne s'imagine-t-il pas que, quand le capitalisme entre en crise - crise établie selon son point de vue (nous avons montré qu'il s'agissait de crises imaginaires) - c'est parce qu'il apporterait ses bienfaits aux ouvriers tout en réduisant les intérêts de la classe capitaliste à zéro ? Dans son exemple, Grossmann en arrive à la conclusion que, en faisant dérouler son schéma, à un certain moment (pour lui la 35° année), la consommation de la classe capitaliste tombe à zéro et donc celle-ci n'a plus aucun intérêt à accumuler.
Le mécanisme de l'exploitation, est ainsi relégué au second plan au bénéfice de celui de la distribution. Si nous nous représentons le mode de production capitaliste dans sa forme la plus pure, où la valeur-capital exploiterait le prolétariat sans la moindre dépense de plus-value pour entretenir la classe capitaliste, ou sans que la classe capitaliste ne consomme de plus-value, bref en admettant que le capital n'ait en face de lui que du travail salarié productif et que le capital soit constitué uniquement de capital industriel engagé dans les diverses sphères de la production de plus-value, nous serions alors dans les conditions où le capital qui vise à la recherche du maximum de plus-value, à l'accumulation pour l'accumulation s'exprimant sans facteurs médiateurs serait, pour Grossmann, le socialisme réalisé. La classe capitaliste n'existant pas ou étant réduite à une fonction productive de direction et de coordination du travail social elle n'obtiendrait aucune part de la plus-value ; les seuls revenus venant du salaire. Ce qui revient à dire que, pour Grossmann, les salariés bénéficieront des fruits du système de production alors que l'exploitation y serait portée au maximum ; la tendance immanente du capital, la recherche du maximum de survaleur, l'accumulation pour l'accumulation de valeur extra supplémentaire y étant réalisée. Belle conception que celle de Grossmann qui s'imagine que le mode de production capitaliste, l'existence de la valeur autonome et du salariat, pourrait aller de pair avec l'émancipation du travail alors que le communisme implique la disparition de ces catégories. Si le communisme de Marx vise à la société sans Etat, sans classe et sans argent, la société de l'avenir de Grossmann est l'esclavage salarié surveillé par l'Etat.
Nous avions vu que, pour Grossmann, la « crise » se présentait sous la forme d'une disproportion imaginaire où une surproduction imaginaire de capital constant faisait face à une imaginaire force de travail inemployée.
Puis Grossmann cite Marx. Dans l'extrait cité il ressort (et ce point de vue est répété en bien d'autres endroits), que la surproduction concerne l'ensemble du capital social, c'est-à-dire aussi bien les moyens de production que les moyens de consommation, le secteur I que le secteur II et plus généralement l'ensemble des branches du capital social. Marx parle d'une "baisse du degré" d'exploitation de la force de travail avec pour conséquence une baisse brutale du taux de profit. Il s'ensuit une paralysie du processus de production, une crise dont la manifestation et la solution reposent sur la dévalorisation brutale (baisse des prix, destruction, etc.) du capital existant.
« Cette baisse du taux de profit dans la phase de suraccumulation diffère, cependant, de la baisse du taux de profit dans l'état initial de l'accumulation du capital. La baisse du taux de profit en elle-même constitue un phénomène qui accompagne constamment l'accumulation au cours de ses phases successives, y compris les premières phases de celle-ci, c'est-à-dire celles pendant lesquelles s'accumule une masse croissante de profit et dans celles où cela se produit en liaison avec la croissance de la partie k, destinée à la consommation de la classe capitaliste. (Nous laissons ici de côté les parts ac et av de la plus-value destinées à l'accumulation) » (Grossmann - La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste. Ed. Siglo XXI P.83. Traduit de l'espagnol par CouC)
Après avoir ainsi crée de toutes pièces une surproduction, (encore n'est-elle que partielle), Grossmann continue à se débattre dans d'inextricables contradictions. La baisse du taux de profit est permanente dans le schéma. En aucun cas elle ne prend de caractère brutal. Grossmann en vient même à se poser la question de savoir à quel niveau la baisse du taux de profit se traduit-elle par une crise ? Question qui est le pont aux ânes de toute l'économie politique marxiste. De Grossmann à Tugan-Baranovsky, du CCI en passant par Chaulieu-Castoriadis, qui ne l'a pas posée dans une forme aussi vulgaire ? La « solution » de Grossmann consiste à fonder la crise sur l'apparition d'un point de rupture qui correspond, dans sa représentation schématique, au moment où la masse de plus-value devient insuffisante pour poursuivre l'accumulation sur les bases initiales définies. Pour d'autres, qui marquent une hostilité marquée à la théorie de la baisse du taux de profit, le CCI par exemple, on affirme qu'une situation de ce genre, c'est-à-dire l'existence d'un point particulier, « absolu », qui permettrait de tracer une ligne de démarcation entre la crise et l'accumulation et donc permettrait d'affirmer que la baisse du taux de profit induit une crise de surproduction, n'existe pas. Ils en concluent que la théorie de Marx est fausse ou insuffisante. Contre ceux qui la falsifient et ceux qui la nient la défense et l'approfondissement de la théorie révolutionnaire restent une tâche fondamentale du parti communiste.
Grossmann se trouve donc confronté à la théorie de Marx et à ses affirmations qui sont autant de démentis, à sa conception. Il se lance alors dans de nouvelles falsifications. S'il distingue justement la baisse du taux de profit qui intervient dans les crises, de la baisse du taux de profit qui accompagne l'accumulation, (il s'agit alors d'une baisse tendancielle), encore faudrait-il définir les conditions qui font que la baisse du taux de profit se traduise par une crise. Toute baisse du taux de profit n'est pas synonyme de crise. Mais inversement un niveau élevé du taux de profit ne met pas le capital à l'abri d'une crise de surproduction. Marx a en fait très bien défini dans quel cas la baisse (brutale ) du taux de profit était concomitante d'une crise de surproduction. C'est quand le "degré d'exploitation du travail baisse". Par conséquent, quand par rapport à la tendance du capital qui est l'élévation du degré d'exploitation du travail un retournement brutal de cette tendance apparaît, le taux de profit fléchit brusquement. C'est la crise. Ce phénomène pouvant intervenir à n'importe quel niveau du taux de profit, c'est donc un point "relatif" et non "absolu" au sens où on assimile la baisse du taux de profit, a un processus mécanique, ce qui impliquerait que des rapports de cause à effet identiques provoquent la même réaction au même moment.
La distinction de Grossmann n'est guère destinée à faire avancer la compréhension de la théorie de Marx, elle est plutôt là pour poignarder Marx. La distinction correcte aurait été de dire que la baisse brutale du taux de profit qui se manifeste au moment des crises et de la baisse tendancielle du taux de profit qui s'étend sur plusieurs cycles d'accumulation doivent être distinguées tout en montrant leurs connexions. En fait, après avoir esquivé le problème de la baisse brutale (aucun phénomène de ce genre n'intervient dans la perspective de Grossmann), voire l'avoir nié (cf. ci-dessus les positions de Grossmann sur l'existence de ce que nous appelons un "point absolu"), il lui faut justifier la baisse régulière du taux de profit qui accompagne l'accroissement du taux d'accumulation. Cette première contradiction a fait l'objet des falsifications que l'on a déjà décrites. Grossmann maintenant récidive. Il cite Marx en l'augmentant de commentaires de son cru.
« Mais, au-delà de certaines limites - dit Marx - (dans notre exemple nous désignions cette limite par r qui dans l'exemple schématique que nous présentons fait son apparition lors de la 21ème année de l'accumulation), la baisse de la partie k, destinée à la consommation de la classe capitaliste, et peu après, par la baisse des parties restantes de la plus-value destinée à l'accumulation. "La baisse du taux de profit serait accompagnée dans ce cas par une diminution de la masse absolue du profit (...) et la masse diminuée des profits devrait être calculée sur un capital total augmenté » (op. cit. P.83,84)
Or, dans quelles conditions Marx se place-t-il ici ? Si nous nous reportons à la citation utilisée, supposée illustrer les propos de Grossmann nous ne pouvons que constater que Marx se situe dans un cas bien particulier, celui où la composition organique du capital ne subit pas de modifications du fait d'une modification dans sa composition technique, qu'il n'y a donc pas de progrès de la force productive du travail. Le cas envisagé par Marx s'efforce de montrer comment la baisse du taux de profit intervient. Pour ce faire, dans une perspective didactique, il neutralise le procès valorisation-dévalorisation. D'un point de vue théorique, nous sommes de fait ramenés à une phase dépassée du mode de production capitaliste, la phase de soumission formelle du travail au capital, quand le capital constant est faible et le capital variable développé, que le procès de valorisation repose sur la production de plus-value absolue. Marx n'envisage ici, pour bien faire comprendre le concept de suraccumulation, que la suraccumulation absolue telle qu'elle peut apparaître sans faire intervenir le procès valorisation-dévalorisation. Les modifications dans la composition organique et la baisse du taux d'exploitation résultent d'une hausse du salaire qui provoque une baisse sensible du taux de profit.
« Il y aurait aussi une baisse sensible et subite du taux général de profit, mais la cause en serait cette fois un changement dans la composition du capital, dû non pas au développement des forces productives, mais à une hausse dans la valeur monétaire du capital variable (en raison des salaires accrus) et à la diminution correspondante dans le rapport du surtravail au travail nécessaire » (Marx. Capital Livre III. La Pléiade t.2 P.1034)
Cette perspective est toujours nette dans la citation de Marx reprise par Grossmann et qui figure 10 lignes sous celle que nous venons de citer. Mais Grossmann s'est empressé de la tronquer. « La baisse du taux de profit s'accompagnerait cette fois d'une diminution absolue de la masse du profit, [puisque dans les conditions que nous supposons, la masse de la force de travail employée et le taux de plus-value ne seraient pas accrus, si bien que la masse de plus-value ne pourrait pas non plus être augmentée](la partie tronquée par Grossmann est ici entre crochets). Et la masse de profit réduite serait à calculer sur un capital total accru » (Marx op. cit. P.1034)(Souligné dans notre édition par Grossmann)
Comme on peut le voir, les conditions dans lesquelles s'appliquent une telle constatation, diminution de la masse du profit, sont particulièrement limitées. Elles correspondent à des hypothèses qui n'ont aucun rapport avec celles dans lesquelles Grossmann évolue. C'est-à-dire développement de la force productive du travail dont l'une des expressions est l'élévation de la composition organique du capital, le capital constant s'accroissant plus vite que le capital variable, et une augmentation de la force de travail en action sous l'influence de l'accumulation de la plus-value. Dans un tel cas de figure, quand la contradiction entre la valorisation et la dévalorisation du capital se réalise, quand le procès de valorisation repose sur la création de plus-value relative, quand le taux d'exploitation prospère sous l'effet non pas de l'allongement de la journée de travail (ce cas n'est pas nécessairement exclu pour autant) mais de l'abaissement de la valeur de la force de travail tandis que l'intensité du travail se développe parallèlement, nous sommes théoriquement dans le cadre de la phase de soumission réelle du travail au capital et la suraccumulation du capital ne résulte pas d'une hausse du salaire, le degré de la force productive demeurant inchangé.
Grossmann une nouvelle fois s'est mué en faussaire. Cela fait déjà deux fois que nous le prenons sur le fait, en flagrant délit de trucage. Ce n'est plus un "accident" mais une action systématique pour faire "coller" à toute force une interprétation erronée avec la théorie de Marx.
Bien que reposant elles-mêmes sur une mauvaise compréhension des conceptions de Marx, les déclarations de Mattick, disciple de Grossmann, sur la suraccumulation absolue montrent a contrario que nous sommes bien, avec les hypothèses retenues par Marx, dans un cadre complètement différent de celui retenu par Grossmann pour établir sa théorie des "crises".
« Selon lui (Martin Trottmann - un critique de Grossmann- NDR), Marx en parlant de suraccumulation absolue avait en tête une surproduction consécutive non à une valorisation imparfaite, mais à un manque de force de travail ayant comme conséquence d'élever les salaires et de faire baisser la plus-value. Cependant, le fait que dans les deux cas, le résultat final soit le même, à savoir la suspension de l'accumulation par suite d'un manque de profit, échappa à Trottmann. C'est cet état de choses que Marx voulait mettre en évidence, bien que son exemple soit boiteux et contredit toutes les données de l'expérience et jusqu'à la théorie marxienne de l'accumulation elle-même » (Mattick, Crises et théories des crises Champ libre. p.87-88)
Mattick confirme ici que le cadre théorique considéré par Marx n'est pas le cadre habituel où Grossmann prétend évoluer. Dans la phase de soumission réelle il suffit que la suraccumulation soit relative pour que la crise soit manifeste. Il n'est pas nécessaire que le profit baisse absolument. Si ce cas se présente c'est que la crise est spécialement profonde. Quant à l'idée que cette crise est précédée d'une baisse de la consommation de la classe capitaliste, elle est dénuée de fondement. Là où Grossmann ne manque pas de culot c'est quand il prétend appuyer ses déductions théoriques sur des travaux empiriques qui démontrent l'inverse. Trois études, celle de Mitchell en 1927 pour les Etats-Unis, de Stamp (1918) pour l'Angleterre de 1880 à 1914 et de Lescure pour la France de 1874 à 1919 démontraient que le taux de profit croît de manière ininterrompue dans les périodes de prospérité pour connaître un déclin au moment des crises. Ces faits, loin d'aller dans le sens de Grossmann se retournent contre lui. Entre deux crises nous n'avons pas une baisse régulière du taux de profit comme la représentation schématique de Grossmann nous le présente mais une tendance à la hausse. La crise survenant plutôt à l'apogée du taux de profit et non à la fin d'une longue glissade, à son point le plus bas. Mais d'un cycle à l'autre, la moyenne des taux de profit du cycle aura tendance à baisser. C'est ce dernier phénomène que Marx décrit sous le concept de baisse tendancielle du taux de profit. A l'intérieur du cycle, la recherche du maximum de plus-value conduit à une élévation du taux de profit, qui s'achève par une nouvelle crise. Il manque plusieurs dimensions dans la conception de Grossmann. D'une part, le taux de profit y baisse régulièrement, d'autre part, la crise survient sans baisse brutale du taux de profit. Les conceptions théoriques sont manifestement en contradiction, à l'inverse de celles de Marx, avec les faits établis par les auteurs que nous avons cités, mais Grossmann n'est plus à un mensonge près. Par ailleurs, Grossmann ne peut ignorer que la théorie de Marx est aussi une théorie du cycle. Grossmann en vient donc naturellement à présenter sa conception comme représentative de la théorie du cycle industriel. « La théorie marxienne du cycle économique et qui conçoit la valorisation croissante du capital social comme la cause décisive de l'accumulation du capital en même temps qu'elle attribue à la valorisation insuffisante le virage dans le sens de la crise, se sont entièrement confirmé par les recherches empiriques les plus récentes. » (Grossmann P.84)
Nous avons vu ce qu'il fallait penser de la confrontation de la théorie de Grossmann avec les faits, voyons maintenant le cycle économique. Le cycle de Grossmann ne peut que se présenter ainsi. L'accumulation accélérée du capital liée à une baisse graduelle du taux de profit (ce qui est une contradiction théorique et démenti par les faits) laisse place à une tendance à l'effondrement. Grâce à une "dévalorisation" dont les modalités sont évidemment éludées le capital se retrouve au niveau adéquat pour reprendre le chemin de l'accumulation. A un moment donné les mêmes problèmes vont se manifester, la tendance à l'effondrement s'affirmer à nouveau quand le capital accumulé est trop important. D'après Grossmann, nous avons là une théorie des crises, c'est-à-dire qu'il réintroduit ici le caractère cyclique des crises sans vouloir l'approfondir véritablement. En effet, pour Grossmann il ne peut s'agir que d'une suite de péripéties sur le chemin de la "crise ultime". La tendance fondamentale vers l'effondrement se décompose en une série de cycles, et cette tendance se présente périodiquement. Mais au-delà des vicissitudes, la tendance à l'effondrement est toujours plus présente et mène le capitalisme vers sa crise finale.
« De cette manière, la tendance à l'effondrement en tant que "tendance de base" naturelle du système capitaliste, se décompose en une série de cycles, en apparence indépendants, où la tendance à l'effondrement s'impose seulement périodiquement, une fois ou l'autre, de la même manière que le processus naturel de croissance de la laine des ovins est interrompu avec chaque tonte, pour recommencer ensuite. La théorie marxienne de l'effondrement constitue pour cela le présupposé et le fondement nécessaire de la théorie des crises, parce que la crise, selon Marx, représente seulement une tendance à l'effondrement momentanément interrompue et qui n'a pas atteint son plein développement, ou alors qui représente une déviation passagère de la ligne tendancielle suivie par le capitalisme.
Mais malgré toutes les interruptions périodiques et atténuations de la tendance à l'effondrement, avec le progrès de l'accumulation, le mécanisme global marche nécessairement vers sa fin, car avec la croissance absolue de l'accumulation du capital, la valorisation du capital devient toujours plus difficile. Si ces tendances contraires parvenaient à atténuer ou paralyser - l'exposé de ces tendances contraires et leur dynamique forme le contenu du troisième chapitre de ce livre - alors la tendance à l'effondrement acquiert une prédominance et s'impose dans sa validité absolue comme crise "ultime" »(P 95)
La conception de Grossmann présentée par lui comme identique à celle de Marx est des plus vulgaires. Elle ressemble à la pratique des patriciens romains dans les orgies. Le capital s'accumule comme la nourriture au fond de l'estomac et à chaque bouchée il faut enfourner plus de nourriture. Quand le capital est suraccumulé, quand les dents du fond de notre patricien baignent, le capital connaît une profonde dévalorisation, notre romain se met alors les doigts au fond de la gorge et se précipite aux vespasiennes. Le plus grand silence entoure les modalités de cette dévalorisation (de ce point de vue il y a une différence avec le patricien qui vomit tout son content). Quels sont les rapports qui sont modifiés ? dans quelles proportions ? Pourquoi le capital, étant donné la composition organique atteinte et les besoins en plus-value, peut-il connaître un nouveau cycle d'accumulation ? ou comment le patricien peut-il à nouveau recommencer à manger alors que la dernière bouchée est toujours plus importante et qu'à elle seule elle devient susceptible de remplir l'ensemble de l'estomac ?
En fait le point de vue de Marx implique que l'organisme boulimique de plus-value, donc recherche des bouchées toujours plus grandes qui sont assimilées tandis que les déjections sont régulières. Périodiquement la bouchée attendue se révèle insuffisante en regard des besoins de l'organisme et provoque une mauvaise ingestion et aiguillage de la nourriture qui doit être expulsée violemment (toux et vomissement). La crise passée, l'organisme affaibli mais remis en place peut reprendre sa course et sa fortification jusqu'à la prochaine crise. Celle-ci est indépendante du volume général atteint par les bouchées si ce n'est que plus l'organisme à de besoins plus les crises sont grandes. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un moment absolu, quand le corps serait saturé de nourriture au point de ne plus rien pouvoir avaler, mais d'un moment relatif, d'une insuffisance de nourriture par rapport aux besoins (croissants) nécessaires. On ne peut attendre le trépas de l'intéressé de la crise mais par contre sa fragilisation temporaire avec une relative paralysie pouvant donner l'opportunité de le terrasser. Dans des conditions historiques déterminées, ou au sein d'un cadre géopolitique défini, nous savons que l'organisme ira vers des convulsions toujours plus grandes qui permettent de penser que le monstre peut être achevé sinon il se régénérera au travers de sursauts redoutables, de crises d'une gravité sans précédents. S'il n'y a pas de crise ultime au sens d'une crise économique finale, seul le prolétariat révolutionnaire peut mettre fin à la domination du capital, la contradiction peut connaître un dénouement par la destruction des antagonismes en présence, ce qui signifie la fin de l'humanité.
Après avoir tenté de combiner une théorie aussi pauvre avec l'explication générale du cycle, Grossmann se pose le problème de sa durée. Il est bien évident que de son point de vue la durée du cycle est déterminée par :
1) le niveau de la composition organique
2) l'importance du taux de plus-value
3) le niveau du taux d'accumulation
4) la progression de la composition organique marginale
En d'autres termes, le taux de profit et son niveau et le taux d'accumulation et son niveau. Après de longs détours, Grossmann en arrive, tout en accumulant, à la conclusion ci-dessus qui ne nous a guère éclairé sur la durée du cycle ni sur ces tendances?
C'est que de ce point de vue Grossmann accumule les contradictions avec la théorie de Marx. Dans son schéma le cycle (qui se confond avec la crise finale) dure trente cinq ans. Dans l'hypothèse d'une hausse du taux de la plus-value et donc d'une baisse du taux de profit moindre, la durée du cycle serait allongée. Pour le raccourcir il faut supposer d'une part un accroissement d'autant plus important de la plus-value à accumuler (hypothèse en flagrante contradiction avec la théorie de Marx, mais que Grossmann utilise pour fonder sa théorie) ou d'autre part un accroissement de la composition organique marginale, du rapport du capital constant additionnel au capital variable additionnel. Cette dernière hypothèse suppose de réintroduire une accélération de la baisse du taux de profit que nous venons de limiter par l'élévation du taux de plus-value. En définitive, la crise surviendra d'autant plus vite que le taux de profit baisse et que le taux d'accumulation est élevé, en d'autres termes que les hypothèses contradictoires qui fondent la théorie de Grossmann sont d'autant plus criantes.
Marx travaillait sur l'hypothèse d'un cycle décennal, c'est-à-dire sur la durée du cycle qui s'offrait à ses yeux dans la deuxième moitié du XIX ème siècle. Mais il inférait des lois de la production capitaliste que le cycle irait en se raccourcissant. Des travaux de Grossmann, il ressort que le raccourcissement du cycle est tributaire d'hypothèses contradictoires entre elles et d'autant moins probables que les contre tendances à la baisse du taux de profit (notamment la hausse du taux d'exploitation) se manifestent. Grossmann s'efforce de dissimuler ce point d'une part en ne mentionnant pas les perspectives de Marx d'autre part en bavardant autour d'exemples qui montrent un cycle d'environ dix ans. Par conséquent Grossmann, devenant incapable de fonder véritablement une tendance au raccourcissement du cycle laisse le lecteur dans l'incertitude, en se gardant bien de signaler la totalité de la position de Marx. Pour Marx le temps de rotation du capital fixe, en introduisant une divergence entre la transmission de la valeur au produit, c'est-à-dire le cycle de la valeur et son renouvellement lors de son usure définitive, c'est-à-dire le cycle de la valeur d'usage, était une base matérielle du cycle industriel. S'il n'est jamais parvenu à une solution définitive, il en fera un thème de ses recherches tout au long de sa vie. Avec la rotation du capital fixe, il faut également tenir compte du cycle de la valorisation du capital, qui tend à pousser le taux de profit jusqu'à la limite de rupture ainsi que le cycle du capital dans la sphère financière, avec leur autonomie relative et leurs relations, combinaisons, interpénétrations. De 1815 à 1847 le cycle industriel est d'environ 5 ans. A partir de 1847 il passe à 10 ans. Cette période correspond aussi à l'affermissement de la phase de soumission réelle du travail au capital en Angleterre. C'est-à-dire que le machinisme s'étend dans les diverses branches d'industrie, le capital fixe se développe dans l'ensemble de la société et joue un rôle croissant dans les fondements du cycle industriel et contribue à l'allonger.
« A mesure que la valeur et la durée du capital fixe engagé se développent avec le mode de production capitaliste, la vie de l'industrie et du capital industriel se développe dans chaque entreprise particulière et se prolonge sur une grande période, disons en moyenne 10 ans. » (Marx Pléiade. P.614 T.1)
La phase de soumission réelle instaurée, le développement de la productivité du travail, qui en abaisse la valeur et le progrès technique qui affecte le capital fixe en le rendant obsolète, caractéristiques de cette phase contrebalancent cet allongement "Mais si, d'une part, cette vie est prolongée par le développement du capital fixe, elle est abrégée, d'autre part par le progrès incessant des moyens de production qui va de pair avec le développement du mode de production capitaliste. D'où le renouvellement des moyens de production et leur remplacement continuel par suite de l'usure "morale", bien avant leur usure physique complète."
Dans la mesure où la rotation du capital fixe est un élément de détermination du cycle industriel, elle contribuerait également à son raccourcissement. En tout état de cause la tendance générale de la production capitaliste est la réduction de la durée du cycle.
« Comme les corps célestes une fois lancés dans leurs orbes les décrivent pour un temps indéfini, de même la production sociale une fois jetée dans ce mouvement alternatif d'expansion et de contraction le répète par une nécessité mécanique. Les effets deviennent causes à leur tour, et des péripéties, d'abord irrégulières et en apparence accidentelles, affectent de plus en plus la forme d'une périodicité normale. Mais c'est seulement de l'époque où l'industrie mécanique, ayant jeté des racines assez profondes, exerça une influence prépondérante sur toute la production nationale, où, grâce à elle, le commerce étranger commença à primer le commerce intérieur, où le marché universel s'annexa successivement de vastes terrains au Nouveau Monde, en Asie, en Australie, où enfin les nations industrielles entrant en lice furent devenues assez nombreuses, c'est de cette époque successives embrassent des années et qui aboutissent toujours à une crise générale, fin d'un cycle et point de départ d'un autre. Jusqu'ici la durée périodique de ces cycles est de dix ou onze ans, mais il n'y a aucune raison pour considérer ce chiffre comme constant. Au contraire on doit inférer des lois de la production capitaliste, telles que nous venons de les développer, qu'il est variable et que la période des cycles se raccourcira graduellement. » (Marx, Capital L.I, La Pléiade T.1 P.1149-1150)
On ne s'étonnera pas que fort de l'exemple de Grossmann, son disciple Paul Mattick, minimise l'importance qu'attribue Marx au rôle du capital fixe dans la détermination de la durée du cycle.
"Le cycle déterminé de crises, que le siècle dernier a traversé, constitue cependant un donné empirique dont la théorie marxienne n'a pas traité directement. Certes, Marx devait s'efforcer de rattacher cette périodicité fixe à la rotation du capital. Mais il n'insista guère cependant sur la validité de cette interprétation, et, de toute façon, sa théorie ne prend pas pour base une périodicité particulière des crises. Elle se borne à dire en effet que des crises éclatent forcément, sous forme de surproduction de capital et comme instrument pour assurer la reprise de l'accumulation" (Paul Mattick, Marx et Keynes, Gallimard, P.93)
Comme on peut le constater Mattick n'est pas en reste dès qu'il s'agit de falsifier les positions de Marx, en ce sens il est un bon élève de son maître, le docteur Grossmann.
C'est pourtant en nous rattachant aux analyses de Marx, et en s'appuyant sur les travaux empiriques accomplis depuis 1945, que CouC a pu mettre en évidence le cycle industriel actuel et prévoir les dernières crises qui ont secoué régulièrement la production capitaliste.
17.17 Grossmann et le taux d'intérêt
La théorie de Grossmann est grossièrement mécanique. Il leur est impossible de rendre compte de la réalité de l'accumulation capitaliste qui exige une conception dialectique. Les soubassements théoriques de son analyse, pleinement ricardienne, ont été démontrés dans le numéro 7 de la RIMC. Nous avons vu que le point de vue de Grossmann tournait le dos au communisme scientifique. Comme Grossmann rencontre à, chaque instant des difficultés liées à la différence de ses conceptions d'avec celles de Marx, il lui est toujours plus difficile "d'adapter" son modèle pour le faire ressembler le plus possible aux véritables théories matérialistes. Nous avons vu ici comment de telles tentatives tournaient à la catastrophe à propos du cycle industriel. Remontant un degré dans l'échelle des phénomènes nous allons voir maintenant comment la déroute théorique gagne du terrain en suivant la progression de Grossmann au sujet du crédit et de l'intérêt.
"Une fois que l'on a compris les causes du développement conjoncturel (nous avons vu, en effet à quelle hauteur de "compréhension" nous étions parvenus ! NDR), on peut expliquer alors une série de phénomènes, qui, s'ils ont bien été vérifiés empiriquement, n'ont pas été suffisamment expliqués avec les théories des crises antérieures" (Grossmann opc P.149)
Le lecteur averti des pratiques de Grossmann ne peut ici que se méfier d'autant plus. Voilà Grossmann ouvertement en recherche d'"amélioration", on ne peut que craindre le pire ! Grossmann indique que le cadre général de son analyse implique que soit réalisé un équilibre entre les diverses sphères de la production de la société bourgeoise, que l'accumulation atteint un niveau tel que la force de travail est entièrement employée, tandis que les prix sont constants. Grossmann ajoute que même sur la base de conditions aussi favorables, l'accumulation, à un certain moment, s'effondre. Puis, Grossmann déclare que, dans la réalité, de telles conditions n'existent pas. L'équilibre ne peut être que le fruit du hasard. Deux cas sont donc abstraitement possibles ; l'accumulation est, soit plus élevée, soit inférieure à celle correspondant à la situation d'équilibre. Pour Grossmann seul le deuxième cas est pratiquement possible. Une telle argumentation mérite qu'on s'y arrête. En effet, nous dit Grossmann, comme l'accumulation se fait sur la base de la technique la plus moderne, une accumulation trop grande devrait buter sur la rareté de la force de travail. En y regardant d'un peu plus près, on peut remarquer que ce cas de figure correspond en fait, à la fameuse "crise" pour insuffisance de plus-value. Prenons le point de départ du schéma de Bauer-Grossmann :
200 000 c + 25 000 v
Dans le schéma d'origine on accumule 10% en capital constant et 5% en capital variable soit 20 000 pour l'accroissement du capital constant et 1250 pour l'augmentation du capital variable. La plus-value consommée par le capitaliste s'élève à 3750. Nous avons donc 20 000 ac + 1250 av + 3750 = 25 000. Si l'accumulation était plus importante, par exemple si l'accumulation du capital constant était de 15%, le capital constant nécessaire pour une telle accumulation serait de 30 000, soit une valeur supérieure à la plus-value. Avant même de se poser le problème de la force de travail, nous retrouvons la condition première de la "crise" selon Grossmann, soit l'insuffisance de la plus-value nécessaire pour permettre l'accumulation du capital. En fait donc, la "crise" de Grossmann n'est que l'expression d'un cas de surprospérité de l'accumulation capitaliste, ce que les économistes appellent la "surchauffe", ce qui correspondrait à la phase de sur spéculation du cycle. Non seulement l'accumulation du capital ne serait pas paralysée mais elle battrait son plein, venant se heurter aux limites "naturelles" de l'accumulation, l'élasticité et la plasticité de l'accumulation étant mobilisées au maximum. Reprenons maintenant un exemple qui laisse une place à l'augmentation du capital variable. Si l'accroissement du capital constant est de 10,5% soit 21000, la force de travail nécessaire pour mettre en mouvement ce capital constant aura, sur la base de la composition organique marginale telle que définie précédemment (20000/1250) une valeur de 1312. Il reste encore une plus-value de 2688 pour la consommation de la classe capitaliste. En l'absence d'une telle réduction, nous nous trouvons dans la même situation de crise que précédemment, c'est-à-dire que la plus-value destinée à l'accumulation est insuffisante en regard des besoins de celle-ci. Dans un tel cas de figure, la méthode de Grossmann est d'abord d'envisager l'augmentation du capital constant. Il aurait donc dit que le capital constant s'élevait à 221 000. En puisant 21 000 de plus-value parmi les 21 250 disponibles, il reste seulement 250 pour l'achat de la force de travail alors que 1312 sont nécessaires. Et même en supposant que la population disponible représente une valeur de 1250, une force de travail inemployée de 1062 est alors sur le pavé. Dans le numéro 7 nous avons vu comment Grossmann s'empressait de dissimuler son raisonnement en calculant la "surproduction" de capital sur la base de la composition organique moyenne et non, comme nous l'avons fait, de la composition organique marginale. En l'occurrence au lieu d'un rapport 21000:1312, il calcule une composition organique moyenne 221000 : 26312 qui, rapportée à la population ouvrière en excédent (1062) donne une "surproduction" de capital de 8924. En suivant la méthode de Grossmann nous en retirons les mêmes effets, une insuffisance artificielle de capital variable apparaît, dont une des conséquences est de faire ressortir une surproduction tout aussi artificielle de capital constant. Et ce phénomène peut être mis en évidence dès que l'accumulation capitaliste s'emballe et dépasse ses possibilités matérielles. Pris au propre piège de sa conception, Grossmann bat discrètement la retraite et expédie en trois lignes une telle éventualité, et ce avec l'argument savoureux que la force de travail serait insuffisante. Dans le même cas de figure, suivant le point de vue, suivant que l'on se focalise sur le capital constant ou sur le capital variable on peut faire apparaître soit un excédent de population soit une insuffisance de celle-ci. On a ici une nouvelle fois la preuve du caractère purement artificiel et mécanique de la théorie de Grossmann, de son incapacité à se sortir de ses contradictions sinon par la voie charlatanesque. L'étude du second cas de figure, le seul retenu, et pour cause, par Grossmann ne peut que confirmer ce jugement. Grossmann suppose maintenant que la progression de la valeur du capital constant est de 5% au lieu des 10% de la situation d'origine. Donc le capital constant s'élève à 210000. Du point de vue de la composition organique marginale on pourrait penser que pour mettre en mouvement ce capital constant additionnel un taux de croissance de 2,5% du capital variable ferait l'affaire. En d'autres termes si pour un capital constant additionnel de 20000 un capital variable supplémentaire de 1250 était nécessaire, pour une augmentation du capital constant de 10000 c'est 650 de capital variable qui seraient requis, soit encore une croissance de 625/25000 = 2,5%.
Par rapport à une population disponible équivalent à un capital variable de 1250, la population inemployée représente un capital de 625. Mais ici aussi Grossmann s'empresse de faire ses calculs sur la base de la composition organique moyenne. En conséquence, si pour 220000 c le capital variable correspondant était de 26250 v, pour 210000 c il suffit sur la même base de 25056v. Ce qui implique que le capital variable supplémentaire ne se monte qu'à 26v. Par rapport à 25625 (25000 + 625) trouvés par le calcul précédent, l'armée de réserve est artificiellement accrue et s'élève à 1250-56 = 1194. Mais là n'est pas le plus important. Suivons Grossmann. Par rapport à l'accumulation d'origine, qui s'élevait à 22500 (20000 c + 2500 v) il reste (22500 - 10056 (10000 + 56)) soit 12444. En supposant que la classe capitaliste consomme 10% de la plus-value soit 2500 la première année, les 12444 restant peuvent fournir la base du capital de prêt pour les investissements. En suivant cette logique il obtient le tableau suivant.
Année C V armée de réserve.
1 200000 + 25000 + 2500 + 12444 (14944) + 10000 + 56
2 210000 + 25056 + 1194 + 2505 + 11994 (14499) + 10500 + 57
3 220000 + 25113 + 2449 + 2511 + 11516 (14027) + 11025 + 61
4 231000 + 25174 + 3766 + 2517 + 11009 (13526) + 11576 + 72
5 243101 + 25246 + 5141 + 2524 + 10500 (13034) + 12155 + 57
6 255256 + 25303 + 6603 + 2530 + 10011 (12541) + 12762 + -
7 268018 + 24842 + 7974 + 2484 + 9211 (11603) + 13201 + 38
8 281219 + 24880 + 9576 + 2488 + 8386 (10874) + 14060 + -
9 295279 + 24726 + 11452 +........+ (85081) + 14763 +
Bien que diminuant régulièrement à chaque cycle, un capital inemployé, baptisé pour la circonstance capital de prêt par Grossmann, se cumule pour atteindre 85081. Dans le même temps une armée de réserve accrue artificiellement prend de l'ampleur. Après avoir cité sommairement quelques extraits de Marx, Grossmann déclare "Le capital de prêt, dont nous parlons ici, dans l'analyse du cycle réel de la production doit être différencié du capital de prêt dans sa condition de normalité. Donc ici nous traitons le cas, dans lequel, en conformité avec les hypothèses, l'appareil de production est trop petit (nous supposons que c croît seulement de 5% annuel, au lieu de 10% comme c'est nécessaire) et par conséquent une partie de la plus-value accumulée dans le procès de production ne peut trouver d'investissement productif." (op. cit. p.154)
Grossmann affirme alors que ce capital est la base du développement d'un capital de prêt, à la recherche d'investissements. Il s'agit ici aussi d'une pure fantaisie. Le capital argent susceptible d'être prêté, en fait ne trouve aucun emprunteur sinon il y aurait accumulation. En effet, en face d'un capital argent nous trouvons une plus-value qui revêt la forme matérielle des éléments du capital constant et du capital variable. La valeur correspondant à cette plus-value est en fait mise en jachère si elle n'est pas accumulée. Il ne s'agit pas de capital de prêt mais de capital en excédent. L'idée que du capital productif puisse demeurer inemployé, demeurer en jachère, est le symptôme non pas d'un rapport préteur emprunteur, mais d'une surproduction. Et cette surproduction appelle une dévalorisation brutale du capital et non pas son maintien artificiel d'une année sur l'autre, constituant ainsi une réserve dans laquelle le capital pourrait puiser en cas de besoin. L'idée d'une surproduction permanente est étrangère à la théorie de Marx. Dans notre numéro 22 consacré au militarisme nous avions passé en revue les divagations de Mandel. Ce dernier développait un raisonnement strictement identique à Grossmann pour justifier non pas l'existence du capital de prêt et la baisse du taux d'intérêt mais le développement du secteur de l'armement et son rôle régulateur sur la production capitaliste. Ici c'est le pseudo capital de prêt qui joue un tel rôle. Quand il est en excédent il fait baisser le taux d'intérêt. Cette baisse du taux d'intérêt favorise le taux de profit d'entreprise tout comme le développement de l'armée de réserve qui fait pression sur les salaires. Ces facteurs encouragent l'accumulation et donc la résorption de l'armée de réserve comme du capital de prêt qui trouve alors des débouchés productifs. Voilà la bluette qui sert de théorie du cycle et du taux d'intérêt à Grossmann. Et c'est un tel escroc, faussaire, mercenaire stalinien, qui sert de mentor à une partie du mouvement communiste. Une théorie bourrée de contradictions, qui foule aux pieds le communisme révolutionnaire à chaque pas, nous est resservie, agrémentée, en général, d'autres imbécillités propres à leurs auteurs, par CWO et associés.
18. Grossmann et le commerce international.
18.1 Introduction.
Jamais, sans doute, dans l'histoire des sciences, une théorie n’a rencontré une aussi éclatante confirmation que celle de Marx. Aucune n'a eu un aussi grand pouvoir explicatif et une telle capacité de prévision sur une aussi grande durée. Les fondements d'un tel triomphe sont assez faciles à identifier. Le socialisme scientifique est une théorie moderne ; la plus moderne et la plus récente. Elle s'est développée sur la base de la société capitaliste la plus avancée, celle qui a mis en place la révolution de la machine qui, en se passant de la main de l'homme, peut élever la productivité du travail à des niveaux jamais atteints dans l'histoire de l'humanité. La théorie révolutionnaire a donc pu se hisser sur les épaules de ses devancières et en faire une critique impitoyable. De ce point de vue, elle présente aussi une particularité. Alors que la science est la forme spécifique que prend le travail universel correspondant à l'époque bourgeoise, la conception matérialiste de l'histoire s'est développée comme théorie du prolétariat, la théorie de la classe exploitée moderne. Le travail de découverte scientifique (au sens de théorie adéquate à la réalité) était donc affranchi des préjugés et visions étriquées propres à la classe bourgeoise et à ses savants. En continuité avec ce que nous venons de dire, il faut également souligner qu'elle est la première théorie, et sans doute la seule tant que durera la société divisée en classes, qui applique consciemment la dialectique matérialiste comme méthode de connaissance. Alors que les fondements philosophiques des sciences sont toujours plus vacillants, le contraste avec la force, la sûreté de jugement, la richesse des prévisions, la subtilité de l'analyse du matérialisme du prolétariat n'en est que plus saisissant. Enfin, la théorie révolutionnaire est une conception globale du monde, capable de penser sa place et la place des autres formes de la connaissance, comme de ses relations avec elles, sachant que la science est mobilisée contre le prolétariat, puisque tout développement des forces productives signifie, dans le mode de production capitaliste, un progrès dans l'exploitation du prolétariat.
Jamais, sans doute, dans l'histoire des sciences, une théorie n'a eu autant de mal à s'imposer que la théorie de Marx. L'abjuration de Galilée, les persécutions subies ou les difficultés rencontrées par de nombreux savants pour faire valoir leur point de vue ne sont rien en regard des outrages que subit le socialisme scientifique, et les bagnes et les charniers ont été, sont et seront le lot de ceux qui s'en veulent les défenseurs obstinés.
Théorie du prolétariat, le socialisme scientifique est une abomination pour les classes dirigeantes dont elle annonce la fin de leur domination. Il est donc évident que les forces intellectuelles de la bourgeoisie, et la force de celle-ci par rapport à nombre d'autres classes dominantes est d'être capable d'attirer et d'intégrer en son sein tout ce que la société compte comme talents, sont mobilisées contre la théorie de Marx et tous les moyens sont bons pour en limiter l'influence. Les savants de la Renaissance accompagnaient la montée de la bourgeoisie et sa conquête du pouvoir. Ils pouvaient donc bénéficier de l'appui de celle-ci à mesure qu'elle jouait un rôle économique grandissant en affirmant le pouvoir de l'argent et du capital. Le prolétariat lui, s'il est une force sociale grandissante dans la société bourgeoise, ne peut espérer conquérir d'abord un quelconque pouvoir économique qui serait le levier de son émancipation politique. Le processus est inverse. Le prolétariat doit auparavant s'emparer du pouvoir politique pour assurer son émancipation économique et celle de l'humanité en général en abolissant à jamais les modes de production reposant sur l'existence de classes d'hommes antagoniques. Dans la mesure où le développement des sciences de la nature est lié aux besoins pratiques du développement du mode de production capitaliste, la nécessité de théories plus adéquates pour pouvoir dominer plus profondément la nature finit, quels que soient les détours, par s'imposer et dans une très grande majorité de cas, la vérification expérimentale des théories peut être observée. Pour le prolétariat, le champ d'expérience est la société toute entière et la preuve de la validité est aussi grandiose que la construction théorique elle-même, puisqu'il s'agit de la révolution internationale.
La théorie du prolétariat était cependant tellement puissante, que pour la museler, l'attaque frontale des penseurs nains de la bourgeoisie ne pouvait suffire. Il fallait aussi en saper les bases, l'édulcorer, la falsifier, la trahir, et la réviser. Ce fut le rôle de la social-démocratie, dont le point culminant fut le coup mortel porté lors de la trahison de 1914. Si ce premier coup s’est révélé mortel, il n’arriva pas à enrayer le processus révolutionnaire puisque l'Octobre rouge de 1917 constitua, après la Commune de Paris, une nouvelle preuve par neuf qui éclairait l’avenir du prolétariat. Là encore, on ne redira jamais assez que la social-démocratie fut le premier responsable de notre défaite. Pour achever d’extirper la vigueur révolutionnaire du prolétariat, il fallait reprendre le même travail. A l’Ouest, la social-démocratie égorgeait le prolétariat allemand, et fourvoyait l’ensemble du prolétariat européen. Dans la suite, à l’Est, le stalinisme portait le coup de grâce tandis que dans les pays ou l’unité nationale était fragile la bourgeoisie se réfugiait dans les bras d’aventuriers fascistes, une fois la vague révolutionnaire brisée par la social-démocratie. Démocrates, sociaux-démocrates, fascistes et staliniens, formèrent la plus grande sainte alliance de l'histoire contre leur ennemi commun : le prolétariat révolutionnaire.
En travestissant la théorie révolutionnaire, la société bourgeoise faisait coup double. En même temps qu'elle annihilait la théorie du prolétariat quant à sa possibilité d'action sur la société, elle régénérait le pôle du matérialisme bourgeois mis à mal par son propre développement. En vampirisant la théorie révolutionnaire elle régénérait la sienne, à l'instar du capital qui se régénérait dans l'exploitation la plus intense que le prolétariat ait jamais connu.
On ne saurait trop souligner la lourde responsabilité des héritiers du camp révolutionnaire qui n’ont que faiblement poursuivi l’œuvre théorique tout au long de la contre-révolution. Cette tendance n’a d’ailleurs fait que se dégrader dans les trente dernières années ; les résidus de l’actuel milieu révolutionnaire se révélant chaque jour moins capables de produire une quelconque réflexion à même de renouer avec la grande tradition scientifique de la dialectique matérialiste. Pour notre part, indifférent aux sarcasmes et autres accusations, nous avons toujours essayé, à la mesure de nos faibles forces, de réaliser un travail le plus sérieux possible concernant les questions cruciales pour le mouvement prolétarien. Parmi celles-ci l’étude des crises représente un élément fondamental. La critique de Grossmann est aujourd’hui l’occasion d’aborder certains points fondamentaux liés à la question du commerce international.
18.2 Le communisme théorique et le commerce international
Pour Marx, "la production capitaliste ne peut exister sans commerce extérieur" (Marx, Capital L.II, La Pléiade, T.2 P.803). On ne peut donc se représenter le commerce extérieur comme un élément annexe, éventuellement superfétatoire, que l'on pourrait ou non ajouter à l'analyse. Le commerce extérieur est intimement lié à la production capitaliste et à son développement ; il en est un moment organique. Fidèle à la logique métaphysicienne, la pensée bourgeoise sépare fréquemment l'"économie fermée" de l'"économie ouverte". Le commerce extérieur apparaît alors comme un élément supplémentaire qui vient compliquer ou raffiner la théorie ou le modèle, une nouvelle variable sur laquelle on peut jouer ou non. Tour à tour planche de salut, moteur de la croissance ou menace et contrainte, l'échange international est traité comme un élément séparé et la théorie économique se plie volontiers aux intérêts économico-politiques du moment. Il suffit de voir l'évolution des théories du commerce international, qui sont passées du credo du libre échange (alors que dans la réalité, il a été souvent minoritaire) tant que les intérêts qu'il servait y trouvaient leur compte, à une défense croissante de politiques nationales capables d'introduire de bonnes doses de protectionnisme quand ces mêmes intérêts se voient menacés par le libre échange qu'ils ont jusque là défendu.
Bien entendu, il arrive à Marx dans certaines parties de son œuvre de faire abstraction du commerce extérieur. C'est notamment le cas, dans le livre II du "Capital", lorsqu'il analyse les schémas de reproduction. Dans cette partie de l'ouvrage, Marx étudie le capital "en général", à un très haut niveau d'abstraction, comme s'il n'existait qu'une seule nation, qu'un seul marché. Il suppose que le capital s'est emparé de toutes les branches de production et qu'il se décompose en deux grandes sections représentatives du capital productif, que le crédit n'existe pas, que la société est exclusivement composée de capitalistes et de prolétaires, etc. Mais c'est en posant ces hypothèses restrictives, dont celle de l'absence d'un commerce extérieur, qu'il donne justement la précision que nous avons citée plus haut : "la production capitaliste ne peut exister sans commerce extérieur"
Tout au long des numéros de Communisme ou Civilisation, nous n’avons cessé de rapporter le fait que Marx n’a pas achevé son "Economie". Le "Capital" dans son ensemble ne représentait que le sixième de cette œuvre alors que l’étude du capital dans sa dimension internationale en représentait un tiers (un volume devait étudier le commerce extérieur et un autre le marché mondial), preuve supplémentaire de l’importance de ces aspects dans la conception scientifique du socialisme. Ce rappel montre à nouveau l'importance que Marx attachait à ces sujets et qu'il comptait leur donner de beaucoup plus amples développements et des développements particuliers. A contrario, étant donné que les éléments laissés par Marx sont relativement peu nombreux, ils témoignent également de la tâche qui attend le parti communiste pour élaborer un point de vue critique de l’économie politique sur ces thèmes. Ce point de vue critique devrait aussi intégrer près de 150 ans d’histoire du marché mondial qui a connu bien des bouleversements.
Dans nos numéros consacrés aux deux phases historiques de la production capitaliste, (cf. N° 5, 7, 9)[91] nous avons déjà abordé le commerce extérieur sous l'angle de sa nécessité et de son rôle majeur dans la naissance de la phase de soumission formelle du travail au capital. D'autre part, un des rôles historiques de cette même phase de soumission formelle sera de créer un quasi-marché mondial qui est lui-même à la base de la phase de soumission réelle du travail au capital.
"Au cours du XVII° siècle, les progrès irrésistibles de la concentration du commerce et de la manufacture dans un seul pays, l'Angleterre, créèrent peu à peu, pour cette nation, un marché quasi mondial, et partant une demande de ses produits manufacturés, que les forces productives de l'industrie traditionnelle ne pouvaient plus satisfaire. Cette demande, en excédant les ressources productives, fut la force d'impulsion qui suscita la troisième période de la propriété privée depuis le Moyen Age : elle créa la grande industrie fondée sur l'utilisation de forces élémentaires à des fins industrielles, le machinisme et la division du travail à une énorme échelle". (Marx, L'Idéologie Allemande, La Pléiade, T.3, p.1102)
Avec l'avènement de la grande industrie, donc de la phase de soumission réelle du travail au capital, un nouveau marché mondial va être façonné à l'image de la production capitaliste la plus moderne.
"D'une part le marché mondial constitue la base du capitalisme ; de l'autre, c'est la nécessité pour celui-ci de produire à une échelle constamment élargie qui l'incite à étendre continuellement le marché mondial (…)" (Marx, Capital, L.III, La Pléiade, T.2, p. 1101)
18.3 De l’impérialisme
Le concept d'"Impérialisme", contrairement à ce que voudrait nous faire croire Roger Dangeville est absent chez Marx et ce n'est que par des procédés de faussaire (en abusant du terme impérialiste parlant de l'empereur Napoléon III) qu'il est possible de tenir de tels points de vue. D'ailleurs pour nombre de marxistes ce fait n'est guère contesté.
Pour Lénine, par exemple, l'Impérialisme est une phase récente du mode de production capitaliste, une phase que Marx et Engels n'ont pas connue car elle se manifeste après leur mort. Lénine date même assez précisément cette phase impérialiste puisqu'il prend en compte un point de départ postérieur à 1898. Cette date correspond à la fin du conflit entre l'Espagne et les États-Unis qui voit la fin de l'Empire colonial espagnol en Amérique avec la perte de Cuba. Si l'on suit à la lettre Lénine, on en conclura que ce conflit n'est pas impérialiste, que la défaite de la vieille puissance coloniale espagnole face au jeune capitalisme américain en plein développement ne figure pas au rang des conflits impérialistes. [92]
Notons pour faire bonne mesure qu'à cette époque les États-Unis sont sur le point de devenir la première puissance mondiale et que la révolution bourgeoise y a été parachevée avec la fin de la guerre civile en 1867 (fin de la guerre de sécession).
Ce que Marx et Engels, selon Lénine et les tenants de cette thèse, n'auraient pas décrit, c'est la formation du capital financier, concept décrit comme la fusion, l'interpénétration du capital industriel et du capital bancaire. L'impérialisme c'est aussi le capitalisme monopoliste qui succède au capitalisme de libre concurrence. Or, comme nous l'avons déjà largement démontré dans les travaux consacrés à la question agraire[93], le point de vue défendu par le socialisme scientifique n'est pas celui là. Pour la théorie révolutionnaire le monopole et la concurrence ne sont pas antithétiques. La gauche d'Italie le soulignera également fréquemment. La gauche d’Italie restera cependant toujours à mi-chemin dans la critique du léninisme. Ses critiques sur les conceptions tactiques avec des arguments flirtant souvent avec l’idéalisme ne remontent jamais explicitement vers les principes fondamentaux supposés être partagés. Même quand implicitement on tendait vers une remise en cause des fondements théoriques du léninisme on ne poursuivit pas cette tendance. Les thèses sur le fascisme sont même en partie dans la continuité des théories monopolistes. Dans certains textes, le fascisme assimilé à la centralisation du pouvoir politique est relié à la concentration et à la centralisation du capital sur le plan économique, ce qui ferait donc de celui-ci un phénomène particulièrement représentatif de l’évolution de l’Etat moderne. Ce n’est pas le lieu ici de développer ces aspects de la gauche d’Italie. Ils sont ici pour souligner son incapacité à rompre avec le léninisme et les pratiques de faussaire de Dangeville sont là pour montrer les trésors de jésuitisme déployés pour établir une continuité là où il n’y en avait pas.
Pour qui défend l’idée, ce qui est notre cas, que la théorie anticipe et prévoit la totalité du cours capitaliste (ce qui ne signifie pas que tout est écrit, qu’il n’y a plus d’effort scientifique à faire), la perspective léniniste héritée de la social-démocratie, d’un développement spécifique du mode de production capitaliste, non prévu par Marx, et appelé "impérialisme" pour reprendre les concepts qui étaient en vigueur dans les milieux coloniaux de la fin du XIXè siècle et du début du XXè siècle, ne peut donc être acceptée.
La production capitaliste moderne repose sur la soumission réelle du travail au capital. Les formes d'extraction de la plus-value qui la caractérisent reposent tout particulièrement sur le développement de la productivité et de l'intensité du travail. Pour le prolétariat cette phase signifie un accroissement important de son exploitation, une augmentation du taux de plus-value (même si le salaire réel augmente et que le temps de travail diminue).
La répartition de cette plus-value entre propriétaire foncier et capitaliste fait l'objet d'une explication théorique qui démontre comment le profit moyen et le surprofit loin de s'opposer s'articulent. La théorie agraire de Marx est aussi l'occasion de montrer le rôle et le domaine des prix de monopole c'est-à-dire de prix qui sont fixés sans relation avec le temps de travail qu'ils contiennent pour être dictés par l'importance de la demande en regard d'une offre limitée (c'est le cas par exemple d'un grand vin).
Donc, dès la rédaction du Capital étaient décrites, expliquées les racines de l'ensemble de phénomènes soi disant caractéristiques de l'impérialisme. Ceci étant dit, il s’est cristallisé des positions sur la base de l’ossification de la pensée de Lénine (le " léninisme ") que l’on doit bien distinguer tant de la pensée de Marx que de celle de Lénine. Ces courants de pensée, qui s'expriment bien dans le stalinisme passé ou moderne affirment que la phase impérialiste est une phase où le mode de production capitaliste via le monopole sinon domine la loi de la valeur, à défaut de s’en affranchir. Cette effronterie théorique laisse envisager qu'il est possible de parvenir à une complète maîtrise du capitalisme par l'intermédiaire d'une étatisation plus poussée de l'économie. La nationalisation des sociétés, la conservation de la valeur, du salariat, de l'argent et de l'État voilà le nec plus ultra de ce "socialisme" qui laisse subsister le prolétariat et la bourgeoisie, la prostitution et la police et tourne le dos à la société sans classe dans laquelle les catégories marchandes et l'Etat sont bannies, ce qui a été, est et sera le but du prolétariat révolutionnaire s'il veut jamais gagner un jour son émancipation.
La théorie de Marx décrit donc l'intégralité du cours du MPC, définit aussi bien le but (la société sans classes) que les moyens (dictature du prolétariat, constitution de la classe en parti) et donne l'exemple d'une victoire théorique sans précédent dans l'histoire de la pensée.
Si du point de vue communiste révolutionnaire les concepts d'Impérialisme ne reposent que sur du sable, cela ne signifie pas pour autant que la phase de soumission réelle du travail au capital n'ait pas d'histoire. Mais cette histoire couvre déjà deux siècles et concerne des événement aussi vastes que le colonialisme et la décolonisation du XIXè siècle et du XXè, les guerres où le prolétariat a pu soutenir un des deux camps en présence comme mettre en œuvre un défaitisme révolutionnaire.
Cette même phase de soumission réelle du travail au capital verra aussi la montée en puissance de l'État au cours du siècle actuel. Elle verra aussi des périodes de révolution et surtout des périodes de contre-révolution. Tout au long de nos numéros sur la crise nous avons montré que tant les théories de Rosa Luxemburg (et donc toutes les théories qui s'appuyaient sur elles) que celles de Grossmann (et donc toutes les théories qui s'appuyaient sur elles) ou de Lénine (et donc tous les courants issus de la Troisième internationale) étaient en contradiction avec l’orthodoxie révolutionnaire. Toutes tournaient le dos au socialisme de Marx et d’Engels. Aucune ne renouait avec la tradition scientifique et révolutionnaire du communisme.
En d'autres termes encore, tout le milieu révolutionnaire dans toutes ses composantes, du C.C.I. à la C.W.O. en passant par Battaglia Communista et les diverses sectes bordiguistes, ou reniait à tort la théorie de Marx ou l'anéantissait sous prétexte de la défendre et de la restaurer. Bien entendu, toutes les conséquences politiques que l'on pourrait tirer de bases théoriques d'une insigne faiblesse et en contradiction avec l'orthodoxie du communisme ne peuvent être que nulles et non avenues.
Bien révélatrice à cet égard de l’idéalisme profond, du romantisme petit-bourgeois du milieu communiste est la réaction de la C.W.O.. Dans un numéro ancien, nous montrions brièvement, nous reviendrons sur ce sujet, qu’il n’existait pas chez Marx, de péréquation du taux de profit à l’échelle internationale, au même titre que sur le plan national. Bien évidemment la C.W.O. n’avait pas inventée toute seule une telle conception, mais l’avait reprise au stalinien Grossmann, via Mattick. Notre critique ruinait du même coup leur conception de la décadence et de l’impérialisme et par suite, bien évidemment, leurs conceptions "politiques", si on peut parler de conceptions politiques pour des écrits qui réécrivent dans le jargon "milieu communiste" les articles de la presse bourgeoise. Bien loin de se défendre sur le plan théorique, bien loin de justifier leur théorie sur le plan scientifique (ce qui, il est vrai, était une gageure étant donné l’importance des divagations théoriques de la C.W.O.), on préféra exhiber ce qu’il fallait démontrer. La C.W.O. répondit en substance "Mais votre critique (donc la position de Marx) aboutit à nier le caractère réactionnaire des luttes de libération nationale", ce qui est notre position politique. Oui, Messieurs ! votre position politique n’est pas plus orthodoxe que vos conceptions économiques. Dans la mesure où celle qui sous-tend l’autre n’a pas de fondement, les deux peuvent être également expédiées dans les poubelles de l’histoire. En revanche, tout comme sur le plan économique, les positions de Marx et Engels sur la question nationale conservent à notre époque toute leur "validité", pour autant que les situations y soient identiques.
18.4 Les évolutions du PIB : chiffres internationaux.
Comparons l'évolution de quelques pays qui figurent au sommet de l'échelle des nations.
A tout seigneur tout honneur, les États-Unis d'Amérique. Nous disposons de deux séries d'estimations. La plus importante est estimée en écus. Le PIB américain est passé de 483,4 milliards d'écus en 1960 à 1276 milliards d'écus en 1975 pour atteindre 4917,5 milliards d'écus en 1992. En 32 ans le PIB, aux prix courants, c'est-à-dire inflation incluse, a été multiplié par plus de 10, ce qui correspond a un taux de croissance nominal de 7,5% par an.
L'opinion commune, c'est-à-dire celle qui sert de vade-mecum de la pensée à la bourgeoisie est que depuis l'après-guerre jusqu'en 1975 environ, nous vivions dans une période idyllique qui a permis à un économiste réactionnaire Jean Fourastié, de forger le concept de " trente glorieuses". Ce concept qui a fait florès est encore aujourd’hui sur toutes les bouches et sous toutes les plumes de droite comme de gauche. L'image est tellement populaire qu'elle figure déjà dans les livres d'histoire et sans doute pour longtemps. C'est ainsi qu'on raconte l'histoire aux nouvelles générations. Les soi-disant trente glorieuses avec leur cortège de guerres coloniales, de misère, de luttes de classes, de répression des classes ouvrières, furent parcourues, comme les suivantes, par un cycle d'environ 6 ans qui, il est vrai, ne déboucha que très rarement sur un recul effectif de la valeur de la production. Mais les mêmes contradictions qui aujourd'hui éclatent au grand jour étaient déjà à l'œuvre. Tout au plus étaient elles estompées dans une période qui il est vrai est l'une des plus prospères (ce qui signifie que l'exploitation du prolétariat n'y a jamais été aussi féconde) de l'époque correspondant à la domination de la phase de soumission réelle du travail au capital du mode de production capitaliste.
Si nous décomposons les éléments en notre possession (ici concernant les Etats-Unis) entre deux grandes périodes, d’une durée sensiblement identique, dont l’une appartient aux "trente glorieuses" et l’autre aux "années de crise", nous obtenons un premier résultat
De 1960 à 1975, le taux de croissance moyen est de 6,6 %. Il est de 8,2 % pour la période suivante (1975-1992). Ce calcul tient compte de l’inflation donc il ne peut être pris pour un argument définitif. Nous reviendrons donc sur sa signification réelle.
En élargissant ces chiffres aux principaux pays industrialisés, nous obtenons le tableau suivant (prix courants, milliards d'écus)
Tableau I : Evolution du PIB (source I)
|
|
1960 |
1975 |
1992 |
% moyen |
% 60-75 |
%75-92 |
|
Etats-Unis |
483,4 |
1276 |
4917,5 |
7,5% |
6,7% |
8,25% |
|
R.F.A. |
68,4 |
337 |
1360,5 |
9,8% |
11,1% |
8,5% |
|
France |
57,7 |
276,3 |
1016,1 |
9,4% |
11% |
7,9% |
|
Japon |
41,9 |
403,1 |
3024,1 |
14,3% |
16,3% |
12,5% |
|
Italie |
37,6 |
171,3 |
989,5 |
10,7% |
10,6% |
10,8% |
|
Royaume-Uni |
68,4 |
188,8 |
889,3 |
8,3% |
7% |
9,5% |
|
Total |
757,4 |
2652,5 |
12197 |
9% |
8,7% |
9,4% |
Ce tableau prend en compte la croissance nominale, c'est-à-dire y compris l'inflation. Cependant sur une longue période une inflation divergente a des conséquences sur le taux de change des monnaies. En supposant que ce taux de change soit bien ajusté au moment du calcul, ce qui est d'autant plus vrai que la période considérée est longue ou que les calculs tiennent compte d'une moyenne, nous avons ainsi une bonne idée du poids relatif effectif des nations sur le marché mondial. Il s'agit ici de leurs valeurs absolues. On peut constater que les comportements des nations étudiées sont assez différents. Dans l'échantillon concerné, pour la totalité de la période, les bourgeoisies qui ont tiré le mieux leur épingle du jeu sont dans l'ordre celles du Japon, d'Italie, d'Allemagne, de France, puis du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Donc tous les pays d'Europe et le Japon ont amélioré leur position relative vis-à-vis des Etats-Unis qui représentent une part décroissante de la valeur mondiale.
Il ne s'agit pas pour autant d'une situation uniforme. La tendance sur plus de trente ans n'est pas la même si on décompose cette période en deux tranches de durées sensiblement égales (1960-1975) et (1975-1992). La première tranche fait partie des soi-disant " trente glorieuses ", la seconde tranche de la période dite de " crise ". Si dans la première période la hiérarchie est identique à celle de l'ensemble de la période. Trois pays ont un comportement meilleur dans la seconde période que dans la première. Il ne s'agit pas pour autant d'une amélioration relative de leur position sur le marché du monde. Ils ne font que se comporter mieux dans cette deuxième période. Il ne s'agit pas non plus nécessairement d'une performance supérieure. Le tableau, établi en valeurs absolues, a des avantages. Il ne doit pas cependant induire en erreur. La croissance globale supérieure de la deuxième période peut signifier et signifie en fait une inflation plus forte de l'ensemble du monde capitaliste dans cette période. Mais compte tenu de cette inflation et de la croissance réelle, la situation sur le marché du monde peut être bien appréciée.
Ainsi les Etats-Unis font partie des pays qui ont un taux de croissance nominal supérieur dans cette phase. Ils n'améliorent pas leur position relative (sauf vis-à-vis de la France) mais ils régressent moins vite sur le marché mondial. Ce jugement doit être également nuancé par le fait que la monnaie américaine est sans doute surévaluée. Les Etats-Unis du fait du monopole du dollar vivent en partie à crédit sur le reste du monde.
Le résultat le plus spectaculaire est celui du Royaume-Uni qui passe de l'avant dernière place à la troisième et qui dégage un taux de croissance supérieur à la moyenne de l'échantillon. De nombreux facteurs ont du jouer dans ce retour en grâce, mais on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE en 1972.
Les tendances que nous avons mises en relief sont-elles confirmées par la seconde série de chiffres ? Dans cette série le PIB n'est pas exprimé en écus[94] mais en monnaie locale.
Tableau II : Evolution du PIB (source II)
|
|
1970 |
1975 |
1992 |
% |
|
Etats-Unis |
1010,7 |
1585,8 |
5955,8 |
8,3 % |
|
Japon |
73,1 |
148,0 |
473,0 |
8,8% |
|
Allemagne |
675,3 |
1026,6 |
2983,7 |
7% |
|
France |
793,5 |
1467,9 |
7155,1 |
10,5% |
|
Italie |
67,2 |
138,6 |
1542,9 |
15,3% |
|
Royaume-Uni |
51,8 |
105,9 |
606,8 |
11,8% |
Les taux indiqués ci-dessus tiennent compte de l'inflation, ce qui explique que les meilleurs résultats (sur le plan nominal) soient obtenus par les pays les plus inflationnistes (Italie et Royaume-Uni).
Pour annuler l'effet relatif de l'inflation nous devons corriger les résultats obtenus par l'évolution du taux de change nominal des monnaies. Les théories bourgeoises postulent ce qu'elles appellent la parité de pouvoir d'achat de la monnaie. En d'autres termes, elles prétendent que si un pays voit ses prix augmenter plus vite qu'un autre sa monnaie se dévaluera dans les mêmes proportions de manière à rétablir la parité antérieure. Il n'en va pas ainsi, ni dans la théorie ni dans la réalité. Aussi faut-il se garder lorsqu'on traite du marché mondial de comparer uniquement les taux de croissance obtenus dans chaque pays pris séparément. Exprimés en monnaie nationale, ils ne tiennent pas compte, même s'ils intègrent l'inflation, de l'évolution des taux de change. Pour faire les calculs requis nous disposons d'une série à peu près équivalente qui mesure les évolutions du dollar par rapport aux autres monnaies pour pratiquement les mêmes époques. Nous obtenons alors le tableau suivant. Les résultats des États-Unis sont, par définition, inchangés puisque le dollar constitue la référence de la série.
Tableau III : Evolution du PIB (en monnaie unifiée)
|
|
1970 |
1975 |
1992 |
% |
|
Etats-Unis |
1010,7 |
1585,8 |
5955,8 |
8,3 % |
|
Japon |
209,7 |
573,8 |
3654 |
13,8% |
|
Allemagne |
179,6 |
462,4 |
1841,8 |
11,1% |
|
France |
158,7 |
323,3 |
1315,3 |
10,1% |
|
Italie |
108,9 |
174,8 |
1263,9 |
11,8% |
|
Royaume-Uni |
136,3 |
216,1 |
1083,5 |
9,8% |
Nous retrouvons la hiérarchie relative dégagée lors de la première série de chiffres, même si la période de référence est plus courte et les données sur les taux de change moins précises.
Cette première série de statistiques sur l'évolution absolue, et les rapports relatifs entre quelques uns des plus grands pays du monde capitaliste qu’elle indique, nous a permis de mettre en évidence des faits qui ne sont pas toujours bien perçus. Sauf effondrement de la lire à l'image du peso mexicain ou du rouble (la Russie payant en une fois tout ce qui a été escompté depuis ce dernier demi-siècle), on peut constater que le pays européen qui a le mieux affermi sa position sur le marché mondial est l'Italie. C'est le pays qui a créé le plus de valeur (du moins apparemment), c'est-à-dire celui pour lequel la valeur créée reçoit sur le marché mondial la valorisation la plus importante parmi les pays étudiés. Dans les deux cas on peut constater que la prétention de la bourgeoisie italienne d'avoir dépassé la Grande-Bretagne paraît fondée. Bien que, étant donné l'océan de dettes sur lequel flotte la République italienne, une catastrophe monétaire ne soit pas à exclure, ceci ne doit pas cacher la relative bonne performance du capitalisme italien vis-à-vis de ses rivaux, phénomène trop rarement souligné.
18.5 Création de valeur et temps de travail.
Il convient maintenant d'évaluer ces résultats en fonction d'un deuxième paramètre qui est celui du temps de travail. Les sources dont nous disposons sont encore approximatives et une étude plus détaillée serait évidemment plus intéressante, mais les séries sont suffisantes pour dégager les grandes tendances. Dans un premier temps rappelons que la valeur d'une marchandise (w), et ici nous raisonnons au niveau du capital-marchandise équivalent à la totalité de la production marchande, est égale à la somme de la valeur du capital constant (c) du capital variable (v) et de la plus-value ou survaleur (pl ou s) ce qui se résume par cette équation :
w = c + v + pl.
Tenter de retrouver l’équivalent des catégories du socialisme scientifique dans le maquis des statistiques bourgeoises est une tâche très délicate. Outre que l’ennemi de classe n’a ni l’intérêt, ni la capacité intellectuelle, du fait de la débilité des théories qui sous-tendent son action dans le domaine de la statistique, de mettre en œuvre une connaissance statistique digne de ce nom, il est en partie vain, pour des raisons théoriques propres à la théorie communiste, d’établir des correspondances avec les données disponibles. Cependant, en dépit de nécessaires approximations, les écarts de grandeur sont suffisamment parlants pour que peu de doutes subsistent en ce qui concerne les grandes tendances. L’objectif que nous poursuivons ici est de rapporter les valeurs que nous avons calculées à la masse de travail productif qu’il a fallu pour les produire. Or cette perspective ne peut être qu’approximative.
Le calcul de la valeur par actif, est un élément plus intéressant, sans être, loin de là, parfait, que la valeur du PIB par habitant, car il donne une meilleure approche de ce qu'on peut appeler l'intensité apparente du travail, c'est-à-dire de la valeur apparemment créée par la force de travail. Bien sûr, pour obtenir de meilleurs résultats, il faudrait connaître le nombre d'heures travaillées par cette population occupée (une partie des actifs ne travaille pas à plein temps, le temps de travail annuel diffère selon les pays). D'autre part, pour obtenir la valeur apparente effective il faut aussi défalquer la partie qui représente le capital fixe (environ 10%). Enfin, et cela aucune statistique ne le donne, il ne faudrait prendre en compte que le travail productif (avec les conséquences théoriques que cet aspect des choses soulève - à savoir qu'une partie de la valeur créée n'est pas prise en compte dans le PIB). Ces arguments ne valent que dans le cadre d'un capitalisme pur, aussi ne faut-il pas non plus oublier les travaux créateurs de valeur, qui ne relèvent pas du salariat, existant encore dans les sociétés modernes (paysans, artisans, etc., même si leur part va en déclinant). Les difficultés sont vastes mais tentons l’expérience.
18.6 Population, population active : chiffres internationaux
Commençons par la comparaison entre l’évolution de la population employée, la population active et la population totale. Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de la population, de la population active et de la population employée dans les pays étudiés. Le chiffre de la population employée a été calculé, en retirant de la population active le taux de chômage officiel de la période considérée. Le premier tableau donne la population totale et la population active moyenne de la période considérée. Par exemple, les Etats-Unis avaient une population moyenne de 198,4 millions d’habitants pendant la période 1961-1973 et une population active de 78,2 millions de personnes. En 1992, la population représentait 255,3 millions d’habitants et la population active 127 millions d’habitants. La colonne appelée Delta calcule l’accroissement de la population et l’accroissement de la population active. Pour les Etats-Unis, pour continuer notre exemple, le calcul donne un accroissement de la population de 56,9 millions d’habitants et un accroissement de la population active de 48,8 millions d’habitants. La dernière colonne intitulée % calcule le pourcentage de la population active par rapport à la population totale en 1992 et le rapport entre l’accroissement de la population active et la population totale. Pour les Etats-Unis nous constatons que la population active représente 49% de la population en 1992 (127/255,3), tandis que le rapport entre la population active additionnelle et la population totale supplémentaire est de 85% (48,8/56,9). On voit ici que la variation moyenne est supérieure à la première moyenne obtenue ; cela revient à dire que la population active a un taux de croissance supérieur à celui de la population totale.
Tableau IV : Evolution de la population et de la population active
|
|
61-73 |
74-80 |
81-90 |
1992 |
Delta |
% |
|
USA |
198,4 78,2 |
220,5 99,3 |
239,7 116,7 |
255,3 127,0 |
56,9 48,8 |
49 85 |
|
Japon |
100,5 49,4 |
113,7 54,6 |
120,9 60,2 |
124,4 66,2 |
23,9 16,8 |
53 70 |
|
R.F.A. |
59,3 26,8 |
61,6 27,4 |
61,6 29,4 |
64,0 31,1 |
4,7 4,3 |
48 91 |
|
France |
49,4 20,8 |
53,2 22,8 |
55,4 24,0 |
57,3 24,8 |
7,9 4,0 |
43 50 |
|
R-U |
54,8 25,4 |
56,2 26,1 |
56,7 27,5 |
57,6 28 |
2,8 2,6 |
48 92 |
|
Italie |
52,5 20,7 |
55,9 21,5 |
57,1 23,3 |
57,9 24,3 |
5,4 3,6 |
42 66 |
Tous les pays étudiés ont vu leur population active croître plus vite que leur population. Cela ne signifie pas que l’emploi effectif ait augmenté plus vite que la population. En effet, la population active intègre également les chômeurs déclarés. En revanche, cela signifie qu’une partie croissante de la population recherche un travail. Marx distinguait la surpopulation absolue de la surpopulation relative (Cf. Les deux phases de la production capitaliste). La surpopulation absolue provient d’un accroissement de la population qui dépasserait les limites de ce qu’exige l’accumulation du capital sur la base d’une constance du développement des forces productives. Dans la phase de soumission formelle du travail au capital, c’est la seule forme de surpopulation. Mais, avec la phase de soumission réelle du travail au capital se développe une autre forme de surpopulation qui ne supprime pas l’autre pour autant : la surpopulation relative. Cette surpopulation relative prend sa source dans le développement contradictoire de la productivité du travail.
"La demande de travail effective étant réglée non seulement par la grandeur du capital variable déjà mis en œuvre, mais encore par la moyenne de son accroissement continu, l’offre de travail reste normale tant qu’elle suit ce mouvement. Mais, quand le capital variable descend à une moyenne d’accroissement inférieure, la même offre de travail qui était jusque là normale devient désormais anormale, surabondante, de sorte qu’une fraction plus ou moins considérable de la classe salariée, ayant cessé d’être nécessaire pour la mise en valeur du capital, et perdu sa raison d’être, est maintenant devenue superflue, surnuméraire. Comme ce jeu continue à se répéter avec la marche ascendante de l’accumulation, celle-ci traîne à sa suite une surpopulation croissante.
La loi de la décroissance proportionnelle du capital variable, et de la diminution correspondante dans la demande de travail relative, a donc pour corollaires l’accroissement absolu du capital variable et l’augmentation absolue de la demande de travail suivant une proportion décroissante, et enfin, pour complément, la production d’une surpopulation relative. Nous l’appelons "relative", parce qu’elle provient, non d’un accroissement positif de la population ouvrière qui dépasserait les limites de la richesse en voie d’accumulation, mais, au contraire, d’un accroissement accéléré du capital social qui lui permet de se passer d’une partie plus ou moins considérable de ses manouvriers."
(Marx, Capital, Livre I, Pléiade, t.1, p.1145-1146)
Nous venons de rappeler les différences entre les deux formes de surpopulation et compte tenu des éléments que nous avons collationnés dans le tableau ci dessus, il faut très vraisemblablement déduire de la différence observée entre la croissance de la population active et celle de la population en général, que le développement d’une surpopulation absolue est un élément qu’il ne faudrait pas négliger dans la formation de ce qu’on appelle le chômage. Il n’y a pas lieu de développer ici cet aspect. Nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour nous faire une opinion plus circonstanciée. Toutefois, si nous prenons le cas de la France, pays pour lequel nous disposons de quelques données, il est quelques chiffres qui méritent d’être reproduits.
Ces éléments sont d’autant plus intéressants que la France est le pays ou l’écart est le plus faible entre la croissance de la population active et la croissance de la population. Le dernier recensement date de 1990. Les éléments obtenus se comparent avec le recensement précédent soit celui de 1982. Durant cette période de 8 ans, la population active ayant un emploi a augmenté de près de 800.000 personnes (22.232.974 en 1990, 21.465.960 en 1982). Mais ce chiffre global cache des différences entre hommes et femmes. La population active masculine a diminué de près de 200.000 emplois, tandis que la population active féminine augmentait de près de 1.000.000 d’emplois. La question de la substitution des femmes aux hommes est plus complexe qu’un simple remplacement poste à poste car les professions ont évolué différemment. On peut toutefois considérer, étant donné que le salaire féminin est en moyenne inférieur à celui d’un homme, que le capital y a largement trouvé son compte.
D’autre part, le nombre d’emplois à temps partiel a augmenté dans la même période de plusieurs centaines de milliers, ce qui signifierait qu’en solde net, les emplois créés seraient, pour l’essentiel, des emplois à temps partiel qui permettent très difficilement d’assurer par eux-mêmes la reproduction complète de la force de travail. Enfin, le chômage frappe plus fortement la population féminine. Ce paradoxe d’une augmentation rapide de l’emploi féminin (+ 11,4 % contre 4,4 % pour l’augmentation de la population et 3,6% pour l’augmentation de la population active occupée) tout en conservant un taux de chômage plus élevé trouve une partie de son explication dans l’élévation du taux d’activité des femmes, lui-même à la fois cause et conséquence de la modification des rapports entre les sexes, de la composition de la famille, etc. On peut noter également que les pays "latins", comme la France et l’Italie, ont un rapport population active/population de plusieurs points inférieur aux pays anglo-saxons ou encore au Japon. Les uns sont proches de 40%, les autres de 50%. Une des conséquences, de ce phénomène est de donner une sous-estimation mécanique du chômage dans les pays ou la population active est la plus importante puisque les taux de chômage sont rapportés à la population active. Le taux d’activité, comme la part de la population active dans la population ont varié dans l’histoire, et nous n’en tirerons ici pas d’autres conclusions. Une étude de l’INSEE sur deux siècles de travail montre que le taux d’activité des femmes de 25 à 54 ans est dans les années actuelles le plus élevé de l’histoire de la phase de soumission réelle du travail au capital, que la population active masculine atteint un apogée vers 1974, que le rapport entre la population active et la population augmente régulièrement au XIXè siècle pour dépasser 50% entre 1896 et 1921. A cette époque correspond aussi un rapport entre la population active féminine et la population qui est l’un des plus élevé de l’histoire et c’est ce taux que nous retrouvons de nos jours pour les femmes. Nous avons souvent démontré que contrairement aux cris d’une fraction de la bourgeoisie et des partis réformistes, la période ouverte depuis 1974 ne pouvait être considérée comme une période de crise, celles-ci n’ayant pas de caractère permanent. Mais on sera tenté de voir dans les éléments que nous avons mis en lumière les racines matérielles, en relation bien sûr avec le ralentissement de la croissance de la productivité (telle que la définit la bourgeoisie), d’un tel état d’esprit. A contrario, on remarquera que l’histoire appelle la période qui va de la fin du XIX° siècle à l’aube de la première guerre mondiale (période qui selon les historiens se caractérise par une baisse des prix associée à une hausse de salaires), la "belle époque". Ce que la bourgeoisie occidentale, notamment, perçoit comme une période de crise, recoupe une période qui se caractérise par la manifestation évidente de crises de surproduction dont le cycle est d’environ 6 ans, ce qui marque une éclatante victoire théorique pour le socialisme scientifique. Mais les crises ne sont pas permanentes. Et, si l’on en croit la banque mondiale, les dix dernières années ont été, du point de vue de l’histoire du monde, les plus fortes années de croissance jamais enregistrées. La conjonction de ces sentiments dans notre aire, qui sont en contradiction évidente avec les tendances globales de l’économie mondiale, signifient simplement que les vieux pays impérialistes sont concurrencés par de plus jeunes rivaux et que leur importance relative est en recul sur le marché mondial.
18.7 Population active, population employée : chiffres internationaux
Nous venons de mettre l’accent sur la formation d’une surpopulation absolue et sur les rapports qu’elle entretient avec la surpopulation relative. Notre objectif reste avant tout d’établir, sommairement, la masse de travail vivant qui correspond aux valeurs recensées dans le PIB. Pour cela, il faut déduire de la population active la partie de celle-ci qui, comme son nom ne l’indique pas, reste inactive car elle n’arrive pas à vendre sa force de travail aux seigneurs du capital. Quant à la partie occupée, elle ressent, dans la crainte de rejoindre l’autre fraction, le poids que le capital fait peser sur le prix de sa force de travail. Pour obtenir la population active employée, il faut déduire les chômeurs. Nous connaissons le taux de chômage et son évolution. Nous pouvons calculer la population occupée et la tendance qu’elle suit.
En appliquant le taux de chômage qui figure à la première ligne de chaque case du tableau à la population active du tableau précédent nous obtenons la masse des chômeurs. Une fois ceux-ci défalqués de la population active nous obtenons la population active occupée. Par exemple dans la période 1961-1973, le taux moyen de chômage aux Etats-Unis a été de 4,9%. Rapporté à la population active pour la même période (78,2 millions cf. tableau IV), nous obtenons 3,8 millions de chômeurs. Si nous les déduisons de la population active nous obtenons 74,4 millions (78,2 - 3,8) de personnes employées. Certains pays comme les Etats-Unis ont vu le nombre d’emplois croître considérablement (43,4 millions de personnes soit 117,8 millions - 74,4 millions). Cette croissance est en revanche beaucoup plus faible dans les pays européens recensés ou elle atteint au mieux 2,6 millions de personnes en RFA. L’ensemble des pays européens étudiés ici disposent d’une population pratiquement comparable à celle des Etats-Unis et ils voient la population employée croître de 7 millions de personnes soit 6 fois moins qu’aux Etats-Unis. Tous les pays recensés réunis (Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France) créent moitié moins d’emploi que les seuls Etats-Unis alors que leur population totale dépasse de plus de 40% celle des Etats-Unis. La dernière colonne calcule l’augmentation de la population employée. Pour les Etats-Unis, on constate donc une augmentation de la population employée de 43,4 millions de personnes (117,8 - 74,4) entre les dates répertoriées dans le tableau. Si nous rapportons ce chiffre à la variation de population (cf. tableau IV) nous obtenons le pourcentage de la deuxième ligne. Les Etats-Unis ont vu dans le même temps leur population augmenter de 56,9 millions. La confrontation des deux variations donne pour les Etats-Unis un pourcentage de 76% (43,4/56,8). Si ce taux est supérieur à celui obtenu à la première ligne de la dernière colonne du tableau ci-dessus cela signifie que la population employée a augmenté plus vite que la population. Nous avions déjà montré que la population active avait augmenté plus vite que la population totale. Il n’en est pas forcément de même pour la population employée dans la mesure où le taux de chômage est généralement en augmentation régulière (du moins en tendance).
Tableau V : Taux de chômage et variation de la population employée
|
|
61-73 |
74-80 |
81-90 |
1992 |
% Pop |
|
USA |
4,9% 74,4 |
6,9% 92,4 |
7,1% 108,4 |
7,2% 117,8 |
43,4 76% |
|
Japon |
1,2% 48,8 |
1,9% 53,5 |
2,5% 58,7 |
2,2% 64,7 |
15,9 66% |
|
R.F.A. |
1% 26,5 |
4% 26,3 |
8,2% 27 |
6,3% 29,1 |
2,6 55% |
|
France |
2% 20,4 |
4,8% 21,7 |
9,3% 21,7 |
9,8% 22,4 |
2 25% |
|
R-U |
2,1% 24,9 |
3,9% 25,1 |
9,1% 25 |
9,7% 25,3 |
0,4 15% |
|
Italie |
5,4% 19,6 |
6,8% 20,0 |
10,6% 20,8 |
11,1% 21,6 |
2 37% |
Le résultat de l’analyse est, sous cet aspect, beaucoup plus contrasté. Certains pays comme les États-Unis, le Japon et la R.F.A. ont une croissance de la population occupée plus rapide que celle de la population, comme le montre un taux d'accroissement marginal supérieur au rapport population active/population. Pour les autres pays (Italie, France, Royaume-Uni) le phénomène est inverse. L'Italie est plus ou moins proche d’une situation équilibrée car le rapport entre la population occupée et la population active y est à peu près constant. Dans deux pays la croissance de l'emploi est plus faible que la croissance de la population : il s'agit de la France et du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, où la population active augmente très vite, dans un rapport marginal de 100% avec la population, le taux de chômage est donc parmi les plus élevés. Dans une approche sommaire de la surpopulation relative, puisque nous traçons un trait d’égalité entre la croissance de la population et la croissance de la population employée pour définir la limite entre la population excédentaire engendrée par le progrès de la productivité du travail et celle qui résulte d’un accroissement de la population à la recherche d’un emploi plus rapide que "la richesse en voie d’accumulation", que constatons nous ? Si nous regardons la situation nette, le résultat marginal, trois pays ont compensé par leur accumulation les effets de l’augmentation de la productivité du travail. De ce point de vue, leur surpopulation, telle qu’elle s’exprime à travers le chômage, se présente uniquement comme une surpopulation absolue (Etats-Unis, RFA, Japon). Dans les trois autres pays, les deux effets se cumulent pour atteindre un maximum au Royaume-Uni qui présente à la fois la surpopulation relative et absolue la plus importante. Il existe bien sûr un paramètre important qui a un effet direct sur la résorption de la surpopulation, c’est le taux d’accumulation de la plus-value que le raisonnement suppose identique partout ce qui n’est évidemment pas le cas.
Aux importantes réserves près, relatives notamment au temps de travail et la masse du travail productif, nous avons un aperçu sommaire de la masse de travail correspondant au PIB créé. Nous supposons donc ici, un même degré de socialisation du travail, un temps de travail moyen identique, une part identique entre travail productif et travail improductif. S’agissant de pays d’importance relative comparable, s’agissant des pays capitalistes les plus développés nous nous satisferons pour le moment de cette approximation.
18.8 PIB et capital fixe : chiffres internationaux
Pour obtenir ce qui, dans le PIB, correspond formellement au temps de travail vivant, il faut pouvoir défalquer ce qui correspond au capital fixe usé dans le processus de production.
Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler qu'en première analyse le PIB équivalait non pas à c+v+pl mais à v+pl+ la partie fixe du capital constant. Encore faut-il remarquer qu’à travers un concept comme la formation brute de capital fixe on recense non seulement la partie usée du capital fixe mais également la partie accumulée.
Les pratiques des diverses comptabilités privées dont sont issus les comptes nationaux sont loin d'être homogènes et la détermination de la valeur du capital fixe reste assez imprécise. Toujours en première analyse, si la valeur du produit social augmente (en l'occurrence le PIB) cela peut donc être dû soit à l'augmentation du capital fixe, donc d'une partie du travail mort, soit à l'augmentation du travail vivant. Ce dernier peut augmenter soit du fait de l'accroissement de la population productive (pour un temps de travail moyen inchangé) soit du fait de l'augmentation de l'intensité du travail. Le fait de ne tenir compte que du seul travail vivant nous évite pour le moment de savoir quelle partie est obtenue par le prolétariat sous la forme d'un salaire qui équivaut au capital variable et quelle part revient au capital en tant que plus-value. Bien entendu, il ne faudra rien attendre de la statistique bourgeoise sur ce sujet. Aussi pouvons nous ici ne pas nous en préoccuper et donc distinguer uniquement ce qui relève du travail mort, du capital fixe et ce qui appartient au travail vivant sans savoir quelle est la part relative du travail nécessaire et du surtravail.
Nous disposons de deux types de données. D’une part ce que la statistique appelle la formation brute de capital fixe. Cette valeur correspond à l’addition de la partie usée du capital fixe et de la partie nouvellement accumulée. Nous obtenons ainsi le tableau suivant :
Tableau VI : Formation brute de capital fixe en % du PIB
|
|
61-73 |
74-80 |
81-90 |
1992 |
|
Etats-Unis |
15,0 % |
16,7 % |
16,3 % |
12,9 % |
|
Japon |
32,9 % |
31,8 % |
29,2 % |
30,9 % |
|
Italie |
24,6 % |
24,0 % |
20,9 % |
19,7 % |
|
France |
23,4 % |
23,5 % |
20,4 % |
20,3 % |
|
Grande-Bretagne |
18,4 % |
19,1 % |
17,5 % |
15,5 % |
|
RFA |
24,9 % |
21,0 % |
20,2 % |
21,9% (1991) |
Il existe partout, à des degrés divers, une baisse de la formation de capital fixe depuis les années de la période 1961-1973. Il reste à distinguer ce qui relève d’une baisse de l’accumulation et ce qui correspondrait à la part de la valeur du capital fixe dans le produit social.
Les éléments dont nous disposons montrent qu'il existe une tendance à l'augmentation de la part du capital fixe dans le produit total.
La dépréciation du capital qui doit correspondre à l’usure du capital fixe utilisé au cours du processus de production évolue comme indiqué dans le tableau suivant :
Tableau VII : Dépréciation du capital fixe en % du PIB
|
|
61-73 |
74-80 |
81-90 |
1992 |
|
Etats-Unis |
8,6 % |
10,5 % |
11,5 % |
10,8 % |
|
Japon |
13,0 % |
12,7 % |
13,9 % |
15,7 % |
|
Italie |
10,4 % |
12 % |
12,1 % |
12,6 % |
|
France |
9 % |
11,5 % |
12,6 % |
12,6 % |
|
Grande-Bretagne |
8,8 % |
11,3 % |
11,7 % |
11,5 % |
|
RFA |
9,7 % |
11,3 % |
12,7 % |
12,6 % (1991) |
A première vue, cela signifie que globalement le capital fixe aurait représenté une part plus importante dans la valeur totale du produit. Cette croissance explique donc une part de l’augmentation du PIB. Quand le Produit Intérieur Brut vaut 100, si le capital fixe représente 10% du PIB alors le Produit Intérieur Net vaut 90. Si la part du capital fixe passe à 15% tandis que le PIB s’élève à 200, le produit intérieur net vaut dans ce cas 170. Il a moins que doublé alors que le PIB a doublé. Si le produit net reflète uniquement l’action du travail vivant, le produit brut qui adjoint une partie de la valeur du capital fixe peut augmenter plus vite du fait de l’augmentation plus rapide du capital fixe. Dans notre exemple, tandis que le PIB double, la valeur du capital fixe transférée au produit triple (elle passe de 10 à 30). Ceci dit, comme la progression réelle du capital fixe est limitée, ce facteur ne peut à lui seul expliquer la progression du PIB. Certaines tendances du milieu communiste, à une époque, faisaient ce genre de réponse et attribuaient la croissance du PIB à la seule augmentation du capital fixe. Autant dire qu’elles tournaient le dos à la réalité et aux faits les plus élémentaires. Nous pouvons voir que l’évolution du capital fixe reste limitée et que l’ordre de grandeur reste comparable entre les différents pays.
Observons maintenant quelle part est dévolue officiellement à l’accumulation du capital fixe. Nous obtenons cette information en calculant la différence entre les deux derniers tableaux que nous avons établis :
Tableau VIII : Taux d’accumulation du capital fixe en % du PIB
|
|
61-73 |
74-80 |
81-90 |
1992 |
|
Etats-Unis |
6,4 % |
6,2 % |
4,8 % |
2,1 % |
|
Japon |
19,9 % |
19,1 % |
15,3 % |
15,2 % |
|
Italie |
14,2 % |
12,0 % |
8,8 % |
8,1 % |
|
France |
14,4 % |
12,0 % |
7,8 % |
7,7 % |
|
Grande-Bretagne |
9,6 % |
7,8 % |
5,8 % |
4,0 % |
|
RFA |
15,2% |
9,7% |
7,5 % |
9,3 % (1991) |
On peut observer ici, une tendance contraire à l’évolution de la part du capital fixe dans le PIB et qui se traduit par un ralentissement du taux d’accumulation, avec notamment une nette inflexion dans les années 1980. Les deux tendances non seulement ne sont pas contradictoires mais se complètent pleinement. En première analyse, si l’accroissement du capital fixe dans le PIB peut être une indication de la baisse du taux de profit et de l’augmentation de la composition organique, il s’ensuit que cette baisse du taux de profit a tendance à décourager l’accumulation et induit donc une baisse du taux d’accumulation. Le sujet mériterait d’autres commentaires que nous ne pouvons entreprendre ici. Notons simplement pour ajouter à la perplexité de bon nombre de disciples zélés de la baisse du taux de profit que les pays qui ont la part du capital fixe la plus élevée et donc qui devraient connaître les taux de profit les plus faibles sont les pays qui réussissent le mieux sur le marché mondial (Japon, Italie) tandis que les vieux capitalismes, ceux qui ont été ou sont les premiers du monde et qui ont réalisé les performances les plus médiocres ont les taux les plus faibles (Grande-Bretagne, Etats-Unis).
L’importance relative du capital fixe est comparable entre les diverses nations étudiées et l’évolution est sensiblement la même. D’autre part, il existe des incertitudes dans les calculs statistiques du capital net (ce qui explique que les statisticiens préfèrent donner le PIBrut). Enfin, au delà de l’analyse du capital fixe tel qu’il est fourni par la statistique, il importerait de connaître comment celui-ci se ventile entre les emplois productifs et improductifs.
Ces réserves exprimées, appliquons au tableau recensant l’évolution du PIB, les éléments dont nous disposons quant à l’évolution de la dépréciation du capital fixe. En défalquant cette dépréciation du capital fixe nous obtiendrons une évaluation du rapport entre la valeur apparemment produite telle que l’exprime le PIB et le travail vivant.
Par exemple, pour les Etats-Unis, nous défalquerons du PIB de 1960, la valeur moyenne de la période correspondante. La dépréciation du capital fixe est de 8,6%. Par conséquent nous obtenons, un produit intérieur net de 483,4 - 8,6%(483,4) = 441,8 milliards d’écus.
Tableau IX : Evolution du Produit Intérieur Net (en milliards d’Ecus)
|
|
1960 |
1975 |
1992 |
|
États-Unis |
441,8 |
1142,0 |
4386,4 |
|
R.F.A. |
61,7 |
299,0 |
1187,7 |
|
France |
52,5 |
244,5 |
888,07 |
|
Japon |
36,4 |
351,9 |
2549,3 |
|
Italie |
33,6 |
150,7 |
864,8 |
|
Royaume Uni |
62,3 |
167,4 |
787,0 |
18.9 Intensité apparente du travail : chiffres internationaux
En prenant en compte ces nouvelles données nous pouvons calculer, tout d'abord la valeur créée par actif. Les sources dont nous disposons ne sont pas exactement en correspondance au début de la période, mais l'erreur sera la même pour tous les pays.
Dans le tableau ci-dessous, on trouvera la différence entre les produits intérieur net pour une période donnée.
Par exemple, la différence entre le produit intérieur net des Etats-Unis entre 1960 et 1992 est de 3.944.6 milliards d’écus. Pour une période comparable (cf. tableau V), la population employée a connu une variation de 43,4 millions. En rapportant ces deux chiffres nous obtenons un chiffre qui n’a en soi pas grande signification mais qui nous permet de classer les pays selon le degré de développement de leur intensité apparente. Les deux dernières colonnes du tableau X établissent le niveau absolu de l’intensité apparente en 1992 et en 1996, selon des données provenant d’une autre source et converties en écus. En divisant le PInet de 1992 par la population employée de 1992, nous obtenons un montant de 37,2 milliers d’écus. Pour 1996, les chiffres en milliers de francs donnent le résultat approximatif suivant : 242. Soit le PIB de 1995 : 34.210,3 milliards de francs - 11% de dépréciation du capital fixe (valeur estimée en fonction des résultats connus ; cf. tableau VII) divisé par la population employée soit 125,5 millions (valeur estimée à partir du chiffre du chômage en mai 96 soit 7,448 millions de personnes représentant 5,6% de la population active - 7,448 millions). Ce calcul donne 30 447 milliards de PInet et une population employée de 125,5 millions. Les chiffres de 1992 et 1996 ont donc une relative signification à la différence des premiers. Ils traduisent une première expression de l’intensité apparente du travail. Si toute la population était productive et salariée, il indiquerait que la valeur apparemment créée par le travail vivant serait de près de 242 000 francs par personne employée aux Etats-Unis en 1996.
Tableau X : Variation de population et variation du PIB.
|
|
D PIn |
D Pop |
DPI/DPO |
1992 (M écus) |
1996 (M francs) |
|
USA |
3944,6 |
43,4 |
91 |
37,2 |
242 |
|
Japon |
2512,9 |
15,9 |
158 |
39,4 |
308 |
|
R.F.A. |
1126 |
2,6 |
433 |
40,8 |
340 |
|
France |
835 |
2 |
417 |
39,6 |
279 |
|
R-U |
724,7 |
0,4 |
1811 |
31,1 |
173 |
|
Italie |
831,2 |
2 |
415 |
40,0 |
232 |
18.10 Le déclin du Royaume-Uni et des Etats-Unis
Nous obtenons un résultat contrasté. Le taux de croissance le plus élevé pour ce qui est de l’intensité apparente est réalisé par la Grande-Bretagne, mais en valeur absolue elle occupe la dernière place. Le Royaume-Uni a donc descendu l’échelle des nations ou du moins elle a monté moins vite que les autres. Elle s’est faite supplanter par de nombreux pays, à la fois sur le plan absolu mais aussi sur le plan relatif. En même temps elle semble amorcer un certain redressement, un peu comme si après s’être repliée sur ses bases les plus fortes elle repartait à l’assaut du Monde. En même temps, une très forte croissance de la population active, alliée à une très faible augmentation de la population employée se traduit en 1992 par un gonflement du chômage (notons que le Royaume Uni est un des seuls pays d’Europe où le temps de travail a augmenté). Les derniers chiffres dont nous disposons laissent apparaître une résorption du chômage et une augmentation de la population employée qui atteint près de 26 millions de personnes selon nos estimations soit une nette augmentation en regard des années passées. En dépit de cela, le Royaume-Uni reste en queue du tableau. Première puissance mondiale au XIX° siècle, il est aujourd’hui une nation moyenne. L’expression de sa productivité du travail sur le marché mondial, la situe loin des autres puissances européennes étudiées ainsi que du Japon. Les confettis de son Empire font encore que le soleil ne s’y couche jamais, comme d’ailleurs pour la République française, mais il est beaucoup plus pâle qu’auparavant.
La question du déclin relatif du Royaume-Uni, déclin non seulement en regard de pays à la population plus importante mais aussi par rapport à ceux qui ont une population comparable est une interrogation ancienne. Quand le Royaume Uni a vu sa suprématie contestée par l’Allemagne et les Etats-Unis, et, dans une moindre mesure par la France, une première vague de réflexion a eu lieu sur les causes de ce déclin. C’est à ce débat que fait écho Grossmann. La question qui est posée est de savoir quels sont les facteurs qui font qu’une bourgeoisie réussit mieux qu’une autre à exploiter le prolétariat et comment elle peut perdre cet avantage au fil du temps. On ne peut simplement invoquer les lois du mode de production capitaliste comme le fait Grossmann. Qui plus est lorsqu’il s’agit de lois directement issues non de Marx, mais des acrobaties arithmétiques de notre bon Docteur et dont nous avons eu l’occasion de démontrer l’inanité. En effet, pour Grossmann, à un niveau déterminé de l’accumulation du capital le progrès technique doit se ralentir, étant donné que la valorisation du capital est insuffisante pour répondre à cet objectif (cf. Grossmann, p.173 La loi de l’accumulation et de l’effondrement du système capitaliste). A supposer que tout cela ait un fondement, cela pourrait expliquer pourquoi le pays le plus en avance est rattrapé par les autres. Cela n’explique pas pourquoi il est dépassé. Les lois du mode de production capitaliste sont les mêmes pour tous. Que des pays plus peuplés dépassent le Royaume-Uni soit. Mais de première puissance du monde, il a rétrogradé à la sixième place sur le plan absolu et le recul est plus marqué encore en valeur relative (PIB/habitant et a fortiori PIB/actif) où le Royaume-Uni se situe au delà du vingtième rang.
Les observateurs du début du XXè siècle (Victor Bérard, L’Angleterre et l’impérialisme, Paris, 1900. Schulze-Gaevernitz, L’Impérialisme britannique et le libre-échange anglais au début du XX° siècle, Leipzig, 1906, par exemple) avaient considéré qu’une des caractéristiques culturelles des anglais était leur conservatisme technique, une appréhension ou un refus des innovations technologiques lui même attribué à un processus historique de décomposition sur le plan spirituel. Grossmann remarque à juste titre que dans ce cas on ne voit pas pourquoi ils furent les premiers à les mettre en œuvre à certaines époques. Si les exemples sont légions où des innovations anglaises (à commencer par celles, célèbres de Bessemer puis Thomas dans la sidérurgie) ne trouvèrent pas immédiatement de champ d’application consistant en Grande-Bretagne alors qu’elles étaient mises en œuvre à l’étranger, on ne peut faire reposer sur le caractère national d’un peuple, dont les racines remontent bien avant l’ère capitaliste et que le mode de production actuel a justement pour résultat de dissoudre, l’explication du déclin relatif. On n’ira pas jusqu’à dire qu’il n’a aucune influence. Dans cette affaire, il est peu probable que l’on puisse ramener les différences dans l’importance de l’accumulation à un seul facteur explicatif. Dans la conjonction du tout qui aboutit au constat final, le facteur culturel a nécessairement une dimension qui s’articule de manière complexe avec les autres.
Quels autres facteurs peuvent être mobilisés ? Un tel sujet mériterait une analyse approfondie. Sans donc vouloir être complet et sans volonté de les classer on peut remarquer :
- C’est notamment en tant que puissance maritime que le Royaume-Uni s’est imposé dans le commerce mondial, puissance maritime que sa situation d’île avait notamment aidé à constituer. On peut penser que dans les transports terrestres, par définition, dans le cas d’une île, moins ouverts vers l’extérieur, le Royaume-Uni s’est montré moins à l’aise et, quand les relations sur le continent se sont développées, plus facilement concurrençable. Les dernières enquêtes montrent que dans la patrie du chemin de fer, le temps de transport n’a pratiquement pas diminué, voire régressé, sur certaines lignes depuis près d’un siècle. Et tout le monde connaît les difficultés pour construire une ligne à grande vitesse entre Folkestone et Londres.
- Les transports maritimes eux-mêmes ont évolué avec le percement du canal de Suez. Jusqu’à son ouverture il revenait par exemple moins cher à un soyeux lyonnais de faire transiter sa matière première par Londres que par la Méditerranée.
- Les matières premières nécessaires au développement de bien des industries (houille, fer) du XIX° siècle étaient abondantes en Grande-Bretagne.
- Un modèle démographique caractérisé par une augmentation puis un maintien du taux de natalité, un recul du taux de mortalité s’est imposé d’abord en Angleterre au cours du XVIII° siècle. Les zones industrielles sont également celles qui ont vu croître le plus vite leur population.
- Alors que les élites anglaises ont eu et, sans doute, continuent de bénéficier d’un système éducatif de très grande qualité, l’éducation de masse a été le parent pauvre. Si le capitalisme anglais pouvait s’accommoder et même rechercher pour mieux l’assujettir, un prolétariat analphabète et illettré, l’évolution même du MPC a conduit la société bourgeoise à doter le prolétariat d’un degré d’instruction croissant qui rend toujours plus délicate et toujours moins justifiée la domination de la classe bourgeoise, comme le pouvoir de commandement attaché au capital. En même temps, l’insuffisance croissante du système scolaire, rongé par la bureaucratisation, les contradictions sociales, la séparation vis-à-vis de l’activité productive et dans une moindre mesure sportive, où l’instruction et la culture apparaissent comme des apanages des classes dominantes qu’il faut ingurgiter enrobé d’un démocratisme humaniste dégoûtant et hypocrite, suscitent rébellion et révolte de nombreux jeunes souvent nourris au lait empoisonné de l’individualisme.
- Plus que tout autre, le Royaume-Uni a été un grand pays colonialiste. Comme pour la France, il est vraisemblable qu’une telle situation ait favorisé un certain parasitisme et retardé ou freiné les évolutions que les pays non coloniaux ont du entreprendre plus rapidement. Sans compter la question irlandaise qui reste un boulet à traîner.
Abordons deux autres point qui mériteraient une réflexion.
Très tôt et assez radicalement, le Royaume-Uni a sacrifié son agriculture, au profit de son industrie. N’y a t-il pas eu de conséquences sur la maîtrise des sciences de la vie qui sont devenues et seront toujours plus un des ressorts fondamentaux du progrès des forces productives ?
Le Royaume-Uni est une des démocraties le plus stables du monde. Elle signifie que la bourgeoisie a conservé le pouvoir politique en permanence et donc que les antagonismes de classe n’ont jamais atteint une telle proportion qu’ils en viennent à pousser la bourgeoisie à vouloir délaisser le pouvoir politique, que la lutte des classes n’a jamais été telle qu’elle serve d’épouvantail au point de vouloir freiner le développement économique, en limitant le développement du prolétariat, comme chercha en partie à le faire la troisième république en France, en maintenant le plus possible une paysannerie à l’abri de tarifs protecteurs, ou, au contraire, à accélérer le développement en essayant via une croissance rapide à intégrer le prolétariat, comme ce fut le cas en France après 1968. Par bien des côtés, le développement du machinisme et des forces productives est en relation avec la lutte des classes. La stabilité de sa démocratie et son développement en ploutocratie ne sont ils pas les indices que l’intégration nécessaire du prolétariat pour assurer le développement capitaliste a pu être obtenu plus facilement et donc au détriment du développement du capitalisme moderne.
Le pays qui a succédé au Royaume-Uni, à la tête du monde, emprunte depuis de nombreuses années le même chemin. Les Etats-Unis maintiennent encore un haut niveau de productivité qui reste comparable avec celui des autres pays étudiés. Mais tous, à l’exception du Royaume-Uni, l’ont dépassé. Si nous regardons la tendance de la progression de l’intensité apparente du travail, les Etats-Unis occupent la dernière place du tableau (cf .3ème colonne du tableau X). Cela signifie que la productivité du travail croît plus rapidement dans les autres pays. Les Etats-Unis ont la croissance la plus faible parmi les pays analysés. C’est le pays qui a eu le plus besoin d’accroître le nombre des prolétaires pour étancher sa soif de plus-value. Les autres ont surtout accru la productivité et l’intensité du travail ce qui se répercute dans la valeur de l’intensité apparente telle qu’elle s’exprime sur le marché mondial. L’accroissement de la plus-value aux Etats-Unis est donc le fruit certes de l’augmentation de la productivité et de l’intensité mais aussi de la masse du travail vivant employé. Le niveau de la productivité et de l’intensité du travail y sont plus faibles en regard du standard mondial que représentent, par exemple, les puissances européennes les plus développées. On admirera au passage, le crétinisme de cette même bourgeoisie européenne dont les économistes n’ont d’autre modèle à offrir pour résoudre la question sociale, que le modèle étasunien ou britannique, c’est-à-dire des modèles de déclin. La pensée économique moderne est tellement indigente qu’elle prend pour des vertus les signes les plus certains de la faiblesse. La science économique agonisante hallucine. Elle voit dans les marques de la pauvreté, les symboles de la richesse. Dans son délire, à cause de sa méconnaissance profonde des mécanismes fondamentaux de la production capitaliste, à cause de sa haine du communisme, elle trouve là aussi l’occasion de lancer une critique contre la théorie révolutionnaire, critique qui tourne évidemment à sa confusion. Superficiellement on ne peut que constater que des masses de travail égales n’engendrent pas la même valeur sur le marché mondial. La bourgeoisie exulte. Regardez braves gens ! La théorie de la valeur travail est fausse. Elle annonçait notre mort ; elle est erronée ; nous sommes sauvés !
Mais ces quelques comparaisons entre pays d’importance relative semblable, c’est-à-dire entre des pays qui occupent les meilleures places au festin impérialiste, montrent qu’il existe des différences notables entre les niveaux d’intensité apparente. Ces différences sont encore plus importantes quand on compare des pays qui sont les plus éloignés sur l’échelle industrielle.
Selon la seule théorie capable d’expliquer ces phénomènes, la théorie communiste, cela signifie que plus l’intensité apparente est élevée plus le niveau de productivité est grand, car sur le marché mondial la productivité compte comme intensité. Ainsi s’explique l’apparent paradoxe qui ruine les théories ricardiennes de la valeur, et qui se traduit par le fait que des masses de travail égales donnent sur le marché mondial une valeur inégale.
Les Etats-Unis ont beau avoir créé le plus d’emploi pendant cette période, ils ont beau avoir créé plus d’emplois que l’ensemble des autres pays recensés, ils sont le pays qui a le moins progressé sur l’échelle des nations. Ce n’est que si l’on pouvait montrer que le travail improductif s’est particulièrement développé aux Etats-Unis que les conclusions pourraient être infléchies. En effet, le travail improductif n’est ni créateur de plus-value, ni créateur de valeur et de ce point de vue un emploi supplémentaire ne se traduit pas par une augmentation de la valeur et de la plus-value créée. L’hypothèse d’une croissance plus rapide de cet emploi improductif, est loin de devoir être écartée, mais dans ce cas, il faudrait montrer, à l’aide d’une analyse attentive pourquoi les Etats-Unis ont développé leur emploi improductif à un point tel qu’ils affichent une production par emploi inférieure à la plupart des pays analysés ici.
Le corollaire de cette baisse relative des Etats-Unis sur l’échelle des nations (ils occupent toujours sur le plan absolu la première place) est que le salaire réel moyen y a stagné depuis des années au point de se retrouver encore récemment au niveau des années 1960. Comme nous avons eu l’occasion de le dire ce n’est pas le salaire qui détermine le niveau général des prix mais celui-ci qui détermine le salaire. En d’autres termes, c’est le ralentissement des performances américaines sur le marché mondial, la plus faible croissance de la valeur apparente sur le marché mondial qui se traduit par la stagnation de la valeur de la force de travail.
D’autre part, nous avons raisonné comme si la population employée travaillait selon une durée égale. Il existe en fait une masse de travail annuel différente entre les pays et les écarts sont facilement de 20% entre les extrêmes. Les pays européens sont ceux qui travaillent le moins sur l’année. En France, la durée moyenne annuelle du travail (donc y compris le travail à temps partiel) est tombée à 1.520 heures de nos jours. Ce phénomène n’exclut pas un allongement de la durée du travail pour toute une partie de la population qui travaille.
18.11 Le communisme et la loi de la valeur à l’échelle internationale.
18.11.1 Une théorie mise sous le boisseau
Pourquoi sur le marché du monde, des temps de travail identiques se manifestent-ils par des valeurs différentes ?
Seule la théorie de Marx répond correctement à cette question. Seule la théorie de la valeur internationale développée par Marx nous permet de nous retrouver dans le labyrinthe international. C’est cette théorie, ensevelie sous des pelletées d’économie vulgaire par le "marxisme" de la social-démocratie et du stalinisme, ignorée et défigurée par le mouvement communiste qui ne trouve rien de mieux à produire que des inepties luxemburgistes, des resucées de Grossmann ou Mattick quand il ne s’agit pas d’avatars léninistes, que nous avons résolument choisi de défendre.
Qu’un tel point de vue ait été soigneusement éludé, enterré, estropié, édulcoré, éliminé, estompé, écarté ne relève pas du hasard, car nous avons là une des caractéristiques de la théorie de la valeur du parti révolutionnaire.
Ramener la théorie communiste au niveau de la théorie bourgeoise, en faire une variété de l’économie vulgaire telle est la tâche accomplie par la social démocratie et le stalinisme. Que les traîtres et les fossoyeurs du mouvement prolétaire aient trouvé un renfort inattendu dans un mouvement communiste affaibli par 70 ans de contre révolution et devenu une girouette sensible à tous les vents ne peut que les réjouir pour autant qu’ils aient besoin d’aller au delà d’une simple conspiration du silence concernant ce milieu.
Le leitmotiv de l’économie bourgeoise en matière de rapports de force internationaux est lancinant. C’est la faute aux "pays à bas salaires". En payant des salaires moins élevés qu’aux ouvriers des pays capitalistes les plus développés, les entreprises des "pays à bas salaires", disposeraient de coûts de production inférieurs. La concurrence tourne alors à leur avantage.
Les conclusions qu’en tire la bourgeoisie des pays développés sont multiples :
- Une tendance consiste à réclamer un certain niveau de protectionnisme pour empêcher que les produits concurrents inondent le marché grâce à leurs prix plus bas. De diverses manières tous les pays y recourent (droits de douanes, contingentements, normes techniques particulières, marchés protégés, etc.) tout en clamant, la main sur le cœur, qu’ils sont libre échangiste.
- Une seconde tendance consiste à vouloir aligner les salaires du prolétariat des pays développés sur celui de ses frères des autres pays. Le prolétariat des pays jusqu’ici les plus prospères bénéficierait d’un salaire trop important et d’une protection sociale à l’avenant. La création d’une catégorie d’emplois précaires à très faible rémunération dont on laisse se développer l’usage au mépris de la loi, la substitution des femmes aux hommes, l’augmentation de l’âge de la retraite, les mesures relatives aux charges sur les bas salaires, les beaux jours d’une immigration clandestine qui crée une main d’œuvre à la fois surexploitée et en marge de la société, le poids croissant de l’armée de réserve qui pèse sur les salaires de la partie active, les remises en cause de la sécurité sociale, des allocations chômage, la discrimination de la jeunesse condamnée à un long parcours d’expédients avant d’envisager un emploi à peine plus stable, sont autant de faits qui s’inscrivent dans cette tendance. L’objectif est donc de rapprocher (pas à pas pour le moment) les niveaux de salaire, en ramenant le salaire (direct ou indirect - c’est-à-dire en incorporant le coût de la protection sociale, de l’éducation, etc.) du prolétaire le mieux payé au niveau du salaire du prolétaire le plus mal payé.
- Une troisième tendance est une trompette plus souvent embouchée par la social démocratie, bien que la bourgeoisie ne dédaigne pas l’utiliser. Elle consiste à verser de grandes larmes de crocodile sur le sort des classes prolétaires des pays les moins développés mais toujours plus concurrents des vieux capitalismes. L’objectif, outre le fait de détourner l’attention du prolétariat et d’exciter la concurrence entre prolétaires, est d’entraver la force de la concurrence des " pays à bas salaires " en demandant un ajustement du niveau des salaires, de la protection sociale et de l’éducation. Les humanistes bourgeois sont subitement pris de sollicitude envers le prolétariat ... des autres pays. Ils y réclament volontiers une hausse des salaires, l’accroissement de la protection sociale, le respect de l’environnement, et l’interdiction du travail des enfants. Prompts à s’offusquer de l’exploitation chez les autres, ils sont beaucoup moins pressés de la dénoncer dans leur propre pays. Pourtant, comme le démontre la théorie révolutionnaire, cette exploitation y est nécessairement plus importante tout en permettant au prolétariat, dans les périodes fastes, d’obtenir un niveau de vie supérieur. Nos humanistes oublient volontiers leur propre histoire pour montrer du doigt leurs voisins, alors que leur prospérité relative, leur développement est assis sur l’exploitation éhontée de générations d’enfants dans des conditions qui pourraient paraître odieuses à bien des capitalistes actuels du Sud-est asiatique ou d’ailleurs.
En réponse à cela, la théorie révolutionnaire a largement montré que la valeur des marchandises est déterminée par le temps de travail social moyen nécessaire à les reproduire. La force de travail, comme les autres marchandises, obéit à cette loi. En conséquence si les marchandises d’un pays sont plus compétitives que celles produites dans un autre c’est que leur valeur telle qu’elle s’exprime sur le marché mondial est inférieure à la valeur que l’autre pays affiche sur le marché du monde. Le niveau général des salaires n’est pour rien dans tout cela. Il ne fait que déterminer le taux de l’exploitation du travail. Et, la tendance générale veut que ce taux soit d’autant plus élevé que le pays est plus développé sur le plan capitaliste. En d’autres termes encore, c’est parce que les marchandises se vendent à bas prix que le salaire est bas (ce dernier est déterminé par la valeur de la somme des éléments nécessaires à reconstituer, à reproduire pour être plus précis, la force de travail ) et non l’inverse.
18.11.2 Temps de travail et valeur à l’échelle internationale
Il reste à montrer en quoi des temps de travail identiques s’expriment par des prix différents sur le marché mondial. Ici aussi, la théorie de Marx dispose d’une avance exceptionnelle en regard des théories ennemies. La théorie communiste a fait preuve d’une capacité anticipative sans précédent.
Elle montre que sur le marché mondial :
1° L’intensité du travail n’est pas la même dans les différents pays. Un travail plus intense se traduisant par la création de plus de valeur dans le même temps.
2° la productivité du travail se présente sous la forme de l’intensité du travail et donc qu’un travail plus productif compte comme un travail plus intense.
" (...) sur le marché universel dont chaque pays ne forme qu’une partie intégrante. L’intensité moyenne ou ordinaire du travail national n’est pas la même en différents pays. Là elle est plus grande, ici plus petite. Ces moyennes nationales forment donc une échelle dont l’intensité ordinaire du travail universel est l’unité de mesure. Comparé au travail national moins intense, le travail national plus intense produit donc dans le même temps plus de valeur qui s’exprime en plus d’argent.
Dans son application internationale, la loi de la valeur est encore plus profondément modifiée, parce que sur le marché universel le travail national plus productif compte aussi comme travail plus intense, toutes les fois que la nation plus productive n’est pas forcée par la concurrence à rabaisser le prix de vente de ses marchandises au niveau de leur valeur.
Suivant que la production capitaliste est plus développée dans un pays, l’intensité moyenne et la productivité du travail (national) y dépassent d’autant le niveau international. Les différentes quantités de marchandises de la même espèce, qu’on produit dans différents pays dans le même temps de travail, possèdent donc des valeurs internationales différentes qui s’expriment en prix différents, c’est-à-dire en sommes d’argent dont la grandeur varie avec celle de la valeur internationale. La valeur relative de l’argent sera, par conséquent, plus petite chez la nation où la production capitaliste est plus développée que là où elle l’est moins. Il s’ensuit que le salaire nominal, l’équivalent du travail exprimé en argent, sera aussi en moyenne plus élevé chez la première nation que chez la seconde, ce qui n’implique pas du tout qu’il en soit de même du salaire réel, c’est-à-dire de la somme de subsistance mises à la disposition du travailleur"
(Marx, Capital, L.I, La Pléiade, T.1, P. 1059-1060)
Les conséquences théoriques d’une telle proposition sont fondamentales. Dans un ancien numéro de CouC nous avions interprété cette citation de manière erronée. La conception défendue à l’époque se représentait le rapport productivité intensité à l’échelle internationale comme un phénomène réel. Ce qui signifierait que la valeur créée par le prolétaire du pays où la productivité est plus grande, est réellement plus élevée. Ce n’est pas nécessairement le cas s’il s’agit d’un phénomène social qui se traduit par l’établissement de ce que Marx appelle (cf. la question agraire) une fausse valeur sociale. Marx nous dit que sur le marché mondial la productivité du travail compte comme de l’intensité. Cela signifie que l’échelle des valeurs sociales qui s’établit entre les différents pays n’est pas en proportion du temps de travail qui a été nécessaire à les reproduire. Si un pays dispose d’une productivité du travail supérieure à un autre, s’il produit une marchandise en une heure là ou l’autre en met le double, la valeur du produit ne sera pas pour autant deux fois plus basse dans le pays le plus productif. Tout au contraire. La valeur sociale affichée sur le marché mondial sera en grande partie inversement proportionnelle au temps de travail contenu dans ces marchandises. En effet, la productivité qui se définit par un accroissement du nombre de marchandises pour un temps de travail social identique, compte comme du travail plus intense c’est-à-dire créateur de plus de valeur et de marchandises dans le même temps. Comme, par ailleurs, le pays le plus riche développe une intensité du travail plus importante que le pays moins riche, la valeur sociale qui s’établit dans le pays le plus développé sera supérieure à celle qui se forme dans le pays le moins développé. La valeur réellement créée n’est pas pour autant celle qui s’affiche sur le marché mondial. Si le phénomène est donc de nature comptable, c’est qu’il se situe au niveau de la valeur relative des monnaies.
18.11.3 La valeur de la monnaie n’est pas unique
Marx développe ce point de vue quand il nous dit que la valeur relative de l’argent est plus petite dans la nation où la production capitaliste est plus développée que là où elle l’est moins. Il s’ensuit donc que la valeur des monnaies nationales est différente. Elle est en corrélation inverse avec le niveau de développement de la productivité et de l’intensité du travail. Il est évident qu’il existe d’autres facteurs, propres à la sphère monétaire, qui ont une influence sur les taux de change entre les monnaies. Mais ici il s’agit des déterminants fondamentaux de la valeur de l’argent. Il est fréquent de faire de Marx, un contemporain de l’étalon-or et de la monnaie marchandise. On a tôt fait de laisser penser ou d’affirmer que sa théorie se meut naturellement dans cet espace théorique. On peut constater ici qu’il n’en est rien. Si la valeur des monnaies nationales est différente, cela signifie que leur valeur n’est pas déterminée à partir d’une marchandise universelle qui serait l’étalon commun pour tous les pays. Il existe dans la valeur des monnaies un caractère spécifique qui les lie à la productivité et à l’intensité du travail national. La valeur de l’argent, dans la production capitaliste développée, n’est donc pas strictement liée à la valeur d’une marchandise particulière que ce soit l’or ou une autre marchandise étalon. Ce résultat, qui est contenu implicitement, sinon explicitement dans l’analyse du crédit, pose la théorie révolutionnaire comme une théorie particulièrement moderne. Elle seule a su anticiper le développement du mode de production capitaliste. Elle seule est capable d’en fournir l’analyse et ce qui bien plus important d’en donner l’intelligence de sa mise à mort comme de guider cette action.
"Les effets produits par l’exode de l’or révèlent d’une manière frappante que la production, en dépit de son caractère social, n’est pas réellement soumise au contrôle social : la forme sociale de la richesse s’incarne dans une chose extérieure, séparée de la richesse. A la vérité, le système capitaliste a cela de commun avec les systèmes de production antérieurs, en tant que ceux-ci reposent sur le commerce des marchandises et l’échange privé. Mais c’est seulement dans le capitalisme que ce caractère prend les formes les plus choquantes et les plus grotesques d’une contradiction et d’une aberration absurdes ; car, 1°, c’est dans le système capitaliste que ce trouve abolie le plus complètement la production pour la valeur d’usage immédiate, pour la consommation personnelle des producteurs, si bien que la richesse y existe uniquement comme un processus social où production et circulation s’interpénètrent ; 2°, avec le développement du système de crédit, la production capitaliste tend continuellement à surmonter cette barrière métallique, à la fois matérielle et imaginaire, de la richesse et de son mouvement, mais elle vient chaque fois buter contre cet obstacle.
Dans la crise, on voudrait que tous les effets de commerce, tous les titres, toutes les marchandises puissent se convertir simultanément en monnaie de banque, et que toute cette monnaie redevienne à son tour de l’or"
(Marx, Capital L.III, La Pléiade, T.2, p. 1256-1257)
Aujourd’hui les monnaies sont totalement déconnectées de l’étalon or. Pour autant, cela ne veut pas dire que l’or ne joue plus un rôle, notamment dans les crises, de valeur refuge.
18.11.4 Intensité et productivité à l’échelle mondiale
Nous avons montré, en comparant la situation de pays membres du groupe des 7 pays les plus riches de la planète qu’il existait des différences dans la valeur apparente créée par actif. Ces écarts montrent notamment que l’Allemagne, la France ou l’Italie ont des niveaux de productivité et d’intensité du travail comparables, tandis que les Etats-Unis et tout particulièrement le Royaume-Uni ont reculé dans la hiérarchie mondiale. Du point de vue de la théorie révolutionnaire cela signifie que le niveau de la productivité et de l’intensité du travail est plus élevé dans les trois premiers pays. Comme sur le marché mondial, la productivité compte comme intensité, ce qui se traduit par une valeur relative de l’argent plus faible, la valeur exprimée par actif sera plus élevée. Ce phénomène permet aussi de comprendre comment alors que le temps de travail a été divisé par près de deux en 170 ans, la valeur exprimée par actif est multipliée par près de 13. Le temps de travail annuel est de l’ordre de 3.000 heures en 1830. Il est aujourd’hui, en moyenne inférieur à 1.700 heures. Dans le même temps, la valeur créée par heure de travail a été multipliée par 25 environ. On ne saurait assimiler complètement cette augmentation à un accroissement de l’intensité du travail, même si elle joue évidemment un rôle. La productivité compte comme intensité et induit donc un accroissement de la valeur exprimée par heure de travail.
La comptabilité sociale est donc inverse aux apparences. Plus la productivité du travail est développée, moins le temps de travail social pour reproduire la marchandise est grand. Mais sur le marché du monde, cette productivité se présente de manière inversée : la marchandise paraît avoir plus de valeur ; elle a un prix de vente plus important. La marchandise la plus dévalorisée reçoit la valorisation maximum sur le marché mondial. Les marchandises dont la "valeur" est la plus faible s’expriment dans les valeurs sociales les plus élevées. Ce qui est vrai pour une marchandise donnée l’est généralement pour cette marchandise particulière qu’est la force de travail. C’est-à-dire que la valeur de la force de travail des pays les plus développés est, toutes choses égales par ailleurs, la plus basse. Pour un temps de travail identique, le prolétariat du pays le plus développé fournit donc une masse de plus-value plus importante. Le taux d’exploitation est également plus important dans le pays développé. Donc, contrairement à la vision tiers-mondiste ou à la compréhension limitée de l’entendement petit-bourgeois, c’est le prolétariat des pays les plus développés qui est en même temps le plus exploité. Pour un temps de travail égal, et généralement aussi pour un temps de travail moindre, le prolétaire des pays les plus avancés est plus exploité tant du point de vue de la masse que du taux de plus-value. Mais, leur salaire nominal, et, en règle générale, leur salaire réel est plus élevé. Dans la citation ci-dessus, Marx n’induit pas, automatiquement de ce que le salaire nominal soit plus élevé qu’il en va de même pour le salaire réel, mais tout de suite après les lignes que nous avons citées, il ajoute :
"Mais à part cette inégalité de la valeur relative de l’argent en différents pays, on trouvera fréquemment que le salaire journalier, hebdomadaire, etc., est plus élevé chez la nation A (c’est-à-dire la nation la plus riche - NDR) que chez la nation B, tandis que le prix proportionnel du travail, c’est-à-dire son prix comparé, soit à la plus-value, soit à la valeur du produit, est plus élevé chez la nation B que chez la nation A."
(Marx, Capital, L.I, La Pléiade, T.1, P.1060)
Exprimé d’une autre façon, cela signifie que, le plus souvent, le salaire réel sera plus élevé dans la nation la plus riche. Le taux de plus-value (le prix proportionnel du travail comparé à la plus-value) sera également plus important. Il en va de même du rapport de la valeur de la force de travail à la valeur du produit social. Si le rapport v/pl et le rapport v/(c + v + pl) est plus élevé dans la nation B (la nation où le mode de production capitaliste est le moins développé) que dans la nation A, cela signifie que le rapport inverse à savoir pl/v - taux d’exploitation - et (c + v + pl)/v - rapport entre la valeur du produit social et la valeur de la force de travail sont plus élevés chez la nation la plus développée du point de vue capitaliste.
La tendance du premier rapport (pl/v) confirme bien que chez Marx et pour la théorie révolutionnaire, le rapport d’exploitation ne va pas en diminuant avec le développement de la société bourgeoise, que le taux et la masse de la plus-value ont tendance à être d’autant plus grands que la force productive du travail est importante. En revanche, et cela constitue une des chaînes dorées avec lesquelles le capital attache le prolétariat à son char, le salaire réel y est, fréquemment, plus élevé. Ce point de vue est également développé par Marx dans le passage suivant :
"De toute façon, il ne faudrait pas s’imaginer que dans un pays donné, la valeur relative du travail diminue proportionnellement à la productivité du salaire, le niveau du salaire, dans les différents pays, s’établit en proportion inverse de la productivité du travail. C’est juste le contraire qui se produit. Plus un pays est productif par rapport à un autre sur le marché mondial, et plus les salaires comparés aux autres pays y seront élevés. Ce n’est pas seulement le salaire nominal, mais aussi le salaire réel, qui est en Angleterre plus élevé que sur le continent. L’ouvrier mange davantage de viande, satisfait davantage ses besoins. Mais cela ne vaut pas pour l’ouvrier agricole, seulement pour l’ouvrier de manufacture. Mais il n’est pas plus élevé en proportion de la productivité des ouvriers anglais"
(Marx, Théories sur la plus-value. Editions sociales T.2 p 9-10)
Le deuxième rapport [v/(c+v+pl)] nous indique également que dans l’esprit de Marx, la composition organique du capital est d’autant plus importante que le pays est plus développé, que la force productive du travail y est plus grande. Exploitation accrue n’est pas synonyme de pauvreté tel que le sens commun peut la définir. L’apparence et l’essence ne coïncident pas et seule la conception scientifique propre au socialisme est en mesure de dévoiler, prélude à son renversement révolutionnaire, les mystères de la société bourgeoise. Par conséquent, nous avons démontré que le niveau général des prix est plus élevé dans la nation la plus riche. Si la nation la moins développée arrive à concurrencer la nation la pus riche elle sera nécessairement favorisée par rapport à elle car le niveau général des prix y est inférieur. Bien que globalement moins productive elle apparaît comme plus compétitive sur le marché mondial. Le niveau général des salaires n’est pour rien dans cette affaire. Qu’il soit plus ou moins élevé ne change rien à la force productive du travail et à son expression à travers la formation d’une valeur sociale spécifique sur le marché mondial. Le niveau des salaires déterminera quelle part revient au travail et quelle part revient au capital sous forme de plus-value mais en aucun cas la valeur des marchandises et la compétitivité relative des nations. Si, toutes choses égales par ailleurs, le salaire baisse, le profit augmentera mais il n’y aura a priori aucun renforcement de la compétitivité de la nation la plus développée, car la valeur des marchandises demeure identique. Le niveau plus élevé des salaires est au contraire la résultante de cette productivité supérieure et du monopole relatif qui peut découler de la force productive supérieure des nations les plus développées. C’est parce que la force productive du travail est plus développée que la classe dominante peut accorder des miettes et s’attacher le prolétariat, dans les périodes d’expansion, en augmentant son salaire réel. D’autre part, comme on le verra le prolétariat et plus particulièrement une fraction de celui-ci, son aristocratie, peut bénéficier de l’exploitation des nations les moins développées par les nations les plus développées.
La rengaine sur la concurrence des pays à bas salaires n’est donc qu’une des voies idéologiques qu’emprunte la classe capitaliste pour s’en prendre au salaire du prolétariat. S’agit-t-il du discours protectionniste de secteurs plus directement concurrencés par des pays où la valeur des marchandises est plus basse ? ou bien annonce t-on ainsi un déclin relatif général des nations qui jusqu’ici tenaient le haut du pavé ? En d’autres termes le modèle américain ou britannique qui nous est présenté comme la panacée est-il un modèle de déclin relatif propre à ces sociétés ou préfigure-t-il le chemin que devront emprunter les vieilles sociétés européennes, berceau du capitalisme et héritières d’une longue tradition culturelle occidentale ? L’avenir le dira.
Si Marx est explicite sur les rapports entre salaire réel, taux d’exploitation, valeur relative des marchandises et des monnaies sur le marché mondial, le milieu communiste se montre bien plus hésitant. Perspective Internationaliste après une longue pause et de longs tourments qui ont pu faire penser qu’ils risquaient de quitter définitivement l’orbite de la révolution communiste a repris avec vigueur un mouvement de pensée. Il reste de nombreuses lacunes dans l’expression scientifique, mais les progrès sont tellement sensibles que le concept de décadence issu du C.C.I. n’est plus qu’un décorum, une manie de langage, sans assise théorique solide. Il est dur toutefois de rompre avec la ritournelle à décerveler. Aussi dans le numéro 30-31 (Automne 96) on peut lire :
"Pendant la période ascendante du capitalisme, d’autres nations pouvaient rattraper la formidable productivité de l’Angleterre, précisément parce que la relative séparation des marchés nationaux créait des différences entre les taux de profit moyens nationaux, de sorte que les capitaux à faible composition organique pouvaient utiliser leur taux de profit plus élevé pour alimenter leur propre processus d’industrialisation. Dans le capitalisme décadent, cela est devenu impossible, non seulement à cause du fait que le seuil à franchir pour la formation de capital est de plus en plus élevé, mais aussi à cause de l’égalisation mondiale du taux de profit général. Comme nous le verrons plus loin, parmi les rares cas de développement national réussi au cours du 20ème siècle, l’utilisation des barrières douanières a joué au mieux un rôle mineur. Une autre illustration de ce phénomène a été la spectaculaire augmentation du taux de profit dans des aires telles que l’Amérique latine pendant les guerres mondiales, alors qu’elles étaient presque coupées des importations en provenance des capitaux développés et que la valeur marchande de leurs exportation était régulée dans une large mesure par des conditions de production locales. Aujourd’hui la séparation entre les taux de profit est en train de disparaître. En outre, plus le monde connaît des avancées technologiques, moins la production réalisée avec des méthodes arriérées est capable de s’insérer dans la chaîne de production globale. Tout ce que les pays arriérés ont encore a offrir est leur taux extrême d’exploitation." (P.24)
Nous reviendrons plus loin sur ce qu’il faut penser des "théories" de PI concernant le taux de profit. On se contentera de souligner la dernière phrase, qui comme nous l’avons abondamment montré tourne le dos à la théorie révolutionnaire.
Quant aux affirmations d’histoire fiction, sur l’ascendance du XIXème siècle comparée à la décadence du XXè on ne pouvait pas prendre plus mauvais exemple, comme nous l’avons montré, que celui de l’Angleterre. Dépassée vers la fin du XIXè ou au début du XXè par les Etats-Unis et l’Allemagne (jusqu’en 1914, la moitié des transactions mondiales étaient libellées en livres), le Royaume Uni a depuis été dépassé par La France, Le Japon et l’Italie. Ici nous ne considérons que des pays dont la valeur de la production y est absolument plus grande. Quant au revenu par tête qui permet d’exprimer des comparaisons par rapport à des pays plus petits par la taille de leur population mais particulièrement prospères sur le plan capitaliste (Suisse, Luxemburg, par exemple), il permet de constater que la Grande-Bretagne a rétrogradé au 22° rang des nations.
A l’instar de la C.W.O. (héritière zélée du stalinien Grossmann), PI reprend une vieille antienne qui aboutit à nier toute l’importance du commerce extérieur pour la théorie de la valeur. A l’instar du bourgeois, mais sous prétexte d’un "internationalisme" propre aux petits bourgeois des pays impérialistes, on ne peut dépasser le cadre national. Les spécificités de la formation de la valeur sont ignorées. Les fonctions particulières de la monnaie comme monnaie universelle y sont négligées. De la critique de l’économie politique à sa défense, il y a un fossé que s’efforcent de combler les tenants de conceptions ricardiennes. La dialectique ne comprend pas les choses comme un donné, mais comme un processus. On ne les saisit pas uniquement au repos, sinon on n’en comprendrait qu’un aspect, qu’un moment. Pour appréhender leur devenir, il faut en étudier le mouvement. Il en va ainsi pour la valeur et la monnaie. Le travail abstrait ne peut acquérir toute sa détermination de travail social dans la sphère des besoins nationaux (cf. CouC N°4 " Communisme contre valeur "). Pour être adéquat à son concept, il doit quitter le cadre étriqué de la nation pour aborder le besoin universel du système mondial. Rappelons que contrairement à la représentation que se fait la bourgeoisie, le marché mondial, du point de vue communiste ne se résume pas aux échanges internationaux, mais représente la somme de tous les marchés nationaux. Le travail abstrait forme du travail social propre aux sociétés marchandes, d’une part n’atteint toute son expression qu’avec la généralisation de la production marchande, c’est-à-dire le mode de production capitaliste, et d’autre part ne devient pleinement une fraction du travail universel qu’en se réalisant dans une infinité de valeurs d’usage. Le travail abstrait ne se développe pleinement qu’avec le développement de la production marchande et la généralisation de celle-ci. C’est à travers le commerce extérieur et le marché mondial que son déploiement atteint toute son expression. la valeur réalise son être sur le marché du monde.
"(…) c’est seulement le marché extérieur, la transformation du marché en marché mondial, qui mue l’argent en argent mondial et le travail abstrait en travail social. La richesse abstraite, la valeur, l’argent - donc le travail abstrait, se développent dans la mesure où le travail concret évolue dans le sens d’une totalité des différents modes de travail qui englobe le marché mondial. La production capitaliste est basée sur la valeur, c’est-à-dire sur le développement comme travail social du travail contenu dans le produit. Mais cela n’a lieu que sur la base du commerce extérieur et du marché mondial. C’est aussi bien la condition que le résultat de la production capitaliste" (Marx, Théories sur la plus-value, Editions sociales, T.III, p.297)
Le même point de vue est développé dans le livre I du Capital :
"C’est dans le commerce entre nations que la valeur des marchandises se réalise universellement. C’est là aussi que leur figure valeur leur fait vis-à-vis, sous l’aspect de monnaie universelle - monnaie du monde (money of the world) comme l’appelle James Steuart, monnaie de la grande république commerçante, comme disait après lui Adam Smith. C’est sur le marché du monde et là seulement que la monnaie fonctionne dans toute la force du terme, comme la marchandise dont la forme naturelle est en même temps l’incarnation sociale du travail humain en général. Sa manière d’être y devient adéquate à son idée.(...)
La monnaie universelle remplit les trois fonctions de moyen de paiement, de moyen d’achat et de matière sociale de la richesse en général (universal wealth)."
(Souligné par Marx. Marx, Capital L.I la Pléiade T.1 p.687)
Autant d’éléments qui resteront occultés par Grossmann. Il n’envisage même pas cet aspect fondamental de la théorie de la valeur de Marx. Le seul aspect qu’il commente dans le passage précédent, (après l’avoir cité !), c’est l’échange de valeurs d’usage que permet le commerce international, l’extension de la sphère des échanges et donc de nouveaux champs d’accumulation. L’importance décisive du commerce international pour la détermination du temps de travail social, de la valeur, de l’effectuation du travail abstrait en travail social, donc le mécanisme fondamental qui régit la base matérielle de la production marchande, sont complètement passés sous silence. Les fondements de la détermination des prix, l’importance particulière du marché mondial et du commerce extérieur, tout cela est proprement absent (et pour cause !) de la théorie de Grossmann. Mattick et la C.W.O. (ajoutons y Battaglia Communista puisque tous ces braves gens ont le même point de vue anti-communiste) sont dans la même lignée. Ils en viennent donc, à sous-estimer complètement l’importance de cette fonction de la monnaie, prélude à d’autres révisions. On passe sous silence cette fonction spécifique de la monnaie que Marx met en évidence dans "le Capital" lorsqu’il parle de monnaie internationale. La C.W.O. ne prend même pas la peine de s’y référer. Elle préfère la compagnie des économistes bourgeois dont elle s’empresse de recopier les manuels. Il ne peut en être autrement car dans cette fonction de monnaie internationale gisent les présupposés théoriques de la conception scientifique du socialisme relatives à la formation des prix mondiaux, au commerce extérieur et à l’échange international. Le courant qui va de Grossmann à la C.W.O. en passant par Mattick a choisi de tourner le dos au communisme révolutionnaire, mais ils se garde bien d’affronter Marx directement. On contourne l’obstacle en l’ignorant.
Cette ignorance n’est pas le fruit du hasard. Elle correspond pleinement à l’interprétation de type ricardien de la valeur dont fait régulièrement preuve ce courant de pensée. Cette conception permet de circonscrire le débat dans le cadre de l’égalisation du taux de profit. Elle nie l’exploitation des nations et le fait que des quantités inégales de travail puissent être échangées autrement que sur la base de la péréquation des taux de profit. Or, nous l’avons montré ailleurs, l’égalisation du taux de profit entre les diverses fractions du capital suppose une productivité et une intensité du travail similaire entre les branches et composantes du capital. Ici, sur le marché mondial, c’est au contraire l’inégalité de la productivité et de l’intensité du travail qui est posée. Les conditions de l’échange sont complètement différentes et supposent une formation d’une valeur internationale selon une voie qui n’est pas celle de la formation du prix de production. L’établissement d’une valeur internationale suit plutôt, en tenant compte des particularités propres à l’existence d’un marché et d’un commerce international, la logique constitutive de la valeur de marché au sein d’une branche (cf .C ou C n°4).
En décrétant une égalisation des taux de profit entre les capitaux nationaux, on admet que des temps de travail identiques créent et créeront toujours la même valeur. On se situe dans la perspective d’une théorie ricardienne de la valeur. En même temps que l’on défend une théorie de la valeur rabougrie qui ignore tout des fonctions de la monnaie et qui plaide pour l’éternité du mode de production capitaliste on trouve également l’occasion de la nier en introduisant les pratiques monopolistes.
Après être passé à coté de l’essentiel dans un sous chapitre intitulé "l’importance du commerce extérieur pour l’accroissement de la variété des valeurs d’usage", après avoir anéanti la théorie de la valeur dans un autre sous chapitre intitulé "le commerce extérieur et la vente de marchandises à des prix de production qui différent de leur valeur", Grossmann consacre un chapitre au "commerce extérieur et l’importance des monopoles mondiaux. La lutte pour les matières premières mondiales. L’importance des profits monopolistiques". Grossmann suit ici la veine léniniste. En posant le commerce extérieur comme le domaine privilégié des profits de monopole, donc de prix qui sont déterminés sans rapport avec leur valeur, on procède à un nouveau reniement de la théorie de la valeur. D’un côté, on s’efforce de nier toute spécificité à la loi de la valeur dans son application internationale. On ramène la théorie en deçà de ses possibilités. De l’autre côté, on en nie l’action. On la tire au delà de son champ d’action.
Pour la conception scientifique et dialectique développée par le seul communisme révolutionnaire, le commerce extérieur est aussi bien la base de l’existence de prix de monopoles que la base de leur négation. En effet, sans le commerce extérieur la valeur sociale des moyens de consommation de luxe serait insuffisamment déterminée, car ils ne rentrent pas dans le calcul ni de la valeur de la force de travail ni, généralement, du capital constant. Ils pourraient donc avoir un prix relativement indéterminé si le marché mondial n’était là pour que le travail abstrait acquière pleinement sa dimension de travail social. Il en va de même de tous les produits où un monopole pourrait influencer le niveau des prix. A propos de la rente absolue, Marx écrit :
"On pourrait cependant poser la question suivante : si la propriété foncière confère le pouvoir de faire vendre le produit au-dessus de son prix de production, à sa valeur, pourquoi ne confère-t-il pas aussi le pouvoir de la faire vendre au-dessus de sa valeur, donc à un prix de monopole quelconque ? Dans une petite île où il n’existerait pas de commerce extérieur de céréales, les grains, produits alimentaires, pourraient être vendus comme n’importe quel produit à un prix de monopole, c’est-à-dire à un prix limité seulement par l’état de la demande, c’est-à-dire de la demande solvable, et cette demande solvable est d’importance et d’extension très variables suivant le niveau du prix du produit offert." (Marx. Théories sur la plus-value. Editions sociales T.2 P.387)
Par conséquent, une concurrence faible, voire inexistante entre propriétaires fonciers ("une petite île"), une absence de rattachement au marché mondial via le commerce extérieur, permettraient aux prix de devenir des prix de monopole. Le commerce extérieur a donc comme fonction d’empêcher que les prix n’aient plus de relations directes avec le mouvement de la valeur et par conséquent que se forment des prix de monopole. Si le commerce international est un domaine privilégié pour la création de prix de monopoles, il est aussi le domaine privilégié de leur négation.
18.11.5 La question de l’égalisation des taux de profit à l’échelle internationale
Grossmann que nous avons souvent eu l’occasion de prendre en flagrant délit de mensonge et falsification n’est pas au bout de ses turpitudes. Remarquons comment il anéantit toute la spécificité et l’importance de la théorie de Marx. Grossmann fait semblant de se placer dans une perspective historique dont il ignore tout. Si on admet, nous dit-il, comme le fait Ricardo que la loi de la valeur à une validité générale et que les marchandises sont vendues à leur valeur aussi bien dans le commerce intérieur que dans le commerce extérieur, la différence entre les deux perd de son importance. A travers le commerce extérieur on n’échangerait que des valeurs d’usage différentes sous une valeur d’échange identique. Ensuite, Grossmann cite Ricardo pour qui aucune extension du commerce extérieur n’augmente immédiatement la somme de valeur que possède un pays. Puis, il conclut en introduisant Marx : "Marx, en revanche, accentue le rôle de la concurrence dans les relations d’échange internationales entre les états". Tout ceci n’est là que pour préparer une nouvelle invention de Grossmann à savoir l’idée d’une égalisation des taux de profit à l’échelle internationale. Pour ce faire, Grossmann part des caractéristiques générales stylisées de la production capitaliste. Il reprend à la base de son argumentation un exemple de Marx où ce dernier anéantit tous les discours tiers-mondistes passés et à venir. En effet dans cet exemple, conformément aux tendances générales décrites par la théorie, c’est dans le pays le plus développé que le taux d’exploitation est le plus fort. C’est donc le prolétariat des pays les plus développés qui est aussi le plus exploité même s’il est éventuellement mieux payé. En ce qui concerne la composition organique du capital, il en va de même, c’est-à-dire que celle-ci est plus importante dans le pays où le mode de production capitaliste est le plus avancé. Toujours en conformité avec les tendances générales de la production capitaliste, le taux de profit est plus bas dans la région la plus riche. Dans son exemple, Marx considère un pays asiatique où le taux de plus-value serait de 25% contre 100% dans le pays européen. La composition organique est de 1/4 dans le pays asiatique et de 4 dans le pays européen.
On obtient ainsi la configuration suivante :
PAYS ASIATIQUE
16c + 84 v + 21 Pl = 121 = Valeur du produit
PAYS EUROPEEN
84 c + 16 v + 16 pl = 116 = Valeur du produit
Marx développe cet exemple au début du livre III, pour illustrer les ressorts matériels de l’inégalité des taux de profit. Cet exemple se situe donc avant les analyses de l’égalisation des taux de profit et de la conversion des valeurs en prix de production. Marx conclut :
"Dans le pays d’Asie, le taux du profit est donc supérieur de plus de 25% à celui du pays d’Europe, bien que le taux de plus-value dans le premier soit quatre fois plus petit que dans le second. Les Carey, les Bastiat et tutti quanti en tireront la conclusion diamétralement opposée."
(Marx, Capital, L.III., T.2, P.942-943)
En revanche, Grossmann développe à partir de là une théorie étrangère à celle de Marx. Ce point de vue théorique qui ne se caractérise que par son extrême vulgarité est bien entendu partagé par les épigones de Grossmann qu’il s’agisse de Mattick ou de la C.W.O.
"Mais dans le commerce international on n’échange pas des équivalents parce qu’ici, comme sur le marché interne, existe une tendance à l’égalisation des taux de profit, aussi les marchandises du pays capitaliste hautement développé, c’est-à-dire un pays dont la composition organique moyenne est la plus élevée, sont vendues à des prix de production, qui sont toujours plus élevés que leurs valeurs, tandis que, au contraire, les marchandises des pays ayant une composition organique du capital inférieure sont vendues dans le cadre d’une libre concurrence à des prix de production qui en règle générale doivent être inférieurs à leur valeur." (Grossmann, La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste, Siglo XXI, p.278-279)
Grossmann envisage donc une égalisation des taux de profit à l’échelle internationale. Il à même le toupet de laisser penser qu’une telle conception peut également être imputée à Marx.
"Dans l’exemple de Marx, mentionné ci dessus, cela signifierait que sur le marché mondial se formerait un taux de profit moyen de 18,5% et que, du même coup, le pays européen vendrait ses marchandises à un prix de 118,5 au lieu de 116. De cette manière, sur le marché mondial, des transferts de plus-value se produisent au sein de la sphère de la circulation vers le pays capitaliste le plus développé car la distribution de la plus-value ne se réalise pas en relation avec la quantité d’ouvriers employés mais selon l’importance du capital en action." (Grossmann, La loi de l'accumulation et de l'effondrement du système capitaliste, Siglo XXI, p.279)
Donc selon Grossmann, il s’établit un taux de profit moyen. Il se forme donc des prix de production. On remarquera que pour un montant de capital identique (ce qui est le cas de l’exemple) le niveau général des prix est identique. Dans un tel cas de figure, il y a un transfert de plus-value des pays où le taux de profit est supérieur à la moyenne vers ceux qui ont un taux de profit inférieur à cette moyenne. Compte tenu des conditions théoriques générales qui ont été tracées cela signifie que les pays les moins développés, ceux dont la composition organique et le taux de plus-value est inférieur à la moyenne perdent une partie de leur plus-value au profit des pays capitalistes les plus développés. Dans l’exemple ci dessus le pays le plus riche réalise un profit de 18,5 au lieu d’une plus-value de 16. Il obtient donc un profit additionnel de 2,5. Selon cette logique on pourrait diviser le monde en deux camps : l’un qui reçoit plus de profit qu’il n’extorque de plus-value à ses ouvriers, le camp impérialiste, l’autre qui réalise moins de profit qu’il n’en extrait de ses prolétaires, le camp des pays non impérialistes. Et si par hasard, un pays avait des conditions moyennes telles qu’il obtiendrait un profit égal à sa plus-value, on pourrait discuter à perte de vue sur sa situation de "non aligné". Si nous tirons toutes les conséquences de la conception théorique défendue par Grossmann et consorts, on doit également considérer qu’il existe un niveau général des prix identique d’une nation à l’autre. En effet à travers l’égalisation des taux de profit, il se forme un prix de production international identique. D’autre part le niveau de l’exploitation du camp "non impérialiste" par le "camp impérialiste" est fixé par la différence entre le taux de profit de chaque camp et le taux de profit moyen. Dans notre exemple, le taux de profit des pays les plus développés est de 16%. Le taux de profit moyen est de 18,5%. On pourrait fixer le niveau d’exploitation ou le taux de transfert en fonction du capital avancé à 2,5%. En d’autres termes un profit de 2,5 est transféré d’une partie du monde à l’autre.
Supposons que la valeur produite dans les pays les plus développés et ceux dont le taux de profit est inférieur à la moyenne se décompose ainsi :
Pays de type 1 (pays impérialistes ) : c + v + pl = w
Pays de type 2 (pays exploités) : c’ + v’ + pl’ = w’
c/v= n = composition organique
c’/v’= n’. Par définition nous avons n>n’
pl/v= t = taux d’exploitation
pl’/v’=t’. Par définition nous avons t>t’
v et v’ sont liés par le coefficient h qui exprime le rapport entre les masses salariales des pays de type 1 et 2. v = v’h
Que vaut le taux de profit moyen ?
(pl + pl’)/(c + v + c’ + v’)
Si nous divisons tous les termes par v’ nous obtenons :
(pl/v’ + t’) / (c/v’ + v/v’ + n’ + 1)
Si nous substituons v’ à v/h nous obtenons :
(plh/v + t’) / (ch/v + h + n’ + 1)
Soit :
(th + t’) / (nh + h + n’ + 1)
ou
(th + t’) / (h (n+ 1) + n’ +1)
Toutes choses égales par ailleurs, plus le coefficient h est élevé, ce qui revient à dire que le capital est d’autant plus concentré dans les pays impérialistes, plus le taux de profit moyen tend vers le taux de profit des pays développés. On obtient, à la limite, le taux de transfert maximum qui est égal à la différence entre les taux de profit. La masse maximum de plus-value transférée sera donc égale à la différence des taux de profit appliquée au capital avancé dans les pays les moins développés. Plus le capital est concentré dans les pays impérialistes, moins les pays dominés par l’impérialisme sont développés. Mais plus le capital est concentré dans les pays impérialistes moins ce transfert de plus-value est significatif pour le relèvement du taux de profit. L’exploitation des pays les moins développés à travers les transferts de plus-value a alors d’autant moins d’intérêt pour le relèvement du taux de profit bien que la masse de plus-value transférée soit au maximum.
L’autre facteur qui influence alors le taux de transfert est l’écart entre les taux de profit. Plus cet écart est grand plus le taux de transfert est élevé. Ici aussi, on peut penser, dans les conditions théoriques générales qui servent de cadre au raisonnement, que cet écart est d’autant plus important que la concentration du capital est importante. Quand des pays se développent, l’écart entre leur taux de profit et celui de leur devancier diminue. On en arrive à dire que le maximum d’exploitation serait obtenu pour une organisation du marché mondial qui rend cette exploitation d’autant plus négligeable que les base matérielles de cette exploitation sont importantes.
Belle théorie de l’impérialisme que celle là !
Prenons un exemple qui illustrera le résultat général fourni par l’équation mathématique.
Supposons que le capital des pays impérialistes et des pays exploités se décompose comme suit :
I Pays impérialistes : 90 c + 10 v + 10 pl = 110
II Pays exploités : 10 c + 90 v + 20 pl = 120
Le taux de profit est de 10% dans les pays de type I et de 20% dans les pays de type II. Le taux de profit moyen est de 15% et la masse de plus-value transférée est de 5.
Si le capital est concentré beaucoup plus fortement dans les pays impérialistes au point de rassembler 90% du capital social contre 50% auparavant nous obtenons le résultat suivant :
I Pays impérialistes : 900 c + 100 v + 100 pl = 1100
II Pays exploités : 10 c + 90 v + 20 pl = 120
Le taux de profit dans les pays de type I est de 10% et le taux de profit dans les pays de type II est de 20%. Le taux de profit moyen qui s’établit sur cette base est de l’ordre de 10,9%. La plus-value transférée sera alors égale à plus de 9. Elle tend vers une limite de 10 qui représente le maximum possible dans une telle configuration. Mais dans la situation précédente 5 représentait le 1/3 de la plus-value tandis que dans la situation actuelle 9 en représente moins du 1/10°. Son importance relative diminue quand son importance absolue augmente. L’intérêt de l’impérialisme s’éloigne d’autant plus que sa pression est importante. Et, plus les pays entrent en concurrence plus les pays avancés retirent de bénéfices de cette situation. Voilà le magnifique résultat auquel aboutit la théorie de Grossmann !
Qui plus est, pour pouvoir obtenir ce résultat il faut encore qu’il y ait un échange réel entre les pays. Le transfert de plus-value n’est pas un phénomène virtuel qui verrait un pays vendre ses marchandises à un prix de production supérieur à la valeur marchande et l’autre à un prix de production inférieur à sa valeur marchande. Si ces pays n’échangent pas réellement des marchandises, il ne s’effectue aucun transfert de plus-value. Nous n’aurions qu’une hausse ou une baisse nominale des prix sans modifier les rapports réels. Pour que la plus-value soit intégralement transférée, il faut supposer un échange complet de la production. Une telle perspective suppose que la totalité de la production du pays le plus pauvre soit exportée et échangée contre une partie de la production des pays les plus riches. Des pays qui exportent 100% de leur production n’existent pas et en général, plus un pays se développe plus la part de la production consacrée au commerce international est grande. Le dernier demi-siècle a vu le commerce mondial croître plus rapidement (sauf dans les années de crise[95]) que la production.
18.11.6 La formation du prix de production international
Bien entendu, Marx n’a jamais partagé une théorie aussi vulgaire et abracadabrante. Il l’a même explicitement rejetée :
"La péréquation des valeurs par le temps de travail, et bien moins encore celle des prix de production par un taux général de profit, n’existe pas sous cette forme immédiate entre des pays différents" (Marx, Théories sur la plus-value, Editions sociales, T.2, P.227).
Si les taux de profits ne s’égalisent pas selon la logique de la création d’un prix de production et de la formation d’un taux général de profit, il ne faut méconnaître ni le rôle des transferts de capitaux qui participent à la répartition et au proportionnement du capital entre les branches en suivant notamment le taux de profit qu’ils peuvent en obtenir ni le fait que les taux d’intérêts eux sont beaucoup plus sensibles à un processus d’égalisation internationale du fait de la mobilité des capitaux qui s’investissent dans la sphère financière.
"En soulignant la différence entre le taux d’intérêt et le taux de profit, nous négligeons les deux faits suivants qui contribuent à consolider le taux d’intérêt :
1° La préexistence historique du capital productif d’intérêt et l’existence d’un taux d’intérêt traditionnel ;
2° L’influence directe que le marché mondial exerce sur la fixation des taux d’intérêt, indépendamment des conditions de production d’un pays, influence bien plus importante que celle qu’il exerce sur le taux de profit."
(Marx, Capital L.III, La Pléiade T.2 p;1129)
Au delà du bric-à-brac théorique colporté par Grossmann et Cie, il nous faut revenir aux bases de la conception de Marx. Qu’avons nous appris des éléments que nous avons retracés ci dessus ? Quelles sont les caractéristiques générales d’un pays plus développé ?
Toutes choses égales par ailleurs le taux de plus-value est d’autant plus grand que la productivité et l’intensité du travail sont plus développées. C’est dans le pays le plus développé que le taux d’exploitation sera, pour un temps de travail identique, plus important.
La marche en avant de la production capitaliste et de l’exploitation vont de pair. Il s’agit bien sûr d’une thèse inverse de celle du tiers-mondisme.
La perspective d’une plus grande exploitation n’est nullement contradictoire, comme le démontre Marx, avec deux autres caractéristiques générales : le salaire nominal est plus élevé ainsi que le salaire réel. En conséquence, le niveau général des prix est plus élevé. Si le salaire réel est plus élevé, le pouvoir d’achat des prolétaires de la nation la plus riche exprimé dans la monnaie de la nation la moins riche est d’autant plus important. La composition organique du capital est également plus importante dans le pays le plus avancé. En contrepartie, le taux de profit y sera généralement plus bas.
La hiérarchie des nations se fonde donc sur le degré de développement de la force productive du travail. Les nations les plus haut placées sur l’échelle industrielle indiquant aux autres le chemin qui leur reste à gravir.
Les conditions nécessaires à l’égalisation des taux de profit et la formation d’un taux de profit moyen (intensité et productivité du travail égales, ensemble du travail considéré comme du travail simple, égalité des masses de capitaux, capacité pour le capital et le travail à se mouvoir librement, etc.) ne sont pas réunies sur le plan international. Les lois de la formation d’un prix de production de marché international ne sont donc pas identiques à celles qui agissent dans le cadre national. Sur le marché mondial le travail plus productif compte comme travail plus intense. En règle générale, le travail sera d’autant plus intense qu’il est productif.
Sur ces bases générales nous pouvons dresser un portrait robot des rapports entre un pays développé et un autre qui se situe à un degré inférieur de l’échelle industrielle.
Supposons que dans le pays A, 10 prolétaires travaillent 10 heures et produisent 200 unités d’une marchandise. Le capital constant dépensé est de 100 heures (nous supposerons ici qu’il n’y a pas de capital fixe ou du moins que son temps de rotation est égal à 1). Dans le pays B, 10 ouvriers travaillant également 10 heures ne produisent que 100 unités de la même marchandise Le capital constant qu’ils utilisent équivaut à 50 heures de travail. Supposons un taux d’exploitation de 1,5 en A contre 1 en B. La journée de travail se décompose donc ainsi :
A : 40 v + 60 pl
B : 50 v + 50 pl
En A la valeur de la force de travail est plus faible qu’en B. En revanche, le taux de plus-value y est plus élevé.
La composition organique du capital est de 100/40 soit 2,5 en A et 50/50 soit 1 en B. La composition organique est donc plus importante, comme le veulent nos caractéristiques générales, dans le pays le plus développé. En revanche, le taux de profit est supérieur en B. Il s’élève à 50/(50+50) soit 50% en B contre 60/(100+40) = 43% environ en A.
Le résultat d’une journée de travail dans les différents pays donne le résultat suivant :
A : 100 c + 40 v + 60 pl = 200 heures de travail pour 200 unités de marchandises
B : 50 c + 50 v + 50 pl = 150 heures de travail pour 100 unités de marchandises
Il s’ensuit que le rapport de v/[c+v+pl] est plus petit en A (40/200) qu’en B (50/150).
200 unités de marchandises représentent 200 heures de travail en A et 100 unités de marchandises 150 unités en B. Il faut donc une heure de travail en A pour produire une unité de marchandise contre une heure et demie en B. En A la force productive du travail est donc plus développée. Le rapport entre les productivités nationales est de 1,5. La valeur individuelle de la force de travail est de 4 heures en A (10 ouvriers totalisent une valeur de 40 heures) et 5 heures en B. Compte tenu de la productivité, cette valeur équivaut à 4 unités de marchandises en A contre 3 2/3 en B. Le salaire réel correspond donc à 4 unités de marchandises par ouvrier en A contre 3 2/3 en B. Le salaire réel est donc supérieur en A.
Si nous exceptons le problème du niveau général des prix qui est fonction du taux de change et que nous allons aborder, nous retrouvons dans cette illustration l’ensemble des caractéristiques générales correspondant aux descriptions de Marx.
Le niveau général des prix est déterminé par le taux de change entre les monnaies. Supposons que dans le pays A, une heure de travail corresponde à un dollar. Admettons que dans le pays B, une heure de travail se traduise par un franc. Un échange des marchandises sur le plan international à travers l’équivalence en temps de travail impliquerait un taux de change de 1 dollar contre 1 franc. Mais, un tel taux de change suppose qu’une heure de travail en A soit équivalente à une heure de travail en B. Or la force productive du travail est 50% supérieure en A. Nous savons cependant que la productivité doit compter comme intensité sur le marché mondial. Cela revient à échanger un dollar contre 1,5 francs. Exprimée en francs la production de A représente une somme de 300 francs. Tout se passe comme si la valeur de marché internationale était déterminée par la nation la moins productive. C’est-à-dire un mécanisme qui s’apparente à celui de la rente différentielle (cf. les travaux de CouC sur la question agraire).
Cependant un tel taux de change ne répond pas complètement à la dernière caractéristique qui nous manque à savoir un niveau général des prix supérieur en A. Ce niveau doit être tel que l’ouvrier de A puisse obtenir plus d’unités de marchandises en B une fois son salaire converti en monnaie de B qu’il n‘en obtiendrait en A. Sur la base du taux de change indiqué, les 4 dollars de l’ouvrier de A se traduisent par 6 francs en B. Avec ces 6 francs, il achète 4 unités de marchandises soit la même quantité qu’en A. De la même manière les 5 francs de l’ouvrier de B représentent 3 1/3 dollars. Le prix des marchandises étant de 1 dollar, l’ouvrier de B obtient le même pouvoir d’achat en A qu’en B. La théorie de Marx est bien plus vaste que celle qui postule une égalité des pouvoirs d’achat pour déterminer le taux de change. Ici les salaires nominaux ne différent que pour autant que les salaires réels sont différents. Il nous manque donc un élément pour obtenir un représentation plus complète de la perspective de Marx. Le taux de change que nous venons d’établir est donc le taux minimum. Au delà de ce taux de change nous retrouvons l’ensemble des caractéristiques que nous avons définies. Admettons par exemple, un taux de 1,8 francs pour un dollar. Quand l’ouvrier de A convertit son salaire de 4 dollars en francs, il obtient 7,2 francs et 4,8 unités de marchandises soit 0,8 unités de plus qu’en A. En retour, l’ouvrier de B ne reçoit que 2,8 dollars environ. Il ne peut obtenir que 2,8 unités de marchandises là où il en recevait 3,3 environ.
Comment cela est-il possible sur la base de la loi de la valeur ? C’est qu’à l’effet de la productivité il nous faut ajouter celui de l’intensité du travail qui elle aussi va croissant avec le développement des forces productives du travail. La valeur de la monnaie, est donc fonction de la productivité et de l’intensité du travail. La valeur relative des monnaies dépend donc de la productivité qui compte comme intensité sur le marché mondial ainsi que des différences dans l’intensité du travail. Le taux de change est donc fonction de la différence entre les intensités du travail, ce qui sur le marché mondial correspond à la différence entre les intensités nationales du travail et à la différence des productivités nationales qui comptent comme des intensités sur le marché mondial.
Pour être importants dans la mesure où elles constituent les soubassements de la valeur relative des monnaies, on ne saurait ramener le taux de change aux seules déterminations que nous venons d’évoquer. Le taux de change ne peut être compris comme le produit mécanique de l’intensité et de la productivité du travail. De nombreux éléments relevant de la sphère financière et commerciale, comme les taux d’intérêts, les mouvements de capitaux, les rapports entre les balances commerciales, exercent une influence particulière. Il n’entre pas dans notre propos de les développer ici.
18.12 Les formes de l’exploitation dans le commerce international.
Nous avons vu à quel point nous étions éloignés des acrobaties théoriques de Grossmann. Nous avons également atteint le point où nous pouvons discuter les conséquences des éléments que nous avons mis en évidence. Dans la théorie de Marx, il peut y avoir exploitation d’une nation par une autre. Tout se passe ici comme lors de l’échange du travail complexe et du travail simple sur le plan national. Des valeurs différentes sont créées et on échangera des valeurs différentes. Le produit d’une journée de travail de A, le pays le plus riche, s’échange contre le produit de n journées (n supérieur à 1) dans le pays B. Dans notre exemple, en échange de 1 journée de travail A reçoit de B 1,8 jours de travail. Le pays le plus riche, exploite donc le pays le moins riche, même si, comme l’a montré Ricardo, il tire un avantage comparatif de cet échange.
"Et même en tenant compte de la théorie de Ricardo (...) trois jours de travail d’un pays peuvent s’échanger contre un jour dans un autre pays. La loi de la valeur subit dans ce cas une modification importante. Ou bien, le rapport qui existe dans un pays entre le travail qualifié, complexe, et non qualifié, simple peut exister entre les journées de travail de pays différents. Dans ce cas le pays riche exploite le pays pauvre, même si ce dernier réalise un gain dans l’échange. (...)"
(Marx, Théories sur la plus-value, Editions sociales, T.3, P.121)
A travers les rapports entre les monnaies qui déterminent le taux de change se manifeste l’inégalité de l’échange. L’exploitation et les rapports antagoniques sont présents tout au long de l’échelle industrielle, chacun pouvant espérer exploiter un autre plus faible et chercher à limiter son exploitation par les plus forts. Il existe donc un antagonisme universel entre les nations. Sur le marché mondial un produit de 100 € s’échangera contre un produit de 100 € ; mais, suivant les pays, il ne faudra pas le même temps de travail pour les produire. Plus l’écart est grand entre la productivité et l’intensité de deux pays plus le rapport d’exploitation est grand, plus l’exploitation de la nation la moins développée par la nation la plus riche sera forte. L’intérêt de la nation la plus riche (si elle en obtient les valeurs d’usage qu’elle n‘a pas ou qu’elle obtient à un moindre coût relatif c’est aussi l’intérêt de la nation la plus pauvre) est de participer le plus activement possible au commerce international. Pour le pays riche, plus la part consacrée au commerce mondial est élevée, plus le gain qu’il obtient dans l’échange est important. Cette position de force sur le marché mondial est aussi un puissant ressort pour favoriser l’existence d’une aristocratie ouvrière. En développant la force productive du travail, d’un côté on ouvre la perspective d’une augmentation du salaire réel tout en augmentant d’un autre côté la plus-value et on affirme son rang sur le marché mondial.
"Et la classe ouvrière ? on sait qu’elle connut aussi des périodes de misère durant l’essor inouï du commerce et de l’industrie de 1848 à 1888, car même alors sa grande masse bénéficia tout au plus d’une amélioration passagère de sa condition, et seule une minorité privilégiée et protégée jouit d’avantages durables (...) La vérité, la voici : aussi longtemps qu’a duré le monopole industriel de l’Angleterre, la classe ouvrière a participé jusqu’à un certain point aux avantages de ce monopole. Certes, ces avantages se répartissaient fort inégalement en son sein. La minorité privilégiée en empocha la plus grande partie, mais même la masse en avait, du moins par ci par là, sa portion. C’est ce qui explique qu’il n’y a plus de socialisme en Angleterre depuis la mort de l’owenisme.
Avec la ruine de sa suprématie industrielle, la classe ouvrière d’Angleterre va perdre sa situation privilégiée. Dans son ensemble, y compris donc sa minorité privilégiée et dirigeante, elle se verra alignée au niveau des ouvriers de l’étranger. Et c’est pourquoi le socialisme renaîtra en Angleterre."
(Engels, Le syndicalisme, Petite collection Maspero, T.1, p.192-193)
18.13 Limites de l’exploitation, concurrence et division internationale du travail.
Ce processus d’exploitation trouve en lui ses propres limites. Le maximum des échanges est atteint quand un des deux pays engage la totalité de sa production dans le commerce international. Si l’écart relatif entre le degré de développement de la force productive s’élève, l’exploitation peut augmenter quant à son "taux". Par exemple, on échangera l’équivalent de trois journées de travail contre une aujourd’hui alors que ce rapport était de deux pour une hier. En revanche, toutes choses égales par ailleurs, elle induira pour la nation la plus riche une baisse de la part relative des échanges par rapport à la production.
Les éléments théoriques généraux que nous avons développés supposent une forme de division du travail. Si la même marchandise est produite dans les deux pays, c’est le pays le moins développé qui aura les marchandises les moins chères et donc les plus compétitives. Dès qu’un pays moins développé, peut s’engager sur un barreau supérieur de l’échelle industrielle, il risque de remettre en cause les rapports antérieurs et modifier les rapports de concurrence. Ce n’est pas parce que les salaires sont plus bas que les marchandises deviennent concurrentielles et obligent les pays plus développés à baisser leurs prix (c’est cette situation que Marx a vraisemblablement en vue quand il décrit une situation où la concurrence oblige la nation la plus productive à rabaisser le prix de vente au niveau de leur valeur – cf. ci-dessus ) voire à abandonner certaines productions qui leur étaient jusque là dévolues, mais cela est dû l’action de la loi de la valeur à l’échelle internationale. Les jérémiades sur la mondialisation (comme si le mode de production capitaliste ne supposait pas d’emblée le marché mondial !), sur la "concurrence des pays à bas salaires", n’ont d’autre fondement que les modifications dans les rapports relatifs entre les productivités du travail à l’échelle internationale du fait du développement rapide du mode de production capitaliste et de la force productive du travail qui l’accompagne dans nombre de pays qui jusque là étaient restés en retard dans le concert des nations. La base matérielle des fantasmes de la bourgeoisie autour de ce concept étrange de mondialisation n’est que la reconnaissance et la mise en évidence de ce qui a été prévu depuis un siècle et demi par notre parti à savoir le fait que la principale zone des échanges deviendrait le Pacifique. C’est devenu un état de fait depuis la fin de la dernière décennie.
Pour maintenir leur suprématie, les pays les plus développés doivent donc mettre en place la division du travail la plus conforme à leurs intérêts. Quand ils sont concurrencés, ils ont tendance à promouvoir des techniques protectionnistes. Libre échangistes quand la division internationale du travail est conforme à leurs intérêts, protectionnistes quand elle tourne à leur désavantage. La libre concurrence permet d’accroître l’efficacité de la production capitaliste. Elle aura donc un effet positif sur le taux de plus-value. Le protectionnisme cherche à garantir l’existence d’une production qui est le fondement de tout échange et agit sur le maintien de la masse de plus-value. Les deux aspects ne s’excluent pas mutuellement ; ils sont en opposition dialectique.
Quelle est l’organisation du travail la plus favorable aux pays les plus riches ?
Nous avons déjà vu dans la question agraire que le mode de production capitaliste rend relativement plus cher les produits de la terre et du sol par rapport aux produits industriels. Fort de l’avantage qui peut être retiré du commerce international, les pays les plus développés auront tout intérêt à se réserver la fabrication de produits industriels tout en cantonnant les pays les moins développés dans une activité de production de matière première.
"Une nouvelle division internationale du travail, imposée par les sièges principaux de la grande industrie, convertit de cette façon une partie du globe en champ de production agricole pour l’autre partie, qui devient par excellence le champ de production industriel."
(Marx, Capital. L.I La Pléiade T.1 p. 1298)
Dans ces secteurs où le prix de marché est déterminé sur la base des conditions de production les plus défavorables, les pays les moins développés peuvent plus facilement s’inscrire dans la concurrence internationale et développer un avantage concurrentiel.
"Dire que le travail agricole est devenu, dans la phase actuelle du développement de la production capitaliste, relativement moins productif que le travail industriel, signifie seulement que la productivité de l’agriculture ne s’est pas développée au même rythme et dans la même mesure. (...)
"La réduction du temps de travail nécessaire apparaît minime par rapport au progrès de l’industrie. Cela ressort du fait que des pays comme la Russie, etc. peuvent concurrencer efficacement l’Angleterre en ce qui concerne les produits agricoles. La moindre valeur de l’argent dans les pays riches (c’est-à-dire le coût relativement moindre de sa production pour les pays riches) ne pèse en l’occurrence nullement dans la balance. Car il s’agit justement de se demander pourquoi elle n’affecte nullement les produits industriels dans leur concurrence avec les pays pauvres, alors qu’elle affecte leurs produits agricoles. (Cela ne prouve d’ailleurs pas que les pays pauvres produisent à meilleur marché, que leur travail agricole soit plus productif.)"
(Marx, Théories sur le Plus-value, Editions Sociales, T.2, p.12-13)
Si la Russie peut concurrencer l’Angleterre pour ses produits agricoles et non pour ses produits industriels, c’est que la productivité relative de l’agriculture russe (par rapport à sa production industrielle) est, étant donné le taux de change entre les monnaies anglaise et russe, supérieure à la productivité relative de l’agriculture anglaise. Le taux de change résulte d’une moyenne. Il exprime la productivité moyenne. Celle ci est influencée pour beaucoup, en Angleterre, par la productivité des produits industriels. Les secteurs qui ont une productivité sociale supérieure à cette moyenne (c’est le cas des produits industriels en Angleterre et des produits agricoles en Russie) se trouveront en partie favorisés par cette situation tandis que ceux qui ont une productivité inférieure à cette moyenne (c’est le cas des produits agricoles en Angleterre) sont au contraire défavorisés. Il n’en demeure pas moins que la productivité du travail agricole anglais peut être plus élevée sur le plan absolu, sur le plan de la dépense effective de temps de travail pour une unité de marchandise donnée, que la productivité du travail agricole russe.
18.14 En guise de conclusion : vers l’euro ?
Comment comprendre le mouvement actuel de l’économie bourgeoise européenne vers une monnaie unique ? Tout d’abord on ne doit pas exclure l’erreur. S’il est un domaine où la théorie bourgeoise a une infirmité congénitale c’est bien celui de la monnaie. Que ignorance et stupidité aient remplacé Charybde et Scylla reste une hypothèse plausible. Dans ce scénario, l’aventure de l’euro dont la mise en place effective se télescoperait avec la prochaine grande crise de surproduction se traduirait par un fiasco majeur. Le choix politique de la monnaie unique aggraverait la crise en se privant - partiellement, il est vrai, jusqu’en 2002 - de bien des possibilités nationales de réaction. D’autre part cet échec ouvrirait nécessairement la voie à une relance des tendances nationalistes en Europe.
Comment autant de pays, dont les degrés de développement de la force productive du travail sont aussi différents peuvent-ils créer une monnaie unique ?
Dans ce chapitre, nous avons établi que la valeur de la monnaie était en relation avec la productivité et l’intensité du travail sur le plan national. Ce résultat signifie notamment que le niveau général des prix est d’autant plus élevé que la productivité et l’intensité du travail sont importantes.
Passons déjà quelques faits en revue. Au sein d’un pays donné, il existe des différences de productivité entre les régions comme entre les entreprises. On pourrait penser que la distribution de ces productivités autour de la moyenne est sensiblement identique d’un pays à l’autre. Il semblerait que pour les régions, au moins, ce ne soit pas le cas. Un pays comme l’Allemagne présenterait en effet des régions qui sont parmi les plus productives d’Europe et également des régions qui se situent au niveau des régions les moins avancées. Pourtant l’ensemble est fédéré par le Deutsche Mark.
Nous n’avons à notre disposition aucun élément particulier sur ce sujet mais il est vraisemblable que les Etats-Unis d’Amérique ont suivant les Etats, et, au sein des Etats, suivant les comtés, des niveaux de productivité différents. Cet écart entre les pôles les plus productifs et les pôles les moins productifs est-il comparable à celui qui existe en Europe ?
Si c’était le cas, on aurait encore un exemple où une monnaie unique est compatible avec de grands écarts dans la productivité du travail
Tant que la monnaie est vue dans sa fonction de monnaie de compte, il est indifférent qu’il y ait une ou plusieurs monnaies. Une monnaie unique présente au contraire l’avantage de la simplicité, diminue les coûts propres à la monnaie, etc. Ce qui est en revanche ignoré par la théorie monétaire de la bourgeoisie, toutes tendances confondues, y compris le marxisme vulgaire[96], c’est la compréhension de la monnaie dans sa fonction de monnaie internationale qui exprime le travail national comme travail social sur le marché mondial. De ce point de vue, l’existence d’une monnaie unique joue un rôle dissolvant majeur et accentue les tendances propres au capital en quête d’universalité.
Supposons deux grandes branches d’activité, dans un pays donné. Supposons que la croissance de la productivité soit plus importante dans l’une des deux branches. Dans un premier temps les prix, exprimés sur le marché mondial, de la branche I, la branche la plus productive, vont augmenter, du moins tant que le taux de change de la monnaie ne change pas. Au delà les deux branches devront trouver un compromis par rapport à leurs intérêts spécifiques, compromis qui n’exclut ni tension, ni luttes d’influence, ni victoire temporaire d’un camp par rapport à l’autre pour influencer la politique du change. D’autre part la politique industrielle, avec notamment une perspective de spécialisation plus marquée pour une activité, sera aussi sur la sellette. Mais il s’agit de politiques nationales et la politique du change, comme la politique industrielle sont des éléments qui assurent la cohésion et l’existence d’une bourgeoisie nationale. La création d’une monnaie unique ne peut que favoriser la dissolution d’un tel état de fait. Les intérêts de la branche I et II se disjoignent (ils sont en tout cas reportés de la périphérie nationale à la périphérie européenne) tandis qu’on assiste à la recomposition d’autres forces au sein d’un espace supranational (toutes les entreprises de la branche I par exemple). Une telle politique doit donc engendrer une tendance forte vers un Etat qui dépasse les Etats nationaux actuels, de même la création du Zollverein a été un facteur d’unification.
Mais que la bourgeoisie se mette sur une orbite politique dépassant le cadre national, qu’elle aille, si sa politique réussit, qu’elle en soit consciente ou non, vers des Etats-Unis capitalistes d’Europe constitue un évènement de la plus grande importance. Si la bourgeoisie que notre parti a toujours décrite comme incapable d’aller au delà du cadre national entreprend d’ouvrir la voie à des perspectives qui relèvent du programme communiste, voilà qui en dit long sur la maturité des bases matérielles du communisme, sur l’existence d’une situation sublimée pour reprendre un concept d’Invariance N°6.
Aussi, dans le même ordre d’idée que pour le libre échange, notre parti vote en faveur de l’euro[97].
19. Annexe 1 : Communisme et théorie des crises
19.1 Une lettre de « Il nostro lavoro »
Le centre de recherche économique de Turin "II nostro lavoro", dont nous ne savons toujours pas ce qu'il recouvre (à notre opinion, il s'agirait plutôt d'un cercle de petits-bourgeois socialisants que de l'expression de militants révolutionnaires) nous a fait parvenir une lettre accompagnant leur travail intitulé : "Développement et crise (pour une étude de la reproduction élargie)". Cette analyse qui comprend trois parties, l'une de caractère plutôt statistique, la seconde, théorique et la dernière qui fait un tour d'horizon des positions de divers théoriciens sur le sujet, espère fonder (c'est l'objet de la partie théorique) la crise du MPC sur une disproportion entre les deux sections du capital productif telles qu'elles sont décrites dans le livre II du Capital, c'est-à-dire sur une disproportion entre la section des moyens de production et la section des moyens de consommation. De telles tentatives qui s'inscrivent en droite ligne dans la perspective de l'économie vulgaire de tendance rlcardienne vont, bien sûr, à l'encontre de la position classique du communisme révolutionnaire. Nous avons déjà discuté ailleurs de ces questions (cf. chapitres ci-dessus) pour que nous n'y revenions pas ici. (Il est toutefois à supposer que nos exposés ne sont pas suffisamment clairs puisqu'une bonne partie de la lettre repose sur certains malentendus, et comme les auteurs manient parfaitement les concepts, cela signifie qu'il nous faudra revenir encore sur ces sujets).
"Il nostro lavoro" nous reproche, par exemple, de ne pas être clairs sur ce que nous entendons par contradiction valorisation-dévalorisation et ses liens avec la baisse du taux de profit. On peut, dans une certaine mesure, reconnaître que nous n'avons pas fait une étude détaillée de ce point, bien que nous ayons par ailleurs donné, ici ou là, des indications. La raison en est simple : nous ne sommes pas rendus au point de notre plan d'exposition où ces questions doivent être traitées avec plus de détails. Ceci ne nous empêche pas d'essayer à l'avenir de faire un effort pour être plus didactiques.
"Il nostro lavoro" en vient aussi à nous reprocher de ne pas avoir développé la partie théorique de Rosa Luxemburg consacrée justement à la mise en évidence d'une disproportion dans les schémas de reproduction sous l'effet de la hausse de la composition organique. Si ce sujet doit bien être traité ultérieurement, il est loin d'avoir l'importance - et pour cause, puisqu'ils défendent des théories similaires - que lui attribue "II nostro lavoro", ce aussi bien pour nous que pour Rosa Luxemburg elle-même. Cet aspect du problème est développé au chapitre 25 d'un livre qui en comprend 32 ("L'accumulation du capital") et, vu l'essentiel de son argumentation dans son "Anti-critique", ne tient pas compte de cet aspect des choses.
Dans son engouement pour les théories disproportionnalistes, "II nostro lavoro" est donc conduit à rejeter nos critiques de la disproportion, mais malheureusement, il ne s'en explique pas.
Dans sa lettre, le cercle "II nostro lavoro" en vient également à nous proposer un nouvel exemple pour la production d'or dans les schémas. Cf. Chapitre 11)
I 4.000 c + 1.000 v + 1.000 pl
II 1.980 c + 500 v + 500 pl
III 20 c + 5,05 v + 5,05 pl
et de nous reprocher d'inclure la production d'or dans la section I alors que l'on pourrait très bien la situer dans la section II
"II nostro lavoro" ne comprend pas notre allergie à la théorie de Grossmann et quant à lui, considère que le taux d'accumulation devrait augmenter avec la baisse du taux de profit et que s’il n'augmente pas c'est à cause des dépenses improductives qui croissent afin que l'Etat puisse accomplir son rôle d'amortisseur, absorber un chômage croissant et donc maintenir la stabilité économique et sociale. La lettre se termine sur une série de remarques critiques sur Invariance, qu'il est inutile de détailler Ici. Voici notre réponse
19.2 La prévision de la gauche
"II y a tout d'abord une première chose assez irritante dans votre lettre, qui est, d'une part de nous attribuer des positions que nous n'avons pas et d'autre part de nous opposer des arguments qu'il nous arrive de développer nous-mêmes. Peut-être s'agit-il d'une lecture hâtive ou de problèmes de langue, encore que votre français soit très bon, ou que nos positions ne sont pas assez clairement expliquées, ce qui, étant donné votre dextérité pour manier les concepts économiques nous laisse perplexes quant à la compréhension de lecteurs moins expérimentés.
Par exemple au sujet de la prévision, vous nous reprochez la phrase suivante : "En fait seules les lois mathématiques du multiple commun qui font que 3 cycles de 10 ans équivalent à 5 cycles de 6 ans expliquent que 1975 coïncidait effectivement avec une crise." Cette phrase n'a pas pour but d'expliquer la prévision ! Il s'agit d'une remarque ironique qui vise la prévision faite en son temps par la Gauche d'Italie qui avait prévu, en se basant sur un cycle de 10 ans une crise catastrophique ouvrant l'alternative guerre ou révolution pour 1975. Or, le cycle réel, et nos affirmations s'appuient sur l'étude des statistiques des divers pays capitalistes les plus développés, montre, ce qui est particulièrement évident pour la France où le cycle a été le plus régulier, que ce cycle est désormais de 6 ans. Le cycle de la production capitaliste s'est donc raccourci, comme Marx le prévoyait. S’il y a bien eu une crise en 1975, mais ce n'était pas la crise catastrophique attendue, et donc bien à la date désignée par la Gauche, cela ne signifiait pas que la prévision de la gauche était bonne, comme l'ont triomphalement annoncé certains épigones, mais d'une pure coïncidence. C'est cette coïncidence que nous voulions souligner ironiquement dans la phrase incriminée.
19.3 La production de l’or dans les schémas de reproduction
De même, vous nous reprochez d'inclure la production d'or dans la section I et vous citez une de nos remarques critiques contre Rosa Luxembourg. Si nous avons bien compris votre objection, vous nous prêtez l'intention d'ajouter à l'or lui-même inclus dans la section I certaines marchandises qui seront consommées improductivement. Notre propos visait à démonter, par l'absurde, le raisonnement de Rosa Luxemburg et rien de plus. Dans la page précédente, en suivant Marx, nous soulignons que "cette partie du capital (la partie consacrée à la production d'or) sort du cadre et des hypothèses définies dans les schémas de la reproduction simple". Ce qui signifie que cette production ne relève pas plus au sens strict, de la section I que de la section II. En effet, les schémas "ne font qu'analyser les rapports entre les deux grandes sections du capital productif" (souligné dans le texte cf.11.4 soit trois lignes au-dessus du passage cité).
Au niveau de l'analyse où en était Marx, il n'avait pas pour but de compliquer la situation en introduisant de nouvelles sections qui n'entraient pas, pour l'immédiat, dans le champ de son étude. Nous avons, de ce point de vue, agi dans le même souci, tout comme nous avons voulu montrer, et c'est pour cela que formellement nous avons laissé l'or - dans l'étude de l'équilibre des schémas et non dans l'analyse théorique du problème - dans la section I, que cela ne remettait pas en cause l'équilibre des schémas comme le prétendait Rosa Luxemburg.
Par ailleurs, nous avons pris soin de noter que l'important était de bien voir la place qualitative de ce type de production plutôt que de s'attacher au numéro de la section.
Ceci dit nous avons souligné que n'étaient pas pris en compte dans les schémas (cf. 11.4) :
· le capital productif engagé dans les secteurs produisant le capital utilisé improductivement.
· le capital productif engagé dans les secteurs produisant des marchandises pour l'Etat en tant que celui-ci dépense l'argent comme revenu.
· Le capital engagé dans les secteurs improductifs et où donc il ne produit ni valeur ni plus-value à la différence des deux précédents.
Comme nous le soulignions, on parviendrait sans doute à un meilleur classement si I'on essayait de décomposer les capitaux suivants qu'ils s'échangent contre du capital ou contre du revenu. Bien sûr, ici nous ne visons que les capitaux productifs de plus-value et qui sont en dehors des secteurs I et II. La numérotation de ces secteurs n'a, bien sûr, aucune importance. Par contre, pour les secteurs improductifs (dans la mesure où ils ne produisent ni plus-value ni valeur[98]), ils sont en dehors du problème traité dans le livre II dans le cadre de la reproduction du capital.
Si leur analyse s'impose, nous consacrerons à ces questions, comme au problème des armements par exemple, tout ou partie d’un prochain numéro (cf. chapitre 12 et 13), ce n'est vraisemblablement pas dans le cadre des schémas de reproduction qu'il faut la traiter. Rappelons que Marx devait consacrer un livre entier à ces problèmes. S'il est possible et logique de réintroduire le capital productif utilisé improductivement, il est plus délicat,du point de vue théorique, d'introduire les secteurs improductifs proprement dits. Tout au plus et avec les plus grandes précautions pourrait-on envisager cela à titre illustratif.
Pour revenir au cas particulier de la production d'or, nous ne voyons pas très bien ce que vient faire le fait que l'Etat soit ou non propriétaire de cette partie de la production sociale. Outre le fait que les entreprises nationalisées paient des impôts, tout comme d'ailleurs les fonctionnaires (du moins dans la plupart des pays), le problème qui est posé, au niveau d'abstraction où nous nous situons est que toutes les fractions de la classe capitaliste doivent supporter proportionnellement à leur capital les frais engendrés par l'accumulation capitaliste. Tous les capitalistes disposent d'un capital productif de plus-value et il n'y a aucune raison qu'ils ne se partagent pas les frais improductifs. Que l'Etat soit propriétaire ou non de l'une ou de toutes les branches de la production n'a rien à faire ici,
Rosa Luxemburg reprochait à juste titre à Marx de désavantager la section II. Elle oublie que dans sa solution les capitalistes de la production d'or sont eux-mêmes avantagés par rapport aux autres sections. C'est cette position illogique que nous critiquons. Grossmann commet d'ailleurs la même erreur.
Il en va de même pour vous dans votre schéma. Tout schéma qui, outre une composition organique et un taux de plus-value égal dans chaque secteur, satisferait aux conditions suivantes serait valable :
· « les frais monétaires doivent être déduits de la plus-value.
· les dépenses doivent être proportionnelles, pour chaque fraction de la classe capitaliste, aux capitaux avancés.
· la valeur de la production des moyens de production et des moyens de consommation doit être suffisante pour satisfaire tous les besoins, que ce soit la reproduction du capital constant des secteurs productifs ou la reproduction du capital constant du secteur de la production d'or. Quant aux échanges intérieurs ils doivent se dérouler sans difficultés. »(Cf. Chapitre 11.6.1)
Votre schéma ne répond pas à certaines de ces conditions. Si le taux de plus-value est bien le même dans chaque secteur, la composition organique et le taux de profit y sont différents. La composition organique est de 4 dans le secteur I, 3,96 dans le secteur II et supérieure à 3,96 dans le secteur III.
Bien que vous n'indiquiez pas précisément la répartition des frais monétaires entre les diverses sections, ils ne peuvent être proportionnels dans chaque section. Dans la section I ils sont de 20/5000 soit 0,4%. Si nous appliquons ce taux à la section II nous obtenons 9,92. Ce qui laisse 10,1 - 9,92 = 0,18 pour la section III. Soit un rapport de 0,18 / 25,05 = 0,72% et donc des frais monétaires beaucoup plus élevés que dans les autres sections. Bien sûr, il est possible que vous envisagiez une autre répartition mais quel que soit le cas retenu toutes les sections n'auront pas des frais monétaires proportionnels au capital avancé.
Si vous voulez, à toute force, faire un schéma avec une composition organique de 4 et un taux de plus-value de 1, la solution pourrait être :
I 4.000 c + 1.000 v + 1.000 pl frais monétaires : 20
II 1.480 c + 495 v + 495 pl frais monétaires : 9,9
III 20 c + 5 v + 5 pl frais monétaires : 0,1
De manière plus générale, si nous appelons M la masse monétaire et m la masse monétaire usée, la valeur de la production d'or est égale à : m = c3 + v3 + pl3.
Si nous appelons n la composition organique et t le taux d'exploitation nous obtenons dans le secteur de production d'or :
III mn/(n + t + 1) soit c3 + m/(n + t + 1) soit v3 + mt/(n + t + 1) soit pl3
Dans la section I nous avons :
I A = c1 + v1 +pl1
Dans la section II
II B = c2 +v2 +pl2
Nous avons donc la situation suivante :
I c1 + v1 + pl1 = A
II c2 + v2 + pl2 = B
III mn/(n + t + 1) + m/(n + t + 1) + mt/(n + t +1) = m
Le rapport d’échange entre I et II est tel que :
v1 + pl1 – mn/(n + t + 1) = c2
Par conséquent, II devient :
II v1 + pl1 - mn/(n + t + 1) soit c2 + (v1 + pl1 - mn/(n + t + 1))/n soit v2 + (v1 + pl1 - mn/(n + t + 1))t/n soit pl2
Si nous remplaçons c1 par v1n et pl1 par v1t, nous obtenons alors la situation générale suivante :
I v1n + v1 + v1t
II v1 + v1t - mn/(n + t + 1) + (v1 + v1t - mn/(n + t + 1))/n + (v1 + v1t - mn/(n + t + 1))t/n
III mn/(n + t + 1) + m/(n + t + 1) + mt/(n + t +1)
Dans la section I, les frais monétaires s’élèvent à mn/(n + t + 1) et, par rapport au capital avancé, le poids relatif est égal à [mn/(n + t + 1)]/[v1(1 + n)]
Soit : mn/[v1(n + t + 1) (1 + n)]
Comme les faux frais doivent être proportionnels dans les deux sections, dans la section II, ils sont égaux à :
Frais monétaires de II : taux obtenu pour I x capital avancé de II :
(mn/[v1(n + t + 1) (1 + n)]) (v1 + v1t - mn/(n + t + 1)) (1 + 1/n)
[m (n +1) (v1 + v1t - mn/(n + t + 1)]/[v1 (n + t + 1) (1 + n)]
[m (v1 (1 + t) (n + t + 1)) + m2n]/[ v1 (n + t + 1)2]
Quant aux frais monétaires de III, ils sont égaux à :
(m (1 + t))/(n + t + 1) - [m (v1 (1 + t) (n + t + 1)) + m2n]/[ v1 (n + t + 1)2]
Soit l’équivalent du travail vivant du secteur III (v + pl) – les frais monétaires de la section II.
[v1 m (1 +t) (n + t + 1) – v1 m (1 + t) (n + t + 1) + m2n]/ [ v1 (n + t + 1)2]
Soit : m2n / v1 (n + t + 1)2 = participation de III aux frais monétaires
On peut encore raffiner les choses en posant (A + B) / M = r, c’est-à-dire la vitesse de circulation de la monnaie (compte non tenu de la masse monétaire thésaurisée) et M/m = α
soit un indice de l’usure de la masse monétaire.
A + B = v1 (n + t + 1) + [v1 (1 + t) – mn/(n + t +1)] [(n + t + 1)/n]
D’où :
A + B = (v1 (n + t + 1)2/n) – m
Par conséquent :
M = (v1 (n + t + 1)2/nr) – m/r
Et
m = (v1 (n + t + 1)2/nrα) – m/rα
D’où : m (1 + 1/ rα) = v1 (n + t + 1)2/nrα
m = (v1 (n + t + 1)2/[(nrα (1 + 1/rα)] = v1(n + t + 1)2 / n(1 + rα)
En remplaçant m dans les équations précédentes, on obtient par exemple pour la participation de III aux frais monétaires :
[v1(n + t + 1)2 / n(1 + rα)]2 n / (v1 (n + t + 1)2
Soit :
v1(n + t + 1)2 / n(1 + rα)2
Les frais monétaires de cette fraction de la classe capitaliste représentent donc la part de m égale à :
[v1(n + t + 1)2 / n(1 + rα)2] / [v1(n + t + 1)2 / n(1 + rα)] = n(1 + rα) / n(1 + rα)2 = 1/(1 + rα)
La proportion des frais monétaires de la classe des producteurs d’or au sein de la masse monétaire à renouveler et donc au sein de la production d’or est inversement proportionnelle à l’indice d’usure de la masse monétaire et de la vitesse de circulation.
Pour la section I, les frais monétaires s’élèveraient à :
Mn / n + t + 1
Cela devient
v1(n + t + 1)2 n / (n + t + 1) n (1 + rα) = v1 (n + t + 1) / (1 + rα)
Rapportés à la masse monétaire et donc à la production d’or, la part des frais de I s’élève à :
n / (n + t + 1) (ce qui était évident et que nous savions déjà). Plus la composition organique est élevée, plus la part des frais monétaires incombant à I est importante.
Selon le même processus, pour II nous obtenons :
[v1(n + t + 1) (1 + t - (n + t + 1) / (1 + rα))] / [n (1 + rα)] pour le montant des faux frais incombant à II
((1 + t) / (n + t + 1)) - (1 / (1 + rα)) pour la part de II dans l’ensemble de la production d’or.
La part de travail vivant ayant tendance à décroître au sein de la valeur du produit total, la part des dépenses incombant au secteur II aura tendance à décroître. Pour les producteurs d’or, nous avons vu que leur part des faux-frais était en rapport avec la vitesse de circulation et l’usure de la masse monétaire (abstraction faite d’une corrélation entre l’usure et la vitesse de circulation). Cela est logique puisque le volume du capital à avancer dans la production d’or est fonction de ces critères. Pour un indice d’usure donné, plus la vitesse de circulation sera faible et plus la masse monétaire à renouveler sera importante. Pour une vitesse de circulation donnée et donc une masse monétaire donnée, plus l’usure sera importante et plus la masse monétaire à reconstituer sera grande.
Le rapport classique, dans la reproduction simple, entre les sections I et II est égal au rapport entre le travail mort et le travail vivant (dans le cadre des hypothèses retenues) soit n/(t+1).
Sous cet angle, pour le reconstituer il faut regrouper la production de l’or avec la section II.
[n/(n + t + 1)]/[((1 + t)/(n + t + 1)) – (1 / (1 + rα)) + (1 / (1 + rα))] = n/(t+1)
Ces éléments ont donc beaucoup plus d’importance que vous ne leur en attribuez.
19.4 Les théories de la disproportion
Un autre aspect, parfaitement désagréable de vos remarques, tient au fait que vous négligez le fait que nos travaux sont publiés en feuilletons et n’ont pas trouvé toutes leurs conclusions. Par exemple, dire que nous ne sommes pas arrivés à l’équation fondamentale de la reproduction élargie n’a pas grand sens. Les passages que vous visez se rapportent à une partie de nos travaux où nous exposons Marx.
Nous avons seulement systématisé ce que Marx disait sans ambiguïté. Dans la mesure où il n’a pu achever son travail sur la reproduction élargie en particulier, il n’est pas étonnant de ne pas trouver là où nous exposons l’état des travaux de Marx une généralisation de son point de vue. Nous avons pas mal de choses à dire là-dessus[99]. Une lecture plus attentive et un petit coup d’œil sur le plan indicatif de nos travaux vous aurait permis de voir que nous envisageons d’en parler. La même choses vaut pour Rosa luxemburg. Nous avons commencé une critique de Rosa Luxemburg. De grâce, laissez-nous la terminer ! et méditez donc un peu plus ce qui est déjà publié.
Ce qui est par contre sûr, c'est que nous avons déjà réfuté (cf. ci dessus) l'idée que le chapitre 25 de "L'accumulation du capital" soit une des parties les plus aiguës du discours luxemburgiste. Sans entrer dans le sujet, l'un des principaux reproches que l'on peut faire à une telle démarche est d'ordre méthodologique. C'est-à-dire que c'est un non-sens que de vouloir, dans le cadre des schémas de reproduction, introduire la hausse de la composition organique. Tel n'était pas leur objet et telle n'était pas leur destination. Cela nous vaut des débats où l'inanité des arguments ne cède le pas qu'à l'imbécillité des conclusions.
Nous avons déjà été passablement longs aussi vous nous excuserez de ne pas reprendre de manière détaillée le point sur Invariance.
Nous sommes issus de cette revue, mais nous ne revendiquons que les N* 1 à 7 de la première série 1968-69. Les éléments auxquels vous faites allusion ne nous concernent donc pas, sans compter d'une part qu'ils n'ont pas grand intérêt et que d'autre part nous serions assez tentés d'être d'accord avec votre observation finale.
Pour ce qui est de Grossmann, on pourrait vous retourner la question. Grossmann est un professeur d'économie politique stalinien dont l'ouvrage principal est une caricature de la conception communiste de la baisse du taux de profit. Sa théorie, loin de montrer que le MPC ne peut qu'engendrer des crises catastrophiques va plutôt dans le sens de son éternisation. Ricardo aussi pensait que le taux de profit baissait, cela n'en faisait pas pour autant un révolutionnaire. La théorie de Grossmann présente avec celle de Ricardo de nombreuses affinités. A la baisse graduelle de la productivité dans l'agriculture et à la hausse de la rente se substitue une hausse de la composition organique indépendante de la plus-value produite et un ralentissement dans le progrès de la productivité au travail. Son premier sophisme a pour résultat immédiat de faire augmenter le taux d'accumulation alors que le taux de profit baisse ce qui est en contradiction la plus flagrante -contrairement à ce que vous affirmez - avec la théorie de Marx. Ces sophismes le conduisent à falsifier Marx sur cette question comme sur celle de la surpopulation relative puisque sur la base de son raisonnement la surpopulation, malgré la baisse du taux de profit, ne se présente, encore ne s'agit-il que d'un artifice, que lorsque la plus-value vient à manquer. Bien entendu son délire se poursuit à propos de l'exportation de capital etc. - vous n'y échappez pas non plus lorsque dans votre ouvrage vous parlez d'égalisation internationale des taux de profit, thèse tout a . fait contraire à celle de Marx.
Quant aux crises qui apparaissent au bout du compte, elles n'ont rien à voir avec celles que Marx jugeait comme étant déterminantes pour l'avenir du MPC. Il s'agit de crises de disproportion - celles d'ailleurs dont vous raffolez - c'est-à-dire de crises partielles, les seules acceptées par Say, un des économistes les plus vulgaires dénoncés par Marx, et qui impliquent chez leurs théoriciens une conception où l'argent n'est vu que comme moyen d'échange sans voir qu'il contient la possibilité d'une scission entre la vente et l'achat et donc la possibilité d'une crise qui, elle, pourrait être générale. C'est donc sur la fameuse "loi des débouches" que reposent les théories des crises qui voient la disproportion comme le fondement général des crises. Cela conduit par voie de conséquence à la possibilité d'éviter des crises générales pour peu que l'on se donne les moyens, la planification par exemple, de favoriser la limitation et la résorption de ces crises sans compter que les mécanismes du marché favorisent eux-mêmes le rétablissement de l'équilibre. ("L'harmonie n'est toujours que le résultat du mouvement, aboutissant à abolir la disharmonie existante").
Grossmann aurait du rester dans les poubelles de l'histoire si malheureusement un révolutionnaire comme P. Mattick ne l'avait en quelque sorte réhabilité en reprenant l'essentiel de ses théories et en chutant du même coup dans l'économie vulgaire. Comme il est particulièrement important pour le parti communiste de bien montrer sa spécificité et donc de bien se démarquer des faux frères qui pourraient égarer le mouvement prolétarien dans les chemins de la contre-révolution, il est d'usage que, tactiquement, le parti communiste tape d'autant plus fort qu'il s'agit de "cousins", d'"amis" c'est-à-dire de gens dont les conceptions peuvent paraître très proches alors qu'elles sont éloignées de 180° des positions cardinales du communisme. Le fait que vous vous en étonniez montre que nos craintes quant à l'influence de Grossmann étaient justifiées et montre également que nos efforts ont été insuffisants. Nous en tirerons donc la conclusion qu'il nous faudra argumenter davantage, sans craindre de se répéter et de redoubler nos coups.
Si la théorie de Grossmann est contre-révolutionnaire il en va évidemment de même des théories disproportionnalistes. Que vous ne soyez pas d'accord est une chose, encore faudrait-il argumenter. Cela devrait vous conduire à la réfutation des positions de Marx sur cette question dont nous ne voulons être que les fidèles interprètes. Nous craignons seulement - et en cela vous n'êtes pas les seuls puisque depuis plus d'un siècle tous les savants bourgeois, les réformistes et les renégats s'y sont cassés les dents - que vous ne soyez pas de taille pour cela.
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous disons notamment dans les chapitres 5 et 6 et dans d'autres endroits. Si nos exposés ne vous paraissent pas clairs sur cette question, le mieux est de vous reporter à Marx.
Le fond de votre opposition aux théories de Marx vient de ce que vous pensez avoir - comme bien d'autres avant vous - bouleversé l'économie politique en "découvrant" (vous ne le citez pas, mais dans les années 30, Léon Sartre a développé une théorie assez proche de la votre) une nouvelle loi qui démontrerait imparablement que le MPC devrait succomber sous les coups de la disproportion...
Notre attitude à ce sujet est très bien exposée dans "Le Marxisme des bègues" que nous avons reproduit dans notre N°4 :
"II serait inutile et même nuisible de spécifier ou de personnaliser, et de rechercher au loin ou à proximité le lanceur de bombes bactériologiques; il s'agit d'individualiser le virus et de lui appliquer l'antibiotique qu'obstinément nous affirmons se trouver dans la continuité de la ligne, dans la fidélité aux principes, dans la préférence donnée 999 fois sur mille à la rumination catéchique plutôt qu'à l'aventure de la découverte scientifique nouvelle qui exige des ailes d'aigle, et pour laquelle de vulgaires moustiques se sentent attirés par le destin."
En l'occurrence on peut craindre que, loin d'apporter une lumière nouvelle, vous vous y soyez brûlé les ailes. Pour notre part, nous connaissons l'antiviral propre au virus "disproportion" et nous continuerons à l'appliquer.
Votre "démonstration" pp.85 et suivantes repose sur un sophisme qui aurait bien besoin d'une démonstration. Vous écrivez : "Comme on l'a vu Q (c'est-à-dire la composition organique NDR) croît avec le temps plus rapidement que p'v (le taux de plus-value NDR), pour cela le rapport 1 + p'v/Q tend vers 0. On en déduit que, avec le temps et si m (c'est-à-dire le rapport entre le capital variable en I et le capital variable de II et plus généralement le rapport entre la section I et la section II NDR) demeure constant, l’inéquation :
(1 + p'v/Q) m > 1 ne peut être vérifiée." (souligné par nous NDR).
On affirme ici ce qui devrait être démontré. A quoi est donc égal le rapport m ? Il est égal au rapport entre les deux sections. A quoi ce rapport est-il égal ? Dans le cas de la reproduction simple il est égal à Q/(1 + p’v) pour reprendre vos notations. Dans le cas de la reproduction élargie ce rapport est un peu plus complexe puisqu'il est égal à :
Q (Q + p'v (1-x) +1) / [Q + p'v ( 1 + Qx )+ 1] (où x est la fraction de la plus-value consommée) mais cela ne change pas les tendances fondamentales puisqu'avec le temps, en tenant compte des hypothèses antérieures, Q croissant plus vite que p'v ce rapport s'élève. Cela bien sûr a depuis longtemps été souligne par les théoriciens du mouvement communiste, qu'il s'agisse de Lénine ou de Rosa Luxembourg.
Votre raisonnement est à peu près de l'acabit de celui-ci : prenons un cycliste, supposons qu'il reste sur place ; avec le temps il arrivera un moment où il mettra pied à terre. L'ennui c'est que les cyclistes sont plutôt faits pour pédaler et que les rapports entre les sections ont tendance à se modifier. Qu'à cette occasion puissent se manifester des disproportions, qui le nie ? Surtout pas Marx, mais extrapoler de sophismes une théorie abracadabrante faisant des disproportions le fondement de l'effondrement du MPC, permet de dire n'importe quoi sur beaucoup de points. Il est vrai que vous ne vous privez pas de cette dernière possibilité, vos travaux étant la ennième tentative de ramener le programme communiste au niveau de l'économie vulgaire.
Bien entendu, comme vous avez pu vous en rendre compte en lisant notre revue, nous ne sommes pas d'accord avec vous sur le moindre point essentiel. Plutôt que de perdre notre temps à détailler cela, nous préférons vous faire part des doutes qui nous assaillent. Nous ne vous connaissons pas et votre travail fait plutôt penser à un mémoire d'économie politique, truffe d'anglicismes, destiné aux étudiants de la faculté de Turin, qu'à un travail de parti qui s'adresse à l'Internationale des communistes révolutionnaires. On ne sait si on a affaire à un regroupement de révolutionnaires ou à un cercle d'universitaires ou de théoriciens en chambre dont l’académisme est la première vertu.
Vous citez sur le même plan des bourgeois réactionnaires, des imbéciles et des théoriciens communistes. A défaut de savoir que Sweezy est toujours vivant vous auriez pu savoir que, par exemple, Mattick est mort. Quant aux quelques considérations comme celles-ci : "La possibilité, les chances, pour l'oligarchie financière (sic) d'aujourd'hui de surmonter la dépression sont inversement proportionnelles au temps..." elles font naître en nous plus d'un doute, renforcés par la préface. Comme si la seule perspective du capital n'était pas la guerre. Comme si l'alternative n'était pas guerre ou révolution. Quant à la possibilité d'un redressement du capital à l'issue d'une nouvelle guerre mondiale, il est moins que probable, si bien que l'alternative est plus que jamais : communisme ou destruction de l'humanité.
20. Annexe 2 : Où l'on retrouve une classe ouvrière que d'aucuns disaient disparue.
20.1 La diminution de la classe productive
Parmi les arguments secondaires que les thuriféraires de la décadence du capitalisme mettent en avant, il en est un, des plus curieux, qui a trait à l'importance de la classe ouvrière. "Dire comme nous le faisons le C.C.I. et nous mêmes, que la croissance exponentielle (sic) du prolétariat en proportion de la population active – qui caractérisa la phase ascendante du capitalisme – a touché à sa fin depuis environ 1914 n'exclut pas une augmentation considérable de la proportion de la classe ouvrière dans la population de nombreux pays comme le Brésil, la Chine, ou l'Inde depuis ce moment" (P.31 Perspective Internationaliste revue de la FECCI.).
Si l'on comprend bien le sens de cet argument insolite, cela signifie que tant que le capitalisme était ascendant il était à même de créer de nombreux emplois ouvriers, d'accroître la classe ouvrière, et donc par là montrait sa vitalité, tandis qu'aujourd'hui (c’est-à-dire depuis 1914 environ) ce phénomène est stoppé (du moins pour les principaux pays où le développement capitaliste est le plus avancé) voire, comme l'affirme parfois de C.C.I., il y aurait même, avec la "désindustrialisation" de certains pays, un recul absolu des effectifs de la classe ouvrière.
Avant même de regarder plus en détail le bien fondé de telles assertions, il importe de rappeler quelques points fondamentaux du programme communiste. Le but du MPC n'est pas d'employer plus d'ouvriers mais de produire le maximum de plus-value. Dans cette perspective :
"il y a deux tendances qui se contrecarrent sans cesse ; employer le moins de travail possible pour produire une quantité de marchandises égale ou supérieure, un net produce, une surplus-value, un net revenue égaux ou supérieurs ; deuxièmement, employer le plus grand nombre possible de travailleurs (quoique le moins possible par rapport au quantum de marchandises qu'ils produisent), parce que la masse du travail employé – à un niveau donné de force productive – augmente la masse de surplus-value et de surplus produce. L'une de ces tendances jette les ouvriers sur le pavé et rend la population surabondante, l'autre les absorbe à nouveau et élargit absolument l'esclavage du salariat si bien que le sort de l'ouvrier est toujours fluctuant sans qu'il puisse pourtant jamais s'en libérer."
(Marx, Théories sur la plus-value, Editions Sociales, T2, p.686)
Par conséquent, pour obtenir le maximum de plus-value de la classe ouvrière, le capital, pour un temps et une intensité du travail donnés, développe la productivité du travail au travers de l'accroissement de la composition organique du capital si bien que la part du capital variable dans la masse du capital accumulé tend à baisser. Par la même occasion, la croissance de la classe ouvrière est ralentie tandis que le taux de la plus-value relative augmente. Cette tendance est contrecarrée par l'accumulation de la plus-value qui favorise la croissance de la classe ouvrière, et ce d'autant plus que le taux et la masse de cette plus-value augmentent. Cette accumulation supplémentaire, généralement, compense et au delà la tendance précédente; aussi Marx peut-il écrire:
"Le nombre des ouvriers employés par le capital, donc la masse absolue de travail qu’il met en oeuvre, donc la masse absolue du surtravail qu'il absorbe, la quantité de plus-value qu'il crée, donc la quantité de profit qu'il produit, peuvent, par conséquent, s'accroître, et s'accroître progressivement, malgré la baisse progressive du taux de profit. Dans le système capitaliste, c'est là non seulement une possibilité ; c'est une nécessité, si nous négligeons des fluctuations temporaires."
(Marx, Capital, L. III, La Pléiade, T.2, p. 1006)
Avec une éventuelle diminution du nombre absolu d'ouvriers, c'est donc une des limites absolues du mode de production capitaliste qui serait atteinte, non par faiblesse du développement, mais, parce que la productivité du travail aurait été poussée à son comble pour ce que peut admettre la société bourgeoise dont les bases, reposant sur la mise en valeur du capital, sont limitées pour assurer le développement des forces productives.
"D'ailleurs, seul le mode de production capitaliste exige que le nombre des salariés augmente absolument, malgré leur diminution relative. Pour lui, les travailleurs sont en surnombre dès qu'il n'est plus indispensable de les occuper de 12 à 15 heures par jour. Un développement des forces productives qui diminuerait le nombre absolu des ouvriers, donc qui permettrait à toute la nation d'accomplir sa production totale en un temps moindre, entraînerait une révolution, parce qu'il rendrait superflue la majeure partie de la population." (Marx, Capital, L.III, La Pléiade, T.2, p.1043)
Pour Marx, donc, la perspective d'une diminution de la classe ouvrière, hormis le cas de fluctuations passagères, n'était qu'une hypothèse d'école dont la réalisation signifiait un tel développement de la force productive du travail que les limites de la production capitalistes étaient atteintes et donc que, à brève échéance, les bases de la production capitaliste seraient réduites à néant. Que plus de 70 ans après la date fatidique de 1914 le mode de production capitaliste accumule de la plus-value tandis que le taux et la masse de cette plus-value ont cru à un rythme supérieur à celui du XIXème siècle, siècle de la soi disant phase ascendante du MPC, voilà qui n'est pas pour gêner ceux dont la profondeur de pensée s'arrête au fond du demi de bière du café du commerce. Qu'à cette occasion, comme en d'autres, la théorie révolutionnaire soit malmenée ne sera donc pas pour nous surprendre.
20.2 Conséquences théoriques
Car enfin, que peut signifier l'éventualité d'une stagnation ou d'une diminution absolue du nombre de travailleurs productifs?
En schématisant on peut envisager plusieurs cas de figure. Tout d'abord ce cas adviendrait si la plus-value n'était plus accumulée; on aurait alors, toutes choses égales par ailleurs, une reproduction simple de la société, la plus-value étant dépensée improductivement et n'étant donc pas accumulée. Il est possible que la vision fantasmagorique qu'ont le C.C.I. et associés du développement capitaliste ait quelque chose à voir avec une telle supposition puisque selon leur conception la plus-value ne peut être réalisée au sein des rapports de production capitalistes.
D'autre part, dans l'entre deux guerre, les tenants de la décadence justifiaient leur théorie par le fait que la plus-value n'augmentait plus ; ce qui, à l'époque, pouvait paraître plausible. L'accumulation effrénée qui a suivi la IIème guerre mondiale est venue balayer tous les sophismes à base de luxemburgisme plus ou moins – plutôt moins d'ailleurs – bien assimilé. De fait, le C.C.I. n'a jamais pu fournir, et pour cause, une explication rationnelle qui, selon sa propre logique, permettrait de comprendre la possibilité d'une accumulation de la plus-value ; accumulation qui suppose une réalisation que l'on a auparavant décrétée impossible de manière significative. Or l'accumulation du capital, quelle que soit l'importance du taux de croissance et en dehors des années de crises (tous les 6 ans environ) est une réalité difficile à nier.
Nous en arrivons alors, toujours schématiquement, à une deuxième possibilité d'absence de croissance du nombre d'ouvriers, cas qui correspond à la perspective envisagée par Marx ci-dessus et qui intervient lorsque la composition organique du capital nouvellement accumulé est telle que la part du capital variable est nulle. Dans les faits, seul le capital constant serait accumulé, la composition organique marginale étant, de fait, égale à l'infini.
Un tel cas de figure implique une automatisation poussée à son comble et de gigantesques progrès dans la productivité du travail et, très vraisemblablement, une baisse rapide du taux de profit. Si le nombre d'ouvriers était stationnaire, toutes choses égales par ailleurs, la masse du travail vivant le serait aussi et donc une fois déduit le capital constant de la valeur de la production celle ci demeurerait constante. Seule une croissance de l'intensité du travail ou de la durée du travail pourrait alors expliquer l'augmentation de la valeur créée par le travail vivant. Comme dans les conditions actuelles le temps de travail global a eu tendance à baisser, l'augmentation de l'intensité devrait non seulement expliquer l'augmentation de la valeur mais avoir été suffisamment forte pour compenser la diminution du temps de travail.
Une accumulation réduite dans les faits au seul capital constant, une croissance de la valeur créée par le travail vivant résultant uniquement de l'accroissement de l'intensité du travail, une croissance et une accumulation que l'on déclare par ailleurs impossible voilà le bric-à-brac théorique avec lequel le C.C.I. croit bouleverser la théorie révolutionnaire.
20.3 Les faits
Venons en maintenant aux faits. Que les discours du C.C.I., faible écho des assertions de la presse économique bourgeoise, soient en parfaite contradiction avec le programme communiste ne fait que montrer une incohérence que nous avons maintes fois souligné. Que le C.C.I. divague n'a après tout, une fois que le monde des sectes qui caractérise le milieu révolutionnaire est replacé à sa véritable dimension, pas plus d'importance qu'un pet de lapin ; il reste que, si les faits invoqués étaient exacts, étant donné la situation actuelle, c'est la théorie révolutionnaire qui pourrait ne pas s'en relever.
Examinons le cas de la France qui a le mérite de mettre le maximum de difficultés sur notre chemin puisque la population active n'y a que très peu augmenté au cours du XXème siècle contrairement à d'autres pays capitalistes développés.
En 1800, la population de la France était composée d'environ 28 millions de personnes, en 1850 ce nombre s'élevait à 36 millions environ, en 1900 à 40 millions, 42 millions en 1950 et 55 millions en 1985 (à territoire constant).
Pour les même dates, la population active est estimée à environ 20 millions en 1900, chiffre qui demeure identique en 1950 et qui s'élève autour de 22 millions en 1985 (ajoutons que la population active comprend les chômeurs). Selon Lesourd et Gérard (Histoire économique XIXe-XXe siècle) la population active vers 1850 est proche de 22 millions. Ce n'est qu'à partir de 1851 qu'existent des recensements qui permettent de se faire une idée plus précise de l'importance de la population active et de sa structure. Comme c'est aussi la période où s'instaure, en France, le capitalisme moderne, c’est-à-dire la phase de soumission réelle du travail au capital, ces données nous suffirons pour nous faire une idée de l'évolution des classes sociales mêmes si elles sont souvent imprécises.
Si l'on en croit les chiffres ci-dessus la population active aurait plutôt diminué au cours de la dernière moitié du XIXème siècle – période de la soi disant ascendance du capitalisme – tandis qu'elle aurait plutôt augmenté au cours du XXème siècle. Toutefois étant donné les imprécisions, l'importance plus ou moins grande du chômage, etc., nous pouvons considérer que tandis que la population s'accroît de près de 20 millions de personnes la population active demeure grosso modo stationnaire. Si l'on veut bien faire abstraction – excusez du peu – des rapports d'exploitation et des énormes disparités que cela implique il faut une singulière vision des choses pour déclarer décadente une société qui est capable d'entretenir, et en général plutôt mieux, 20 millions de personnes supplémentaires sans qu'elles aient à travailler. Qu'il existe 8 millions de retraités, que plus de 13 millions de jeunes étudient contre 6,5 millions en 1906 voilà indéniablement des symptômes de décadence !
Venons-en maintenant à l'évolution du nombre de producteurs de plus-value. Toujours selon Lesourd et Gérard qui eux mêmes se réfèrent à Marchal et Lecaillon, en 1851 le nombre de salariés était de 11,9 millions, en 1911 11,7 millions, en 1954 12,5 millions. En 1982, on recensait 17,8 millions de salariés. Si l'on prend à la lettre ces chiffres, sachant que l'évolution du MPC implique également le développement d'un salariat improductif, ce serait plutôt le XIXème siècle qui verrait diminuer le nombre d'ouvriers!
Ce que l'on peut constater c'est aussi que la formidable accumulation capitaliste de l'après guerre s'est accompagnée d'une extension massive du salariat et même si le salariat improductif s'est aussi grandement développé on ne saurait considérer que lui seul en explique la croissance. De ce point de vue, les catégories économiques de la bourgeoisie, par ailleurs extrêmement rudimentaires, peuvent peut-être constituer une référence pour le C.C.I. mais en aucun cas pour le programme communiste (il est d'ailleurs assez ironique de noter que les prolétaires évanouis du C.C.I. peuvent éventuellement se réincarner parmi les classes moyennes lorsqu'ils viennent grossir la "troisième vague de lutte" dans les banques, les assurances, l'éducation nationale, etc.)
Avec la baisse relative, sinon absolue, des effectifs du secteur que la bourgeoisie appelle secondaire (l'industrie) la bourgeoisie se montre à la fois inquiète et ravie. Inquiète, car elle a peur de la montée du chômage que cela implique, inquiète car elle se souvient qu'elle a fondé sa domination sur la puissance industrielle mais aussi ravie, quoiqu'un peu étonnée, de voir que le spectre révolutionnaire pourrait être définitivement conjuré avec la régression numérique du prolétariat. Quand le bourgeois veut se donner de l'assurance, il va même jusqu'à constater que le secteur secondaire n'a finalement jamais été majoritaire dans la société ; celle-ci serait en fait passée de l'agriculture aux services sans que jamais l'industrie ne domine. La bourgeoisie a trouvé avec le C.C.I. de bonnes âmes qui s'en vont répandre la bonne nouvelle.
L'ennui c'est que si le "tertiaire" recouvre certes une bonne part du travail improductif il n'est pas entièrement réductible à celui-ci. La réparation automobile, et d'autres objets de consommation, est une activité du tertiaire ; il n'en demeure pas moins qu'elle est, quand elle s'effectue sous l'égide du salariat, une activité productrice de plus-value. Il en va de même pour une bonne part de la restauration et de l'hôtellerie tout comme des transports eux aussi classés dans le tertiaire. Sur le plan des catégories professionnelles, une partie du travail productif, une part croissante du travail productif, n'est plus recensée sous la catégorie "ouvriers" soit sous l'influence de l'une des mille et une tentatives de "revalorisation de la condition ouvrière" soit parce que la force de travail qui y est employée est effectivement plus qualifiée que la moyenne.
L'analyse de la structure de la population active française d'après le recensement de 1982 donne – il s'agit bien sûr d'une estimation grossière – 7,8 millions d'ouvriers déclarés comme tels; si nous ajoutons les catégories du "tertiaire" où peut se trouver la plus grande partie des productifs de ce secteur, soit 1,6 millions d'employés du commerce et des services aux particuliers (sur un total de 6,2 millions d'employés), 1,2 millions de techniciens, contremaîtres et agents de maîtrise sur un total de 4 millions de membres des professions intermédiaires et 0,9 millions de cadres d'entreprise sur un total de 1,9 millions de cadres et professions intellectuelles supérieures nous obtenons un total de 11,5 millions de productifs.
Sans doute cette estimation est elle superficielle et il y aurait beaucoup à discuter ici et là (il y a forcément dans ces chiffres une partie de travailleurs improductifs faisant partie des classes moyennes modernes) on peut cependant être à peu près sûr que les travailleurs productifs représentent la majorité de la population active et dépassent donc les 10 millions de membres, que le prolétariat a sans cesse augmenté, aussi bien relativement que de manière absolue avec le développement de la production capitaliste. Bien entendu, il existe encore des classes dont le travail produit de la valeur mais pas pour autant de la plus-value (la masse de paysans et des artisans s'élève à 3 millions de personnes).
Nous sommes dans tous les cas éloignés d'assertions fantaisistes, provenant en droite ligne des magazines de vulgarisation économique bourgeois, comme celles émises par le C.C.I. ou la F.E.C.C.I. du type: "Le phénomène de désindustrialisation au cœur des pays capitalistes les plus avancés (il suffit de penser aux Midlands anglais ou au Mid-West américain) et la baisse de la proportion de la classe ouvrière dans ces pays est une preuve supplémentaire de ce que, de condition du développement des forces productives de l'homme, le capitalisme dans sa phase décadente s'est transformé en le plus grand obstacle à ce développement même." (Perspective internationaliste no 5 p. 31).
Nous indiquions un peu plus haut qu'il existait des travailleurs producteurs de valeur qui cependant n'étaient pas productifs du point de vue propre au mode de production capitaliste puisqu'ils ne créent pas de plus-value. Ce sont, pour l'essentiel, les paysans et les artisans dont l'importance va en diminuant avec le développement capitaliste. Ils sont progressivement supplantés par le salariat dont nous avons vu qu'il représentait une part toujours plus grande de la population active. Cela n'empêche pas la renaissance de certains artisans dans les pores de la grande industrie, leur disparition progressive n'est ni unilatérale ni linéaire. Ce faisant, à population créatrice de valeur constante (prolétariat + classes productives sur la base de la production marchande) la productivité sociale augmente et avec elle l'intensité moyenne du travail et donc la valeur créée s'accroît. Etant donné la plus faible productivité et intensité du travail résultat du travail accompli dans le cadre de la petite propriété agricole ou de l'artisanat le remplacement d'un paysan par un ouvrier dont la productivité et l'intensité du travail sont sans commune mesure, permet l'accroissement de la valeur sociale et de la plus-value créée.
Cela montre la supériorité du salariat et du travail associé sur le travail accompli sur la base de la production marchande simple qui, de ce fait, est supplantée par le salariat. De la même manière, le cours catastrophique de la forme de production capitaliste montre que si le système reposant sur le salariat a été un facteur considérable pour permettre le développement des forces productives, il est devenu depuis qu'existe un machinisme suffisamment important, c’est-à-dire depuis 1848, un obstacle à ce même développement.
20.4 Variations mensongères
Le lecteur serait naïf de penser qu'un tel argument soit né dans les cervelles brumeuses des experts en décadence du C.C.I., cet effort serait par trop au dessus de leurs moyens. En fait, il nous vient en droite ligne de F. Sternberg (y compris les statistiques) qui dans son livre "Le conflit du siècle", achevé en 1952, le développe (dès 1926, sa position de 1952 était présente en germe dans son ouvrage sur l'impérialisme). Avec lui, comme on l'a déjà remarqué au sujet du C.C.I., l'appareil statistique s'arrête au lendemain de la IIème guerre mondiale, ce qui fait qu'est ignorée la période d'accumulation sans doute la plus importante de l'histoire de la phase de soumission réelle du travail au capital, au cours du second après-guerre.
Ce que ne dit pas non plus le C.C.I. c'est que, pour Sternberg, une telle perspective détruisait un des fondements de la théorie de Marx (ce en quoi il était logique).
"Outre la tendance générale des travailleurs à accentuer le caractère classe moyenne de leurs revenus, de leur standing de vie et – même pour une grande partie d'entre eux – de leur idéologie, l'époque qui nous retient ici infligera encore un autre démenti aux prévisions de Marx : rien n'y démontre l'existence d'une tendance vigoureuse et permanente au renforcement de la position numérique des travailleurs industriels dans le cadre global de la société; bien au contraire nous allons assister à l'affaiblissement continu et progressif de cette tendance."
(F. Sternberg, Le conflit du siècle, P.116)
Pour autant que l'argumentation du C.C.I. ne date pas de 1950 et ne soit pas un plagiat du critique de Marx et du programme communiste, Sternberg, elle est alors l'occasion de variations de son cru où la bêtise est la seule excuse au mensonge: "Jusqu'à 1914, la population effectivement intégrée à l'économie capitaliste croissait plus vite que le reste de la population mondiale. C'était la phase ascendante du capitalisme. Cette tendance s'est depuis définitivement renversée."(La décadence du capitalisme P.54)
Selon le BIT l'évolution de la population active à été la suivante (en millions de personnes) :
|
|
1750 |
1900 |
1980 |
|
|
|
|
|
|
Asie du sud |
106 |
183 |
523 |
|
|
|
|
|
|
Asie Orientale |
118 |
207 |
508 |
|
|
|
|
|
|
Afrique |
48 |
56 |
170 |
|
|
|
|
|
|
Amérique Latine |
7 |
27 |
117 |
|
|
|
|
|
|
Europe |
56 |
134 |
218 |
|
|
|
|
|
|
U.R.S.S. |
20 |
61 |
135 |
|
|
|
|
|
|
Amérique du Nord |
1 |
33 |
113 |
|
|
|
|
|
|
Océanie |
1 |
3 |
10 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
357 |
704 |
1.794 |
|
|
|
|
|
|
Population Mondiale |
740 |
1540 |
4.490 |
|
|
|
|
|
|
Pourcentage |
48% |
45% |
40% |
|
|
|
|
|
La population active a donc moins que doublé en 150 ans pendant la dite "phase ascendante du capitalisme"et a plus que doublé en 80 ans pendant la "phase de décadence du capitalisme". Dans le même temps, se développe une surpopulation relative croissante et, comme l'a démontré le programme communiste, celle ci s'accroît avec la phase de soumission réelle du travail au capital. Par conséquent, les thèses des partisans de la décadence du capitalisme, sur cette question, sont donc purement et simplement mensongères.
Cette population croissante, comme on a pu en avoir un aperçu plus haut, prend des formes variées. D'un côté, une masse croissante de sans-réserve absolus qui n'ont d'autre ressource que de mourir de faim, de l'autre, une population qui, bien qu'inactive, bénéficie des ressources de la société : entretien, éducation, etc. Sans même parler de la population active improductive.
En abolissant les classes sociales, le prolétariat puisera dans cette immense surpopulation pour répartir, diminuer, améliorer, reconvertir le temps de travail productif général nécessaire à la satisfaction des besoins humains. D'où son mot d'ordre : généralisation du travail manuel, prolétarisation de la société comme moyen d'abolition du prolétariat.
Le fantastique développement des forces productives qui a produit cette surpopulation montre dialectiquement à quel point le communisme est actuel et quelles potentialités sont désormais offertes à l'espèce pour son épanouissement. L'épanouissement de quelques-uns qui est aujourd'hui possible grâce à la surexploitation du prolétariat, sera demain élargi à tous les membres de la société.
"La création, en dehors du temps de travail nécessaire, de nombreux loisirs au profit de la société en général et de chaque individu en particulier pour le plein développement de ses facultés créatrices, apparaît dans le système capitaliste et précapitaliste, comme temps de non-travail, comme loisir pour quelques-uns. Ce qu'il y a de nouveau dans le capital, c'est qu'il augmente le temps du surtravail des masses par tous les moyens de l'art et de la science, puisque aussi bien il a pour but immédiat non la valeur d'usage mais la valeur en soi, qu'il ne peut réaliser sans l'appropriation directe du temps de surtravail, qui constitue sa richesse. Ainsi, réduisant à son minimum le temps du travail, le capital contribue malgré lui à créer du temps social disponible au service de tous, pour l'épanouissement de chacun. Mais, tout en créant du temps disponible, il tend à le transformer en surtravail.(...)
Le temps de travail nécessaire s'alignera d'une part sur les besoins de l'individu social, tandis qu'on assistera d'autre part à un tel accroissement de forces productives que les loisirs augmenteront pour chacun, alors que la production sera calculée en vue de la richesse de tous. La vraie richesse étant la pleine puissance productive de tous les individus, l'étalon de mesure en sera non pas le temps de travail, mais le temps disponible. Adopter le temps de travail comme étalon de la richesse, c'est fonder celle-ci sur la pauvreté ; c'est vouloir que le loisir n'existe que dans et par l'opposition au temps de surtravail ; c'est réduire le temps tout entier au seul temps de travail (...)
De même qu'avec le développement de la grande industrie, l'appropriation du temps de travail d'autrui cesse d'être la raison et la source de la richesse, de même le travail immédiat cesse d'être comme tel la base de la production (...)"
( Marx, Grundrisse, La Pléiade, t.2, p.307-308)
21. ANNEXE 3 : SOMMAIRE DES TRAVAUX DE COMMUNISME OU CIVILISATION
21.1 A- Textes parus dans la revue "Communisme ou Civilisation" (1976-1998)
N°1. Octobre 1976
"Communisme ou Civilisation"
Thèses complémentaires au N°6 d'Invariance.
N°2 Mai 1977
La Gauche Communiste d'Italie (Thèses)
La question agraire (I)
- Les trois classes du mode de production capitaliste.
N°3 Octobre 1977
Le communisme en tant que dépassement positif de la propriété privée...
N°4 Mai 1978
La question agraire (II)
- Communisme contre valeur
Le marxisme des bègues.
N°5 Octobre 1978
Les deux phases historiques de la production capitaliste (I)
N°6 Mai 1979
La question agraire (III)
- Nature, surprofit et aliment de base.
N°7 Octobre 1979
Les deux phases historiques de la production capitaliste (II)
N°8 Mai 1980
La théorie de la crise catastrophique du MPC, base vitale de la prévision révolutionnaire du communisme (I)
La question agraire (IV) - Terre vierge, capital satyre, la rente différentielle I.
N°9 Octobre 1980
Les deux phases historiques de la production capitaliste (III)
N°10. Mai 1981
La question agraire (V) - Terre marâtre, capital souteneur : la rente différentielle II.
N°11 Octobre 1981
La révolution communiste, thèses de travail (I)
- Introduction : Programme, classe, parti.
N°12 Mai 1982
La théorie de la crise catastrophique du MPC, base vitale de la prévision révolutionnaire du communisme (II)
- Théories de la reproduction du capital Fichier PDF (version 4) 42 pages 1,5 Mo
N°13 Octobre 1982
La question agraire (VI)
- La rente absolue
N°14 Mai 1983
La théorie de la crise catastrophique du MPC, base vitale de la prévision révolutionnaire du communisme (III)
- La crise chez Rosa Luxemburg
N°15 Octobre 1983
La question agraire (VII) - La rente de monopole - La question du logement - Le prix de la terre
N°16 Mai 1984
La révolution communiste, thèses de travail (II)
- Bref historique du mouvement de la classe prolétarienne dans l'aire euro-nord américaine. (Des origines à 1848)
N°17 Octobre 1984
La théorie de la crise catastrophique du MPC, base vitale de la prévision révolutionnaire du communisme (IV)
- Rosa Luxemburg et l'or dans les schémas de reproduction
N°18 Mai 1985
La révolution communiste, thèses de travail (III)
- Bref historique... (La révolution de 1848)
N°19 Octobre 1985
La question agraire (VIII) - Conclusion
N°20 Mai 1986
La révolution communiste, thèses de travail (IV)
- Bref historique... - La révolution de 1848 en Allemagne - L'échec du chartisme en Angleterre
N°21 Octobre 1986
Correspondance (1976-1986)
N°22 Mai 1987
La théorie de la crise catastrophique du MPC, base vitale de la prévision révolutionnaire du communisme (V)
- Avant-propos - Accumulation du capital et militarisme.
- Annexe : où l'on retrouve une classe ouvrière que d'aucuns disaient disparue.
N°23 Octobre 1987
Appel au mouvement révolutionnaire
La révolution communiste, thèses de travail (V)
- Bref historique... (L'AIT ; La commune de Paris).
21.2 B- Travaux de Communisme ou Civilisation parus dans la Revue Internationale du Mouvement Communiste (RIMC), de 1988 à 1998.
N°1 Octobre 1988
La théorie de la crise catastrophique du MPC, base vitale de la prévision révolutionnaire du communisme (VI)
- Présentation
- Rosa Luxemburg et les théories de la disproportion dans les schémas de reproduction.
- Annexe. Le C.C.I. et l'accumulation du capital
N°2 Février 1989
La révolution communiste, thèses de travail (VI)
- Bref historique... (De la Commune à la fondation de la Seconde Internationale).
N°3 Juin 1989
La révolution communiste, thèses de travail (VII)
N°4 Octobre 1989
La théorie de la crise catastrophique du MPC, base vitale de la prévision révolutionnaire du communisme (VII) - Les théories des crises de Fritz Sternberg
La révolution communiste, thèses de travail (VIII)
- Bref historique.(Le mouvement ouvrier français après la Commune 1872-1889)(1)
Critique d'un sociologue dans le pétrin
N°5 Février 1990
Réflexions sur le cours du MPC à l'Est
La révolution communiste, thèses de travail (IX)
- Bref historique.(Le mouvement ouvrier français après la Commune 1872-1889)(2)
N°6 Juin 1990
La révolution communiste, thèses de travail (X)
- Bref historique.(Le mouvement ouvrier dans les autres pays européens des origines à 1889 (Italie, Autriche-Hongrie)
N°7 Octobre 1990
La théorie de la crise catastrophique du MPC, base vitale de la prévision révolutionnaire du communisme (VIII)
- Les théories de crises de Grossmann-Mattick et le programme communiste
N°8 Février 1991
Le mouvement communiste et la guerre.
La révolution communiste, thèses de travail (XI)
- Bref historique.(Le mouvement ouvrier américain des origines à 1889)(1)
N°9 Juin 1991
La révolution communiste, thèses de travail (XII)
- Bref historique.(Le mouvement ouvrier américain des origines à 1889)(2)
N°10 Octobre 1991
Editorial
La théorie de la crise catastrophique du MPC, base vitale de la prévision révolutionnaire du communisme (IX) - La théorie des crises de Grossmann (suite)
A propos de la publication d'un texte de Bilan. Crises et cycles dans l'économie du capitalisme agonisant (Bilan N° 10 - 1934)
N°11 Février 1992
Editorial
- Bref historique.(La Seconde Internationale (1))
- Dialectique des forces productives et des rapports de production dans la théorie communiste
-
N° 12-13 1993/1994
- Bref historique.(La Seconde Internationale (2))
- Marx-Engels et la guerre
N°14 Avril 1998
- La fin d'un cycle
- Nos divergences
La théorie de la crise catastrophique du MPC, base vitale de la prévision révolutionnaire du communisme (X)
- La théorie des crises de Grossmann-Mattick : Grossmann et le commerce international
Robin Goodfellow
BP 60048
92163 ANTONY CEDEX
FRANCE

http://www.robingoodfellow.info
robin.goodfellow@robingoodfellow.info